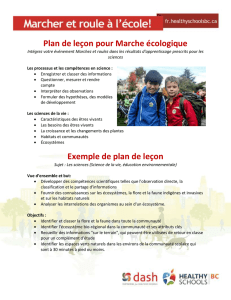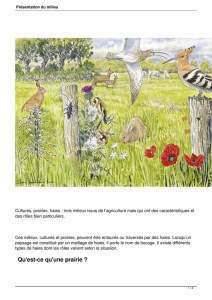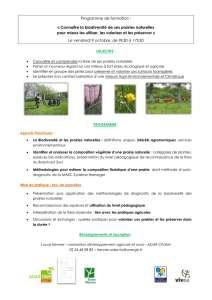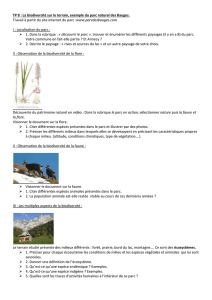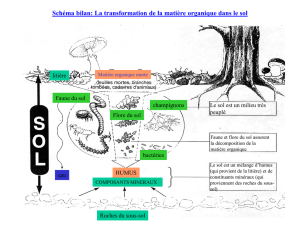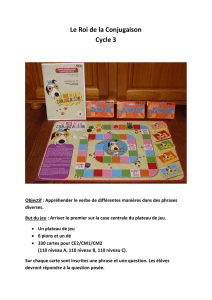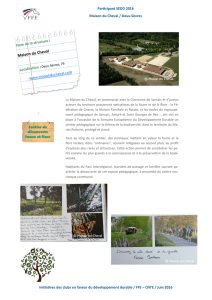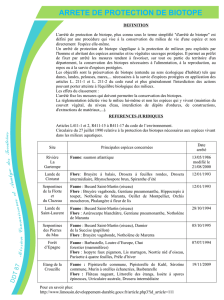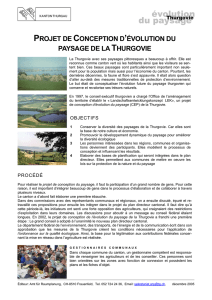Le Plateau, version imprimable

www.vd.ch/biodiversite-plateau juillet 2010 1/8
6. Le Plateau
Le Plateau vaudois couvre plus de 1'400 km2, soit près de la moitié du canton. Longtemps
considéré comme le grenier de la Suisse Romande, ce vaste territoire essentiellement agricole
a subi, durant la seconde partie du 20ème siècle, de profondes mutations en lien avec
l'augmentation de la productivité des terres. Les drainages, l'agrandissement des parcelles,
l'utilisation de fertilisants et de pesticides, la suppression des haies ont grandement facilité la
tâche des agriculteurs, mais ce sont autant d’interventions ayant entraîné une banalisation du
paysage rural. Cette évolution s’est également traduite par une banalisation moins visible des
milieux naturels et par un appauvrissement de la flore et de la faune, autrefois riches, qui
dépendaient des milieux semi-naturels créés par l’agriculture traditionnelle. Prairies naturelles,
zones humides, flore des moissons, faune des haies ont ainsi fait les frais de cette évolution.
Cette tendance s'est toutefois ralentie ces dernières années. En effet, dès le début des années
1990, de profondes réformes de la politique agricole ont été opérées, parallèlement à une prise
de conscience des enjeux biologiques et paysagers dans l'agriculture. De nombreuses mesures
de promotion de la biodiversité en zone agricole ont alors été mises en place. Désormais,
prestations écologiques, surfaces de compensation et réseaux écologiques visent à favoriser la
diversité des habitats naturels, de la faune et de la flore. Coquelicots, bleuets, bruants jaunes,
pie-grièche écorcheurs, lièvres figurent ainsi parmi les espèces que vous pouvez observer en
parcourant le Gros de Vaud.
Si l'agriculture a tout intérêt à prendre soin de la biodiversité, c'est que celle-ci le lui rend bien,
en lui fournissant aussi de précieux services : les milieux naturels proches des cultures abritent
de nombreux auxiliaires de l’agriculture, tels les insectes pollinisateurs ou prédateurs des
ravageurs. La diversité des plantes et les haies assurent également la stabilité des sols et
limitent l’érosion. Et finalement, nous profitons tous de cette diversité biologique des
campagnes, même si l'économie de marché peine encore à reconnaître à son juste prix cet
élément qualitatif essentiel. Une majorité d’entre nous accorde cependant une importance
croissante à un paysage de qualité. Les plus curieux retrouvent même des saveurs gustatives
végétales que l’on croyait oubliées, le long des haies ou des chemins, et jusque sur les
meilleures tables de la région.

www.vd.ch/biodiversite-plateau juillet 2010 2/8
Le Plateau, diversité des habitats
Le Plateau vaudois représente près de la moitié de la superficie du canton. C'est un vaste
territoire de plus de 1'400 km2 aux enjeux multiples. Sa topographie le prédispose en effet
aussi bien à l’agriculture qu’à l’urbanisation. Pour répondre aux besoins croissants d’une
société en développement, la densité des infrastructures et les surfaces construites n'ont cessé
de croître durant la seconde partie du 20ème siècle. Alors qu’en 1960, il était encore possible de
parcourir 18 km2 sur le Plateau suisse sans rencontrer d’obstacles artificiels, cette surface s’est
réduite à 8 km2 en 2007. Parallèlement, des efforts considérables ont été consentis pour
améliorer la productivité des terres et en rationaliser l’exploitation: augmentation de la surface
moyenne des parcelles, suppression des obstacles (haies, arbres isolés), drainage des zones
humides etc. Les pratiques agricoles ont suivi cette évolution, avec un fort accroissement des
apports de fertilisants de synthèse, d'herbicides et de pesticides, et une accélération de la
rotation des cultures… Le paysage rural traditionnel semi-naturel a progressivement cédé la
place à un paysage toujours plus maîtrisé et technique.
Ces grandes mutations ont eu un impact significatif sur le paysage et les habitats naturels,
dont le nombre et la diversité ont drastiquement diminué: marais, prairies maigres humides ou
sèches, cours d’eau, haies, arbres isolés ont payé un lourd tribut. Cette banalisation ne
concerne pas uniquement la valeur esthétique du paysage rural. Elle touche également à sa
substance biologique, plus discrète, en appauvrissant les communautés animales et végétales.
Cette évolution est particulièrement marquée dans les régions d'agriculture intensive, comme
le Gros de Vaud ou la plaine de l'Orbe. Seules les régions les moins rentables d'un point de vue
agricole ont conservé jusqu'à aujourd'hui un peu de leur caractère bocager traditionnel,
marqué par la présence de haies, de bosquets et de vergers.
Îlots forestiers dans un paysage
céréalier © D. Gétaz Les arbres, sentinelles paysagères
dans le territoire rural © P. Patthey Mosaïque de vergers, de prairies et de
champs de colza © G. Porchet
Cette évolution se poursuit encore aujourd'hui, de manière atténuée. Pourtant, depuis
plusieurs années, la multifonctionnalité de l'agriculture et sa contribution à la conservation du
patrimoine naturel et paysager sont unanimement reconnues. Dès le début des années 1990,
la prise en compte des enjeux biologiques dans l'agriculture a conduit à la mise en place de
nombreux programmes incitatifs destinés à promouvoir la diversité des habitats dans les zones
cultivées: les prestations écologiques requises, les surfaces de compensation écologique et les
réseaux écologiques sont autant d'instruments au service de la nature et du paysage mis en
place dans les exploitations.
Les surfaces de compensation écologique représentent approximativement 10% de la surface
agricole cantonale. Il s'agit essentiellement de prairies extensives, de jachères, de haies et
bosquets, de prés à litière. Gérés de manière différenciée (entretien tardif permettant à la flore
et à la faune de compléter leur cycle reproductif), souvent extensive (sans fumure, sans
produits phyto-sanitaires), ces milieux constituent actuellement les refuges vitaux de la
biodiversité en zone agricole.

www.vd.ch/biodiversite-plateau juillet 2010 3/8
Un pré à litière dans la région de
Lavigny. L'exploitation agricole permet
à de nombreuses espèces de se
maintenir, dont la rainette verte © J.
Pellet
Une jachère florale, refuge et lieu de
nourrissage de nombreuses espèces
des milieux agricoles © D. Gétaz
Un chemin non revêtu, habitat de
nombreuses espèces, dont la sauge
des prés © S. Jutzeler
Une étude récente des stations de recherche agronomique a démontré que, malgré ces efforts,
les surfaces de compensation écologique sont souvent comme des îles dans un paysage
uniforme et que le manque de liaisons entre elles limite considérablement leur intérêt
biologique. Il est en effet indispensable que ces surfaces soient disposées dans le territoire de
manière à permettre des échanges entre elles pour la faune et pour la flore. C'est le rôle des
réseaux écologiques, dont la promotion est assurée depuis 2001 par l'Ordonnance sur la
Qualité Ecologique (OQE).
Dans le canton de Vaud, plus de 200 exploitants agricoles ont mis en réseau leurs surfaces de
compensation dans 14 régions du canton, pour une surface totale de plus de 12'000 hectares.
Ces réseaux écologiques sont constitués de manière à préserver la biodiversité en général,
mais également à favoriser des cortèges bien précis d'espèces exigeantes qui font l'objet de
mesures particulières (fauche retardée, plantation de haies avec de nombreux épineux, etc.).
Le succès de ces réseaux pour ces espèces démontre l'important potentiel de biodiversité que
recèlent encore nos paysages ruraux.
Une prairie extensive comme élément
semi-naturel dans un réseau OQE ©
A. Maillefer
Les bandes herbeuses en lisière sont
des lieux de passage importants pour
la faune dans les réseaux OQE © A.
Maillefer
Les réseaux OQE permettent de
valoriser des surfaces improductives
potentiellement intéressantes pour les
espèces-cibles. Ici un champ
s’inondant au printemps. © S.
Jutzeler

www.vd.ch/biodiversite-plateau juillet 2010 4/8
Le saviez-vous?
Le Réseau Ecologique National (REN) est le fruit d'une étude de grande
ampleur dont l'objectif est de préserver la flore et la faune par la mise
en réseau de leurs habitats. Ce réseau identifie les zones refuges pour la
flore et la faune et précise les lieux de passages préférentiels de cette
dernière. Parfois qualifié de "réseau vert suisse", le REN est un outil
fondamental pour une planification territoriale durable. Sa
retranscription au niveau cantonal est le REC (Réseau écologique
cantonal), en cours d'élaboration. Il comprend différents sous-réseaux
(milieux humides et eaux stagnantes, eaux courantes, zones agricoles…)
destinés chacun à satisfaire au mieux les exigences des espèces
animales et végétales qui leur sont liées.
Le Plateau, diversité des espèces
Jusque dans les années 1950-60, le paysage rural du Plateau vaudois abritait une grande
diversité d'espèces végétales et animales, directement liée à la diversité des milieux naturels
particuliers créés par l'exploitation agricole: prairies maigres, haies, jachères, bassières
inondables ou champs de céréales, pour n'en citer que certains.
Emblématique de cette richesse, la flore messicole, ou flore des moissons, comprend des
dizaines d’espèces en Suisse, dont les plus populaires sont le coquelicot, le bleuet ou la
camomille. On y trouve aussi des plantes parmi les plus menacées du pays. Compagne de
l’être humain depuis les débuts de l’agriculture, étroitement dépendante des travaux des
champs, cette flore a été très appauvrie par l’intensification de l’agriculture. Les espèces les
plus sensibles, comme l'adonis d'été, ont disparu du canton.
La mise en place de réseaux écologiques axés sur la flore messicole, là où les conditions sont
favorables, offre l'opportunité de conserver ce patrimoine: l’espacement de quelques lignes de
cultures, le renoncement aux engrais et aux traitements phytosanitaires au bord des champ
font partie des mesures à encourager.
L'adonis d'été, disparu du canton de
Vaud © B. Bäumler, CRSF
La camomille, plante médicinale
autrefois récoltée dans les champs
cultivés © S. Jutzeler
Bleuets et coquelicots dans un champ d’orge
© S. Jutzeler

www.vd.ch/biodiversite-plateau juillet 2010 5/8
On considère que la moitié des oiseaux nicheurs de nos campagnes sont actuellement
menacés. L'absence de surfaces extensives pour les nicheurs au sol, la disparition des haies et
des bosquets, ou l'absence de vieux arbres à cavités pour les nicheurs cavernicoles sont autant
de facteurs aggravant. Ces petites structures sont des éléments clés de l'habitat de nombreux
oiseaux nicheurs, comme le bruant jaune et la pie-grièche écorcheur.
Le torcol fourmilier est un oiseau
devenu rare dans nos paysages
agricoles en raison de l'absence
d'arbres à cavités nécessaire à sa
nidification © A.-C. Plumettaz
Le tarier des prés, un nicheur au sol
qui a besoin des surfaces extensives à
grande échelle © P. Rapin
Le bruant jaune, une espèce
caractéristique des paysages bocagers
où abondent les haies buissonnantes
© P. Rapin
Habitant symbolique de nos paysages agricoles, le lièvre brun a subi un rapide déclin durant la
seconde moitié du 20ème siècle. Il est actuellement répandu dans le canton, mais ses effectifs
sont faibles et au seuil de l'extinction dans bon nombre de régions. Le lièvre fait l'objet d'un
important programme de suivi dans le canton afin d'évaluer dans quelle mesure la mise en
place de jachères florales, de prairies extensives et de haies lui est favorable.
Le lièvre brun, un habitant discret de
nos campagnes © G. Porchet
Le castor est un habitant des cours d'eau de plaine; il est donc naturellement présent dans les
zones agricoles du Plateau. Eteint au début du 19ème siècle suite aux persécutions de l'homme,
le castor a été réintroduit en Suisse dans les années 1960. Au total, 141 castors ont été lâchés
en Suisse de 1957 à 1977, dont 21 dans le canton de Vaud. Le dernier recensement national
fait état de 1'600 castors répartis sur 470 territoires. Un succès total! Afin de maintenir et
développer les populations de castor tout en réduisant les conflits avec l'agriculture et les
propriétaires forestiers, la Conservation de la faune a démarré cette année la rédaction d'un
plan d'action cantonal en faveur du castor. Ce document stratégique sera disponible en ligne
dès le printemps 2011.
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%