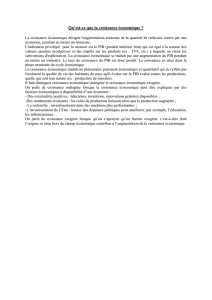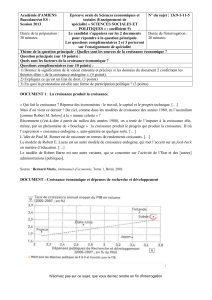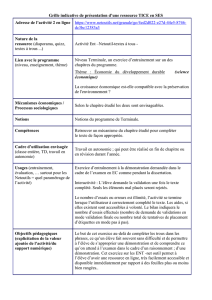étude analytique et économétrique pour le cas de L

1
POLITIQUES EDUCATIVES ET CROISSANCE CONOMIQUE :
ETUDE ANALYTIQUE ET ECONOMETRIQUE POUR LE CAS DE
L’ALGERIE
Mohammed BOUZNIT Doctorant à L’Ecole Nationale Supérieure en Statistique et
Economie Appliquée Alger, Algérie & Maitre assistant classe A à l’université de Bejaia
Introduction:
Depuis le milieu des années 80, une grande partie des études macroéconomiques se sont
penchées sur la question de la croissance économique en à savoir, à long terme, quels sont les
déterminants des écarts observés entre les niveaux de vie dans différents pays ? Par
conséquent, une séries d’ouvrages et d’articles ont été édités sur les théories de la croissance
endogène, à commencer par les analyses théoriques de Paul Romer (1986) et de Lucas (1988),
ainsi que les travaux empiriques dont l’intérêt est de vérifier le modèle néoclassique de la
convergence, qui se base sur l’hypothèse selon laquelle, plus le niveau de départ du produit
intérieur brut par habitant est faible plus le taux de croissance attendu est élevé. Ce courant
trouve ses explications notamment dans les travaux de Baumol (1986), Barro (1991), Barro et
Sala-i-Martin (1992), Harris(2002) et Barro(2006) ; Mankiw, Romer et Weil (1992).
Cette variété de recherches a contribué à l’établissement des bases de données transnationales
comparables, en particulier, des données sur le PIB, le niveau de productivité et les
indicateurs du capital humain, Summers et Heston (1988), Barro et Lee (1993, 1996). Cette
disponibilité de données a permis ultérieurement aux chercheurs d’effectuer de nombreux
travaux visant à tester les déterminants, à long terme, de la croissance économique.
En ce qui concerne les facteurs explicatifs de la croissance, les théories de la croissance
endogène, apparues dés la fin des années 80, se distinguent des théories traditionnelles et
Solowienne. La pensée traditionnelle ne donne pas une explication satisfaisante de la
croissance à long terme, elle a une vision pessimiste, où la croissance a tendance à disparaître
progressivement. En conséquence, elle s’annule dans un état stationnaire qui est fatal. Cela est
dû au fait négatif de l’accumulation supplémentaire des facteurs de production.
En revanche, les théories de la croissance endogène admettent l’obtention d’une croissance
stable et durable. Cette prédiction a été approuvée par un ensemble de travaux empiriques.
Les travaux pionniers de Paul Romer (1986, 1990 ) et Robert Lucas (1988) placent le rôle du
capital humain, en tant que produit du système éducatif, au cœur de la problématique de la
croissance.
Etant donné les études effectuées sur un ensemble de pays, des mesures du capital humain
fondées sur le rendement scolaire semble avoir à long terme, un effet positif et significatif sur
la croissance économique et la convergence des économies.

2
En effet, les premières contributions qui mettaient en exergue le rôle de l’éducation dans le
processus de croissance, consistaient en les travaux de R. Lucas (1988) Barro (91), et
Mankiew, Romer et Weil (1992). Barro (1991) montre que l’éducation affecte non seulement
la croissance, mais qu’elle conditionne également le processus de convergence. Il s’agit de
résultats qui remettent en cause d’une manière implicite le modèle de Solow(1956).
Néanmoins, Mankiew, Romer et Weil (1992) montrent que « les différences de croissance
observées entre les pays peuvent être appréhendés dans le cadre néoclassique standard,
éventuellement augmenté au capital humain »1.
Dés lors, les théories de la croissance endogène et les travaux empiriques établissent une
relation robuste entre l’accumulation du capital humain et la croissance économique, tandis
que les indicateurs du capital humain connaissent deux problèmes : l’un est lié à la mesure
des indicateurs de l’éducation qui forment le stock du capital humain ; l’autre est lié à la
spécification du modèle, où il est possible que la relation entre le stock du capital humain et la
croissance économique soit plus complexe que celle déduite des fonctions de productions
standards (Coob-Douglas).
Les études récentes se concentrent de plus en plus sur les mesures ou les proxy du capital
humain, c'est-à-dire l’indicateur le plus pertinent du capital humain qui explique le mieux les
inégalités de croissance économique et de rattrapage des différenciations des niveaux de vie.
A titre d’exemple, les travaux de Serge Coulombe et Jean François Tremblay (2007) sur le
capital humain et les niveaux de vie dans les provinces canadiennes. L’article de Zhewg Wei
et Rew Hao (2011) porte sur le rôle du capital humain dans la croissance de la productivité
totale des facteurs de production en approuvant les prédictions des théories de la croissance
endogène.
Partant de là, l’objet de cette communication est d’analyser le rôle que joue l’accumulation du
capital humain dans la croissance du PIB par tête en répondant à la question suivante :
A long terme, dans quelle mesure le capital humain est--il facteur déterminant de la
croissance et de la convergence des niveaux de vie?
Notre travail s’appuiera sur les théories de la croissance endogène préconisant un rôle
important du capital humain en tant que produit de l’éducation dans la croissance
économique.
Pour se faire, nous essayerons, et à travers une analyse théorique et empirique en utilisant
des techniques économétriques pour vérifier et expliquer la relation structurelle entre les
indicateurs du capital humain, la croissance et le rattrapage en matière de développement
économique.
1. Cadre théorique et conceptuel :
1 R.Barro, les facteurs de la croissance économique :une analyse transnationale par pays. Economica.2000.

3
Notre travail sera fondé sur la théorie de la croissance endogène qui met l’accent sur le rôle
important du capital humain en tant que produit de l’éducation dans la croissance
économique.
Les théories traditionnelles expliquent la croissance économique par l’accumulation de deux
facteurs qui sont le capital et le travail, et que les rendements marginaux des ces derniers sont
décroissants, ce qui entraîne avec le temps un état stationnaire où la croissance à long terme
s’annule. Pour repousser cette fatalité de l’état stationnaire, les économistes traditionnels ont
proposé certains mécanismes, notamment, la division du travail (Adam Smith), et l’intérêt de
l’avantage comparatif (David Ricardo), et l’effet exogène du progrès technique (Solow
1956)2.
En revanche, les nouvelles théories considèrent la croissance comme un phénomène
économique et que le taux de croissance est déterminé par les comportements des agents
économiques est des variables macroéconomique, et le phénomène de la croissance sera
expliqué selon deux approches :
* La première approche insiste sur le lien entre le caractère autoentretenue de
la croissance et la constance de rendement marginal des facteurs cumulable
(capital, travail). Dans ce cas la rentabilité marginale ne dépend pas de la
quantité des ressources allouées à l’accumulation.
* La deuxième approche des nouvelles théories repose sur les facteurs de la
croissance, notamment, le capital matériel privé et le capital immatériel
public, le capital humain et la technologie.
A l’intérieur de ce cadre d’analyse, non seulement les pouvoirs publics peuvent influencer la
croissance économique. De plus, Romer3 montre qu’il existe des externalités dans
l’accumulation du capital.
2. Cconcept du capital humain dans le domaine de l’éducation :
Le terme capital humain (human capital) est attribue tantôt à J.Mincer (1956), tantôt à
T.Schultz, en tant que capital, sa nature relève de sa capacité à s’accumuler. A ce propos, le
capital humain définit comme un « stock de compétences productives incorporées dans
l’individu ». La formation individuelle (temps passé en institutions scolaires et en formation
continue) est considérée comme la forme principale d’investissement en capital humain, à
laquelle s’ajoute l’apprentissage.
Parmi les autres définitions du capital humain, par exemple, celle de Laroche, Merette et
Ruggeri (1999), ils considèrent les aptitudes innées ainsi que les connaissances et les
compétences que l’on peut acquièrent au cours de la vie. On prétend que, le nombre de
2 Robert M. Solow; A contribution to the theory of economic growth; the Quarterly Journal of Economics;
vol 70; N°.1; Feb.1956;pp. 65-94
3Paul M. Romer ; Increasing returns and long run growth; the journal of political economy; vol.94; N°.5;
(Oct.1986); pp. 102-1037.

4
compétences que les être humains acquièrent au cours de leur vie dépend en partie de leurs
aptitudes au départ, ce potentiel est un aspect important du capital humain.
Laroche, Merette et Ruggeri (1999)4 définit cinq aspects ou caractéristiques du
capital humain qui méritent une certaine attention :
Le capital humain est un bien non négociable incarné dans les êtres
humains, bien que la circulation des services produit fasse l’objet d’une
commercialisation ;
Les personnes, surtout les jeunes, ne sont pas toujours maîtres la voie ou
du rythme selon lesquels ils acquièrent du capital humain ;
Le capital humain comporte un aspect qualitatif et quantitatif à la fois, ce
qui reflète la qualité des apports de l’instruction ;
Le capital humain peut être soit général, soit propre à une entreprise ou un
acteur.
Le capital humain produit des facteurs externes individuels et sociaux.
Le modèle de croissance endogène développé par Lucas (1988) 5utilise une conception du
savoir comme bien rival et à exclusivité d’usage, il est le produit de l’éducation et est
incorporé aux individus en tant que capital humain.
Le modèle de Lucas, supposait qu’il y a deux secteurs, le secteur de production et le secteur
de formation, dans le premier chaque individu produit les biens avec son propre capital
physique, et une partie du capital humain qui est cumulable avec une productivité marginale
non décroissante. Dans le second, le capital humain se forme et s’accumule à partir de lui-
même avec la part du capital humain non employé dans le secteur productif.
L’hypothèse que propose Lucas est que la compétence d’un individu et le temps qu’il
consacre aux études détermine son rythme d’apprentissage, et que les individus sont
semblables.
La fonction de production d’éducation
est supposée non décroissante et linaire. Le capital
humain, hcroit de façon linaire sans limite, et son accumulation s’écrit :
1
h
h Où :
1 Représente le temps consacré à l’accumulation de capital humain.
La croissance économique à long terme est assurée par l’efficacité de l’accumulation de
capital humain
, et le taux de croissance est donné par :
1/11g
De l’expression on constate que la croissance autœntretenue repose sur l’hypothèse de non
décroissance de la fonction de production d’éducation,
,
4 Laroche, M. Merette et G.C.Ruggeri (1999) ‘’on the concept and dimensions of human capital in a knewledge-
Based Ecnomy Context’’ Canada Public Policy. N°1,p87-100.
5 Robert E. Lucas ;on the mechanics of economic development; Journal of monetary economics 22. (1988);
pp. 3-42

5
Ainsi, Lucas a introduit un effet positif de l’externalité,
, sur la production de biens final. En
effet, il accélère le processus de production mais n’en est pas la cause principale.
L’introduction de cet effet externe est utilisée pour montrer les différences entre nations en
termes de croissance économique et de niveau de vie. Ainsi, pour justifier les constats de non
convergence.
3. Système et politiques éducatives en Algérie:
Pour les spécialistes, tous les enfants doivent recevoir une instruction de base de neuf années,
comprenant un enseignement primaire et quelques années d’enseignement secondaire, en
revanche la réalité de la plupart des pays à faible revenu est malheureusement loin de cet
objectif, il est plus réaliste de mettre en place un système éducatif universel, qui permet
l’accès à la scolarité élémentaire donnant à chacun le niveau d’alphabétisation minimal
nécessaire pour la vie.
Actuellement, le système éducatif algérien est composé de quatre sous systèmes placés sous
la tutelle administrative et pédagogique de deux départements distincts.
Il comprend un enseignement primaire et moyen qui est obligatoire pour tous les enfants âgés
de 6 à 16 ans révolus, et se termine par le brevet d’enseignement moyen (BEM), cet
enseignement est la préoccupation majeure de toute politique éducative, la raison pour
laquelle l’état Algérien consacre chaque année une part importante du budget de l’état au
budget de fonctionnement de l’enseignement fondamental (11,5% en 1999)6.
Un enseignement secondaire de trois ans qui accueille selon les statistiques du
ministère de l’éducation nationale, environ de 50% des élèves de l’enseignement moyen, cet
enseignement est sanctionné par le baccalauréat.
L’enseignement primaire, moyen et secondaire est placé sous la tutelle du ministère de
l’éducation nationale.
L’enseignement supérieur est placé sous la tutelle du ministère de l’enseignement
supérieur et de la recherche scientifique, et la formation professionnelle est gérée par le
ministère de la formation et l’enseignement professionnels.
La politique de scolarisation menée depuis l’indépendance à pour effet en Algérie de
permettre un égal accès des enfants a l’instruction quelque soit leurs sexes et leurs classe
d’origine. À titre d’exemple, pour l’enseignement de base 1er et 2ème palier on a enregistré
une évolution de plus de 2 points chez les femmes, il était de 11,6% en 1987 et est passé à
13,9% en 1997, pour les hommes il était de 15,4% en 1987 et a augmenté à 16% en 19977.
On note également que l’état Algérien a mis en place des politiques éducatives, notamment la
démocratisation de l’éducation, dont l’objectif principal est d’augmenter le taux de
scolarisation de la population, surtout l’éducation fondamentale, et d’éliminer l’écart de
formation entre les hommes et les femmes. La démocratisation de l’éducation a abouti à une
6 Annuaire Statistique, Ministère de l’éducation Nationale ,2004.
7 Idem
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
1
/
20
100%