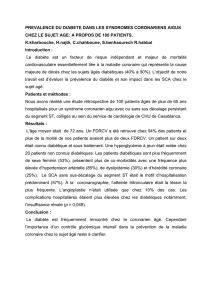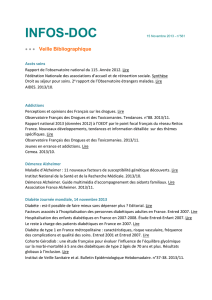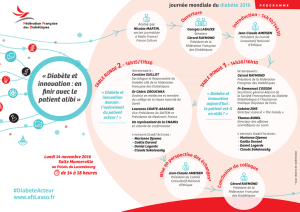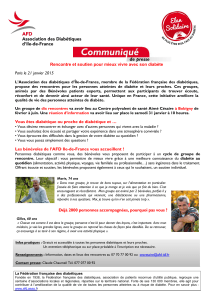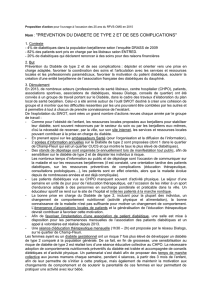Etude ENTRED 2007-2010

1
Etude ENTRED 2007-2010
(Echantillon national témoin représentatif des personnes diabétiques traitées)
Résultats du module « information et éducation »
Rapport concernant :
l’information et l’éducation reçues par les personnes diabétiques,
les pratiques éducatives des médecins,
ainsi que les attentes des personnes diabétiques et des médecins
Cécile Fournier, Amélie Chabert, Helen Mosnier-Pudar, Isabelle Aujoulat,
Anne Fagot-Campagna, Arnaud Gautier
pour le groupe d’experts « démarche éducative » de l’Inpes
Décembre 2011

2
Sommaire
Introduction et remerciements .................................................................................................... 3
I. Contexte .................................................................................................................................. 4
I.1. Contexte scientifique et données épidémiologiques ........................................................ 4
I.1.1. Avant le démarrage de l’étude Entred 2007-2011 .................................................... 4
I.1.2. Données publiées depuis 2007 .................................................................................. 5
I.2. Contexte politique et interventions .................................................................................. 5
I.2.1. Historique de la prise en charge du diabète en France et contexte au moment du
démarrage de l’étude Entred 2007-2011 ............................................................................ 6
I.2.2. Focus sur le développement des pratiques éducatives proposées aux personnes
diabétiques au moment du démarrage de l’étude Entred 2007-2011 ................................. 7
I.2.3. Apports de la première étude Entred 2001-2003 et enjeux liés à la second étude
Entred 2007-2010 ............................................................................................................. 10
I.2.4. Evolutions du contexte depuis 2007 ....................................................................... 12
II. Objectifs de l’étude Entred 2007-2010 ................................................................................ 14
II. 1. Objectifs généraux et spécifiques ................................................................................ 14
II. 2. Objectifs du module « information et éducation » ...................................................... 14
III. Méthodologie ..................................................................................................................... 16
III. 1. Méthodologie de l’enquête Entred-Métropole ........................................................... 16
III.1.1. Populations ........................................................................................................... 16
III.1.2. Méthode d’investigation ....................................................................................... 17
III.1.3. Durée et modalités d’organisation ........................................................................ 18
III.2. Taux de participation et caractéristiques des répondants ............................................ 18
III.2.1. Taux de participation ............................................................................................ 18
III.2.2. Caractéristiques des répondants ........................................................................... 19
IV. Méthodologie d’analyse d’Entred-Métropole .................................................................... 20
V. Résultats .............................................................................................................................. 21
VI. Synthèse des principaux résultats ...................................................................................... 57
VI.1. Questions aux personnes diabétiques .......................................................................... 57
VI.2. Questions croisées adressées aux personnes diabétiques de type 2 et à leur médecin 60
VI.3. Questions aux médecins .............................................................................................. 61
VII. Discussion ......................................................................................................................... 64
VII.1. Discussion à partir des résultats ................................................................................. 64
VII.2. Richesse et limites de l’étude .................................................................................... 71
X. Perspectives ......................................................................................................................... 72
XI. Références bibliographiques .............................................................................................. 78
XII. Annexe 1. Liste des publications et communications sur les résultats de l’étude Entred
concernant la démarche éducative ............................................................................................ 85
XII. Annexe 2 : Fonctionnement général de l’étude ................................................................ 87

3
Introduction et remerciements
Dans la continuité de la première étude nationale Entred sur le diabète réalisée en 2001, une
nouvelle étude Entred (« Échantillon national témoin représentatif des personnes
diabétiques ») a été mise en place en 2007, réalisée exclusivement sur fonds publics.
L'étude Entred 2007-2010 avait pour objectif d’approfondir les connaissances sur l’état de
santé des personnes diabétiques en France, sur leur prise en charge médicale, sur leur qualité
de vie, sur les besoins en matière d’information et d’éducation et sur le coût du diabète.
L’étude Entred 2007-2010 a été promue par l’Institut de veille sanitaire, qui a financé l’étude
en partenariat avec l’Assurance maladie (Cnamts et Régime Social des Indépendants),
l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (Inpes) et la Haute Autorité de
santé (HAS).
L’étude Entred 2007-2010 a reçu le soutien de l’Association française des diabétiques (AFD),
du Conseil national de l'ordre des médecins (Cnom), de l'Association de langue française pour
l'étude du diabète et des maladies métaboliques (Alfédiam, devenue Société francophone du
diabète (SFD)), de la Fédération nationale des associations régionales d'endocrinologie-
diabétologie-métabolisme (Fénarédiam), du Syndicat national des médecins spécialistes en
endocrinologie, diabète, maladies métaboliques et nutrition (Sedmen) et de l'Association
nationale de coordination des réseaux diabète (Ancred).
Les personnes diabétiques et leurs médecins, ainsi que les médecins-conseil de l’Assurance
maladie qui ont participé à l’étude Entred 2007-2010, sont chaleureusement remerciés pour
leur contribution importante à cette étude, qui permet d’améliorer les connaissances sur le
diabète en France et de guider les efforts vers une meilleure prise en charge du diabète. Merci
également au Dr. Carmen Kreft-Jaïs pour sa relecture attentive et ses corrections.
Ce rapport est centré sur les résultats concernant l’information et la démarche éducative
proposée aux patients, explorant les pratiques actuelles ainsi que les besoins et attentes des
personnes diabétiques et des médecins qui assurent leur suivi. Cette partie de l’enquête a été
pilotée par l’Inpes, avec le concours d’un groupe d’experts et en lien étroit avec le comité de
pilotage et le conseil scientifique de l’étude.
Tous les résultats de l’étude Entred 2007-2011 sont disponibles sur :
http://www.invs.sante.fr/surveillance/diabete/entred_2007_2010/
Les résultats concernant la démarche éducative sont également disponibles sur le site de
l’Inpes : http://www.inpes.sante.fr/educationpatient/entred.htm

4
I. Contexte
I.1. Contexte scientifique et données épidémiologiques
I.1.1. Avant le démarrage de l’étude Entred 2007-2011
L’informatisation des données médicales de l’Assurance maladie, débutée en 1997, a permis à
la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CnamTS) d’établir une
première estimation de la prévalence du diabète traité pharmacologiquement en France
métropolitaine à 3,2 % en 1998 (Ricordeau, 2000). Une deuxième estimation consolidée a
apporté le chiffre de 3,8 % en 2005 (Kusnik-Joinville, 2007).
La France se situait ainsi dans la moyenne inférieure des pays européens et bien en deçà des
estimations nord-américaines (7 % aux Etats-Unis en 2005 en comprenant l’ensemble des cas
de diabète diagnostiqués et méconnus(CDC, 2005)). La prévalence du diabète était toutefois
beaucoup plus élevée dans les départements d’outre-mer, avec des prévalences deux à trois
fois plus élevées qu’en métropole (Favier et al, 2005 ; Cardoso et al, 2006). Néanmoins, les
projections de prévalence du diabète traité en France métropolitaine restaient inquiétantes
(Bonaldi et al, 2006). Mises à jour à partir de l’enquête Obépi 2006, les projections
prédisaient entre 1999 et 2016 une augmentation de 44 % du nombre de personnes
diabétiques (données non publiées). Cette augmentation serait due pour 14 % à la croissance
de la population, pour 38 % à l’augmentation de l’obésité, laquelle pourrait être partiellement
contrôlée, et pour 48 % à son vieillissement lequel est inéluctable. Ces estimations semblaient
inférieures à la réalité. En effet, l’augmentation du diabète traité a été estimée par l’Assurance
maladie (Kusnik-Joinville et al, 2007) entre 2000 et 2005 à 5,7 % par an. D’autre part, ces
estimations ne prenaient pas en compte les cas de diabète traités par régime seul, ainsi que les
cas de diabète non diagnostiqués pour lesquels peu de données consolidées existent encore
aujourd’hui.
Par ailleurs, le coût des soins des personnes diabétiques de type 2 traitées par antidiabétiques
oraux ou insuline était important et en pleine expansion. Il était estimé par l’Assurance
maladie à 5 910 euros par personne et par an, fin 2004 (Vallier et al, 2006).
Le diabète s’accompagne d’un risque vasculaire et d’une morbidité élevés (Delcourt et al,
1996 ; King et al, 1998 ; Detournay et al, 2005), ainsi que d’une altération de la qualité de vie.
Selon l’étude Entred 2001-2003, réalisée auprès de 3 648 personnes diabétiques (plus de 90 %
avaient un diabète de type 2) et leurs 1 718 médecins, les complications macrovasculaires
(angor, infarctus du myocarde, revascularisation) concernaient 17 % des diabétiques (Romon
et al, 2005), la neuropathie au moins 6 % et la rétinopathie au moins 10 % (Fagot-Campagna
A et al, 2005). De plus, 74 % des personnes diabétiques déclaraient un surpoids, 54 % une
hypertension artérielle et 51 % une dyslipidémie (Romon et al, 2005), facteurs de risque des
maladies cardiovasculaires.
Le diabète s’accompagne également d’un risque de mourir de maladies cardiovasculaires
deux à trois fois plus élevé que celui des personnes non diabétiques (Gu et al, 1998). L’impact
du diabète sur la mortalité était toutefois très sous-estimé de par l’absence fréquente de sa
déclaration dans les certificats de décès (Fuller, 1993).
En France métropolitaine, en 2006, 32 156 certificats de décès mentionnaient un diabète,
représentant 6,1% de l’ensemble des décès. Le taux de mortalité liée au diabète standardisé
sur l’âge était de 30,8 pour 100 000, et était plus élevé chez les hommes que chez les femmes
(41 versus 23 pour 100 000) (indicateur n°55). (La documentation française, 2009).

5
Le programme diabète de l’Assurance maladie entre 1998 et 2000, puis l’étude Entred entre
2001 et 2003, ont montré que la qualité de la prise en charge médicale des personnes
diabétiques était insuffisante au regard des recommandations actuelles de suivi et de prise en
charge thérapeutique du diabète (Fagot-Campagna et al, 2003). Ainsi, dans Entred en 2001,
seulement une personne sur trois avait bénéficié des trois dosages de l’hémoglobine glyquée
(HbA1c) nécessaires au suivi de l’équilibre glycémique, une personne sur cinq de la recherche
d’une microalbuminurie permettant de dépister une atteinte rénale, et moins d’une sur deux
d’un fond de l’œil pour dépister une rétinopathie diabétique (Romon et al, 2005 ; Fagot-
Campagna et al, 2005). De plus, la prise en charge thérapeutique était également apparue
insuffisante en 2001 puisque seulement un peu plus du quart des personnes diabétiques
avaient un bon contrôle glycémique (HbA1c ≤ 6,5 %, www.invs.sante.fr/entred/résultats). Le
traitement hypoglycémiant de première intention, recommandé en présence d’un surpoids ou
d’une obésité, n’était attribué qu’à 35 % des personnes correspondantes
(www.invs.sante.fr/entred/résultats). Parmi les personnes diabétiques ayant déclaré une
coronaropathie, donc à haut risque de mortalité cardiovasculaire, moins de la moitié avaient
bénéficié de trois ou quatre des thérapies recommandées (Marant et al, 2005). Cependant,
l’étude Entred 2001 a démontré une certaine amélioration de la qualité du suivi et des
traitements entre 2001 et 2003 (www.invs.sante.fr/entred/résultats), également observée entre
1999 et 2005 dans les deux études Ecodia (Varroud-Vial et al, 2007).
I.1.2. Données publiées depuis 2007
En 2007, la prévalence du diabète traité pharmacologiquement en France a été estimée à
3,95% (Kusnik-Joinville et al, 2008).
La prévalence du diabète a continué de progresser, surpassant les prévisions des experts
(Ricci et al, 2010). Entre 2000 et 2009, la prévalence du diabète traité a ainsi progressé de
2,6% à 4,4% et le nombre de diabétiques traités est passé en France de 1,6 à 2,9 millions. Il
existe d’importantes disparités géographiques avec des prévalences fortes en outre-mer, dans
le nord-est de la métropole et en Seine-Saint-Denis.
La prévalence augmente avec l’âge et est plus élevée chez les hommes que chez les femmes.
Elle dépasse 14% chez les plus de 65 ans et atteint un taux maximal chez les 75-79 ans
(18,2 % chez les hommes et 13,2 % chez les femmes). La prévalence est également plus
élevée chez les personnes de niveau socio-économique moins favorisé (particulièrement les
femmes), et chez les femmes originaires du Maghreb.
La surveillance des personnes diabétiques (3 dosages annuels de l’HBA1C, bilan lipidique
annuel, dépistage des complications du diabète) s’est améliorée entre les deux vagues
d’enquête Entred 2001 et 2007, même si des progrès restent à faire (DREES, 2010). Les
facteurs de risque cardiovasculaire sont aussi plus souvent traités par médicament :
antihypertenseurs, statines et antiagrégants plaquettaires (Ricci et al, 1010).
Le taux de mortalité a baissé d'environ 10% entre la période 2001-2006 et l'année 2009. (Ricci
et al, 2010).
Cependant, l'inertie thérapeutique restait importante dans la prise en charge des personnes
diabétiques de type 2 en France en 2008-2009. En effet, seuls 39 % des patients nécessitant
une intensification du traitement en avaient bénéficié dans les 6 mois après un deuxième
dosage d'HbA1c déséquilibré, ce taux passant à 59% à 12 mois (Bouée et al, 2010).
I.2. Contexte politique et interventions
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
1
/
89
100%