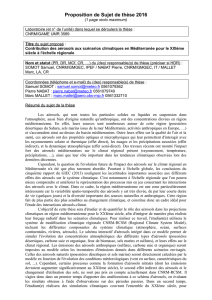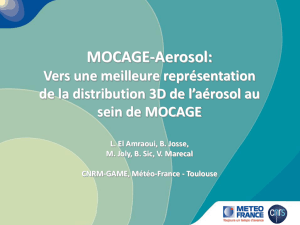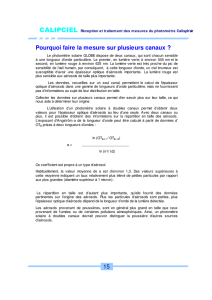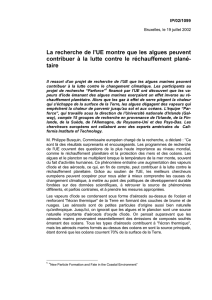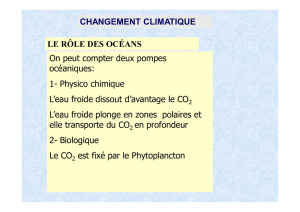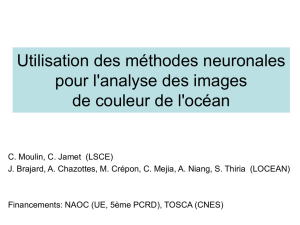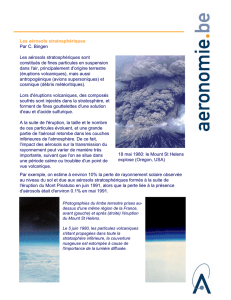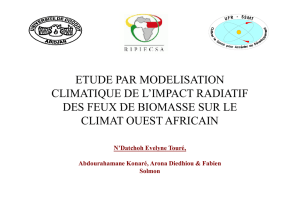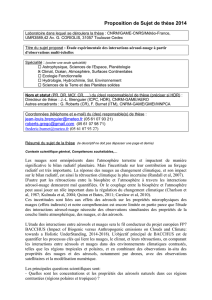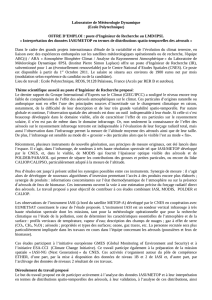Modélisation des aérosols de feux de biomasse et impact sur le

Proposition de Sujet de thèse 2017
(1 page recto maximum)
Laboratoire (et n° de l’unité) dans lequel se déroulera la thèse :
CNRM - UMR 3589
Titre du sujet proposé :
Modélisation des aérosols de feux de biomasse et impact sur le bilan radiatif et le
climat de la région de l’Atlantique sud.
Nom et statut (PR, DR, MCf, CR, …) du (des) responsable (s) de thèse (préciser si HDR) :
M. Mallet, CNRM/GMGEC (CR CNRS) / P. Nabat, CNRM/GMGEC (IT), S. Somot,
CNRM/GMGEC (IPEF)
Coordonnées (téléphone et e-mail) du (des) responsable(s) de thèse :
[email protected] : 0561079033
[email protected] : 0561079740
[email protected] : 0561079362
Résumé du sujet de la thèse
Motivations de l’étude :
L'Atlantique sud entre 5° et 25° sud est une région où l'on observe de fortes concentrations en aérosols
atmosphériques liés aux feux de biomasse. L’Afrique australe est en effet la principale source d’émission
d’aérosols de brûlis à l’échelle globale (50% des émissions globales ; van der Werf et al., 2010). Elle est
également caractérisée par la présence de nuages bas de type stratocumulus quasi-permanents, qui sont des
nuages caractérisés par de forts albédo et exerçant un forçage radiatif important. Une modification des propriétés
macrophysiques et microphysiques de ce type de nuages, due à la présence de particules, peut donc avoir un
impact climatique important. Selon la distribution verticale des aérosols, plusieurs interactions peuvent avoir
lieu, en particulier s’il s’agit d’aérosols absorbant le rayonnement solaire, comme c’est le cas pour les aérosols
de brûlis. Transportés au-dessus des stratocumulus, ces aérosols peuvent donner lieu à des zones de
réchauffement, modifiant les profils de température et d’entrainement au sommet du nuage (Johnson et al.,
2004), modifiant ces propriétés (effet semi-direct). Incorporés dans les stratocumulus, ils peuvent accélérer
l’évaporation des gouttelettes d’eau par réchauffement local, et en même temps contribuer à l’augmentation du
nombre de noyaux de condensation (CCN), de gouttelettes et la réflectivité du nuage (effet indirect). En outre, la
complexité de cette région fait qu'il reste encore une incertitude forte sur l'estimation même du signe
(positif/négatif) du forçage radiatif direct (diffusion/absorption du rayonnement) des aérosols de brûlis estimé au
sommet de l'atmosphère par les modèles de grandes échelles (Stier et al., 2013). Il faut également souligner que
cette région est également caractérisée par des biais importants de SST détectés dans les modèles de climat
globaux comme ceux participants à CMIP. A notre connaissance, le rôle éventuel des aérosols dans les
problématiques mentionnés ci-dessus n'a jamais été étudié en détails jusqu'à présent. Dans ce cadre, plusieurs
campagnes de mesures coordonnées (AEROCLO-SA (FR) mais également Clarify (UK) et ORACLES (US))
seront mises en place lors de l’été 2017 sur cette région afin d’étudier les interactions entre aérosols-nuages-
rayonnement et climat (Zuidema et al., 2016).
Objectifs principaux et Méthodologie :
Le premier objectif sera (i) de mettre en place sur cette région une configuration du modèle de climat régional
CNRM-RCSM, dont le modèle atmosphérique ALADIN-Climat intègre un schéma interactif d'aérosols pour les
cinq types principaux (poussières désertiques, sels marins, carbones élémentaires, carbones-suies et sulfates,
Nabat et al., 2015), puis (ii) d’améliorer la représentation des aérosols de feux de biomasse et plus
spécifiquement leurs propriétés optiques (et notamment d'absorption dans le spectre solaire), hygroscopiques et
de noyaux de condensation, utiles ensuite pour le calcul des différents forçages radiatifs.
Le second sera ensuite de réaliser des simulations pour les cas observés lors de la campagne AEROCLO-SA (été
2017). Le but sera d'étudier la capacité du modèle à reproduire (i) la concentration atmosphérique en aérosols de
feux en zone source mais également lors de son transport au dessus de l'océan Atlantique, (ii) la structure
verticale et notamment l'altitude du panache de feux par rapport aux nuages bas, (iii) leurs capacités absorbantes
et les taux d'échauffements radiatifs associés et enfin (iv) le forçage radiatif exercé au sommet de l'atmosphère.
Ici, des tests de sensibilité seront réalisés en utilisant différents inventaires d'émissions disponibles (GFAS,
GFED, APIFLAME,...) et différentes hauteurs d'injections. Des simulations réalisées avec le module de feux de
SURFEX seront également testées. Ces simulations « sur épisodes » seront essentielles avant de réaliser des

simulations climatiques longues et seront évaluées en profitant des nombreuses observations effectuées dans le
cadre des projets cités précédemment. En parallèle, les observations développées récemment sur le capteur
POLDER (estimation des propriétés des aérosols localisées au dessus du nuage) seront également utilisées en
collaboration avec le LOA (Univ. Lille 1).
Enfin, la dernière partie de la thèse aura pour objectif d'utiliser la version du modèle mise en place
précédemment pour réaliser des simulations climatiques (typiquement multi-décennales) sur une période passée.
Le but sera d'étudier la variabilité interannuelle des aérosols de brûlis et leurs différents effets radiatifs. Un des
objectifs final sera d'étudier l'impact des aérosols sur les propriétés microphysiques du nuage, sur le
rayonnement en surface et sur la température de surface de la mer.
Collaborations GMGEC :
A. Voldoire, R. Waldman (échanges océan-atmosphère, CNRM-CM, équipe IOGA)
R. Seferian (émission feux de biomasse, équipe EST)
R. Roehrig (physique atmosphérique et représentation des stratocumulus marins, équipe AMACS)
Collaborations hors-GMGEC:
→ GMME/VEGEO (D. Carrer, produits aérosols MSG)
→ LISA (PI ANR AEROCLO-SA)
→ LATMOS (C. Flamand)
→ LOA (F. Waquet)
→ Met-Office (J. Haywod)
→ Nasa-ARC (Jens Redemann)
Nature du travail attendu et compétences souhaitées
Le (ou la) candidat(e) devra avoir des connaissances scientifiques générales sur le système climatique, la chimie
de l'atmosphère et les aérosols. Des compétences techniques en matière de modélisation climatique seraient
appréciables, comme la connaissance de l'environnement (linux) et du langage de programmation (fortran90)
nécessaires à l'utilisation et à la modification des modèles utilisés. Des outils graphiques et d'analyses statistiques
devront également être utilisés pour l'exploitation et la valorisation des résultats de simulations. Une bonne
connaissance de l'anglais (écrit et oral) est également souhaitable.
Références bibliographiques
Nabat, P., S. Somot, M. Mallet, F. Sevault, M. Chiacchio, and M. Wild, Direct and semi-direct aerosol radiative effect on the
Mediterranean climate variability using a coupled Regional Climate System Model, Climate dynamics, 44, 1127-1155,
DOI:10.1007/s00382-014-2205-6, 2015.
Van der Werf, G. R., Randerson, J. T., Giglio, L., Collatz, G. J., Mu, M., Kasibhatla, P. S., Morton, D. C., DeFries, R. S., Jin,
Y., and van Leeuwen, T. T.: Global fire emissions and the contribution of deforestation, savanna, forest, agricultural, and peat
fires (1997– 2009), Atmos. Chem. Phys., 10, 11707–11735, doi:10.5194/acp-10-11707-2010, 2010.
Stier, P., et al. (2013), Host model uncertainties in aerosol radiative forcing estimates: Results from the AeroCom Prescribed
intercomparison study, Atmos. Chem. Phys., 13(6), 3245–3270, doi:10.5194/acp-13-3245-2013.
Zuidema, P., et al. (2016), Interactions: Smoke and Clouds above the Southeast Atlantic Upcoming Field Campaigns Probe Absorbing
Aerosol’s Impact on Climate, Bull. Am. Meteorol. Soc., 19-23, doi:10.1175/BAMS-D-15-00082.1.
1
/
2
100%