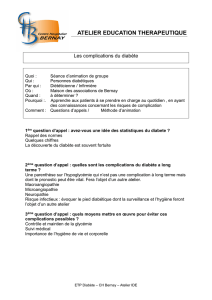Le diabète sucré en Afrique : un enjeu de santé

COMMUNICATION
Le diabète sucré en Afrique :
un enjeu de santé publique
Mots-clé : Diabete. Afrique subsaharienne. Politique de santé
The burden of diabetes in Africa :
a major public health problem
Key-words (Index medicus) : Diabetes mellitus. Africa south of the Sahara.
Health policy
Claude JAFFIOL *
RESUMÉ
438 millions de diabétiques sont attendus en 2030 dans le monde selon les prévisions de
l’OMS, la majorité dans les pays en développement. La Fédération Internationale du
Diabète estime que leur nombre augmentera de 98,1 % en Afrique au cours des vingt
prochaines années avec une conséquence dramatique sur la santé des populations et sur les
budgets très fragiles de ces pays. Cette évolution est liée aux changements survenus dans le
mode de vie des habitants qui quittent les zones rurales pour s’installer dans les villes où ils
espèrent trouver de meilleures conditions d’existence. Ce développement urbain est généra-
teur de sédentarité et de mutations alimentaires qui, avec le vieillissement de la population,
facilitent l’émergence de l’obésité et du diabète. Cette évolution concerne prioritairement le
diabète de type 2. Le type 1 est beaucoup plus rare affectant les enfants et adolescents. Deux
autres variétés sont propres aux africains de race noire, le diabète cétosique transitoire et le
diabète fibro calculeux avec malnutrition. Le cours de la maladie est affecté par de multiples
complications secondaires au mauvais équilibre glycémique et aux infections intercurrentes.
La mortalité est élevée et la qualité de vie très altérée. La prise en charge se heurte à de
multiples difficultés tenant à l’organisation du système de soins incapable de faire face à
l’épidémie, à la limitation des budgets de santé en grande partie absorbés par la lutte contre
les maladies transmissibles, à l’absence d’éducation des patients et à l’impossibilité pour
beaucoup de se procurer l’insuline et les médicaments antidiabétiques, tenant enfin à des
habitudes culturelles qui rendent difficile l’acceptation des messages hygiéno diététiques. La
lutte contre la maladie passe en priorité par sa prévention indispensable pour réduire son
incidence. Une action éducative concernant les zones rurales et urbaines fera appel à tous les
moyens privilégiant le contact direct avec les habitants, en priorité femmes et enfants. Des
campagnes de dépistage doivent être organisées régulièrement avec l’aide des paramédicaux
pour repérer les diabètes méconnus et les hyperglycémies prédiabétiques. Le traitement des
diabètes déclarés nécessite en priorité la gratuité des médicaments et la surveillance des
* Membre de l’Académie nationale de médecine ; e-mail : c.jaffiol@wanadoo.fr
Bull. Acad. Natle Méd., 2011, 195,n
o
6, 1239-1254, séance du 7 juin 2011
1239

grossesses chez les diabétiques. Un effort particulier doit être demandé aux firmes pharma-
ceutiques. Il serait souhaitable que les pays industrialisés apportent une aide contrôlée en
participant à la formation des médecins spécialistes et à des enquêtes épidémiologiques. Il
est hautement souhaitable que des mesures soient prises pour faciliter le retour à la
campagne et à des méthodes de culture respectueuses de l’environnement.
SUMMARY
W.H.O. predicts that there will be some 438 million diabetic patients in 2030, most of them
living in developing countries. The IFD estimates that the prevalence of diabetes will rise by
98 % in Africa during the next 20 years, with dramatic implications for public health and
national budgets of the poorest countries. Type 2 diabetes is the most common form in
Africa ; type 1 is rarer than in western countries and tends to occur later. Two other forms
seem specific to black Africans: ketosis-prone atypical diabetes, and tropical malnutrition-
related diabetes. An increasing prevalence of obesity, diabetes and impaired glucose tole-
rance is observed in all parts of Africa. Several factors contribute to this situation, including
aging, dietary transitions and lack of physical activity, all of which are related to rapid
urbanization. In Africa, diabetes is associated with a high mortality rate, especially among
insulin-dependent patients. Poor metabolic control can lead to severe ketosis and hypogly-
cemic accidents that carry a poor prognosis. Microvascular complications include retino-
pathy and nephropathy, and most patients cannot afford hemodialysis. Foot ulcers are
frequent, due to trauma and neuropathies. Macrovascular complications are also increasing,
with a high prevalence of hypertension. The poor prognosis of diabetes in Africa is related
to late diagnosis, poor education, inadequate access to insulin, antidiabetic drugs and
glycemia self-monitoring devices, absence of controlled diets, and difficult access to medical
care in rural areas. Patient empowerment, knowledge and self-care must be improved.
African governments must develop national prevention programs. Special attention must be
paid to the prevention of obesity and diabetes. The urban environment, infrastructure,
education, exercise and safe nutrition must be part of an overall policy designed to reduce
the burden of chronic non transmissible diseases.
INTRODUCTION
Le diabète sucré autrefois rare en Afrique connaît de nos jours une progression
rapide à l’image de ce qui se passe dans de nombreux pays en développement. Les
prévisions épidémiologiques estiment que la prévalence du diabète aura augmenté
en 2030 de 98 % en Afrique sub-saharienne [1]. Cette situation apparaît comme la
conséquence de mutations dans le mode de vie des populations qui abandonnent
leurs habitudes de vie traditionnelle lorsqu’elles migrent vers les villes. La précarité
budgétaire de nombreux pays africains ne leur permet pas de faire face à cette
nouvelle épidémie qui ajoute ses effets désastreux à celui des maladies transmissi-
bles, toujours présentes voire en expansion telles le paludisme, la tuberculose, le
VIH. Cette nouvelle situation risque de générer à court terme des problèmes
financiers insurmontables, les dépenses de santé pouvant atteindre la quasi-totalité
du budget de certains états. Les données rapportées dans ce travail s’inspirent de
publications de l’Organisation Mondiale de la Santé, de la FAO et de plusieurs
études consacrées à la situation épidémiologiques du diabète en Afrique.
Bull. Acad. Natle Méd., 2011, 195,n
o
6, 1239-1254, séance du 7 juin 2011
1240

ÉPIDÉMIOLOGIE ET SPÉCIFICITÉ DES ASPECTS CLINIQUES DU
DIABÈTE EN AFRIQUE
Les données épidémiologiques concernant les pays africains sont rares et souvent
disparates. Ces discordances sont la conséquence de variations méthodologiques
dans les diverses enquêtes mais sont aussi liées à des disparités ethniques et aux
différences socioculturelles entre des régions très éloignées l’une de l’autre qui ont
conservé leurs traditions.
Un progrès considérable d’uniformisation des critères diagnostiques du diabète a été
fait par l’adoption des recommandations de l’OMS, de l’American Diabetes Asso-
ciation (A.D.A.) et du National Diabetes Data Group des USA permettant une
comparaison des données épidémiologiques.
Diabète de type 1
Sa prévalence varie selon les pays, probablement en raison de différences méthodo-
logiques : 0,33/1 000 au Nigeria, 0,95/1 000 au Soudan [2-3]. Deux études plus
récentes rapportent une incidence annuelle de 10,1/100 000 à Khartoum chez des
enfants de moins de 15 ans [4] et une valeur plus faible à Dar Es Salam chez de jeunes
adultes, soit 1,5/100 000 [5]. Ses aspects cliniques se rapprochent des données
européennes avec quelques différences. L’âge de début serait plus tardif, 15-19 ans en
Tanzanie, 22-23 en Afrique du Sud, 20-25 en Éthiopie [6-7]. Un coma inaugural est
révélateur dans un quart des cas mais le diagnostic n’est pas toujours fait rapide-
ment en l’absence de personnel compétent. Il est parfois confondu avec d’autres
causes de comas, neuro-paludisme, méningite etc. Le pronostic est sombre ; l’espé-
rance de vie des enfants atteints de diabète de type 1 ne dépasserait pas une année
dans les zones rurales.
La recherche de témoins d’auto-immunité confirme la présence d’anticorps anti-
îlots et une liaison inconstante avec les antigènes HLADR3-DR4 [8].
Diabète de type 2 [9, 10]
C’est la forme la plus fréquente responsable de l’épidémie qui s’observe dans les pays
en développement. Le diabète de type2aprogressé dans toute l’Afrique alors qu’il
était rare avant 1980. Sa prévalence est passée en Tanzanie de 2,3 % en 1980 à 4,6 %
en 1996, avec une poussée particulière dans la tranche d’âge de 35 à 54 ans. Au
Cameroun, on note une croissance de 1,5 à 6,6 % entre 1990 et 2003. Le Maghreb
n’échappe pas à cette évolution. Le taux de prévalence serait de 10 % en Tunisie, de
9,3 % en Égypte, de 8,1 % au Maroc. Dans d’autres pays de l’Afrique subsaha-
rienne, les chiffres varient avec des données qui ne sont pas toujours actualisées [10] :
3 % au Bénin,6à8%enAfrique du Sud, 6,4 % au Ghana, 4,2 % au Kenya, 6,7 %
en Guinée, 7,1 % au Congo, 10,2 % au Zimbabwe, 14,5 % dans la République
Bull. Acad. Natle Méd., 2011, 195,n
o
6, 1239-1254, séance du 7 juin 2011
1241

Démocratique du Congo. Les valeurs les plus élevées concernent les zones urbani-
sées. Les campagnes de dépistage systématique confirment qu’au moins la moitié
des patients ignoraient leur affection, en particulier en Tanzanie et en Guinée où 79
et 100 % des cas étaient méconnus [10]. Cette méconnaissance de la maladie est
particulièrement fréquente dans les zones rurales. Les techniques de dépistage font
appel à la mesure de la glycémie à jeun sur sang veineux ou capillaire, cette dernière
étant moins coûteuse avec un résultat immédiat. Un délai de conservation trop
prolongé du sang veineux peut fausser le dosage du glucose qui sera abaissé par
rapport à ses concentrations initiales ce qui réduira le taux de prévalence du diabète.
L’épreuve de charge en glucose a été utilisée dans certaines enquêtes et sa sensibilité
paraît supérieure à la mesure de la glycémie : une étude conduite en zone rurale, en
Afrique du Sud, fait état d’une prévalence du diabète de 2,5 % à partir de la mesure
de la glycémie à jeun et de 3,9 % selon les résultats du test de charge en glucose. Le
dosage de l’HbA1c actuellement recommandé est inutilisable en pratique en raison
de son coût.
La symptomatologie clinique est discrète et la maladie évolue à bas bruit pendant
plusieurs années à moins qu’une complication ne la fasse découvrir.
Hyperglycémie intermédiaire [11]
Il s’agit d’une anomalie souvent annonciatrice d’un diabète plus tardif ce qui lui
confère une intéressante valeur pronostique. Les valeurs seuils sont comprises entre
1,10 et 1,25G/l lorsque la glycémie est mesurée à jeun. Lorsque le sujet n’est pas à
jeun, ce qui est fréquent lors des campagnes de dépistage, les seuils sont de 1,50 G/l
moins de deux heures après un repas et 1,20 G/l plus de deux heures après. Une
valeur égale ou supérieure à 2G/l correspond à un état diabétique. Dans l’étude de
Christensen et al., [12], il est observé une liaison positive entre l’intolérance au
glucose, l’âge, la vie en milieu urbain et divers paramètres anthropométriques entre
autres l’obésité abdominale ; cette dernière paraît être le meilleur facteur prédictif
d’insulino-résistance. À l’opposé, une liaison inverse est notée entre l’intolérance au
glucose et l’exercice physique. Le dépistage des hyperglycémies intermédiaires est
particulièrement utile dans les populations présentant un faible taux de diabètes
avérés ; une forte prévalence peut annoncer une épidémie de diabète comme ce fut le
cas en Tanzanie [13] et au Cameroun [9] où un taux élevé de sujets intolérants au
glucose fut suivi vingt ans plus tard d’une augmentation de la prévalence du diabète.
Formes atypiques de diabète
Elles s’observent essentiellement en Afrique noire mais aussi dans les populations
émigrées en Europe. Deux se rencontrent avec des fréquences variables.
Diabète cétosique transitoire [14, 15]
Il affecte 15 % environ des diabétiques en Afrique subsaharienne, souvent de sexe
masculin. Son début rappelle celui d’un diabète de type 1 avec une glycémie élevée et
Bull. Acad. Natle Méd., 2011, 195,n
o
6, 1239-1254, séance du 7 juin 2011
1242

la présence de corps cétoniques. La symptomatologie clinique est très caricaturale à
cette exception que dans la moitié des cas le sujet est en surpoids avec des antécé-
dents familiaux de diabète. L’insulinothérapie entraîne rapidement une rémission et
peut alors être interrompue. Des rechutes surviennent parfois nécessitant la reprise
de l’insuline avec une évolution favorable. La physiopathologie reste mal connue.
Les mécanismes en cause associent un défaut de sécrétion d’insuline à un état
d’insulino résistance avec hyper-glucagonémie. Les témoins d’auto-immunité
retrouvés chez les diabétiques de type 1 sont absents. Le rôle d’une infection virale
herpétique a été évoqué comme facteur déclenchant. Des anticorps contre le virus
de l’herpès 8 (HHV-8) ont été trouvés chez 88 % des sujets atteints de diabète
atypique contre 15 % chez des diabétiques de type 2 [16].
Diabète nutritionnel fibro-calculeux [17]
Les sujets atteints sont maigres, sous alimentés avec des calcifications pancréatiques.
Certains travaux ont évoqué le rôle du manioc sans que ne soit confirmée de
façon certaine son implication dans la survenue du diabète. L’insulinothérapie est
nécessaire.
UNE COMORBIDITÉ DÉTERMINANTE, L’OBÉSITÉ
Tous les travaux soulignent les liens étroits entre diabète de type 2 et obésité. Cette
relation est bien établie du point de vue épidémiologique, physiopathologique et
thérapeutique. La progression de l’obésité suit un cours parallèle à celle du diabète
avec une croissance spectaculaire dans les pays en développement. En 1998, Poapkin
et Doak [20] estimaient que l’augmentation de la prévalence de l’obésité dans le tiers
monde était passée de 2,3 à 19,6 % durant les dix ans écoulés principalement dans
les zones urbanisées. En Afrique, de nombreux pays sont touchés avec une nette
prédominance féminine. Les enfants et adolescents ne sont pas épargnés, avec une
prévalence de 7,8 % en Afrique du Sud. L’obésité abdominale est une composante
du syndrome métabolique qui présente, chez la femme, une liaison indépendante
avec le diabète [21, 22].
COMPLICATIONS
Toutes les complications classiques du diabète s’observent en Afrique mais leur
sévérité est plus grande qu’en Europe en raison de la méconnaissance initiale de la
maladie, de sa prise en charge tardive, de la mauvaise qualité des soins et des
affections transmissibles intercurrentes qui jouent un rôle aggravant.
La mortalité liée au diabète est diversement évaluée selon les pays. La variabilité des
chiffres dépend de la fiabilité des certificats de décès qui omettent parfois de signaler
le diabète ; le taux global avancé par Roglie et al. [23] est de 5,2 %, situant le diabète
Bull. Acad. Natle Méd., 2011, 195,n
o
6, 1239-1254, séance du 7 juin 2011
1243
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
1
/
16
100%