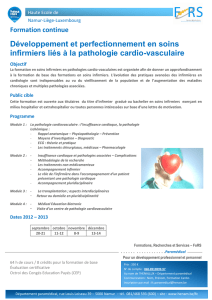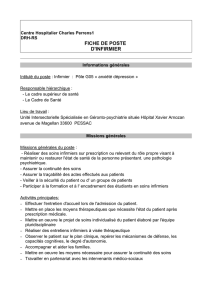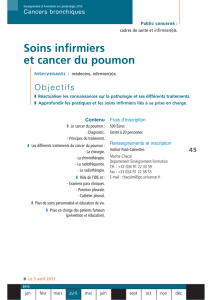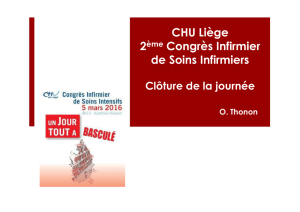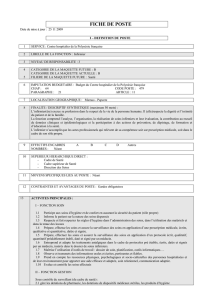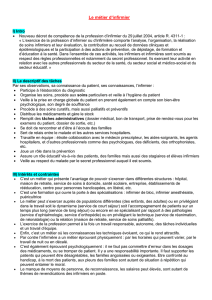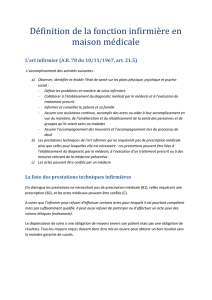Évaluation et enregistrement de la douleur :un

1
Évaluation et enregistrement de la douleur :
un impératif en soins infirmiers
Auteures : Anabela Barreira et Olívia Gomes
infirmières à l’Hôpital Visconde de Salreu, au Portugal
Directrice de recherche : Nídia Salgueiro
Enfermeira Professora Aposentada
Traduction: Claire-Andrée Fenette-Leclerc, inf., PhD.
Infiressources, mai 2010
Résumé
Même si la douleur est considérée comme une expérience subjective, il demeure qu’elle
doit être évaluée et enregistrée de façon systématique en tant que le cinquième signe
vital. Toutefois, dans de nombreux établissements hospitaliers portugais, on ne retrouve
pas cette pratique. La présente étude qui visait à améliorer l’évaluation et
l’enregistrement des signes de la douleur dans un service de spécialités chirurgicales a
été faite à partir d’une méthodologie de recherche-action. Quatorze infirmiers1
Mots-clés : douleur, évaluation de la douleur, signes vitaux
ont
participé à cette recherche pendant la période s’étendant du 26 novembre au 30 mai
2008. Les résultats ont montré la nécessité de donner de la formation au personnel
infirmier relativement à la problématique de la douleur considérée comme le cinquième
signe vital et de créer un nouvel instrument pour l’enregistrement des variations de la
douleur.
Introduction
Tout au long de son histoire, l’homme a tenté de comprendre la douleur, d’en saisir les
causes, les mécanismes et les processus, tout comme les manières de l’atténuer ou de
l’éliminer. Les premières civilisations ont inscrit sur des tablettes de pierre les premiers
récits sur la douleur. Celle-ci étant reliée au mal ou à la magie, son soulagement relevait
de la responsabilité des prêtres et des sorciers.
Les Grecs et les Romains furent les premiers à évoquer l’importance du cerveau et du
système nerveux dans la production et la perception de la douleur. Aristote a établi le
lien entre la douleur et le système nerveux central alors que Léonard de Vinci et ses
contemporains défendirent l’idée que le cerveau était l’organe responsable des
sensations transmises par la moelle épinière.
En 1664, René Descartes décrivit ce que l’on connaît aujourd’hui comme le trajet de la
douleur. On concevait alors la douleur comme un phénomène physique que l’on devait
contrer par des moyens mécaniques. Dès le 19e siècle, des progrès scientifiques ont
permis d’améliorer la thérapie analgésique avec la découverte des vertus de l’opium, de
la morphine, de la codéine et de la cocaïne, suivie plus tard par le développement de la
molécule d’aspirine. Déjà à cette époque, grâce au développement de la seringue
1 Au Portugal, il est courant de désigner le personnel infirmier par le substantif masculin, infirmier. Dans
la traduction de ce texte, nous avons utilisé cette appellation, sauf pour les auteures que nous désignons
sous le vocable d’infirmières.

2
hypodermique, l’anesthésie générale et l’anesthésie locale pouvaient être appliquées à la
chirurgie (Wikipédia, 2009).
Aujourd’hui, on considère que la douleur constitue un phénomène multidimensionnel
avec une composante physiologique ou neurologique, mais aussi une dimension
psychosociale, spirituelle et culturelle que nous percevons comme présente ou sous-
jacente dans les descriptions des expériences de douleur.
La douleur prend une signification particulière pour chaque personne. Nous savons tous,
de façon générale, ce qu’est la douleur, mais il demeure difficile pour quelqu’un de
décrire sa propre douleur comme de définir avec exactitude l’expérience de la douleur
chez une autre personne.
La douleur dont il est ici question s’avère un aspect de la santé particulièrement
significatif pour la pratique infirmière. Il est essentiel et impératif que les infirmiers
développent les compétences nécessaires pour procéder au diagnostic de la douleur
perçue par le malade et ainsi décider des interventions les plus appropriées pour la
soulager. Toutefois dans certains services, les infirmiers ne perçoivent pas encore la
douleur comme étant le 5e signe vital et la question initiale à se poser est la suivante :
Quelles sont les principales difficultés rencontrées par le personnel infirmier dans
l’évaluation et l’enregistrement systématique de la douleur?
Pour répondre à cette question, il faut en poser deux autres : Qu’est-ce que les infirmiers
observent et enregistrent relativement à la douleur? et Qu’est-ce que les infirmiers
observent et n’enregistrent pas? Dans le but d’améliorer l’évaluation et l’enregistrement
systématique de la douleur dans un service de spécialités chirurgicales, l’étude visait
principalement à identifier les principales difficultés des infirmiers dans l’évaluation et
l’enregistrement systématique de la douleur en tant que 5e signe vital.
Puisque la méthodologie de la recherche-action, par son double caractère, permet d’une
part de produire des connaissances et d’autre part, d’introduire des changements, nous
avons opté pour le modèle de Lavoie, Marquis et Laurin (1996) dont les cinq étapes
évoluent de la réflexion initiale, vers l’évaluation, la réflexion, la prise de décision
suivie du rapport final et de la diffusion des nouvelles connaissances.
Définition de la douleur
Plusieurs auteurs comme Melzack et Wall (1987), Black et Matasarin-Jacobs E (1996)
et Hacpille (2000) indiquent que la douleur n’est pas facile à définir puisqu’elle
représente une expérience unique, une sensation intime et personnelle, ce qui rend
impossible la connaissance de la douleur de l’autre (Sapeta, 2007). Sofaer (1994),
insiste d’ailleurs sur la grande diversité biologique et comportementale qui va influer
sur la manière dont la douleur est ressentie et comment le malade va y réagir. Il est
impossible de sentir ce que le malade ressent et les professionnels ont aussi des
perceptions diversifiées relativement à la douleur. Selon Ribeiro et Cardoso (2007),
même si la douleur se manifeste par des réponses différentes chez différentes personnes
et bien qu’elle soit conditionnée par les circonstances et l’histoire de vie, l’infirmier doit
reconnaitre la structure de réponse à la douleur, c’est-à-dire les caractéristiques propres
à ces réponses.

3
La classification internationale pour la pratique infirmière décrit ainsi la douleur :
Un type de sensation ayant comme caractéristiques spécifiques
l’augmentation de la perception sensorielle de certaines parties du corps,
habituellement accompagnée d’une expérience subjective de souffrance
intense telle qu’une expression faciale caractéristique, des yeux ternes ou
éteints, un regard souffrant, des expressions faciales figées ou changeantes,
des grimaces, une modification du tonus musculaire, de l’apathie ou de la
rigidité, un comportement auto-protecteur, une diminution de la capacité
d’attention, une altération de la perception temporelle, la fuite des contacts
sociaux, une altération du processus de pensée, un comportement distrait ou
marqué par une recherche incessante de contact avec d’autres personnes ou
de nouvelles activités.
Les sensations sont reliées à la durée de la douleur; l’apparition subite de
la sensation de douleur associée à des lésions aigües des tissus est ponctuée
par des réactions automatiques telles que la hausse de la tension artérielle,
de la pulsation, du rythme respiratoire, de la transpiration, des sueurs
froides, de l’horripilation (chair de poule) ainsi que de la pâleur
accompagnée de tension musculaire, une perte d’appétit et de l’anxiété; les
sensations de douleur aigües sont auto-limitatives et fonctionnent comme un
mécanisme de protection pour mener la victime à fuir ou à se retirer de la
source de la douleur pour éviter un mal plus grand; la douleur aigüe est
habituellement désignée comme la sensation aigüe et intense d’un coup de
poignard, d’un choc ou d’un supplice. Les sensations de douleur chronique,
constantes ou récurrentes ne sont pas accompagnées de réponses
automatiques; la douleur chronique est normalement désignée comme
vague, incommodante, sourde, effrayante ou insupportable; elle peut être
associée à des troubles du sommeil, à de l’irritabilité, de la dépression, de
l’isolement, du désespoir ou à un sentiment d’abandon.
Classification internationale de la pratique infirmière. (CIPE 2002)
Les actions développées par l’infirmier seront d’autant plus efficaces que meilleures et
plus adéquates seront l’évaluation et l’interprétation de la douleur et de ses
manifestations chez le malade.
La douleur est un phénomène multidimensionnel et l’universalité de l’expérience croise
la subjectivité individuelle ou plutôt... la douleur est telle que la personne la décrit et
elle existe toujours comme la personne dit qu’elle existe. À cause de la nature subjective
de la douleur, il peut être difficile de la qualifier ou de la quantifier de façon totalement
satisfaisante. Elle constitue un des problèmes les plus intrigants pour les sciences de la
santé et un grand défi pour la personne malade qui doit apprendre à vivre avec elle
quand elle ne peut être soulagée; la douleur est aussi un défi pour les professionnels de
la santé qui ignorent les moyens de soulager la souffrance du malade.
Évaluation de la douleur
L’évaluation de la douleur doit avoir comme principe directeur la notion présentée par
l’Association internationale pour l’étude de la douleur, en 1993 : “Évaluer la personne,
pas juste la douleur.”

4
Pour procéder à une telle évaluation, il existe différentes stratégies notamment
l’entrevue, l’observation du comportement ou l’auto-évaluation. (Ribeiro e Cardoso,
2007). D’un autre côté, l’utilisation systématique d’instruments (échelles, inventaires,
questionnaires, etc.) est considérée plus valide pour l’évaluation de la douleur. Il existe
des instruments unidimensionnels (échelle visuelle, échelle analogique, échelle
numérique, échelle qualitative, échelle de facies) et multidimensionnels (Brief pain
inventory, le questionnaire sur la douleur de McGill2
Selon Ribeiro e Cardoso (2007), il existe des dimensions de la douleur qui, avec ou sans
instruments, doivent être évaluées systématiquement, à savoir, la localisation, l’intensité
et la qualité de la douleur. Naturellement, la localisation peut être déterminée par le
malade soit par la description verbale ou la délimitation de la zone douloureuse, et la
description de l’intensité peut être obtenue par le récit individuel. Depuis l’émission au
Portugal de la Circulaire normative no 09 de la direction générale de la Santé du
14/06/2003,
, les journaux de la douleur, etc.);
et encore d’autres qui comportent des échelles comportementales ( Doloplus – utilisé
chez les ainés; EDIN, ENIPS, CRIES, PIPP, NFCS, DAN, OPS, utilisés chez les
enfants). Les échelles unidimensionnelles évaluent seulement une dimension de la
douleur à travers l’auto-évaluation de l’intensité de la douleur. Elles sont utiles dans les
situations de douleur aigüe d’étiologie claire et peuvent simplifier beaucoup
l’évaluation de certains types de douleur. Les études sur la douleur recommandent
l’utilisation d’instruments multidimensionnels qui prennent en compte l’intensité, la
localisation et la souffrance du malade dans une évaluation complexe et continue.
3
La qualité de la douleur constitue un aspect révélateur servant à sa caractérisation. Les
paroles et les gestes peuvent constituer de l’information pertinente pour le diagnostic.
(Ribeiro et Cardoso, 2007). En se basant sur ces prémisses, le Questionnaire de McGill
sur la douleur proposé par Melzack et Wall (1987) suggère certaines paroles que la
personne peut utiliser pour mieux décrire sa douleur. Pour leur part, MAcCaffery et
Beebe (1992), insistent sur l’importance d’observer et d’évaluer les comportements de
la personne souffrante, notamment l’expression faciale, les pleurs, l’activité physique et
l’irritabilité.
qui identifiait la douleur comme le cinquième signe vital, dont l’intensité
doit être évaluée et enregistrée de façon systématique, il est du devoir du professionnel
de la santé d’effectuer un contrôle efficace de la douleur, un contrôle continu et régulier,
avec le recours à diverses techniques. Il est aussi de son devoir d’optimiser la
thérapeutique appliquée, ce qui constitue un droit des malades et une forme effective
d’humanisation des unités de soins. D’un autre côté, la constance dans la classification
de la douleur, aux fins de caractérisation, encourage la monitorisation, depuis
l’évaluation initiale jusqu’à l’évaluation des interventions.
Le mode d’expression de la douleur peut être conditionné autant par les caractéristiques
personnelles (les expériences antérieures, la capacité de communication, l’âge), par la
perception de la douleur reliée à l’état de conscience, à l’intégrité du système nerveux,
à l’état physique et émotif que par des aspects socioculturels ou environnementaux. Le
début et la durée de la douleur, ses variations dans le temps, les facteurs qui indiquent
ou qui aggravent sa perception constituent aussi des éléments qui aident à caractériser
la douleur du malade.
2 McGill Pain Questionary
3 A Circular Normativa nº 09 da Direcção Geral de Saúde datada de 14/06/2003 - Portugal

5
Il s’avère aussi que toute cette information, son évaluation et son interprétation
permettent au personnel infirmier de proposer des interventions personnalisées et ainsi
de mieux satisfaire les besoins essentiels des patients.
Parcours méthodologique
Afin d’identifier les principales difficultés des infirmiers dans l’évaluation et
l’enregistrement systématiques de la douleur vue comme un 5e signe vital et avec
l’objectif d’améliorer cette pratique dans le service de spécialités chirurgicales, deux
infirmières affectées au Projet institutionnel intitulé “Évaluation et enregistrement de la
douleur” et qui suivaient un Cours sur la Recherche-Action de l’Ordre des Infirmiers4
Elles ont décidé de recourir à la méthodologie de recherche-action pour développer ce
projet dans un service de spécialités chirurgicales. Elles ont réuni les chercheurs et les
acteurs “praticiens” dans un objectif de recherche pour les premiers et de changement
pour les derniers. Puisqu’il s’agissait d’une recherche interne, elles disposaient de
conditions favorables au développement du projet. L’établissement a défendu sa
mission de recherche
se sont interrogées sur les principales difficultés du personnel infirmier dans
l’évaluation et l’enregistrement de la douleur comme 5e signe vital ? Elles ont cherché
à savoir ce qu’évaluaient et enregistraient les infirmiers et ce qu’ils évaluaient et
n’enregistraient pas relativement à la douleur.
5
Utilisant le modèle de Lavoie, Marquis et Laurin (1996) avec quelques adaptations, les
infirmières chercheuses qui connaissaient la réalité du milieu commencèrent le 26
novembre 2007 par la consultation de la bibliographie pertinente en partageant ensuite
leurs découvertes avec le milieu. Tous les infirmiers de l’unité de soins étaient
intéressés à participer à la recherche, à consulter les références sur la douleur et le
modèle méthodologique de la recherche.
et le conseil d’administration a désiré s’impliquer pour
l’amélioration de la qualité des services, acceptant d’octroyer du temps, du matériel et
les ressources nécessaires à tous les intervenants de cette étude.
Une première réunion a permis aux chercheuses de définir les rôles, de choisir les
acteurs, le directeur du projet et le commissaire-arbitre, de déterminer une planification
temporelle du projet et l’échelonnement des réunions. Il fut décidé par assentiment
général que le directeur du projet serait l’infirmier-chef du service et que devraient être
présents un membre de la commission d’éthique et un membre du bureau de la
coordination du service infirmier pour représenter la commission arbitrale. Dès le
départ, il fut ainsi garanti que cette étude suivrait les modèles éthiques recommandés.
Prenant en compte les droits des infirmiers relatifs aux droits à la vie privée et à
l’anonymat, il fut convenu que c’est sans préjudice qu’ils pourraient se retirer de la
recherche s’ils le désiraient. Tous les infirmiers ont participé à la collecte des
observations sur le terrain, ont tenu leur journal de bord et ont réfléchi à l’évaluation et
à l’enregistrement de la douleur.
Une fois la situation problématique identifiée, toute la documentation nécessaire réunie,
les personnes clés consultées et en tenant compte de la possibilité d’intervenir en
contexte réel, un instrument d’observation des dossiers et des pratiques infirmières fut
construit en fonction des dimensions, de l'emplacement, de l'intensité et de la qualité de
4 Ordem dos Enfermeiros
5 Au Portugal, les hôpitaux sont dotés d’une mission de recherche.
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%