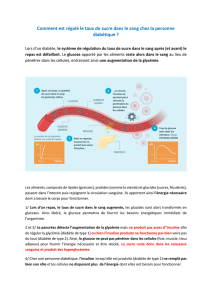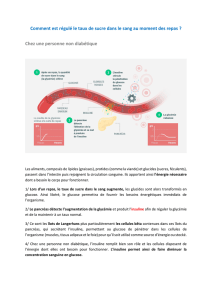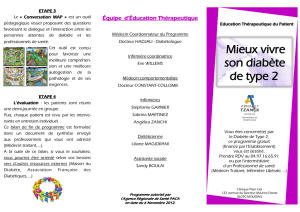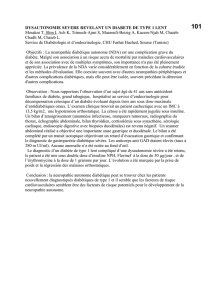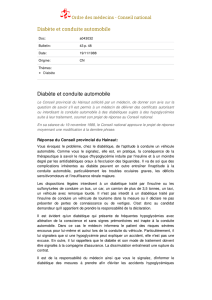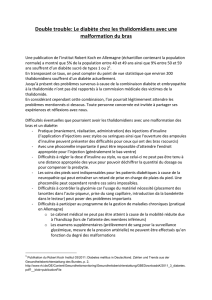L`exercice chez le diabétique de type 2

53le clinicien décembre 2002
Le diabète de type 2 est destiné, dans les prochaines
années, à atteindre des proportions endémiques, autant
chez les enfants et les adolescents que chez les adultes.
Environ le tiers des cas ne sont ni diagnostiqués ni
traités, ce qui représente approximativement 5 à 6 mil-
lions de personnes aux États-Unis.1Compte tenu de
l’incidence et de la prévalence accrue du diabète, on
peut aisément anticiper une augmentation des risques
de complications, tels que les maladies cardiovascu-
laires, l’hypertension artérielle, les problèmes vascu-
laires périphériques, l’atteinte rénale, les neuropathies
ou les rétinopathies. Pourtant, une grande proportion
des cas de diabète de type 2 pourraient être évités par
de saines habitudes de vie. Ainsi, il a été démontré que
de l’exercice physique pratiqué de façon régulière peut
diminuer considérablement les risques d’apparition de
la maladie, de l’ordre de 25 % à 50 %.2-5
L’exercice
chez le diabétique de type 2 :
la peur de l’hypoglycémie
Par Annie Ferland, Dt.P., et Paul Poirier, M.D., Ph.D., FRCPC, FACC
Le diabète de type 2 est destiné, dans les prochaines années, à atteindre des
proportions endémiques, autant chez les enfants et les adolescents que chez les
adultes. Pourtant, une grande proportion des cas de diabète de type 2 pourraient être
évités par de saines habitudes de vie, dont l’exercice.
A, B, D, et E
Le cas de Daniel
Daniel est âgé de 43 ans et il est diabétique de type 2
depuis maintenant 4 ans. Il est sédentaire, présente un
indice de masse corporel de 30 kg/m2et reçoit comme
traitement 500 mg de metformine 3 fois par jour. Il désire
entreprendre un programme d’entraînement afin de
perdre un peu de poids, mais il est craintif et ne sait pas
quelle sorte d’activité pratiquer. Quelle devrait-être votre
approche?
a) Prescrire un test à l’effort.
b) Soumettre le patient à un examen médical
complet.
c) Déconseiller toute forme d’exercice.
d) Recommander la pratique de 30 minutes d’activité
aérobie modérée, telle la marche ou le vélo, idéalement
tous les jours.
e) Référer le patient à un kinésiologue afin qu’il l’aide à
mettre au point une stratégie de départ et à choisir
avec lui les activités qui lui conviennent, au besoin.
Réponses :

La prévention du diabète
de type 2
Le diabète de type 2 est étroitement lié à un problème
d’obésité et à une mauvaise alimenta-
tion. Une bonne maîtrise métabolique
dépend de plusieurs facteurs tels la
diète, un poids santé, l’activité
physique et la prise ou non d’hypo-
glycémiants. On considère que
toute personne ayant un indice de
masse corporelle (IMC) entre
20,0 et 24,9 kg/m2a un poids santé,
donc court moins de risques de souf-
frir de diabète, même en ayant des
antécédents familiaux défavorables
ou de mauvaises habitudes de vie. Outre l’alimenta-
tion, la sédentarité a un impact très important sur le
poids et les risques de complications métaboliques.
Les bienfaits de l’exercice dans la prévention et le
traitement du diabète de type 2 sont importants. Un
programme d’activité physique régulière peut
améliorer la maîtrise de la glycémie, l’efficacité de
l’action de l’insuline, la condition physique et favori-
ser la perte et le maintien du poids, tout en permettant
même, potentiellement, de conserver une bonne
santé.6Toutefois, les profession-
nels de la santé conseillent la plu-
part du temps aux patients de ne
pas faire d’exercice sans avoir con-
sommé un repas ou une collation
au préalable, par crainte d’hypo-
glycémie. Pourtant, des preuves
récentes suggèrent le contraire. Il
est donc important de mieux pres-
crire l’exercice chez les patients
afin d’obtenir une maîtrise
métabolique adéquate et sécuritaire.
54 le clinicien décembre 2002
L’exercice et le diabète
En bref :
L’exercice et le diabète
Un programme d’activité physique régulière peut
améliorer la maîtrise de la glycémie, l’efficacité de
l’action de l’insuline et la condition physique, en plus de
favoriser la perte et le maintien du poids.
De façon générale, on observe une diminution des
concentrations d’insuline plasmatique lors d’une
séance d’exercice d’intensité modérée, entraînant ainsi
une augmentation de la production du glucose sanguin
et le maintien de celui-ci dans les limites normales.
Il a été prouvé récemment que la glycémie ne s’abaisse
que très peu à la suite d’une séance d’exercice d’une
heure, ou qu’elle ne change pratiquement pas lorsque
celle-ci est pratiquée à jeun.
Avant de commencer un programme d’entraînement, le
patient diabétique de type 2 devrait se soumettre à une
évaluation médicale approfondie.
La prescription d’un test à l’effort est suggérée lorsque
le patient présente des risques de maladie cardio-
vasculaire.
Il est suggéré de pratiquer au moins 30 minutes
d’exercice aérobie d’intensité modérée 3 à 5 fois par
semaine ou mieux, tous les jours.
Mme Ferland est diététiste et
étudiante à la maîtrise en
kinésiologie, Faculté de
médecine, Centre de recherche
hôpital Laval.
Le Dr Poirier est cardiologue et
responsable médical du
programme de prévention
des maladies cardiaques, hôpital
Laval et Institut universitaire de
cardiologie.
POURQUOI
SOURIT-IL?
Voir page 26

L’exercice et le diabète
L’impact de l’exercice sur
la glycémie
L’activité physique aérobie fait partie du traitement
du patient présentant un diabète de type 2 traité
avec des hypoglycémiants oraux, au même titre que
l’alimentation. Une séance d’exercice provoque une
intensification des besoins en énergie, ce qui
entraîne la mobilisation du glycogène dans les sites
de réserve ainsi qu’une augmentation de l’oxyda-
tion par les muscles. Pendant la première phase de
l’exercice, les muscles sollicités utiliseront le
glycogène musculaire comme source d’énergie. Si
l’exercice se prolonge, le glucose sanguin
provenant de la glycogénolyse hépatique et les
acides gras provenant de la lipolyse du tissu
adipeux prendront graduellement la relève, au fur et
à mesure qu’il y aura déplétion du glycogène
musculaire.7Ces différentes réserves sont
d’importance variable. Le tableau 1 permet de
visualiser la distribution de 1 800 Kcal des réserves
glucidiques d’un patient pesant 68 kg.8On remar-
que que la proportion provenant des glucides san-
guins est minime et rapidement épuisée. Toutefois,
les muscles squelettiques et le foie présentent une
réserve de glycogène beaucoup plus importante et
peuvent ainsi fournir une quantité appréciable de
glucose par la glycogénolyse. Les changements
dans les taux d’hormones circulantes (insuline,
glucagon, catécholamines) ainsi que dans l’activité
du système nerveux sympathique gouvernent la
mobilisation et l’utilisation des sources d’énergie.
Le but ultime est de maintenir la glycémie stable,
afin de préserver les fonctions du système nerveux
central. De façon générale, on observe une diminu-
tion des concentrations d’insuline plasmatique lors
d’une séance d’exercice d’intensité modérée,
entraînant ainsi une augmentation du glucose san-
guin et le maintien de celui-ci dans les limites nor-
males.9Toutefois, chez le patient diabétique, cette
diminution de l’insuline sera beaucoup moins
importante, entraînant par le fait même l’inhibition
de la production de glucose sanguin.10
Toute personne ayant
un indice de masse corporelle
entre 20,0 et 24,9 kg/m2court
moins de risques de souffrir de
diabète, même en ayant de
mauvaises habitudes de vie.
DIVISION DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES
LABORATOIRES ABBOTT, LIMITÉE
SAINT-LAURENT (QUÉBEC) H4S 1Z1
Tableau 1
La distribution des réserves de glycogène
et de glucides sanguins, musculaires et
hépatiques chez un patient pesant 68 kg
Glucose sanguin 80 Kcal
Glycogène hépatique 3 210 Kcal
Glycogène musculaire 1 400 Kcal
Total 1 800 Kcal
Adapté de : Clark, N : Sports Nutrition Guidebook, deuxième
édition, Human Kinetics, 1997, p. 111.

le clinicien décembre 200258
L’exercice et le diabète
L’ h ypoglycémie au moment de l’exercice n’est
pas chose courante chez une personne non diabé-
tique, puisque des ajustements dans la sécrétion
d’insuline permettent de maintenir la glycémie à un
niveau normal. La réaction du métabolisme à
l’exercice peut varier en fonction de plusieurs fac-
teurs tels l’âge, le statut nutritionnel et la capacité
cardiovasculaire. Chez la personne diabétique, la
production de glucose par la glycogénolyse muscu-
laire reste sensiblement la même que chez une per-
sonne non diabétique. Il a toutefois été prouvé que
la production de glucose par le foie diminue pen-
dant l’exercice. 10,11
L’activité physique et
les risques d’hypoglycémie
Des séances d’exercice régulières permettent de mieux
maîtriser la glycémie et peuvent entraîner une réduction
de la médication hypoglycémiante nécessaire chez le
patient diabétique. Même si les bienfaits de l’exercice
physique dans la prévention du diabète sont bien connus,
l’impact d’une séance d’exercice sur la glycémie
demeure controversé. Quelques études ont évalué l’influ-
ence d’un exercice pratiqué à jeun et à la suite d’une
brève interruption de la médication, mais ceci est peu
représentatif de la situation réelle à laquelle le clinicien
fait face.12 Plusieurs professionnels de la santé tiennent
encore pour acquis qu’il y a un risque d’hypoglycémie
important lorsqu’un patient diabétique de type 2 fait de
l’exercice à jeun. Cette recommandation, associée tant
aux patients diabétique de type 1 que de type 2 traités à
l’insuline, a été appliquée ad litteram aux diabétiques
traités avec des hypoglycémiants oraux. Cette crainte est
amplifiée par le risque potentiel d’hypoglycémie induit
par un traitement aux sulfonylurées, contrairement à la
metformine. Selon la recommandation de leur médecin,
la vaste majorité des sujets diabétiques de type 2 vont
s’entraîner à l’état postprandial à cause de la peur d’in-
duire une réaction hypoglycémique lorsqu’ils sont à jeun.
Pourtant, de récentes preuves révèlent que la glycémie ne
s’abaisse que très peu à la suite d’une séance d’exercice
d’une heure et qu’elle ne change pratiquement pas
lorsque celle-ci est pratiquée à jeun.11,13,14 Même chez
les patients traités aux sulfonylurées, il n’est pas néces-
saire de restreindre les périodes d’exercice à l’état post-
prandial. Cependant, on peut anticiper une baisse signi-
ficative de la glycémie lorsque cette même séance d’ex-
ercice est effectuée après un repas. Les risques d’une
réaction hypoglycémique sont plus élevés lorsqu’un
patient diabétique de type 2 pratique une activité après un
repas plutôt qu’à jeun.11 Il faut alors lui suggérer d’omet-
tre de prendre sa médication hypoglycémiante avant
ladite séance. Une surveillance de la glycémie avant et
après l’exercice est toutefois recommandée afin de
sécuriser le patient et de créer un effet de motivation.
Outre le statut nutritionnel, plusieurs autres facteurs, tels
la durée et l’intensité de la séance d’exercice et le type de
traitement pharmacologique, peuvent influencer la
réponse glucidique à l’exercice.
Impact de l’exercice sur
la sensibilité à l’insuline
L’ exercice physique pratiqué de façon régulière a une
Tableau 2
Les critères permettant d’identifier
les personnes diabétiques de type 2 qui
nécessitent un test d’effort
Personne âgée de plus de 35 ans
Personne souffrant de diabète de type 2 depuis plus
de 10 ans
Présence de un ou de plusieurs facteurs de risque de
maladie coronarienne
Présence d’un problème vasculaire tel
une rétinopathie ou une néphropathie (incluant
la microalbuminurie)
Problème vasculaire périphérique
Neuropathie autonome
Adapté de American Diabetes Association : Clinical Practice
Recommandation. Diabetes Care 25 (suppl.1):S64, 2002.

L’exercice et le diabète
influence favorable sur la sensibilité à l’insuline
chez le patient diabétique de type 2. Que ce soit
une activité aérobie ou musculaire, celle-ci a un
effet positif sur la tolérance au glucose.10 Outre
ces bienfaits, toute activité physique sollicitant
intensément la masse musculaire peut accélérer la
perte de poids chez un sujet obèse, entraînant une
meilleure maîtrise métabolique. L’impact de
l’exercice sur la sensibilité à l’insuline serait dû à
l’effet résiduel de la dernière séance. Pour avoir
des effets plus durables, il faut que l’exercice
engendre une perte de masse adipeuse.15
Les recommandations au
patient diabétique de type 2
Les bénéfices apportés par la pratique régulière
d’une activité physique sur la santé sont consid-
érables et constituent une partie importante du
traitement du patient diabétique de type 2.
Pourtant, la majorité de la population ne satis-
fait pas aux normes établies en matière d’exercice
physique. Avant de commencer un programme d’en-
traînement, le patient diabétique de type 2 devrait se
soumettre à une évaluation médicale approfondie. Un
examen physique est nécessaire
afin de déceler tous signes ou
symptômes pouvant révéler une
complication touchant les yeux,
les reins, le cœur ou les vais-
seaux sanguins. La prescription
d’un test à l’effort est indiqué
lorsque le patient présente des
risques de maladie cardiovascu-
laire. En ce sens, le tableau 2
indique les recommandations
pour lesquelles une personne
devrait être soumise à un test à
l’effort.12 Ce type de test nous
fournit l’information relative à
la réponse hémodynamique en
terme de fréquence cardiaque et de tension artérielle
lors d’un exercice maximal. Toute anomalie au niveau
de l’électrocardiogramme à l’effort nécessite une éva-
luation plus spécifique par imagerie nucléaire ou par
PrADVAIR®est indiqué comme traitement d'entretien de l'asthme chez les patients atteints d’une maladie
obstructive réversible des voies respiratoires, lorsque l'utilisation d'une association médicamenteuse
est jugée appropriée. PrADVAIR®ne devrait pas être utilisé chez les patients dont l'asthme peut être
maîtrisé par l'administration occasionnelle d'un ß2-agoniste en inhalation à courte durée d'action.
PrADVAIR®renferme un ß2-agoniste à longue durée d'action et ne doit pas être utilisé comme
médicament de secours. Pour le soulagement des symptômes d'asthme aigus, il faut avoir recours à
un bronchodilatateur en inhalation à courte durée d'action (comme le salbutamol).
Chez les adolescents et les adultes, les effets indésirables le plus souvent signalés sont l'irritation de
la gorge (2 %), l’enrouement et la dysphonie (2 %), la céphalée (2 %), la candidose (2 %), qui peut être
atténuée par le rinçage de la bouche et le gargarisme avec de l’eau après l’inhalation, et les
palpitations (≤1 %).
Monographie du produit fournie sur demande.
PrADVAIR®et DISKUS®sont des marques déposées, utilisées sous licence par GlaxoSmithKline Inc.
MCL’apparence, à savoir la couleur, la forme et la taille, du dispositif d'inhalation DISKUS®est une mar-
que de commerce, utilisée sous licence par GlaxoSmithKline Inc.
ADVAIR
100, 250 et 500 ADVAIR
125 et 250
ADVAIR DISKUS
®
ET MAINTENANT ADVAIR AÉROSOL-DOSEUR
SONT INSCRITS À LA LISTE DE MÉDICAMENTS DU QUÉBEC.
Tableau 3
Exercice recommandé
Type Aérobie : musculation, course à pied, vélo,
ski de fond, raquette, etc.
Musculation (entraînement en résistance à une
intensité modérée) : programme en circuit
utilisant des poids légers en effectuant 10 à
15 répétitions
Intensité 60 % à 90 % de la fréquence cardiaque
maximale ou 50 % à 80 % du VO2max
Durée 20 à 60 minutes, avec une période de 5 à
10 minutes d’échauffement et de retour au
calme
Fréquence Au minimum de 3 à 5 fois par semaine,
idéalement tous les jours
Adapté de : Campaigne, BN : ACSM’s resource manual for guidelines
for exercise testing and prescription. American College of Sports
Medicine, quatrième édition, 2001, p. 277.
VO2max : consommation maximale d’oxygène.
 6
6
 7
7
1
/
7
100%