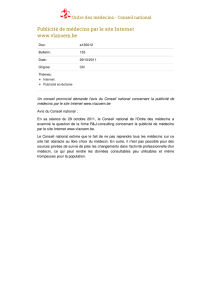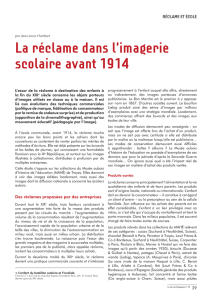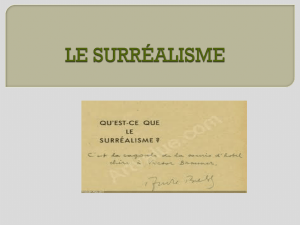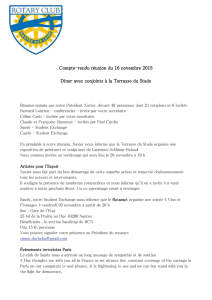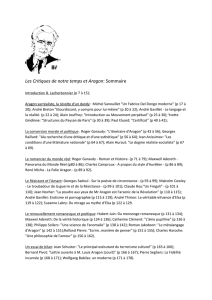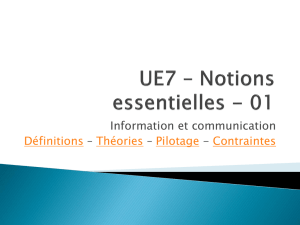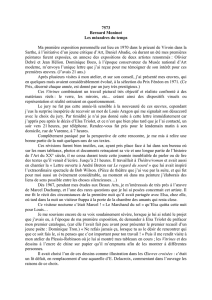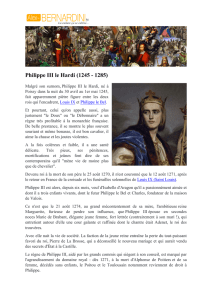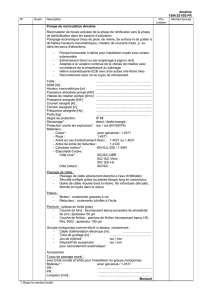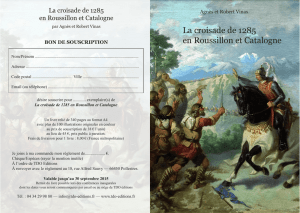les poèmes en prose critiques d`aragon, de sic à littérature

LES POÈTES ET LA PUBLICITÉ
par Adrien CAVALLARO
Université Paris-Sorbonne
« LE GOÛT DE LA RÉCLAME ».
LES POÈMES EN PROSE CRITIQUES D’ARAGON, DE
SIC
À
LITTÉRATURE
(1918-1920)
Aragon orne sa lettre du 18 mai 1918, adressée à Breton, première du volume récemment
édité par Lionel Follet, de ce qu’il appelle un « poème », très bref : « Peine d’amende / Défense
d’afficher1 ». Il s’agit d’une transposition de pancartes ou d’inscriptions des plus courantes,
proscrivant la réclame, et qui revient, légèrement modifiée, dans la première des rubriques
de « Critique synthétique » éphémèrement données à Pierre Albert-Birot entre octobre 1918 et
février-mars 1919 pour la revue
SIC
Mise en évidence par la typographie, en grandes capitales
et en gras, elle témoigne de ce qu’Aragon appelle, un peu plus de dix ans plus tard, dans son
« Introduction à 19302 », un « goût de la réclame », qui serait caractéristique du moderne
1917‑1920; si elle en témoigne, c’est néanmoins de façon paradoxale : d’un côté, le transfert
de l’espace familier de la correspondance à l’espace littéraire et artistique de la revue est le
signe d’une préoccupation que faisait valoir le tout premier texte critique d’Aragon, écrit pour
Apollinaire et tardivement publié,
Alcide ou De l’esthétique du saugrenu
3 ; mais d’un autre
côté, cette prédilection pour l’affiche est d’emblée déplacée dans une perspective critique,
faisant de la « défense d’afficher » une sorte d’affiche au second degré, dont les particularités
typographiques et le cadre formel sont retenus, et comme dépouillés de contenu.
Je me propose d’étudier ici les manifestations de ce « goût de la réclame » dans un ensemble
de textes critiques, publiés d’abord dans
SIC
en 1918-1919, repris par Aragon dans le premier
volume de
L’Œuvre poétique
4, puis dans Littérature entre mars 1919 et septembre‑octobre 1920
(textes qui cette fois n’ont pas été repris, malgré une véritable continuité avec la « Critique
1.
Lettres à André Breton. 1918‑1931
, édition établie, présentée et annotée par Lionel Follet, Paris, Gallimard, 2011, p. 74.
2.
La Révolution surréaliste
, n° 12, 15 décembre 1929, repris dans
Chroniques I. 1918‑1932
, édition Bernard Leulliot, Paris, Stock,
1998, p. 339‑350.
3. Aragon publie ce texte pour la première fois en 1964 dans l’« Avant‑lire » qui précède
Le Libertinage
, repris dans les
Œuvres
romanesques complètes
, éd. Daniel Bougnoux, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », t. I, 1997, p. 258‑261.
4. Sous le titre « Critiques synthétiques. Octobre 1918 – Mars 1919 » (
L’Œuvre poétique
, tome I, 1917‑1920, Paris, Livre Club Diderot,
1974, p. 71‑79). Qu’Aragon ait choisi de reprendre ces textes est le signe qu’il leur conférait une dimension poétique, qu’elle
soit formelle ou thématique. On peut s’étonner qu’il n’ait pas également repris les textes donnés par la suite à
Littérature
, qui
délaissent certes les expérimentations typographiques de l’époque de
SIC
, mais qui par bien des côtés en perpétuent l’ambition
(voir
infra
). Sur
L’Œuvre poétique
, voir Josette Pintueles,
Aragon et son « Œuvre poétique ». L’« Œuvre » au dé
, Paris, Classiques
Garnier, coll. « Études de littérature des XXe et XXIe siècles », 2014, en particulier, p. 85‑101.

synthétique ») : on peut y trouver un biais pour confronter la théorie forgée à l’issue de l’« année
mentale5 » qui sépare le premier
Manifeste du Second manifeste
avec les pratiques scripturales
critiques des années de formation, mais également, du point de vue de l’histoire des formes, pour
cerner les contours d’une sous-catégorie critique instable du genre lui aussi constitutivement
instable du poème en prose6.
Qu’est-ce que la « réclame » pour Aragon ?
En préambule de cette réflexion, il est nécessaire d’explorer ce qu’Aragon entend par « goût de
la réclame » dans cette « Introduction à 1930 » qui fait du moderne une valeur périssable, relative,
fondamentalement corrélée à une époque, et dont la mode signerait le déclin. Dans sa définition
la plus rigoureuse, « la modernité est [ainsi] une fonction du temps qui exprime l’actualité
sentimentale de certains objets, dont la nouveauté essentielle n’est pas la caractéristique, mais
dont l’efficacité tient à la découverte récente de leur valeur d’expression7 » : prise dans une
dynamique historique, la modernité doit être saisie à travers un processus d’arrachement –
Breton dirait de
dépaysement
8 – d’objets temporairement dotés d’une puissance affective, par
des opérations de décontextualisation et de recontextualisation dont le collage donne l’une des
formules privilégiées. Si sa fin est bien le « nouveau », ce n’est pas parce qu’elle plongerait «au
fond de l’inconnu » ; elle se situe au contraire dans un geste d’élection et de reconnaissance
foncièrement historicisé, dont le déjà-là d’objets même désuets est le tremplin, si bien que
chaque époque définit son propre moderne : la particularité du « moderne de […] 1917‑1920»
serait de ce point de vue une certaine « conception du lyrisme », déterminée par « un goût
nouveau », « le goût de la réclame9 ».
« Réclame » est ici à prendre en un sens assez large : il ne s’agit pas seulement des
dernières pages du
Petit Parisien
, tapissées de publicités essentiellement pharmaceutiques
pour des produits plus ou moins charlatanesques, mais des « expressions toutes faites », des
« lieux communs du langage qui [prennent], isolés de tout contexte, l’aspect des manchettes
de journaux ou des inscriptions murales10 », avec pour espace de prédilection l’affiche ; à cet
égard, Aragon vise autant derrière le terme un contenu qu’un ensemble de signes, format et
codes typographiques, ainsi qu’une rhétorique formulaire caractéristique qui peut déborder les
5. « Introduction à 1930 »,
La Révolution surréaliste
, n° 12, 15 décembre 1929,
Chroniques I
,
op. cit.
, p. 347.
6. Cet aspect, brièvement abordé ici, s’inscrit dans une réexion plus globale sur la pratique du poème en prose aux XIXe‑XXe
siècles : la question reste dans l’ombre de la thèse, ancienne, de Suzanne Bernard (
Le Poème en prose, de Baudelaire jusqu’à
nos jours
, Paris, Nizet, 1959), dont les développements théoriques sur le genre (
ibid
., p. 434‑465) sont aujourd’hui à tout le moins
discutables.
7. « Introduction à 1930 », art. cit.,
Chroniques I
,
op. cit.
, p. 340.
8. Sur cette notion de
dépaysement
, voir André Breton, « Situation surréaliste de l’objet, situation de l’objet surréaliste », dans
Position politique du surréalisme
[1935],
Œuvres complètes
, éd. Marguerite Bonnet, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la
Pléiade», t. II, 1992, p. 481, ainsi que Marie‑Paule Berranger,
Dépaysement de l’aphorisme
, Paris, José Corti, 1988.
9. « Introduction à 1930 », art. cit.,
Chroniques I
,
op. cit.
, p. 342‑343.
10.
Ibid
., p. 343.
Les poètes et la publicité _ p. 129 ///

messages strictement commerciaux. Or cette réclame est le lieu de théorisation d’une philosophie
dialectique du langage, dont les postulats sont bien ancrés dans la pensée du tournant des
années 1930 du surréalisme, imprégnée, on le sait, d’un hégéliano‑marxisme dont Breton est le
principal artisan11.
Par leur vacuité, les discours forgés pour la réclame vident le langage de sa substance
en bornant sa prétention à signifier ; mais mise à nu par l’affiche, la gratuité scandaleuse de
certaines formules, leur exiguïté sémantique peuvent être paradoxalement et positivement
renversées par des opérations de reconfiguration poétique, comme le suggère Aragon lorsqu’il
affirme que « le sens commun d’un idiotisme se perd devant l’emploi poétique qui en est fait au
profit d’un sens fort, et nouveau, à l’instant découvert12 ».
Ce goût prend essentiellement deux formes, l’une mythologique, descriptive et quelque
peu superficielle, l’autre poétique. La première voit dans la réclame le réservoir privilégié d’une
mythologie moderne, dont le bébé Cadum, oublieux de ses bulles de savon, échappé aux rets de
ses affiches obsédantes, est l’un des emblèmes. L’intérêt pour la question qui m’occupe est de
remarquer qu’Aragon envisage sous cet aspect la naissance, la vie et le déclin des mythes, ce qu’il
appelle leur « cycle évolutif13 » : le « goût de la réclame » conduit à élever au statut de mythe des
figures spécifiques, subtilisées aux affiches, en signe de « protestation contre le produit14», avant
que les mythes, un instant régénérés, ne sombrent à nouveau dans l’« imbécillité15 ». La réclame
engage ainsi tout un processus de clichéisation de figures et de formules, que déplace la pratique
critique aragonienne. La seconde, dans le sillage de laquelle Aragon s’inscrit implicitement, est
plus strictement poétique, ou plutôt poïétique : attachée à « l’efficacité de la réclame16 », elle
entend emprunter à celle‑ci ses moyens formels, en rupture avec toutes les formes connues.
Chez Aragon, cette volonté de « revitalisation » par la réclame excède toutefois les frontières
traditionnelles de la poésie pour irriguer abondamment le discours critique ; par un recours
ambivalent aux figures, discours et cadres formels de la réclame, elle vise à définir une forme
et un style critique neufs, mais aussi un
éthos
polémique et une axiologie de la littérature
contemporaine. On s’attachera à les cerner dans une perspective diachronique pour envisager
les avatars d’une critique en transformation entre
SIC
et
Littérature
, profondément modelée par
le « goût de la réclame », mais de plus en plus indirectement, les signes de la réclame cédant le
pas à la boussole axiologique positive et négative qu’elle constitue peu à peu aux yeux d’Aragon.
11. Voir Emmanuel Rubio,
Les Philosophies d’André Breton (1924‑1941)
, Lausanne, Éditions L’Âge d’homme, coll. « Bibliothèque
Mélusine », 2009, en particulier « Vers un hégéliano‑marxisme conséquent (1925‑1929) », p. 109‑213.
12. « Introduction à 1930 », art. cit.,
Chroniques I
,
op. cit.
, p. 343.
13.
Ibid
., p. 344.
14.
Ibid
.
15.
Ibid
., p. 343.
16.
Ibid
., p. 344.
Les poètes et la publicité _ p. 130 ///

La « Critique synthétique » de
SIC
(octobre 1918-février-mars 1919)
Une mise au point terminologique : la « Critique synthétique » comme pilule
Pink critique
Les textes de « Critique synthétique » donnés à la revue
SIC
comptent parmi les premiers
d’Aragon, qui collabore avec Pierre Albert-Birot depuis mars 191817, et auquel il attribue, bien
plus tard, devant Dominique Arban, la paternité de la catégorie ; il qualifie alors ces textes de
jeunesse d’« espèces de poèmes en prose » :
[… Albert-Birot] appelait cela « La Critique synthétique », parce que ce n’était pas du tout
de la critique. C’étaient des espèces de poèmes en prose, fort courts, à propos d’un livre qui
venait de paraître, ce qui me permettait à la fois la désinvolture, ou aussi bien un certain éloge
poétique de choses que je n’aurais peut-être pas pleinement approuvées si j’en avais écrit sur
le ton à proprement parler critique18.
Marguerite Bonnet a signalé que Vaché employait déjà le terme dans une lettre en date du 9
mai 1918 adressée à Breton qui, dans son article sur Jarry publié en janvier 191919, y fait également
allusion. Plutôt qu’aux débats sur l’origine du terme, on sera sensible à cette ambition esthétique
d’une critique poétique impliquant un format particulier, une concentration qui la fait échapper
à la discursivité traditionnelle du genre et l’attire dans le giron du poème en prose.
Or, cette concentration, Albert‑Birot y insiste dans une lettre invitant le jeune écrivain à
assumer une rubrique qui porterait ce nom, et qu’Aragon recopie intégralement à Breton, du
front, le 11 juillet 1918. La définition qu’en donne le directeur de
SIC
prend le contre-pied d’une
critique traditionnelle tenue en haute suspicion, dont
Le Carnet critique
(une cible récurrente
d’Albert-Birot20) serait le parangon, tout en empruntant à la réclame son image matricielle.
Albert-Birot précise en effet les textes qu’il attend par comparaison avec les « Treize études »
que Breton et Aragon ont déjà publiées dans sa revue21, et qu’il commente ainsi :
Mais peut-être avez-vous été trop nettement jusqu’à la pilule, ce n’est peut-être que
progressivement que l’organisme pourra se faire à cette alimentation concentrée. Si les obus
vous en laissent le loisir pensez donc à cela, envisagez ce qu’il serait possible de faire, non
pour un individu, mais pour une œuvre, pensez aux
Calligrammes
. Je serais tout à fait disposé,
17. « Le 24 juin 1917 »,
SIC
, n° 27, mars 1918.
18.
Aragon parle avec Dominique Arban
, Paris, Seghers, coll. « Cent pages avec… », 1968, p. 33‑34.
19. Dans
Les Écrits nouveaux
, n° 13, janvier 1919 ; recueilli dans
Les Pas perdus
[1924],
Œuvres complètes
, éd. Marguerite Bonnet,
Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », t. I, 1988, p. 216‑226). Pour la lettre à Vaché, voir
ibid
., p. 1249.
20. Le directeur de
SIC
se montre particulièrement peu indulgent à l’égard de la nouvelle revue, dès son lancement. Voir, entre
autres, la rubrique « Etc. » de
SIC
, n° 24, décembre 1917 : « […] critiquer c’est démonter pièce à pièce la machine pour pouvoir dire
pourquoi elle marche et pourquoi elle ne marche pas. Je n’ai pas trouvé de critique dans le Carnet‑Critique, c’est regrettable, il
y avait là une idée intéressante et c’est une revue qui manquait mais il manque encore les – voire même – un critique ». C’est
par ailleurs dans
Le Carnet critique
qu’Aragon publie l’un de ses premiers articles, « Rimbaud. Puisque son nom fut prononcé…»
(n°5, 15 avril‑15 mai 1918).
21.
SIC
, n° 29, mai 1918.
Les poètes et la publicité _ p. 131 ///

si vous pouviez trouver un volume assimilable, à vous donner toutes les critiques d’œuvres
et
à n’en mettre jamais d’autres dans SIC
22.
Si on ne peut avec certitude l’imputer au pouvoir de séduction de la réclame, cette métaphore
de la pilule semble toutefois bien pouvoir en provenir. À feuilleter les journaux à grand tirage
du temps,
Petit Parisien
et
Petit journal
en tête, on s’aperçoit vite en effet que les quatrièmes
pages font presque systématiquement une place aux pilules en tout genre, qui dessinent
alors un horizon important de la réclame, de la fameuse « pilule Pink pour personnes pâles »,
chère notamment à Breton23 (>> ill. 1 & 224), aux pilules Gips, Dupuis, Valda, indiquées pour des
usages plus triviaux. Elles font l’objet d’affiches et d’encarts variés vers lesquels la sensibilité
typographique du fondateur de
SIC
pouvait très vraisemblablement se porter, au point qu’il
est loisible de penser que l’adjectif « synthétique » est ici à considérer dans son acception la
plus simple, caractérisant une critique brève, concentrée, elliptique, et que, sous la plume
d’Albert-Birot, il prend par analogie une coloration publicitaire : afin de régénérer une critique
moribonde, celui-ci suggère en quelque sorte de retravailler la formule d’une série de pilules
Pink critiques, offrant ainsi un modèle théorique publicitaire à une entreprise bientôt acceptée,
et qui cultive elle‑même à l’envi un goût prononcé de la réclame.
La « Critique synthétique » : lyrisme, typographie et goût des « peintures idiotes»
Si les textes qu’Aragon écrit pour
SIC
sont assez peu nombreux, il faut les lire comme
préambules aux textes de
Littérature
: seules quatre rubriques sont en effet assurées, pour
un total de dix brefs textes, sur des œuvres de premier plan (ainsi
Calligrammes
ou
Le Pain
dur
25) comme sur des ouvrages plus confidentiels, dont Albert‑Birot assume le choix. Dans
cette production, la réclame fait office de modèle critique, sur un plan indissociablement formel
et conceptuel : elle sert d’aiguillon essentiellement poétique – entendons par là lyrique et
typographique –, mais aussi d’aiguillon critique puisque la réclame est par analogie une aune
majeure du jugement porté sur les œuvres, et tout autant un indice de la réaction affective
qu’elles encouragent chez le lecteur. Par thématisation, la réclame constitue en effet un réservoir
d’images, mais elle ouvre également à la conduite d’une réflexion spécifique : pôle d’attraction
favorisant l’émerveillement devant des « peintures idiotes » modernes, elle est aussi érigée en
repoussoir alimentant un discours polémique.
La première rubrique, consacrée aux
Calligrammes
d’Apollinaire, en donne plusieurs
ingrédients majeurs pour ce qui concerne la période de
SIC
; à elle seule, elle permet de montrer
que la réclame est d’emblée pourvoyeuse de cadres formels, de patrons syntaxiques, d’images
22.
Lettres à André Breton
,
op
.
cit
., p. 139‑140.
23. Breton attribue la note atteuse de 15 aux pilules Pink dans le n° 18 de
Littérature, nouvelle série
(mars 1921). En leur donnant
la note de 12, Aragon cultive un sentiment proche.
24. Les illustrations sont regroupées dans le dossier iconographique présenté à la n de cet article. Chaque illustration est
accessible directement par simple clic.
25. « Les œuvres littéraires françaises. Critique synthétique »,
SIC
, n° 31, octobre 1918 et n° 33, novembre 1918. On trouvera en
annexe (2) l’ensemble des rubriques données à
SIC.
Les poètes et la publicité _ p. 132 ///
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
1
/
20
100%