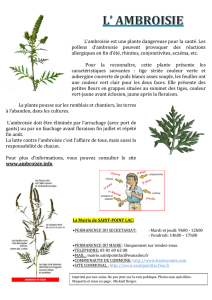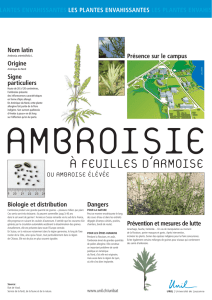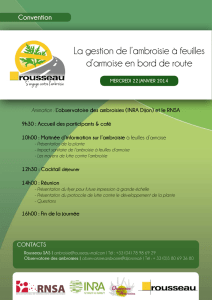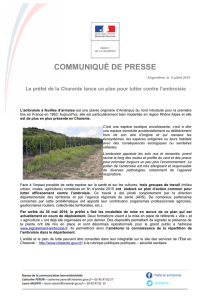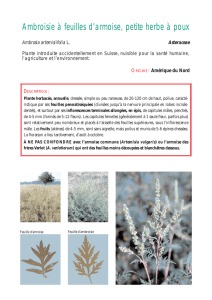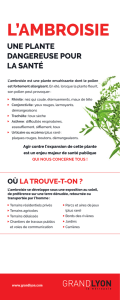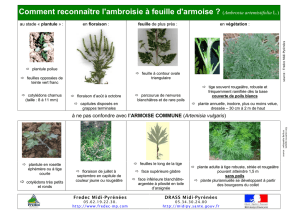Fiche d`identification

L’Ambroisie (très allergisante 5 sur 5)
L’ambroisie à feuille d’armoise (
Ambrosia artemisiifolia
L. de
la famille des Asteracées), appelée également petite herbe à
poux au Québec, est une espèce originaire d’Amérique du
Nord qui envahit aujourd'hui la France et l'Europe.
Très allergisante et envahissante, l’ambroisie colonise les
villes et les campagnes de France. En Région Rhône-Alpes,
depuis le
premier cas de
pollinose due à
l’ambroisie,
observée par un
médecin, le
professeur
Roger Touraine,
en 1964, la maladie se développe au même rythme
que la diffusion de la plante. Responsable de
pollinoses saisonnières sévères (rhinite,
conjonctivite, asthme…), elle affecte aujourd'hui
selon les zones de 6% à 20% de la population
exposée et représente non seulement une
souffrance et un handicap pour les personnes
sensibilisées mais encore un préjudice financier
pour la collectivité.
L’ambroisie a été introduite à la fin du 19
ème
siècle
(puis tout au long 20
ème
siècle) dans de nombreuses
régions du monde probablement
avec des importations de
semences et de fourrage.
Actuellement, les régions les plus
envahies en France sont la région
lyonnaise et les départements
limitrophes du Rhône, le Bas-
Dauphiné (Nord-Isère), la vallée
du Rhône (de Lyon à Montélimar,
voire Avignon) et le Roannais.
Elle est en pleine progression
vers la Bourgogne et le Nord de
la France et de nombreuses
populations d’ambroisies sont
signalées en Poitou-Charentes et
Midi-Pyrénées.
Plante annuelle germant au
printemps (fin mars), l'ambroisie
mesure en moyenne de 30 à 70
cm de haut (jusqu’à 200 cm).
Fiche d’identification
Ambrosia artemisiifolia L. Ambroisie à feuille d’armoise
Famille : Astéracées
Description
Plante herbacée annuelle dressée, ramifiée, de 10 à 150 cm de haut. Tige souvent
rougeâtre, pourvue de sillons. Racine à pivot. Le mot grec “ambrosia” signifie
“odeur exhalée par les feuilles”, “artemisiifolia” = “à feuille d’armoise”.
Feuilles : opposées à la base de la plante puis alternes vers le haut. Très découpées
et minces, à contour ovale-triangulaire, bi-pennatiséquées, de 3 à 10 cm de long, plus
ou moins poilues. Les feuilles froissées sont odorantes.
Fleurs : regroupées en inflorescences terminales allongées.
Fleurs mâles et femelles le plus souvent séparées sur un même pied (plante
monoïque). Il existe des plantes femelles exclusivement. Inflorescences mâles en
grappes. Capitules de 3 à 5 mm de diamètre (formés de 5 à 20 fleurs) situés au
sommet des tiges et produisant le pollen, vertes devenant jaunes lors de la
pollinisation. Fleurs femelles situées à l’aisselle des feuilles supérieures et sur les
axes floraux.
Floraison et pollinisation de août à octobre.
Pollen : bien caractérisé au niveau du genre, le pollen d’ambroisie est parfaitement
identifiable en microscopie photonique. Les grains de pollen sont légèrement
longiaxes, tricolporés, finement échinulés. Leur diamètre moyen est de 25
micromètres.
Fruits : akènes non plumeux (donc non transportés par le vent) de 4 à 5 mm de long,
cylindriques, poilus, munis de 5 à 6 épines dressées, se terminant par un bec de 1
mm environ. Fructification d’octobre à novembre.
Carte approximative de répartition de
l’ambroisie en France

Considérée comme une espèce opportuniste, envahissante et pionnière, elle s’adapte à toutes
les situations écologiques mais tolère difficilement la compétition des plantes à développement
rapide. Elle s’installe préférentiellement dans les sols nus et remaniés (chantiers ; voies de
communication : talus de routes, d’autoroutes et de voies ferrées, bords des rivières), dans les
jachères, dans les cultures à levée tardive, et les vergers. Dans certaines cultures comme le
tournesol, qu’elle envahit préférentiellement, la récolte peut être totalement détruite en raison
de la compétition imposée par cette mauvaise herbe. Dans les céréales, immédiatement après la
moisson, elle peut à nouveau réinfester les sols, par l’intermédiaire de ses semences. En effet, la
contamination due à l’ambroisie cause, en plus de la pollution de l’air par les grains de pollen, celle
du sol par ses semences qui ont une longévité pouvant atteindre 40 ans.
En France, la floraison de
l’ambroisie débute en moyenne
début août (semaine 31) et se
poursuit jusqu’à fin octobre
(semaine 44) avec un maximum
des émissions polliniques centré
sur les semaines 35 et 36
(dernière semaine d’août et
première semaine de septembre).
D’une année à l’autre, on peut
toutefois enregistrer une
variabilité importante au niveau
de la date de floraison (cf. dates
du milieu de la pollinisation à Lyon-Bron). Par ailleurs, on enregistre une légère précocité des
dates de floraison que l’on peut attribuer au réchauffement climatique. En effet, au début des
années 80 la date du milieu de la floraison de l’ambroisie se situait autour du 248
ème
jour (5
septembre) à Lyon-Bron, alors quelle se produit aujourd’hui le 243
ème
jour (31 août).
Au niveau de la production pollinique (somme des productions hebdomadaires), on enregistre
globalement une augmentation des émissions que l’on peu attribuer à la diffusion de la plante sur
le territoire français. Toutefois, on enregistre des différences importantes d’une région à
l’autre.
Evolution de la date du milieu de floraison de l’ambroisie à
Lyon-Bron entre 1982 et 2007. Axe des ordonnées : nombre
de jours écoulés depuis le 1
er
janvier de l’année considérée.
(sources AFEDA)
230
235
240
245
250
255
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
Années
Date moyenne (1997-2007) de floraison de l'ambroisie à
Lyon-Bron (sources : AFEDA)
0
5
10
15
20
25
20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
Semaines
% de floraison

Dans la région Lyonnaise, « berceau » de l’ambroisie, les mesures réalisées depuis 1982
traduisent une évolution en 3 temps :
• de 1982 à 1994 les concentrations polliniques d’ambroisie ne cessent d’augmenter (l’année
1983 est caractérisée par des concentrations particulièrement fortes en raison de
l’immense chantier d’EUREXPO). La production pollinique annuelle passe de moins de 300
grains au début des années 1980 à plus de 1400 grains en 1994.
• de 1994 à 2000 les concentrations polliniques d’ambroisie diminuent significativement.
Elles passent de 1432 grains en 1994 à 330 grains en 2000.
• de 2000 à 2007 les concentrations polliniques d’ambroisie sont stables avec une
production annuelle moyenne de l’ordre de 300 grains.
L’évolution des concentrations polliniques depuis les premières mesures réalisées en 1982 peut
s’expliquer de différentes façons :
• l’environnement du capteur de Lyon-Bron a évolué au fil du temps. La proximité de
l’agglomération lyonnaise a favorisé l’urbanisation des communes limitrophes réduisant
ainsi les terrains propices au développement de l’ambroisie. Les ambroisies qui étaient,
dans un premier temps, favorisées par les activités humaines (chantier, routes,...) ont été
progressivement concurrencées par les espaces urbains.
• les campagnes d’arrachage et de lutte (préventive et currative), reconduites chaque
année depuis le milieu des années 90, commencent à produire leur effet sur les
populations qui se maintenaient en milieux urbain et périurbain.
• un effort considérable a été réalisé par le monde agricole qui est sensible à la
problématique de l’ambroisie. Des interventions durant la culture (désherbage chimique
et/ou mécanique) et en interculture permettent de réduire la pression de cette
adventice.
• une diminution de la culture du tournesol dans l’ensemble de la région Rhône-Alpes en
raison de la concurrence de l’ambroisie (perte de rendement jusqu’à 70%).
Les mesures polliniques réalisées sont représentatives de l’ensemble d’une région
topographiquement homogène. Toutefois, dans le cas d’une espèce invasive ou d’une espèce qui a
une distribution hétérogène, comme c’est le cas pour l’ambroisie, des différences peuvent être
observées au sein d’une même région. Ainsi, à Lyon-Saint-Exupery, la production pollinique
d’ambroisie et deux fois plus importante qu’à Lyon-Bron distant d’une vingtaine de kilomètres
Evolution de la production annuelle d’ambroisie à Lyon-Bron et
Lyon-Saint-Exupery entre 1982 et 2007 (sources : AFEDA)
Ambroisie
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003 2006
Années
Prod. pollinique LYB
0
400
800
1200
1600
2000
2400
2800
3200
Prod. pollinique LYS
Lyon-Bron Lyon-St.-Exupery

seulement. Cette différence, que l’on retrouve durant toute la période d’enregistrement
commune (96-07), s’explique par l’environnement des capteurs. A Lyon-Bron, proche banlieue de
Lyon, les quartiers résidentiels et les zones commerciales ne laissent que peu de place à
l’ambroisie. Au contraire, à Lyon-Saint-Exupery, les champs et les friches sont favorables à
l’ambroisie qui colonise les chaumes de blé et les tournesols.
Dans les autres régions françaises on enregistre partout une augmentation significative des
concentrations polliniques d’ambroisie. La comparaison d’enregistrements réalisés à plus de 20
ans d’intervalle dans 4 villes
françaises (Nevers,
Montélimard-Ancône, Lyon-Bron
et Ambérieu-en-bugey) montre
que la production pollinique a
augmenté partout sauf dans la
région lyonnaise. Au nord et au
sud de Lyon les concentrations
ont ainsi été multipliées par 4.6
fois traduisant ainsi un
envahissement majeur de ces
zones. La zone de Montélimar,
particulièrement envahie est
devenue en l’espace de 2
décennies « l’épicentre » de
l’ambroisie en France. Cette situation, en grande partie attribuable au manque de réactivité des
pouvoirs locaux, traduit la capacité d’envahissement de cette espèce.
L’ambroisie, qui gagne aujourd’hui du terrain partout en France deviendra sans nulle doute un
problème de santé publique majeur. Pour freiner sa propagation il est nécessaire d’aborder cette
question globalement et non plus localement comme c’est actuellement le cas.
L'AFEDA
En France, l’histoire de l’ambroisie est écrite en grande partie par
l’Association Française d’Etude des Ambroisies (AFEDA). Créée en 1983,
cette association s’est donnée comme objectif "de développer la connaissance
scientifique des ambroisies, pour limiter leur extension en France et en
Europe. Soulager les malades (voire les animaux) qui souffrent des troubles
provoqués par la pollution atmosphérique qu’elles engendrent,
essentiellement dans la région Rhône-Alpes" (extrait des statuts).
Outre son rôle dans de nombreuses études scientifiques qui ont donné lieu à
une centaine de publications, l’AFEDA a contribué à l’information et
l’éducation des institutions et du public confrontés à une plante presque
inconnue il y a 35 ans. Les études réalisées par l’AFEDA ont ainsi suscité des
mesures au niveau législatif (mise en place de décrets spécifiques aux
niveaux départemental et communal) et au niveau social (mise en place de
chantiers d’arrachage par certaines collectivités). Sur le plan sanitaire,
l'AFEDA édite depuis 1985 des documents destinés à la sensibilisation du
public tels des calendriers polliniques qu’elle diffuse maintenant par le biais
du Minitel, de l’Audiotel, de l’Internet.
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
Années
Production pollinique
Nevers (x 2,5)
Montélimar-Ancône (x4,6)
Lyon-Bron (x 0,8) Ambérieu-en-Bugey (x4,6)
1
/
4
100%