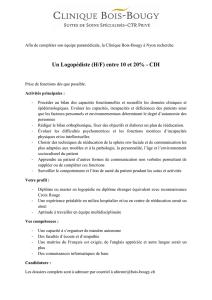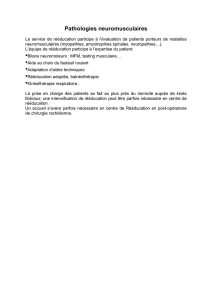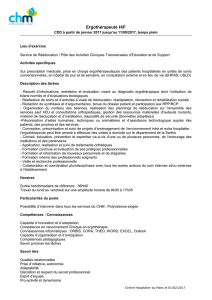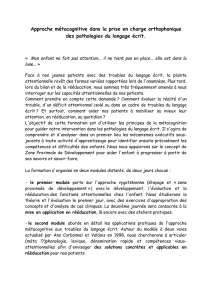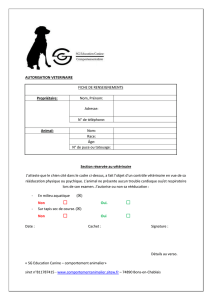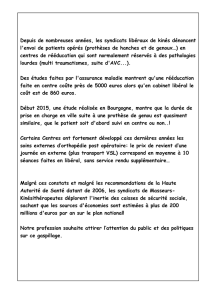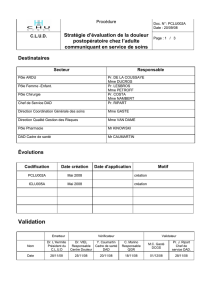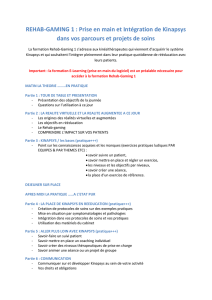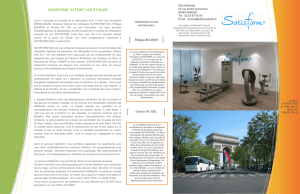Analgésie et rééducation en orthopédie

DOULEUR 297
ANALGESIE ET REEDUCATION EN ORTHOPEDIE
C. Gavillot*, H. Bouaziz**, F. Dap***, S. Boileau**. *Institut Régional de Réadapta-
tion, 34 rue Lionnois, 54000 Nancy, **Département d’Anesthésie Réanimation, CHU,
29 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 54035 Nancy, ***Service de Chirurgie
plastique et reconstructrice de l’appareil locomoteur, CHU, Hôpital Jeanne d’Arc,
54201 Dommartin-les-Toul, France.
INTRODUCTION
L’incidence des douleurs postopératoires sévères en chirurgie orthopédique
concerne par ordre de fréquence le rachis, le pied et la main, la hanche, le genou et
l’épaule [1]. La douleur, de type inflammatoire, est liée à la cicatrisation et dure en
moyenne de 5 à 7 jours, mais la douleur de forte intensité dépasse rarement 72 heures.
Au niveau du membre supérieur, après certains gestes tels que l’arthrolyse du coude
ou la ténolyse des fléchisseurs, une mobilisation précoce est indispensable pour assurer
une récupération fonctionnelle optimale. Du fait de la recrudescence des douleurs lors
de la rééducation, la chirurgie du membre supérieur fait partie des indications de mise
en place d’un cathéter périnerveux pour assurer une analgésie de qualité durant les
premiers jours postopératoires [2].
1. PRINCIPES DE LA REEDUCATION
1.1. ARTHROLYSE DU COUDE
1.1.1. OBJECTIF
L’arthrolyse du coude est une intervention mobilisatrice qui vise à redonner au
coude une mobilité fonctionnelle en supprimant les rétractions capsulo-ligamentaires,
musculaires et aponévrotiques et en réalisant l’ablation d’ostéomes, de corps étrangers
ou de butoirs osseux [3].
1.1.2. PHYSIOLOGIE ARTICULAIRE
Anatomiquement le coude ne représente qu’une seule articulation, mais physiologi-
quement il possède deux fonctions : la flexion-extension qui permet d’éloigner ou de
rapprocher la main du corps et la prono-supination qui oriente la main dans l’espace.
C’est grâce à la flexion du coude que l’homme peut porter les aliments jusqu’à sa
bouche : il saisit un aliment en extension pronation et le porte à la bouche en flexion
supination. La position de référence, définie par la convention internationale,
correspond à l’extension complète (0°) avec une prono-supination neutre. Les amplitu-

MAPAR 2000298
des normales du coude sont de 145° en flexion, 0° en extension, 170° en prono-supination
.
Certains sujets possédant une grande laxité ligamentaire ont une extension de 5 à 10°.
À l’intérieur du secteur de mobilité normale, on distingue un secteur fonctionnel utile
entre 30° et 130° de flexion et un secteur minimum utile entre 80° et 120° de flexion.
1.1.3. ETIOLOGIES DES RAIDEURS DU COUDE
La grande majorité des raideurs du coude est d’origine post-traumatique (fracture
de la palette humérale, luxation du coude, fracture de l’olécrâne …). Les autres étiolo-
gies se partagent entre paraostéoarthropathies neurogènes après coma, exostoses dans
les suites de brûlures et ostéochondromatoses [3, 4].
1.1.4. INDICATIONS
L’arthrolyse est envisagée, après avoir épuisé les ressources d’une rééducation bien
conduite et un délai de 6 mois minimum par rapport au traumatisme initial, sur une
articulation solide et froide, chez un patient motivé et coopérant dont l’enraidissement
provoque un déficit fonctionnel à l’origine d’un handicap dans la vie professionnelle,
les loisirs ou dans les activités de la vie quotidienne [3]. Une rééducation préopératoire
est nécessaire pour améliorer la trophicité tissulaire, refamiliariser le patient avec les
techniques de gain d’amplitudes, améliorer la proprioception d’un membre limité
fonctionnellement et s’assurer de la coopération et de la volonté de récupération du
patient [5, 6].
1.1.5. TECHNIQUE CHIRURGICALE
L’opéré est installé en décubitus dorsal, un garrot à la racine du membre et sous
anesthésie locorégionale par bloc axillaire. Un cathéter peut être laissé en place pour
réaliser un bloc continu permettant de débuter la rééducation de façon indolore [3].
Les voies d’abord latérales et médiales ont la préférence des auteurs [3, 4] utilisées
de façon isolée ou associées entre elles, selon l’origine de la raideur et le geste à
réaliser.
Le geste d’arthrolyse comporte une capsulectomie totale antérieure et postérieure,
l’ablation des obstacles osseux tels que becs ostéophytiques ou corps étrangers libres
intra-articulaires. En cas de souffrance neurologique, le nerf cubital est neurolysé.
1.1.6. REEDUCATION POSTOPERATOIRE
1.1.6.1. Principes
La prise en charge de la rééducation en secteur hospitalier est nécessaire du fait des
multiples difficultés à gérer (douleurs, réaction inflammatoire) impliquant une collabo-
ration étroite entre équipe chirurgicale et équipe de rééducation. Les séances de
kinésithérapie sont pluri-quotidiennes. La rééducation débute le jour même ou après un
délai de 48 heures [6]. Elle vise à obtenir en fin de traitement les amplitudes obtenues
en peropératoire et à améliorer les possibilités fonctionnelles en s’assurant que le
patient utilise les amplitudes acquises [3]. Le coude est une articulation très suscepti-
ble : la douleur entraîne des contractures réflexes préjudiciables à la récupération
optimale des amplitudes. Des antalgiques et des anti-inflammatoires non stéroïdiens
(AINS) sont systématiquement prescrits [5]. L’indométacine, à la dose de 100 mg par
jour, vise à réduire le risque d’ostéome [4]. La mise en place d’un cathéter par voie
interscalènique ou axillaire pour réaliser un bloc sensitif est souvent nécessaire [5].
Certaines équipes réalisent une analgésie par cathéter péridural cervical [4].
1.1.6.2. Techniques
A la sortie du bloc opératoire, une attelle plâtrée immobilise le coude opéré dans la
position extrême du secteur où l’on souhaite un gain d’amplitude, le plus souvent en

DOULEUR 299
extension. Le patient doit être confortablement installé, le membre supérieur en posi-
tion déclive. L’épaule, le poignet et les doigts sont mobilisés pour favoriser la détente
musculaire et la circulation de retour. Après retrait de l’attelle, le kinésithérapeute
débute les mobilisations actives aidées qui permettent un réveil proprioceptif. Elles
sont réalisées de façon très douce, lente en flexion supination et en extension pronation.
Les mouvements de balayage sont proscrits pour éviter les réactions inflammatoires :
le travail des amplitudes extrêmes commence par le secteur où l’articulation était
placée dans l’attelle. Des postures manuelles douces sont réalisées en fin d’amplitude.
Pendant les deux premières semaines postopératoires, la rééducation est marquée par la
douleur et les techniques de physiothérapie à visée anti-inflammatoire et antalgique
sont indispensables : cryothérapie, drainage postural, manœuvres de drainage lympha-
tique, pressothérapie. Les massages sont proscrits car ils favorisent la survenue
d’ostéomes et de fibrose.
Après 48 heures, le patient débute les mobilisations passives sur arthromoteur
[4-6]. L’attelle motorisée permet une mobilisation passive continue, lente et non
douloureuse souvent mieux tolérée que les mobilisations manuelles. Elle complète les
mobilisations effectuées par le kinésithérapeute à raison de deux séances par jour. Le
patient dispose d’une commande pour inverser le sens du mouvement en cas de
douleur. Le réglage des amplitudes en flexion et extension est réalisé selon les
amplitudes maximales obtenues lors de la séance de kinésithérapie préalable. Du fait
de la limitation des réglages, l’attelle permet un mouvement entre 20° et 110° de flexion.
Puis le patient apprend à réaliser des mobilisations auto-passives douces qu’il répétera
pluri-quotidiennement entre les séances de kinésithérapie [5, 6].
Après ablation des redons, vers le 3ème ou 4ème jour postopératoire, l’attelle plâtrée
est remplacée par des orthèses réalisées en matériau thermoformable dans les amplitu-
des extrêmes de flexion et d’extension. Elles sont portées en alternance entre les séances
de rééducation et modifiées en fonction des gains articulaires obtenus. L’orthèse
d’extension est toujours portée la nuit. L’orthèse articulée verrouillable permet d’alter-
ner plus facilement les postures dans les secteurs extrêmes d’extension et de flexion. À
partir du 15ème jour, la rééducation est progressivement intensifiée, en surveillant la
régression des signes inflammatoires locaux. Des exercices actifs plus globaux sont
réalisés en utilisant l’effet de la pesanteur et en variant les positions de travail. Les
techniques de gain d’amplitude du type «contracter-relacher» sont utilisées. Dès
cicatrisation, la balnéothérapie est employée pour ses effets décontracturants et antalgi-
ques, permettant de nombreux exercices sans déclencher de réaction inflammatoire. Le
travail contre-résistance autre que manuelle ou hydraulique est à proscrire pendant les
trois premiers mois. La prise en charge en ergothérapie permet d’utiliser les amplitudes
acquises par le travail analytique.
À partir du 3ème mois, le travail de renforcement musculaire, statique et dynamique,
est réalisé en surveillant attentivement les réactions inflammatoires.
La rééducation se poursuit jusqu’à obtention des amplitudes peropératoires, entre
3 et 6 mois, et tant qu’une progression est notée [6].
1.1.7. RESULTATS
Les complications sont rares : hématomes, sepsis, complications nerveuses essen-
tiellement cubitales et récidive en cas d’ostéoarthropathie neurogène.
Les meilleurs résultats concernent les raideurs par brûlures, puis par atteinte neuro-
gène ; les raideurs post-traumatiques sont de moins bon pronostic, sans doute en raison
de l’atteinte de l’interligne articulaire. Il est possible d’annoncer un gain prédictif moyen
d’environ la moitié de l’amplitude totale manquante en préopératoire [5].

MAPAR 2000300
À 3 mois de l’intervention, on note le plus souvent une aggravation par rapport aux
amplitudes obtenues en peropératoire, mais à long terme les études montrent une
amélioration de la situation [3-5]. Le patient doit donc être extrêmement motivé pour
poursuivre la rééducation au-delà de 3 mois. Globalement, les différents auteurs
obtiennent de 60 à 65 % de bons et très bons résultats [3, 4] et insistent sur le fait que le
résultat final dépend essentiellement de la participation optimale du patient à sa
rééducation.
1.2. TENOLYSE DES FLECHISSEURS
1.2.1. OBJECTIF
La ténolyse a pour but de libérer chirurgicalement les adhérences du tendon fléchis-
seur des tissus avoisinants en respectant, si possible, le système des poulies digitales.
La ténolyse représente une agression chirurgicale importante et en postopératoire de
nouvelles adhérences sont inéluctables. La rééducation précoce indispensable va
permettre la transformation de ces adhérences en mésotendon, afin de redonner au
tendon une fonction la plus proche possible de la normale.
1.2.2. ETIOLOGIES DES ADHERENCES
Les adhérences peuvent survenir dans deux circonstances : après réparation chirur-
gicale des tendons fléchisseurs (suture simple primitive ou secondaire, greffe tendineuse)
ou au décours d’un traumatisme sans lésion tendineuse, écrasement de la main, fractu-
res de métacarpien ou de phalange, phlegmon de la gaine des fléchisseurs ou syndrome
algodystrophique. Après réparation tendineuse, la cicatrisation relève de deux méca-
nismes : extrinsèque et intrinsèque. La cicatrisation extrinsèque est due à une prolifération
de tissu fibroblastique richement vascularisé provenant des tissus conjonctifs voisins.
Ce mode de cicatrisation est facteur d’adhérences quasi inévitables. La cicatrisation
intrinsèque fait appel à la capacité du tendon à cicatriser par ses cellules propres, les
ténoblastes, sans tissu de granulation et sans adhérences. La nature du traumatisme
influe sur la qualité de la cicatrisation tendineuse et il a été démontré que les adhérences
étaient proportionnelles à l’importance du traumatisme tendineux. Ainsi, les plaies
tendineuses franches sont de meilleur pronostic que les lésions par écrasement. Il est
également prouvé que la qualité de la réparation chirurgicale initiale conditionne les
résultats fonctionnels des réparations tendineuses : suture la moins traumatisante et
dévascularisante possible, réparation systématique des deux tendons fléchisseurs
superficiel et profond dans le canal digital, respect et si possible réparation de la gaine
digitale qui a un rôle de surface de glissement et de nutrition par le liquide synovial. Le
suivi postopératoire et la rééducation précoce protégée, passive ou activopassive sans
tension sur la suture, diminuent le risque d’adhérences [7].
1.2.3. INDICATIONS
Une ténolyse est envisagée lorsque la mobilité passive du doigt est supérieure à la
mobilité active ; c’est l’importance de la différence entre les mobilités actives et passives
qui signe la présence d’adhérences péritendineuses. Le geste chirurgical est indiqué
lorsque le déficit d’amplitude active entraîne un retentissement fonctionnel.
Les adhérences, dans le canal digital en zone 2 (classification de l’IFSSH), sont les
plus fréquentes et les plus difficiles à traiter. Par contre, les adhérences en zones 3 à 6
(de la paume de la main à l’avant-bras) sont de bon pronostic, quelle que soit leur
étiologie.

DOULEUR 301
1.2.4. CONDITIONS POUR EFFECTUER UNE TENOLYSE
Il est préférable de réaliser une ténolyse des fléchisseurs chez un patient ayant
récupéré une bonne flexion passive du doigt, sous peine d’un échec de l’intervention.
La rééducation, comportant mobilisations et orthèses dynamiques, doit être poursuivie
jusqu’à l’intervention afin d’entretenir ou de récupérer la mobilité passive. La ténolyse
est réalisée lorsqu’aucun progrès fonctionnel n’est constaté après une période de
4 à 6 semaines de rééducation quotidienne et d’appareillage adapté [7, 8].Toutefois, s’il
persiste une raideur articulaire, un geste d’arthrolyse associée peut être envisagé. Un
délai minimum de 3 mois est nécessaire au décours d’une chirurgie tendineuse primaire
avant d’envisager un geste de ténolyse. Ce délai est de 6 mois après greffe tendineuse
ou après guérison d’un phlegmon des gaines et de 18 mois après le début d’une algo-
dystrophie. L’état trophique cutané, en particulier palmaire, la vascularisation et
l’innervation du doigt sont également pris en compte. La motivation et la coopération
du patient doivent être certaines car il devra parfaitement collaborer après l’interven-
tion pour suivre une rééducation longue et difficile, indispensable au succès de la
ténolyse. Ceci implique un véritable contrat de soin avec le patient qui doit être averti
en préopératoire des contraintes du traitement [8].
1.2.5. TECHNIQUE CHIRURGICALE [8, 9, 10]
L’intervention est réalisée habituellement sous anesthésie locorégionale par bloc
plexique et avec garrot pneumatique. Au niveau digital, la voie d’abord est dorso-
latérale ou palmaire en zigzag de type Bruner [8]. Les tendons fléchisseurs superficiels
et profonds sont libérés et individualisés progressivement en étant le plus atraumatique
possible. La ténolyse entraîne une dévascularisation et donc une fragilisation des
tendons. Le geste est techniquement plus difficile au niveau du canal digital. Il faut
conserver le plus grand nombre de poulies, au minimum A2 et A4 dont le rôle bioméca-
nique est essentiel. Elles peuvent être reconstruites, à l’aide d’un transplant libre de
petit palmaire, avec un montage suffisamment solide pour permettre une mobilisation
immédiate. Si, en fin d’intervention, il persiste un déficit d’extension de l’articulation
interphalangienne proximale (IPP), une arthrolyse avec libération des freins de la
plaque palmaire est réalisée dans le même temps opératoire. Lorsque la ténolyse est
terminée, le libre jeu des tendons fléchisseurs est systématiquement vérifié en deman-
dant au patient une flexion active des doigts (bloc sensitif pur), après la levée du garrot
pneumatique pour supprimer la paralysie due à l’ischémie musculaire [8, 9], ou en
réalisant une traction sur le tendon grâce à une courte incision au quart inférieur de
l’avant-bras. Certains auteurs effectuent ce geste en fin d’intervention pour laisser les
doigts fléchis dans le pansement afin que les premières adhérences, inéluctables, se
forment en flexion [11] Ainsi, à l’ouverture du pansement, 48 à 72 heures plus tard, les
adhérences pourront facilement céder en demandant au patient de réaliser une
extension active des doigts. Si, elle est incomplète, une extension passive douce sera
réalisée par le chirurgien. Les mêmes auteurs mettent en place, en fin d’intervention, un
ou deux cathéters à proximité des troncs nerveux intéressant le ou les doigts ténolysés.
Une injection d’anesthésique local de longue durée est réalisée en fin d’intervention
pour améliorer le confort postopératoire, puis une deuxième injection au moment de
l’ouverture du pansement et de la première séance de kinésithérapie. Le cathéter peut le
plus souvent être retiré après cette deuxième injection [11].
1.2.6. REEDUCATION POSTOPERATOIRE
Afin de limiter la constitution de nouvelles adhérences, la rééducation doit débuter
le jour même ou le lendemain de l’intervention.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
1
/
13
100%