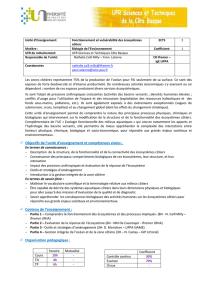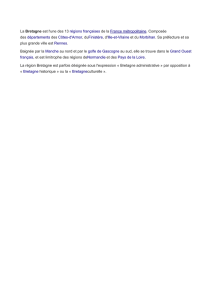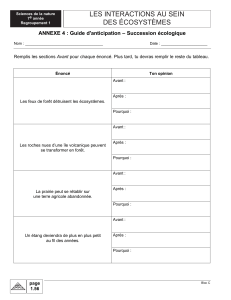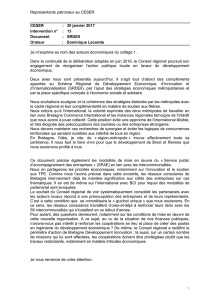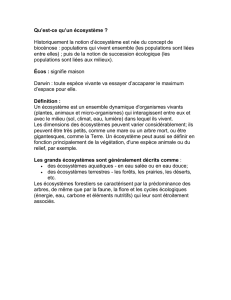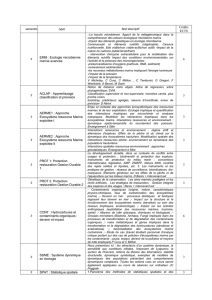Milieux côtiers, ressources marines et société 1. Des écosystèmes

CESER de Bretagne – Décembre 2011 I
Milieux côtiers, ressources marines et société
Synthèse
Rapporteurs : MM. Jean-Paul GUYOMARC’H et François LE FOLL
« Qui, qui, qui sont les haploops ? », « Vous avez dit haploops ? », « Les haploops
font un tube en Bretagne », « Ils sont 400 milliards à Concarneau »… voici quelques
titres d’articles parus dans la presse à l’occasion de campagnes menées par l’Ifremer
en 2010 et 2011 pour mieux connaître ces « crustacés mystérieux » qui vivent en
colonies de milliers d’individus au mètre carré et sont localisés uniquement en baie
de Concarneau et en baie de Vilaine. Des études préliminaires montrent que ces
peuplements méconnus présentent des fonctions écologiques sans doute uniques, en
pleine phase d’exploration scientifique. Il semblerait ainsi que des espèces d’intérêt
commercial y trouvent un habitat préférentiel : roussette, tacaud, griset, étrille,
coquille Saint-Jacques, baudroie et Saint-Pierre… Les peuplements à haploops
joueraient-ils un rôle majeur dans le fonctionnement des écosystèmes côtiers
bretons, et dans le renouvellement des ressources halieutiques exploitées ?
Cet exemple illustre à la fois la richesse et la diversité des écosystèmes côtiers
bretons, mais aussi la connaissance encore partielle que nous en avons à ce jour.
Pourtant, dans la première région maritime de France, bien des activités humaines
dépendent des ressources offertes par la mer et le littoral. Il importe donc de
mieux connaître cette richesse que constituent pour la Bretagne ses
écosystèmes côtiers, mais aussi d’identifier les pressions qu’ils subissent
pour mieux les préserver, les valoriser et soutenir dans le temps les
fonctions qu’ils assurent et les activités qu’ils permettent.
1. Des écosystèmes côtiers riches et variés, d’intérêt
écologique et économique
La Bretagne est caractérisée par une très grande diversité d’écosystèmes côtiers, liée
à ses 2730 km de côtes découpées, son exposition aux courants océaniques, la
grande amplitude de ses marées et la très grande diversité des fonds sous-marins.
Entre Golfe de Gascogne et Manche, la Bretagne est en outre traversée par les
limites naturelles des aires de répartition d’espèces plutôt méridionales ou plutôt
septentrionales, ce qui en fait une zone de transition biogéographique remarquable.
Conseil économique, social
et environnemental

Synthèse
CESER de Bretagne – Décembre 2011
II
Grande Vasière du Golfe de Gascogne, ceintures d’algues, forêts de laminaires, bancs
de maërl, herbiers de zostères, peuplements à haploops sont quelques-uns
seulement des habitats remarquables de Bretagne, jouant un rôle particulier dans le
fonctionnement des écosystèmes côtiers : production primaire importante,
architectures complexes induisant une forte diversité de la faune et de la flore
associées, zones de reproduction, de nourricerie ou de refuge pour de nombreuses
espèces… Ils présentent ainsi des intérêts écologiques et économiques car ils
abritent, pour la plupart d’entre eux, des espèces d’intérêt commercial et constituent
un réservoir de gènes et de molécules potentiellement exploitables…
2. Milieux côtiers, ressources marines et société :
une approche par les services écosystémiques
Ces quelques exemples montrent le lien étroit qui existe entre milieux côtiers et
ressources marines. La pérennité des ressources offertes par la mer et le littoral
nécessite que les écosystèmes soient maintenus en bon état et qu’ils soient en
mesure de remplir des fonctions écologiques nombreuses et diversifiées. Or, les
atteintes au fonctionnement des écosystèmes, elles-mêmes conséquence d’une
certaine évolution de la société (changements économiques, démographiques,
sociopolitiques, scientifiques, technologiques, culturels, etc.), peuvent compromettre
la capacité des écosystèmes à remplir ces fonctions et donc à fournir ces ressources
de façon durable.
Ce postulat du lien entre le bon fonctionnement des écosystèmes, la durabilité des
ressources qu’ils fournissent et par conséquent des activités humaines qui en
dépendent, est à la base de l’évaluation des écosystèmes pour le millénaire
(Millennium Ecosystem Assessment), réflexion menée au niveau international en
2005 qui a marqué une étape importante dans la prise en compte des liens entre le
fonctionnement des écosystèmes et la société. Cette évaluation a proposé d’appeler
« services » les fonctions remplies par les écosystèmes dont la société retire un
bénéfice.
Parler de services rendus par les écosystèmes, et plus encore chercher à leur donner
une valeur, sont deux approches controversées ; elles opposent une vision
anthropocentrée de l’environnement à une vision dans laquelle les écosystèmes ont
une valeur intrinsèque qui impose de les conserver en tant que tels. Pour certains
auteurs, ces approches sont approximatives, orientées, voire même risquées,
puisqu’elles pourraient conduire à adopter des conclusions ou des modes de gestion
favorables aux services rendus à la société mais défavorables au fonctionnement des
écosystèmes. Elles s’appuient en outre sur des critères d’appréciation qui sont ceux
d’aujourd’hui et qui peuvent tout à fait être modifiés demain.
Il est ainsi important de bien distinguer :
- l’approche conceptuelle, qui considère la nature non pas comme un bien à
mettre en réserve, mais un support aux activités humaines et à la vie ;
- l’évaluation économique des services rendus par les écosystèmes
(quantification et monétarisation), sujette à discussion tant l’exercice est
difficile et nos connaissances ou méthodes limitées pour y parvenir ;
- l’usage qui peut en être fait dans la prise de décision.

Synthèse
CESER de Bretagne – Décembre 2011 III
Sans aller jusqu’à la monétarisation, la notion de services écosystémiques est un
outil utile à l’étude des interactions entre milieux côtiers, ressources marines et
société. Son application en Bretagne permet de bien comprendre l’enjeu d’une
préservation du bon fonctionnement des écosystèmes côtiers comme gage de
ressources et donc d’activités durables.
3. Les écosystèmes côtiers bretons, fournisseurs de
ressources et de services
Les écosystèmes côtiers et marins de Bretagne assurent des fonctions écologiques
nombreuses et variées : production primaire, chaînes alimentaires, support à la
biodiversité, cycles géochimiques, échanges gazeux, recyclage, épuration de l’eau,
transport de sédiments, etc. Ces fonctions écologiques sont elles-mêmes à la base de
ressources et de services nombreux fournis à la société, que l’évaluation des
écosystèmes pour le millénaire a classés en quatre catégories : les services
d’approvisionnement, les services culturels, les services de régulation et les services
supports.
3.1. Les services d’approvisionnement : l’exploitation des
ressources marines
Les services d’approvisionnement recouvrent toutes les ressources extraites du
milieu naturel à des fins telles que l’alimentation humaine, l’industrie, l’agriculture, la
santé, la cosmétique, ou encore la production d’énergie. Il s’agit des ressources
vivantes, minérales, énergétiques, et des ressources « invisibles ».
3.1.1. L’exploitation des ressources vivantes
Il s’agit de l’exploitation des ressources animales ou végétales, sauvages ou
cultivées, telles que poissons, crustacés, mollusques et algues par la pêche et
l’aquaculture.
La pêche maritime bretonne est caractérisée par une production importante, une
grande diversité des pêcheries et des métiers pratiqués. Malgré le développement
important de la pêche au large après la seconde guerre mondiale, la zone côtière
bretonne reste fréquentée par un nombre important de navires de pêche et de
pêcheurs à pied et les captures y sont significatives. Après les algues, la sardine
domine les captures et devance la coquille Saint-Jacques, le bulot, l’araignée et la
baudroie. En termes de valeur, la baudroie, la langoustine et la coquille Saint-
Jacques sont les espèces emblématiques de la pêche bretonne. Ce sont plus de 40
espèces qui sont pêchées dans la bande côtière, par environ 1200 navires sur les
1400 immatriculés en Bretagne, 3 000 marins pêcheurs sur 5 000, 500 pêcheurs à
pied, pour un total d’un peu plus de 100 000 tonnes prélevées en 2008. Ces chiffres
démontrent le degré de dépendance de la pêche vis-à-vis de la zone côtière.
La récolte des algues constitue le premier apport, en quantité, des produits de la
pêche dans la bande côtière bretonne. C’est une spécificité en France, liée à la

Synthèse
CESER de Bretagne – Décembre 2011
IV
présence en Bretagne de forêts de laminaires et de ceintures d’algues uniques. La
quasi-totalité des algues produites en France vient de Bretagne.
La conchyliculture concerne essentiellement les huîtres creuses et les moules, pour
lesquelles la Bretagne concentre un tiers de la production française, ainsi que les
huîtres plates, en totalité produites en Bretagne. Avec 70 000 tonnes de coquillages
produites chaque année, la production conchylicole de Bretagne générait, jusqu’en
2008, 2 500 emplois équivalents temps plein. La surmortalité qui frappe les élevages
ostréicoles a conduit à des pertes de cheptel avoisinant les 50 %, et jusqu’à 70 %
dans certaines zones (baie de Quiberon), avec de lourdes conséquences sur l’emploi
et les entreprises.
Les conditions naturelles permettent également la culture d’algues. Même s’il n’y
pas ou peu de marché interne pour les algues alimentaires en Bretagne, la région
peut saisir l’opportunité de l’export dans un contexte fortement marqué par les
évènements qui ont frappé le Japon en mars 2011, non seulement en matière de
diversification des activités traditionnelles conchylicoles, mais aussi par le
développement d’une aquaculture nouvelle.
3.1.2. L’exploitation des ressources minérales
Les matériaux extraits du milieu marin sont de deux types : les matériaux siliceux
et les matériaux calcaires. Il existait en Bretagne quatre sites de production de
matériaux siliceux, dont les apports ont considérablement diminué ces dix dernières
années (60 000 tonnes en 2001, 3 000 tonnes en 2007). La spécificité de la
Bretagne vient de la présence de gisements de matériaux calcaires, dont sont
extraits tous les tonnages produits en métropole (501 600 tonnes en 2008). Face à
l’arrêt programmé de l’exploitation du maërl, de nouvelles concessions ont été
octroyées pour l’extraction de sables coquilliers.
L’eau de mer est également exploitée en tant que telle, pour ses vertus
thérapeutiques, dans les établissements de soin, de rééducation, ainsi que dans les
10 établissements de thalassothérapie de la région, qui ont accueilli 66 000 curistes
en 2009.
3.1.3. L’exploitation des ressources énergétiques
A la croisée de grands systèmes océaniques, la Bretagne dispose de ressources
énergétiques exceptionnelles : vents soutenus, houle puissante et courants de
marée importants. Pionnière par la mise en service en 1966 de l’usine marémotrice
de la Rance (240 MW), la Bretagne a accueilli à Bréhat à l’automne 2011 la première
hydrolienne en France, et devrait voir se développer dans les années à venir des
parcs éoliens offshore (500 MW en baie de Saint-Brieuc dans le cadre du premier
appel d’offres), susceptibles de créer une filière industrielle créatrice de richesses et
d’emplois.

Synthèse
CESER de Bretagne – Décembre 2011 V
3.1.4. L’exploitation des ressources « invisibles »
Le milieu marin représente un immense réservoir, peu exploré, de gènes et de
molécules utiles dans le domaine de la recherche fondamentale et susceptibles
d’être à l’origine de nouveaux produits ou procédés dans le domaine de la santé, de
la cosmétique, de l’alimentation ou de l’agriculture. Grâce à la diversité de ses
écosystèmes marins et côtiers, et grâce aux compétences qu’elle réunit en sciences
de la mer, la Bretagne dispose d’atouts pour le développement des biotechnologies
marines. 65 entreprises, équipes de recherche ou centres d’innovation
technologique travaillent dans ce domaine en Bretagne et développent des produits à
haute valeur ajoutée.
3.2. Les services culturels : la mer, source d’aménités
Les services culturels recouvrent l’ensemble des aménités offertes par la mer et le
littoral en termes de bien-être, de loisirs, de tourisme, d’éducation, de recherche et
de formation.
3.2.1. Les paysages et patrimoines côtiers, source d’attractivité
La qualité et la diversité des paysages côtiers (plages, falaises, côtes rocheuses, îles,
golfes, rias) et des paysages sous-marins fondent l’identité maritime de la Bretagne.
S’y ajoute un patrimoine naturel très riche, pour la flore comme pour la faune, ainsi
qu’un patrimoine culturel façonné par les activités humaines au cours du temps
(phares, ports, fortifications, vieux gréements, métiers de tradition). Ces nombreux
atouts sont l’une des raisons qui font de la Bretagne la quatrième région touristique
de France, avec 97 millions de nuitées en 2009, dont 86 % sur le littoral, générant
50 000 emplois salariés. Les sports nautiques représentent 42 % des sports nature
pratiqués en Bretagne, avec notamment la voile, la plongée sous-marine et le canoë-
kayak. 630 sites pour la pratique du nautisme, répartis sur le littoral, ont accueilli
près de 850 000 clients en 2011, générant 2 000 emplois équivalents temps plein.
3.2.2. Les milieux côtiers, supports à l’éducation, à la recherche et à
la formation
Créée en 1859, la station de biologie marine de Concarneau est la plus ancienne du
monde. Avec celles de Roscoff et de Dinard, outre la recherche scientifique, elle a
initié la vulgarisation des connaissances sur le milieu marin, reprise ensuite par de
nombreux sites de découverte, musées, aquariums, centres de culture scientifique,
technique et industrielle, s’adressant aux particuliers comme aux scolaires.
La richesse et la diversité des écosystèmes marins et des activités maritimes ont par
ailleurs permis que se structure en Bretagne le premier pôle de recherche et de
formation européen en sciences de la mer, autour de l’Ifremer, de la station
biologique de Roscoff et de l’Institut universitaire européen de la mer (IUEM)
notamment, mais s’appuyant aussi sur un certain nombre d’autres universités,
grandes écoles et lycées maritimes.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
1
/
14
100%