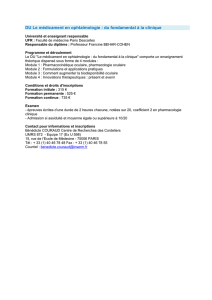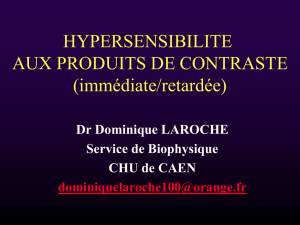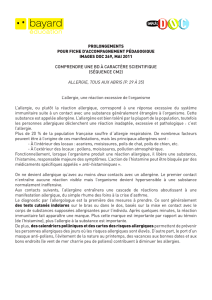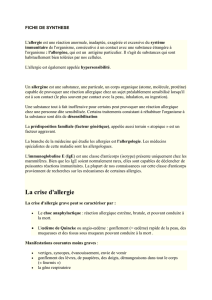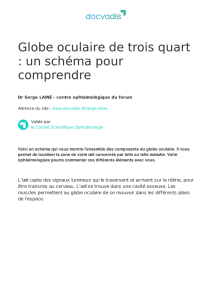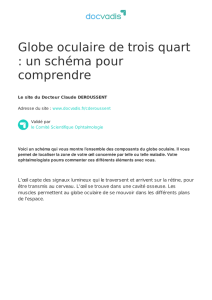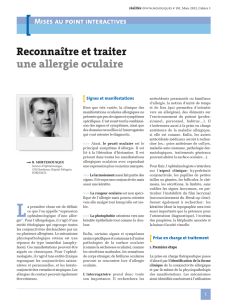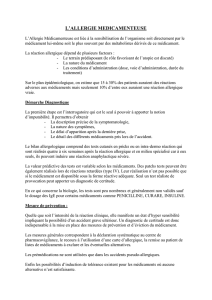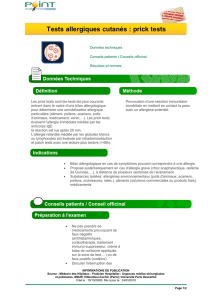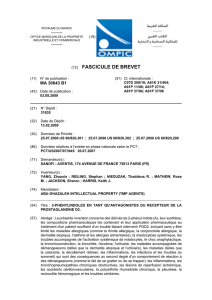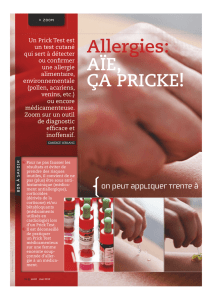Les maladies oculaires d`origine allergique

Ophtalmologie
Conférences scientifiques
M A I / J U I N 2 0 0 5
Volume 3, numéro 3
COMPTE RENDU DES CONFÉRENCES
SCIENTIFIQUES DU DÉPA R T E M E N T
D ’ O P H TA L M O L O G I E ET
DES SCIENCES DE LA VISION,
FA C U LT É D E MÉDECINE,
U N I V E R S I T É D E T O R O N T O
Département d’ophtalmologie
et des sciences de la vision
Faculté de médecine
Université de Toronto
60 Murray St.
Bureau 1-003
Toronto (Ontario) M5G 1X5
Le contenu rédactionnel d’Ophtalmologie –
Conférences scientifiq u e s est déterminé
exclusivement par le Département
d’ophtalmologie et des sciences de la vision,
Faculté de médicine, Université de To r o n t o .
Département d’ophtalmologie
et des sciences de la vision
Jeffrey Jay Hurwitz, M.D., Rédacteur
Professeur et président
Martin Steinbach, Ph.D.
Directeur de la recherche
The Hospital for Sick Children
Elise Heon, M.D.
Ophtalmologiste en chef
Mount Sinai Hospital
Jeffrey J. Hurwitz, M.D.
Ophtalmologiste en chef
Princess Margaret Hospital
(Clinique des tumeurs oculaires)
E. Rand Simpson, M.D.
Directeur, Service d’oncologie oculaire
St. Michael’s Hospital
Alan Berger, M.D.
Ophtalmologiste en chef
Sunnybrook and Women’s College
Health Sciences Centre
William S. Dixon, M.D.
Ophtalmologiste en chef
The Toronto Hospital
(Toronto Western Division and
Toronto General Division)
Robert G. Devenyi, M.D.
Ophtalmologiste en chef
Les maladies oculaires d’origine allergique
PAR AL L A NR. SLO M O V I C , MA, M.D., FR C S, MI C H A E L HYA M S, M.D., RU T H LA PI D , M.D.
Les maladies oculaires d’o r i g ine allergique sont un problème fréquent et potentiellement
grave pour l’ophtalmologiste. Le spectre de ces maladies s’étend de l’allergie oculaire mineure
à des pathologies gr a ves et chroniques menaçant la vision ayant un impact important sur la
qualité de vie. Les maladies oculaires d’origine allergique touchent environ 20 % de la popula-
tion. Au Canada, environ 6 millions de personnes souffrent de ces affections et en Ontario, le
taux est de 55 %. D’un point de vue économique, on estime qu’en Amérique du Nord, le coût
de l’a l l e r g ie oculaire est de 250 millions de dollars par année en raison de la productivité
perdue au travail. Par conséquent, il est important que l’o p h t a l m o l o g iste ait une bonne
connaissance de ces maladies. Ce numéro d’Ophtalmologie – Conférences scientifiq u e s m e t
l’accent sur le diagnostic et le traitement de ces pathologies fréquentes.
Quatre facteurs essentiels doivent être pris en compte dans les examens effectués chez le
patient qui souffre d’allergie oculaire présumée.
•Les facteurs environnementaux (ex. les pollens) peuvent causer une conjonctivite allergique
saisonnière aiguë et les conditions climatiques jouent un rôle important dans la kératoconjonc-
tivite vernale.
•Les facteurs génétiques. Chez un enfant, le risque de développer une allergie oculaire est 4
fois plus élevé si un parent est atopique. Si les deux parents sont affectés, le risque est 10 fois plus
élevé.
•Les médicaments peuvent agir comme des allergènes ou des modulateurs immuns. Par exem-
ple, certains médicaments (ex. les antihistaminiques oraux) peuvent assécher les muqueuses
oculaires, aggravant les effets des allergènes externes sur l’œil. D’autres médicaments (ex. les
stabilisateurs des mastocytes topiques) à des concentrations élevées stimulent les mastocytes,
exacerbant les effets de l’allergie oculaire.
•Les facteurs mécaniques, comme le frottement des yeux et le port de lentilles cornéennes,
peuvent également exacerber les symptômes d’allergie. Les lentilles cornéennes contribuent à
l’apparition d’une forme d’allergie oculaire : la conjonctivite papillaire géante.
Diagnostic et diagnostic différentiel
La conjonctive est fréquemment impliquée dans les réactions allergiques, car cette fine mem-
brane muqueuse est directement exposée aux allergènes environnementaux. Étant donné que la
majorité des maladies oculaires d’origine allergique touchent la conjonctive, le regroupement des
maladies oculaires d’origine allergique sous une seule dénomination « la conjonctivite allergique »
est devenue une pratique courante. Cependant, sur la base de notre compréhension actuelle de la
p a t h o p hysiologie et de l’évolution clinique de cette affection, une classification plus précise a été
proposée dans laquelle on a inclu 4 sous-types distincts d’allergie oculaire. Le spectre de gravité
s’étend des affections causant une gêne et une irritation, mais ne menaçant pas la vision (ex. la
conjonctivite allergique saisonnière et la conjonctivite papillaire géante) à des pathologies pouvant
causer une ulcération cornéenne avec la formation de cicatrices et entraînant potentiellement la
cécité (telles que la kératoconjonctivite vernale et atopique).
Les démangeaisons sont le symptôme le plus fréquent chez les patients présentant une
conjonctivite allergique. Le chémosis et l’injection conjonctivale sont des signes fréquemment
associés, bien que dans la plupart des cas, ils soient discrets. Une exception peut se produire dans
le cas de réactions allergiques aiguës, en particulier lorsqu’elles sont associées à un frottement des
yeux vigoureux, où le chémosis peut être sévère. L’oedème palpébral est un autre signe d’affection
oculaire d’origine allergique. Le diagnostic différentiel de l’allergie oculaire comprend d’a u t r e s
affections de la surface oculaire (ex. la kératite sèche et la blépharite).
Sous-types distincts d’allergie oculaire
Conjonctivite allergique
La conjonctivite allergique saisonnière (CAS) est la forme la plus fréquente d’affection oculaire
d ’origine allergique, touchant 5 à 22 % de la population. Elle est étroitement associée aux cycles
d ’allergènes aéroportés provenant des plantes. Fort heureusement, c’est une affection spontané-
ment résolutive due à une hypersensibilité de type 1. On l’appelle souvent « c o n j o n c t i v i t e
allergique aiguë » et elle représente environ 50 % de toutes les allergies oculaires. Elle est
généralement accompagnée de rhinite allergique saisonnière. C’est la forme oculaire du rhume des
MC
Département
d’ophtalmologie et des
sciences de la vision
Disponible sur Internet à : w w w. o p h t a l m o l o g i e c o n f e r e n c e s . c a

foins et elle est souvent la principale manifestation chez les
patients souffrant du rhume des foins. Comme son nom
l’indique, sa prévalence est saisonnière, en raison de l’expo-
sition aux graminées, au pollen d’arbres ou à l’herbe à poux.
En Ontario, les facteurs responsables sont les pollens
d ’arbres et de fleurs au début du printemps, les pollens de
plantes herbacées vers la fin du printemps et au début de
l’été et l’herbe à poux vers la fin de l’été et au début de
l ’automne. Durant les mois de juillet et d’août, la présence
de graminées et d’herbe à poux coïncide et c’est la période
la plus difficile pour les patients affectés.
Le symptôme prédominant de la CAS est une légère
démangeaison oculaire et périoculaire bilatérale, mais
d ’autres symptômes (ex. rougeur, sensation de brûlure, lar-
moiements excessifs et présence de sécrétions muqueuses
blanches croûteuses) peuvent être présents. Les symptômes
sont bilatéraux, bien qu’ils puissent être asymétriques.
Occasionnellement, le patient peut se plaindre de photo-
phobie et un grand nombre de patients ont des antécédents
d ’autres troubles allergiques, d’allergies alimentaires ou de
sensibilité aux animaux de compagnie. Lors de l’e x a m e n
ophtalmologique, les signes peuvent être absents ou consis-
ter en une légère injection conjonctivale. Il peut y avoir une
légère réaction papillaire impliquant la conjonctive tar-
sienne. Un léger chémosis peut être présent au niveau de la
conjonctive bulbaire.
La conjonctive allergique perannuelle (CAP) est égale-
ment appelée conjonctive allergique chronique, car elle
persiste toute l’année. Comme la forme aiguë, c’est une
réaction d’hypersensibilité de type 1 qui consiste en une
réaction d’hypersensibilité de phase précoce et de phase
tardive. Sa prévalence documentée est de 0,03 %, et 87 %
des patients présentent des exacerbations saisonnières. Elle
est due le plus souvent à une exposition à des allergènes
de maison toujours présents (ex. les squames d’animaux, les
déjections d’acariens, les moisissures et les pollens). Des
exacerbations peuvent survenir au printemps ou en
automne en raison de l’exposition accrue aux acariens et
aux allergènes fongiques durant ces périodes de l’a n n é e .
Les signes et les symptômes cliniques associés à la CAP
sont similaires à ceux de la CAS, bien qu’ils soient souvent
plus légers et plus persistants. Dans la plupart des cas, ils
sont bilatéraux, mais ils peuvent se manifester unilatérale-
ment si un antigène, tels que les squames d’a n i m a u x ,
atteint un œil par contact avec la main.
Kératoconjonctivite vernale (KCV
)
La KCV est une affection oculaire inflammatoire
bilatérale récidivante et habituellement spontanément réso-
lutive. C’est une affection menaçant potentiellement la vision
qui se manifeste le plus souvent entre 3 et 20 ans et dont
la prévalence est plus élevée chez les garçons. Les exacerba-
tions saisonnières sont caractéristiques, d’où le terme de
«v e r n a l » (printemps). Invariablement, les enfants qui en
sont atteints ont des antécédents familiaux de rhume des
foins, d’allergie, d’atopie ou d’asthme. La KCV disparaît sou-
vent après la puberté. Elle est particulièrement fréquente
dans les climats chauds et secs (au bord de la Méditerranée,
en Afrique occidentale, au Pakistan et en Inde).
Les symptômes comprennent les démangeaisons
intenses, la photophobie et la vision brouillée. Les patients
ont tendance à se frotter très fréquemment les yeux et ont
des sécrétions oculaires croûteuses ou visqueuses. Ils peu-
vent manifester un pseudo-ptosis et lorsque l’on retourne la
paupière, on observe l’aspect pavimenteux classique de la
conjonctive tarsienne supérieure et des sécrétions croû-
teuses abondantes (figure 1). Au bord du limbe, des points
de Horner-Trantas, qui sont un regroupement de cellules
épithéliales dégénérées, et des éosinophiles peuvent être
présents. La conjonctive tarsienne enflammée peut causer
une kératite ponctuée superficielle. La coalescence de ces
deux anomalies peut entraîner la formation d’un petit
ulcère (figure 2), qui est habituellement ovale et horizontal
sur le tiers supérieur de la cornée sous-p a l p é b r a l e
supérieure (figure 2). L’ulcère est directement en contact
avec les papilles pavimenteuses. La base de l’ulcère contient
une plaque de fibrine, de mucus et de débris provenant des
granules éosinophiles qui agissent comme des toxines et
inhibent la réépithélialisation. La guérison est favorisée par
l ’ablation de la plaque. L’inflammation concomitante
favorise la néovascularisation à partir du limbe. Lorsque ces
lésions guérissent, une cicatrice subépithéliale en fo r m e
d ’anneau peut subsister dans la région lésée. L’a s s o c i a t i o n
de la kératite épithéliale ponctuée et de sécrétions
muqueuses accrues peut entraîner une kératite fila-
menteuse. La peau des paupières et le bord des paupières
sont relativement indemnes, comparativement à la conjonc-
tivite atopique. Le frottement des yeux est un problème
important qui peut expliquer l’incidence accrue de kérato-
cône chez ces patients.
Kératoconjonctivite atopique (KCA)
La KCA est une affection chronique qui touche environ
3 % de la population. On pense que les mécanismes de l’hy-
persensibilité de type I et de type IV interviennent dans
cette affection. Cette maladie potentiellement grave et
menaçant la vision peut se manifester à tout âge, mais son
incidence est la plus élevée chez les sujets vers la fin de
l’adolescence ou au début de la vingtaine ayant des antécé-
dents familiaux de rhume des foins, d’allergie, d’atopie ou
d ’asthme. On n’a rapporté aucune prédilection raciale ou
géographique. Cette maladie n’est pas caractérisée par une
variabilité saisonnière qui est fréquente avec d’autres mal-
adies allergiques. Cependant, des exacerbations ont été
notées en hiver, possiblement en raison de la séch e r e s s e
associée au chauffage de la maison. Les manife s t a t i o n s
cutanées concomitantes sont typiques. Les patients signa-
lent souvent des antécédents d’eczéma. Une dermatite est
habituellement manifeste dans la région périoculaire (fig-
ure 3). Les yeux sont affectés chez environ 25 à 50 % des
patients atteints de dermatite atopique.
Les principaux symptômes oculaires sont les
démangeaisons, la sensation de brûlure et la photophobie.
F i g u r e 1 : A p p a ren ce pavimenteuse de la
conjonctive tarsienne supérieure dans la KCV.
Notez l’écoulement entre le pavage
Figure 2 : U l c è re chez un patient atteint de KCV

mentation du rapport CD 4 / C D8. L’histamine est stock é e
dans les granules situées dans les mastocytes et est facile-
ment libérée. Chaque mastocyte contient environ 5 à 10
picogrammes d’histamine. Il existe deux sous-types de
récepteurs de l’histamine H1et H2. L’histamine qui se lie à
ces récepteurs produit la sensation de démangeaisons
entraînant l’activation du récepteur H1et la vasodilatation
provoquée par le récepteur H2.
La phase initiale de la réaction allergique dure env i r o n
20 minutes après l’activation de l’allergène. Les mastocytes
interviennent dans cette phase. Lorsqu’ils sont activés, ils
libèrent de l’histamine et d’autres médiateurs proinflamma-
toires (ex. la prostaglandine D2, le leukotriène C4, la facteur
d’activation des plaquettes et la triptase). L’histamine, la pro-
téase tryptase, les leucotriènes et les éosinophiles peuvent
être détectés dans les larmes. La phase tardive, lorsque les
basophiles interviennent, survient 2 à 9 heures après
l ’activation et l’histamine, mais non la tryptase ou les
éosinophiles, est détectée dans les larmes1. Les signes clini-
ques indiquent que la réaction allergique dure plus
longtemps en raison d’un influx et de l’infiltration de la
conjonctive par des cellules inflammatoires, telles que les
éosinophiles, les neutrophiles et les cellules Th2. La pro-
téine basique majeure de l’éosinophile est cytotoxique pour
l’épithélium cornéen et est impliquée dans les formes plus
graves et chroniques de maladie oculaire allergique (ex. la
KCV et la KCA).
Traitement
Le traitement de l’allergie oculaire peut prêter à confu-
sion, car il existe de nombreuses modalités différentes de
traitement. La revue de Bielory sur le traitement de l’allergie
oculaire énumère 28 options thérapeutiques différentes2.
En règle générale, le traitement est fondé sur la gravité des
symptômes et sur la mesure dans laquelle ils nuisent à la
qualité de vie du patient. Une approche thérapeutique
raisonnable consiste à administrer des soins par paliers, en
modifiant certains facteurs environnementaux et en évitant
les allergènes connus ou soupçonnés comme première
mesure, puis en évoluant progressivement vers une phar-
macothérapie. Pour les symptômes légers, les larmes artifi-
cielles sont parfois l’unique mesure nécessaire, et cela
correspond au premier palier du traitement. La majorité des
patients peuvent être traités avec les nouvelles gouttes
ophtalmiques anti-histaminiques/stabilisatrices des masto-
c y t e s / a n t i - inflammatoires, qui constituent le deuxième
p a l i e r. Les corticostéroïdes, topiques ou systémiques, et
d’autres médicaments immunomodulateurs, représentent le
troisième palier.
Mesures générales de soutien
On recommande d’éviter les allergènes déclenchants en
restant à l’intérieur lorsque la numération du pollen est
élevée, en gardant les fenêtres fermées si possible, en se
lavant les cheveux et en lavant ses vêtements après avoir été
dehors, et en évitant d’utiliser les savonnettes, les cosmé-
tiques et les détergents. D’autres mesures utiles consistent à
utiliser un climatiseur, un filtre électronique et un couvre-
matelas en plastique, à enlever les tapis et à éviter les ani-
maux de compagnie. Il faut éviter de se frotter les yeux, car
l’irritation mécanique entraîne la libération de médiateurs
i n flammatoires, ce qui perpétue le cycle de démangeaisons-
f r o t t e m e n t - démangeaisons. Les larmes artificielles, utilisées 4
à 8 fois par jour, améliorent la fonction de barrière du fil m
lacrymal, diluent les allergènes et les médiateurs et aident à
les éliminer des yeux. Elles atténuent également l’e f fe t
d ’a s s è chement des antihistaminiques systémiques. On
recommande d’utiliser des succédanés des larmes sans con-
servateur et leur réfrigération augmente le confort qu’ils pro-
curent. L’application de compresses froides ou d’une vessie de
glace plusieurs fois par jour peut fournir un soulagement
considérable, en particulier contre les démangeaisons.
L’atteinte eczémateuse de la paupière accompagnée de
desquamation et de rougeur peut être un signe caractéris-
tique. D’autres signes comprennent la kératite épithéliale
ponctuée, des anomalies épithéliales persistantes, la
présence de cicatrices sur la cornée et la néovascularisation.
Ces patients sont sujets à d’autres affections ophtalmo-
logiques telles que le kératocône, la cataracte sous-c a p s u -
laire antérieure et postérieure, le glaucome secondaire, les
s u r i n fections bactériennes ou herpétiques, le décollement
de rétine et très rarement, la dislocation du cristallin
secondaire au frottement des yeux.
La conjonctivite papillaire géante (CPG)
La CPG est une affection réversible, le plus souvent
associée au port de lentilles cornéennes (LC), aux sutures
exposées, au plissement scléral ou à une prothèse. C’est une
réponse à un traumatisme mécanique et non pas seulement
à des mécanismes allergiques. Cependant, elle est encore
classifiée comme l’une des formes d’allergie oculaire. La
p a t h o p hysiologie est une réaction d’hypersensibilité à la
fois de type 1 et de type IV. On estime qu’e nviron 20 mil-
lions de personnes utilisent des lentilles cornéennes (LC). La
CPG survient chez 10 à 15 % des porteurs de LC molles et
chez 1 à 5 % des porteurs de LC dures. Avec les LC molles,
la CPG apparaît généralement en quelques mois, alors
q u ’avec les LC dures, elle peut apparaître après quelques
années. Le diagnostic clinique est établi sur la base du port
antérieur de LC avec une intolérance croissante aux
lentilles. Le patient a des antécédents de démangeaisons
(davantage lorsqu’il a retiré ses lentilles), de vision brouil-
lée, de sécrétions muqueuses avec une adhérence des
paupières la nuit. Le signe diagnostique est la présence
de papilles géantes (>0,3 mm de diamètre) sur le tarse
palpébral supérieur.
Pathophysiologie des maladies oculaires
d’origine allergique
La réaction allergique est généralement provoquée par
l ’exposition oculaire à un allergène qui cause la liaison des
IgE membranaires, ce qui entraîne la dégranulation des
mastocytes. Ce phénomène cause la libération d’une cas-
cade de médiateurs allergiques et inflammatoires, incluant
l’histamine, et la synthèse de l’acide arachidonique entraî-
nant la production de prostaglandine et de leukotriènes qui
sont associés à la sécrétion accrue de mucus et à l’infil t r a-
tion cellulaire.
Les mastocytes sont situés normalement dans le stroma
vasculaire (substantia propria) de la conjonctive. Il existe
e n viron 50 millions de mastocytes dans la conjonctive
humaine, mais ils ne sont identifiables dans l’épithélium
que dans des situations pathologiques. Dans toutes les
formes de maladie oculaire allergique, on peut identifier un
grand nombre de mastocytes dans la conjonctive. Dans la
KCA, la KCV et la CPG, on note également une augmenta-
tion du nombre des lymphocytes T conjonctivaux, en
particulier les cellules CD4 mémoires, entraînant une aug-
Figure 3 : Blépharite eczématoïde chez un
patient atteint de KCA

Soins médicaux
Vasoconstricteurs topiques
Les vasoconstricteurs topiques, incluant la tétrahy-
drozoline, la phényléphrine et d’autres vasocons-
tricteurs, sont des agents sympathomimétiques qui
réduisent la congestion vasculaire par la stimulation de
l ’a l p h a - a d r é n o r é c e p t e u r . Ces médicaments n’ont aucun
e f fet sur la réaction allergique et ne soulagent pas le
principal symptôme de démangeaisons. Les effe t s
indésirables comprennent la dilatation des pupilles,
même à de faibles concentrations, qui pourrait causer
une crise de glaucome à angle fermé. Ces préparations
peuvent elles-mêmes causer une sensation de brûlure
et des démangeaisons. L’utilisation prolongée de vaso-
constricteurs peut entraîner la tachy p hylaxie, incitant
le patient à utiliser les gouttes ophtalmiques plus
fréquemment. L’arrêt de ces médicaments peut causer
une hyperémie de rebond2. En tant que médicaments
a n t i - allergiques généraux, leur utilité est limitée, et la
possibilité qu’ils causent des problèmes l’emporte sur
leurs avantages potentiels.
Antihistaminiques
Les antihistaminiques sont plus efficaces pour le
traitement de l’allergie oculaire lorsqu’ils sont admi-
nistrés topiquement comparativement à la voie sys-
témique. L’administration topique permet l’a p p l i c a t i o n
d ’un e concentration élevée de médicament directe-
ment sur la région ciblée et par conséquent, le début
d’action est plus rapide (quelques minutes). De plus, on
évite les interactions médicamenteuses et les effe t s
secondaires indésirables observés occasionnellement
avec les antihistaminiques par voie orale. Les effe t s
secondaires, tels que la sédation, les étourdissements,
les acouphènes, la nervosité et l’insomnie, sont moins
fréquents avec les antihistaminiques systémiques de
nouvelle génération. Bien que les antihistaminiques
systémiques de troisième génération n’entraînent pas
de sédation, ils peuvent causer un assèchement de la
surface oculaire, exacerbant ainsi les symptômes des
patients souffrant d’allergie oculaire3. Le tableau 1
présente un aperçu des médicaments ophtalmiques
antiallergiques topiques en vente sur le marché, leur
mode d’action et leurs effets indésirables potentiels.
Nous vous présentons ci-dessous un aperçu des
gouttes ophtalmiques antiallergiques courantes :
•Le ch l o r hyd rate d’azélastine 0,5 % est un dérivé
du phtalazinon qui est métabolisé en son métabolite
actif, la desméthylazélastine. Il a de multiples actions :
c ’est un antihistaminique, un antileucotriène et un
bloqueur de la sérotonine. Il a également une action
stabilisatrice des mastocytes. Les indications sont la
conjonctivite saisonnière et perannuelle et les syn-
dromes d’allergie oculaire. Les contre-i n d i c a t i o n s
incluent la sensibilité au chlorure de benzalkonium.
Les effets secondaires sont la sensation de brûlure lors
de l’instillation et un goût amer qui peut être atténué
par l’occlusion des points lacrymaux. L’azélastine est
très efficace pour réduire les démangeaisons en
quelques minutes et elle a une longue durée d’a c t i o n .
La posologie est généralement biquotidienne, mais elle
peut être augmentée à 4 fois par jour.
•L’émédastine 0,01 % est un antagoniste sélectif
des récepteurs histaminiques H1et l’inhibition de la
perméabilité vasculaire stimulée par l’histamine dans
la conjonctive est dose-dépendante. Elle est indiquée
pour la CAS ou les allergies aiguës. La contre-i n d i c a t i o n
est une hypersensibilité au chlorure de benzalkonium.
En Europe, une préparation sans agent conservateur
est commercialisée. Son utilisation n’est pas sûre durant
la grossesse (études chez l’animal) et étant donné que
l ’excrétion rénale et hépatique n’a pas été étudiée, il
faut éviter de la prescrire chez les personnes âgées et
chez les patients souffrant d’insuffisance rénale et
hépatique. C’est un médicament très efficace contre les
démangeaisons et l’allergie aiguë. Son usage
p r o l o n g é
n’a pas été étudié. Sa posologie est biquotidienne.
•La lévocabastine 0,05 % est un dérivé carbénoïde
ayant une action antihistaminique. C’est en fait le
médicament de référence pour les études de labora-
toire sur l’inhibition de l’histamine. Les indications
sont la CAS et la KCV. Elle est très efficace pour
soulager les démangeaisons en état aigu, mais n’est pas
utilisée dans le traitement prolongé de l’allergie. La
c o n t r e - indication est l’allergie au chlorure de benza-
lkonium. Il a été démontré qu’elle est tératogène et est
c o n t r e - indiquée pendant la grossesse. La posologie est
généralement biquotidienne, mais peut être augmentée
à 3 ou 4 fois par jour pour les épisodes aigus ou graves.
•Le kétotifène-fumarate 0,025 % est un antihista-
minique ayant une faible action anticholinergique. Il
stabilise les mastocytes in vitro. Ses indications sont la
CAS et l’allergie aiguë. Ses effets secondaires sont l’irri-
tation locale et la réaction allergique, la kératopathie
ponctuée, les céphalées, la somnolence, la séch e r e s s e
oculaire et la sécheresse de la bouche. Les gouttes
ophtalmiques anti-allergiques de deuxième génération
contiennent une association d’antihistaminiques et de
vasoconstricteurs et sont souvent plus efficaces que
chacun des agents utilisés seuls. Elles sont générale-
ment en vente libre. Les avantages des vasocons-
tricteurs topiques doivent être soupesés par rapport à
leurs effets secondaires potentiels.
Stabilisateurs de mastocytes
Les sous-types de mastocytes varient dans dif-
férents tissus et chez différentes espèces pour des
paramètres tels que la teneur en protéase neutre et la
réponse aux agents thérapeutiques. Par conséquent,
les stabilisateurs des mastocytes qui n’ont pas été mis
au point pour un usage ophtalmique peuvent ne pas
être efficaces pour cet usage. On n’a pas élucidé totale-
ment leur mécanisme d’action exact. Cependant, on
sait que lorsqu’ils sont utilisés comme traitement
p r o p hyl actique, ils sont très efficaces pour prévenir la
Ophtalmologie
Conférences scientifiques
Tableau 1 : Aperçu des préparations
antiallergiques topiques, leur mécanisme
d’action et leurs effets secondaires potentiels
Préparation Mécanisme Effets secondaires
Azélastine IM, Anti-H1, Goût amer,
0,05 % anti-LT,anti-5OH sensation de brûlure
Cromoglycate Anti-H1, IM, prophylaxie Dermatite de contact
2 % Sensation de brûlure
Émédastine Anti-H1, soulagement des Sensation de brûlure
0,05 % démangeaisons en état aigu Dyspnée
Kétotifène Anti-H1, IM Démangeaisons,
0,025 % allergie de contact
Urticaire, Irritation
Lévocabastine Anti-H1, soulagement des Irritation
0,05 % démangeaisons en état aigu
Nédocromil IM, prophylaxie Dermatite de contact
2 % Sensation de brûlure
Opalatadine Anti-H1, IM Démangeaisons,
0,1 % sensation de brûlure,
œdème
Anti-H1 = antihistaminique H1; IM = inhibiteur de mastocytes;
anti-LT = anti-leucotriènes; anti-5OH (5-hydroxypropafénone) = anti-
sérotoninergique

dégranulation des mastocytes, empêchant ainsi la
libération d’histamine et la cascade de réactions cau-
sant des symptômes d’allergie oculaire. Cependant, ils
ne bloquent pas les récepteurs de l’histamine ni ne
préviennent la production de médiateurs nouvelle-
ment formés et par conséquent, ils ne soulagent pas les
symptômes existants. Leur effet sur la stabilisation des
mastocytes est biphasique, ce qui signifie qu’à une
faible concentration, les mastocytes sont stabilisés,
alors qu’à une concentration élevée, la dégranulation
de l’histamine est en fait stimulée. Le seul médicament
qui ne possède pas ce mécanisme biphasique est
l ’olopatadine, qui a un effet stabilisateur dose-d é p e n -
dant uniquement. Pour être efficace, le traitement doit
être initié 2 à 3 semaines avant la saison des allergies.
Dans une méta-analyse effectuée par Owen et coll.5, les
auteurs constatent que les patients utilisant des stabili-
sateurs de mastocytes étaient 4,9 fois (IC à 95 %, 2,5-
9,6) plus susceptibles d’obtenir un bénéfice que ceux
recevant un placebo. Les stabilisateurs de mastocytes
incluent le cromoglycate sodique et le nédocromil
sodique. Le kétotifène est un médicament à action
multiple ayant des propriétés d’inhibition des masto-
cytes, à l’instar de l’opalatadine et de l’azélastine.
Médicaments ayant plus d’un mécanisme d’action
Il s’agit des médicaments contre les allergies ocu-
laires de dernière génération. Leur avantage est le
soulagement symptomatique rapide produit par les
antagonistes des récepteurs de l’histamine à effe t
immédiat, associé à l’avantage des stabilisateurs de
mastocytes qui ont un effet à long terme et constituent
un traitement de fond. L’olopatadine (Patanol) agit
comme un stabilisateur de mastocytes, un antagoniste
des récepteurs H1et inhibe la sécrétion de cytokine.
L’azélastine (Optivar) et le nédocromil (Alocril) ont un
certain effet inhibiteur sur les cellules infla m m a t o i r e s .
Le kétotifène (Zaditor) est un médicament qui agit
comme un antagoniste des récepteurs de l’histamine
et comme un stabilisateur de mastocytes. Le kétotifène
est un antagoniste des récepteurs de l’histamine H1
relativement sélectif et non compétitif et un stabilisa-
teur de mastocytes, inhibant la libération de média-
teurs inflammatoires à partir des mastocytes. De plus,
il module l’action des éosinophiles par plusieurs
mécanismes distincts autres que la stabilisation des
mastocytes incluant un effet direct sur l’e n d o t h é l i u m ,
inhibant la synthèse et l’expression des molécules
d ’adhésion cellulaire qui jouent un rôle clé dans le
recrutement des éosinophiles ; l’antagonisme de l’a c-
tivité du facteur d’activation des plaquettes, inhibant
ainsi le recrutement et l’activation des éosinophiles ;
l’inhibition de la chimiotaxie des éosinophiles et de
l ’activation induite par l’éotaxine et l’IL - 5 ; et un effe t
stabilisant direct sur les éosinophiles, empêchant ainsi
la dégranulation6.
Lors de tests de provocation antigénique, l’olopata-
dine et le kétotifène ont été très efficaces pour réduire
rapidement les signes et les symptômes de la conjonc-
tivite allergique saisonnière (en quelques minutes),
incluant la rougeur, les démangeaisons, les lar-
moiements, le chémosis, le gonflement des paupières
et les sécrétions muqueuses7.
Anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS)
Cette classe de médicaments agit en inhibant la
production de prostaglandine (PG). Les PGE2et PGI2
sont extrêmement pruritogènes pour la muqueuse
conjonctivale. Les AINS réduisent les démangeaisons
oculaires et l’hyperémie en inhibant ces facteurs. Le
délai d’action pour les préparations topiques peut être
de 2 semaines.
Corticostéroïdes topiques
Les corticostéroïdes réduisent la transcription des
gènes pro-i n flammatoires (ex. le gène codant pour la
phospholipase A2) et réduisent donc le taux de PG
produits. Cependant, les corticostéroïdes favorisent
également la libération de l’inhibiteur de la phospholi-
pase A2 (Lipocortine) à partir des leucocytes.
On ne comprend pas précisément le mécanisme au
niveau cellulaire et plasmatique8. Les glucocorticoïdes
inhibent la production des interleukines (IL), parmi
lesquelles IL-4 et IL-5 qui sont les IL principalement
produites par les mastocytes situés sur la surface ocu-
laire. Les corticostéroïdes réduisent également la trans-
cription de l’éotaxine et peuvent induire l’apoptose des
éosinophiles et des lymphocytes T9. Les cortico-
stéroïdes topiques n’ont pas un effet immédiat sur les
démangeaisons oculaires causées par les allergies. Leur
e f f et est fondé sur l’atténuation de la réaction
allergique de la phase tardive.
En raison de leurs effets secondaires potentiels,
incluant la cataracte, une pression intraoculaire accrue
et la fonte cornéenne, les corticostéroïdes sont
généralement réservés aux patients qui ne répondent
pas à d’autres traitements ou à d’autres formes graves
d’allergie, telles que la KCA ou la VKC et aux exacerba-
tions de la KCV. Le schéma posologique consiste en
l ’administration d’une dose élevée de dexaméthasome
ou de prednisolone 8 fois par jour pendant 1 semaine,
puis en la réduction rapide de celle-ci. Les stabilisa-
teurs de mastocytes topiques ou un médicament ayant
deux mécanismes d’action doivent être amorcés en
concomitance.
On a décrit l’utilisation d’injections sus-t a r s i e n n e s
de corticostéroïdes dans les cas de KCV grave.
Holsclaw et coll.1 0 ont constaté que les patients rece-
vant des injections sus-tarsiennes de dexaméthasone
sodique ou de triamcinolone éprouvaient un soulage-
ment des signes et des symptômes dans un délai de 1 à
5 jours et il était ensuite possible de leur administrer
des régimes thérapeutiques conventionnels. L’injection
de triamcinolone chez un patient a entraîné une aug-
mentation de la pression intraoculaire. L’administration
fréquente de corticostéroïdes topiques peut produire le
même effet, tout en évitant certaines des complica-
tions potentielles de l’injection sus-tarsienne. Mises à
part les complications bien connues de la cataracte et
du glaucome secondaires, on devrait prendre en con-
sidération la possibilité de problèmes cutanés, tels que
la nécrose, la dépigmentation et l’atrophie sous-
cutanée. L’injection sus-tarsienne n’est pas notre
méthode de traitement préférée.
Cyclosporine A (CsA)
La cyclosporine A est un immunomodulateur et
inhibe la prolifération des cellules des lymphocytes T
CD4+ par l’inhibition de la transcription calcium-
dépendante, spécifique et réversible de l’IL-2. Cela
réduit la production d’une gamme de cytokines,
inhibant l’activation et/ou la maturation des divers
types de cellules, y compris celles impliquées dans
l ’atopie. Le médicament a des effets inhibiteurs directs
sur l’activation des éosinophiles et des mastocytes et la
libération de médiateurs, ce qui est important dans le
traitement de l’inflammation allergique.
La cyclosporine A topique et par voie orale a
démontré son efficacité dans le traitement des symp-
tômes et la réduction de la quantité de corticostéroïdes
Ophtalmologie
Conférences scientifiques
 6
6
1
/
6
100%