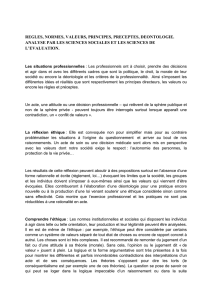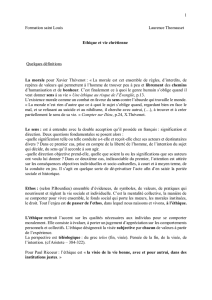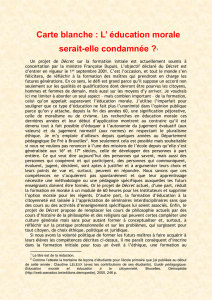LA POLITIQUE EN QUESTION

1
LA POLITIQUE EN QUESTION

2
L’Etat est-il un voyou plus puissant que les autres ?
Le pouvoir souverain se réduit à une espèce de brigandage quand il ne se
subordonne plus à une exigence de justice.
Dans ce passage célèbre de la Cité de Dieu, Saint Augustin pose une question cruciale : qu’est-ce qui
distingue, après tout, le pouvoir des Etats quand ils font usage de leur puissance des exactions d’une
bande de brigands, à part l’efficacité d’une telle puissance et son extension ? Autrement dit, est-ce
simplement une différence de degrés qui séparent ces deux usages de la force (l’Etat apparaissant
alors comme un « voyou » à grande échelle) ou bien une différence de nature (l’usage de la force ne
prenant pas alors le même sens, l’un étant arbitraire et uniquement tourné vers la satisfaction des
intérêts du groupe –le brigandage, l’autre apparaissant au contraire comme le moyen légitime du droit
et l’exercice d’une justice – la puissance d’Etat) ? Dans une telle question, il en va ainsi de la
signification du pouvoir d’Etat et des conditions qui garantissent sa légitimité, c’est-à-dire qui permette
de reconnaître en raison l’usage de sa puissance. Supposons un Etat, par exemple, qui en envahit un
autre n’ayant d’autre objectif à terme que de s’emparer de ses richesses (par exemple, le pétrole), la
seule différence entre cet Etat et une vulgaire troupe de brigands est la puissance dont il dispose et le
fait que cette puissance lui permet de commettre des crimes sans craindre d’être jugé. Dans ce cas, la
légitimité, loin d’être l’expression d’un pouvoir juste, devient simplement synonyme d’impunité : un
pouvoir « légitime » ne serait plus alors qu’un pouvoir dont nul ne peut contester la puissance. Entre
l’Etat voyou et le voyou commun, la seule différence qui demeure est la puissance de feu. La question
alors est essentielle : qu’est-ce qui permet de dépasser cette simple différence de degrés et, ce
faisant, de distinguer l’Etat d’une troupe de brigands ? Un point fondamental qui seule peut permet de
séparer le pouvoir légitime du pouvoir arbitraire : le pouvoir d’Etat se distingue d’une troupe de
brigands si et seulement si l’usage de sa puissance est subordonnée à la justice universelle. A
l’inverse, si ce pouvoir ne s’exerce qu’en vue de satisfaire la cupidité des membres du groupe (on
dirait, aujourd’hui, l’intérêt économique), rien ne le distingue plus alors d’une troupe de brigands, si ce
n’est l’ampleur de ses forfaits et de ses crimes.
Est-il besoin d’insister sur l’actualité des questions que se pose ce texte écrit au Vème après
JC ?
« Sans la justice, en effet, les royaumes sont-ils autre chose
que de grandes troupes de brigands ? Et qu’est-ce qu’une troupe
de brigands, sinon un petit royaume ? Car c’est une réunion
d’hommes où un chef commande, où un pacte social est reconnu,
où certaines conventions règlent le partage du butin. Si cette
troupe funeste, en se recrutant de malfaiteurs, grossit au
point d’occuper un pays, d’établir des postes importants,
d’emporter des villes, de subjuguer des peuples, alors elle
s’arroge ouvertement le titre de royaume, titre qui lui assure
non pas le renoncement à la cupidité, mais la conquête de
l’impunité. C’est une spirituelle et juste réponse que fit à
Alexandre le Grand ce pirate tombé en son pouvoir. « A quoi
pense-tu, lui dit le roi, d’infester la mer ? – A quoi penses-
tu d’infester la terre ? répond le pirate avec une audacieuse
liberté. Mais parce que je n’ai qu’un frêle navire, on
m’appelle corsaire et parce que tu as une grande flotte on te
nomme conquérant ».
SAINT AUGUSTIN, LA CITE DE DIEU (Livre IV, chapitre IX)

3
Politique et Morale :
On gouverne autant par la ruse et la violence que par les lois.
« Combien il serait louable chez un prince de tenir sa parole
et de vivre avec droiture et non avec ruse, chacun le
comprend : toutefois, on voit par expérience, de nos jours, que
tels princes ont fait de grandes choses qui de leur parole ont
tenu peu de compte, et qui ont su par ruse manœuvrer la
cervelle des gens ; et à la fin ils ont dominé ceux qui se sont
fondés sur la loyauté.
Vous devez donc savoir qu’il y a deux manières de combattre :
l’une avec les lois, l’autre avec la force ; la première est
propre à l’homme, la seconde est celle des bêtes ; mais comme
la première, très souvent, ne suffit pas, il convient de
recourir à la seconde. Aussi est-il nécessaire à un prince de
savoir bien user de la bête et de l’homme (…)
Puis donc qu’un prince est obligé de savoir bien user de la
bête, il doit parmi elles prendre le renard et le lion, car le
lion ne se défend pas des rets, le renard ne se défend pas des
loups. Il faut donc être renard pour connaître les rets et lion
pour effrayer les loups. Ceux qui s’en tiennent simplement au
lion n’y entendent rien. Un souverain prudent, par conséquent,
ne peut ni ne doit observer sa foi quand une telle observance
tournerait contre lui et que sont éteintes les raisons qui le
firent promettre. Et si les hommes étaient tous bons, ce
précepte ne serait pas bon ; mais comme ils sont méchants et ne
te l’observeraient pas à toi, toi non plus tu n’as pas à
l’observer avec eux. Et jamais un prince n’a manqué de motifs
légitimes pour colorer son manque de foi (…)
A un prince donc, il n’est pas nécessaire d’avoir en fait
toutes les susdites qualités, mais il est bien nécessaire de
paraître les avoir. Et même, j’oserai dire ceci : que si on les
a et qu’on les observe toujours, elles sont dommageables ; et
que si l’on paraît les avoir, elles sont utiles ; comme de
paraître pitoyable, fidèle, humain, droit, religieux, et de
l’être ; mais d’avoir l’esprit édifié de telle façon que, s’il
faut ne point l’être, tu puisses et saches devenir le
contraire. Et il faut comprendre ceci : c’est qu’un prince, et
surtout un prince nouveau, ne peut observer toutes ces choses
pour lesquelles les hommes sont tenus pour bons, étant souvent
contraint, pour maintenir l’Etat, d’agir contre la foi, contre
la charité, contre l’humanité, contre la religion. Aussi faut-
il qu’il ait un esprit disposé à tourner selon que les vents de
la fortune et les variations des choses lui commandent, et
comme j’ai dit plus haut, ne pas s’écarter du bien, s’il le
peut, mais savoir entrer dans le mal, s’il le faut.
Il faut donc qu’un prince ait grand soin qu’il ne lui sorte
jamais de la bouche chose qui ne soit pleine des cinq qualités
susdites, et qu’il paraisse, à le voir et à l’entendre, toute
miséricorde, toute bonne foi, toute droiture, toute humanité,
toute religion. Et il n’y a chose plus nécessaire à paraître
avoir que cette dernière qualité. Les hommes en général jugent
plus par les yeux que par les mains ; car il échoit à chacun de
voir, à peu de gens de percevoir. Chacun voit ce que tu parais,
peu perçoivent ce que tu es ; et ce petit nombre ne se hasarde
pas à s’opposer à l’opinion d’une foule qui a la majesté de
l’Etat qui la défend ; et dans les actions de tous les hommes,
et surtout des princes où il n’y a pas de tribunal à qui
recourir, on considère la fin. Qu’un prince, donc, fasse en
sorte de vaincre et de maintenir l’Etat : les moyens seront
toujours jugés honorables et loués de chacun ; car le vulgaire
se trouve toujours pris par les apparences et par l’issue de la
chose ; et dans le monde, il n’y a que le vulgaire ; et le
petit nombre ne compte pas quand la foule a où s’appuyer. »
MACHIAVEL, Le Prince, Chapitre XVIII.

4
S’il n’y a pas de « politique de la colombe », y a-t-il une « morale du serpent » ?
Ou,
Une politique qui ferait fi de la morale peut-elle se justifier ?
Dans cet extrait de Vers la paix perpétuelle, Kant interroge les rapports de la morale et de la
politique. Tout homme politique relèvera d’emblée que la morale n’est pas toujours bonne conseillère
pour guider l’action politique et que la politique requiert le plus souvent que l’on sache faire le
« serpent », user de la ruse. Qui voudrait faire la « colombe » à tout prix en politique risque bien de se
faire dévorer. Toutefois, si Kant est bien conscient de la naïveté de cet angélisme qui revient à croire
qu’il peut y avoir un accord immédiat entre politique et morale, il n’en demeure pas moins que cet
accord est l’horizon ultime que toute politique doit poursuivre, si tant est qu’elle veuille être autre
chose que l’exercice arbitraire d’un pouvoir tyrannique. Ainsi –et tout l’enjeu de ce passage est de le
souligner, s’il n’y a pas de « politique de la colombe », d’accord spontané entre les exigences de la
morale et les moyens de l’action politique, il n’y a pas non plus de « morale du serpent », c’est-à-dire
de justification ou de légitimation possible pour une politique qui ne se subordonnerait plus à aucune
exigence morale. Il s’agit donc pour Kant de faire apparaître le caractère irrecevable des principes
d’une « morale politique », c’est-à-dire d’une action politique qui s’inventerait des justifications taillées
uniquement à la mesure de son désir de puissance et qui ne subordonnerait pas cette puissance à
des principes moraux. Selon une telle « morale » (et les guillemets s’imposent ici !) tous les moyens
sont bons et la violence est légitime tant qu’elle permet au pouvoir de s’affirmer et de se maintenir. Le
fait que l’on ne puisse mettre en évidence de tels principes sans éprouver un sentiment de scandale
(sentiment que Kant cherche à provoquer chez son lecteur) découvre à quel point nous supposons
toujours que la politique ne saurait garder un sens sans régler son exercice sur la morale, sans quoi
toute violence pourrait être jugée bonne si elle sert le pouvoir.
Ainsi, un pur cynisme en matière de politique (qui ne connaît pas d’autre borne à la violence que son
efficacité) ne saurait se rendre public sans déclarer son caractère illégitime et arbitraire. Dès lors, si
une « politique de la colombe », une politique pleinement morale, est un idéal qui ne peut jamais être
pleinement accompli, il n’en demeure pas moins qu’une politique ne peut jamais déclarer
publiquement que seule la violence règne, sans apparaître immédiatement barbare.
« La politique dit : « Soyez prudents comme les serpents » ; la
morale ajoute (comme condition restrictive) : « et comme les
colombes, soyez sans détour ».
1
Si l’une et l’autre ne peuvent
pas coexister dans un seul commandement, alors il y a
effectivement conflit entre la politique et la morale ; mais si
l’une et l’autre doivent s’unir absolument, alors le concept du
contraire est absurde et la question de savoir comment il faut
régler ce conflit ne se présente même pas comme un problème. Bien
que la
proposition : l’honnêteté est la meilleure politique renferme une
théorie que la pratique, malheureusement !, contredit très
fréquemment, la proposition également théorique : l’honnêteté est
1
Sur un mode symbolique, Kant pose d’emblée le problème qui sépare politique et
morale : comment en effet joindre sans contradiction ces deux impératifs ? Comment
être à la fois « prudent », comme l’exige la politique, et « sans détour », comme
l’exige la morale ? Etre à la fois « serpent » (user de la ruse pour parvenir à ses
fins) et « colombe » (agir droitement selon ce que l’impératif moral exige) ?
Accorder ces deux exigences semble impossible. Comment en effet concevoir une
« politique de la colombe » ? Comme le relève Kant à la suite, le politique qui
voudrait absolument subordonner son action à un principe d’honnêteté, qui voudrait
faire la colombe à tout prix, court le risque d’être une proie facile pour tous les
« serpents ». Cela dit, que serait une politique qui n’aurait pas pour fil
directeur la morale ? L’estimerions- nous acceptable ? En démasquant à la suite les
règles arbitraires et injustes et le cynisme dont une telle politique se
réclamerait, Kant montre que l’horizon qui légitime une politique est son accord
avec la morale et qu’une pure « politique des serpents » ne peut être mise en
lumière sans d’elle-même accuser son propre scandale.

5
meilleure que toute politique est au-dessus de toute objection,
voire est la condition inévitable de la politique (…)
2
Certes, s’il n’y a pas de liberté et pas de loi morale fondée sur
elle, mais si tout ce qui arrive ou peut arriver n’est que simple
mécanisme de la nature, alors la politique (en tant qu’art
d’utiliser ce mécanisme pour gouverner les hommes) est toute la
sagesse pratique et le concept de droit est une idée creuse. Mais
si on considère comme nécessité inévitable de lier ce concept
avec la politique, alors il faut admettre la possibilité de leur
réunion. Or, je peux bien concevoir un politique moral, c’est-à-
dire quelqu’un qui considère que les principes de la prudence
politique peuvent coexister avec la morale, mais non pas un
moraliste politique qui se forge une morale qui soit profitable à
l’intérêt de l’homme d’Etat (…)
3
Les maximes dont il [le moraliste politique] se sert (…) (bien
qu’il ne veuille pas les énoncer), reviennent à peu près aux
maximes sophistiques suivantes :
1. Fac et excusa.
4
Saisis l’occasion favorable pour t’emparer, de
ta propre autorité (du droit d’un Etat soit sur son peuple, soit
sur un autre peuple voisin) ; la justification se présentera, une
fois le fait accompli, et permettra de maquiller la violence
(particulièrement dans le premier cas où le pouvoir suprême, à
l’intérieur, est en même temps l’autorité législatrice à laquelle
il faut obéir sans ratiociner) bien plus facilement et plus
élégamment que si l’on voulait réfléchir d’abord aux arguments
convaincants, et puis attendre les contre-arguments. Cet aplomb
donne même quelque apparence que l’on est intérieurement
convaincu que l’action est conforme au droit, et le dieu bonus
eventus
5
est, après cela, le meilleur défenseur du droit.
2. Si fecisti nega.
6
Les méfaits que tu as commis, comme par
exemple amener ton peuple à désespérer et par suite, à se
révolter, nie en être responsable ; au contraire, affirme que la
responsabilité en incombe à la désobéissance des sujets, ou bien,
si tu t’es emparé d’un peuple voisin, à la nature de l’homme qui,
s’il ne devance pas autrui par la violence, peut compter avec
certitude qu’autrui le devancera et s’emparera de lui.
3. Divide et impera.
7
Soit : si, dans ton peuple, il y a certains
chefs privilégiés qui t’ont simplement choisi pour être leur chef
suprême (primus inter pares)
8
, sème la désunion parmi eux et
brouille les avec le peuple : range-toi alors du côté du peuple
2
Certes, ce serait se voiler pudiquement la face que de ne pas relever que la
morale n’est pas nécessairement le gage d’une politique efficace. Est-ce à dire que
la politique est libre de toute appréciation morale ? Non, car à terme le jugement
porté sur une politique est subordonné à la morale ; la « condition inévitable » de
la politique est donc d’être appréciée selon les principes moraux. En ce sens, on
pourrait dire que si la politique ne peut faire toujours « avec » la morale ; elle
ne peut jamais faire « sans ». En ce sens, elle ne peut échapper à un jugement
moral quelle que soit son efficacité.
3
La différence entre le « politique moral » et le « moraliste politique » est
essentiel : le premier cherche autant que possible à conformer sa politique aux
exigences de la morale, celle-ci étant l’idéal auquel il cherche à se conformer ;
le second, par contre, invente des principes taillés à la mesure de sa politique et
du pouvoir qu’il cherche à affirmer ; en fait de « morale », il ne s’agit plus
alors que de « recettes » cyniques qui permettent d’assurer efficacement son
pouvoir et de l’étendre. La morale n’est plus que l’illusion par laquelle un
pouvoir cherche à se donner raison et à se donner l’apparence du droit. Kant va
s’efforcer à la suite de dévoiler l’arbitraire dont ces pseudo-maximes sont le
masque.
4
« Agis d’abord et excuse-toi ensuite ». Kant souligne ici le cynisme d’une
politique qui estime que la légitimité d’une action dépend de sa réussite.
5
Le Dieu du succès.
6
« Si tu l’as fait, nie-le ».
7
« Diviser pour régner ».
8
le premier entre ses pairs, ses égaux.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
1
/
9
100%