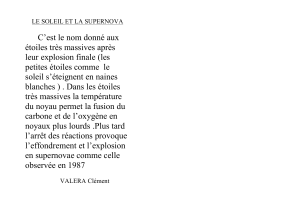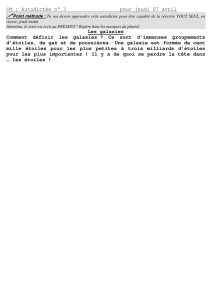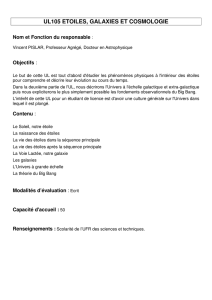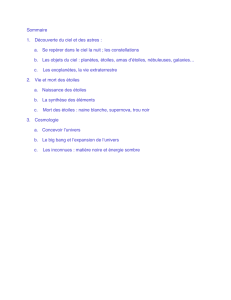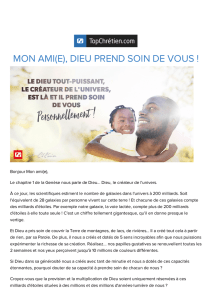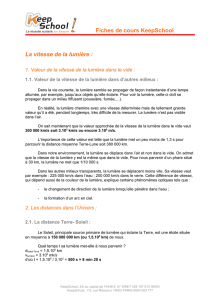VI. Formation des étoiles et des planètes

Service d'Astrophysique 2001-2003 DSM - DAPNIA 32
Formation des étoiles et des planètes
Les compétences et centres d'intérêt du laboratoire
"Formation des étoiles et planètes" du SAp s'articulent
autour de trois axes principaux :
1) les phases les plus précoces de la formation
stellaire à l'échelle des nuages moléculaires dans notre
Galaxie (c'est à dire l'étude de la formation et de
l'évolution des proto-étoiles et des amas de proto-
étoiles);
2) la formation des étoiles à échelle globale dans
les galaxies;
3) les disques proto-planétaires et post-planétaires
et le processus de formation des planètes en leur sein.
Les phases précoces de la
formation stellaire
Les condensations pré-stellaires et les
proto-étoiles de faible masse
Selon notre compréhension actuelle du phénomène, la
formation d'une étoile de type solaire (M* < 2 Mo), voire
d'une étoile de masse intermédiaire (2 Mo < M* < 8 Mo),
se déroule en trois actes principaux :
1) la phase préstellaire au cours de laquelle un
fragment auto-gravitant se condense
progressivement au sein d'un nuage moléculaire puis
s'effondre gravitationnellement,
2) la phase protostellaire pendant laquelle un embryon
stellaire apparaît au sein de la condensation et
grossit en masse en accrétant une grande fraction de
la matière de la condensation qui l'enveloppe (le
reste étant éjecté sous la forme d'un flot bipolaire) et,
enfin,
3) la phase pré-séquence principale pendant laquelle
l'étoile nouvellement formée est entourée d'un
disque circumstellaire et se contracte de manière
quasi-statique jusqu'à amorcer les réactions
nucléaires de fusion de l'hydrogène en hélium.
Ph. André et ses collègues se sont spécialisés depuis
plusieurs années dans l'étude des deux premières phases,
notamment à partir d'observations (sub-)millimétriques de
« condensations pré-stellaires » froides sans signe
d'accrétion/éjection et de proto-étoiles de « Classe 0 »
n'ayant encore accrété qu'une minorité de leur masse
finale (voir revue par André et al. [1]). Ces premières
phases sont cruciales car elles doivent, en partie au moins,
régir l'origine de la «fonction de masse initiale» des
étoiles. En effet, d'une part la masse des étoiles semble
grandement déterminée au stade pré-stellaire (cf. Motte et
al. [2] - voir ci-dessous) et, d'autre part, cette masse est
acquise pendant la phase protostellaire
d'accrétion/éjection.
Structure en densité des proto-étoiles de
faible masse
Grâce à une étude détaillée de la distribution radiale de
densité des enveloppes circumstellaires de 43 proto-
étoiles effectuée dans le continuum des poussières à
1.3mm avec la caméra de bolomètres MAMBO du radio-
télescope de 30m de l'IRAM, Motte & André [3] ont
pu montrer que les conditions initiales de l'effondrement
protostellaire varient sensiblement selon le mode de
formation stellaire, « isolé » ou « en amas ».
Motte & André [3] ont cartographié l'ensemble des 27
candidats proto-étoiles du nuage du Taureau qui avaient
été identifiés préalablement en infrarouge, ainsi que 9
globules isolés détectés par le satellite infrarouge IRAS et
9 proto-étoiles du complexe moléculaire de Persée. Dans
les deux premiers groupes, où les objets sont relativement
isolés, les auteurs ont trouvé que la structure en densité
des enveloppes protostellaires (telles que L1527 sur la
figure 1) est décrite de manière satisfaisante par le modèle
« standard » de Shu et al. (1987, ARA&A, 25, 23) fondé
sur la sphère singulière isotherme (« SIS »).
En revanche, dans le troisième groupe où les objets
stellaires jeunes sont groupés en amas, les enveloppes
protostellaires (telles que L1448-N sur la figure. 1) sont
plus denses et plus compactes. Motte & André [3] ont
suggéré que cette structure en densité est le résultat d'un
effondrement protostellaire plus dynamique (cf. Larson
1969, MNRAS, 145, 271) induit dans des fragments de
nuages de taille finie tels que des sphères isothermes auto-
gravitantes dites de « Bonnor-Ebert ».
La validité de cette suggestion a pu être confirmée depuis
grâce à des simulations hydrodynamiques (de type SPH)
d'effondrement gravitationnel réalisées en collaboration
avec P. Hennebelle et A. Whitworth (Hennebelle et al.
[4]). Les simulations de Hennebelle et al. [4] suivent
l'évolution d'une sphère de Bonnor-Ebert dont
l'effondrement a été induit par une augmentation de la
pression extérieure. Les résultats montrent que des
facteurs de sur-densité élevés (par rapport à une SIS), tels
que ceux observés sur les proto-étoiles de l'amas de
Persée (figure 1), peuvent s'expliquer (uniquement) dans
le cas d'une augmentation forte et très rapide de la
pression extérieure, ce qui génère une onde de
compression violente à l'intérieur de la condensation pré-
stellaire initiale.
En conclusion, il apparaît que l'effondrement
protostellaire est nettement plus violent que le modèle
VI. Formation des étoiles et des planètes
Figure 1: Profils d'intensité moyens à 1.3 mm de la proto-étoile
de Classe 0 L1527 dans le nuage du Taureau (a) et des proto-
étoiles de Classe 0 HH211-MM et L1448-N dans le nuage de
Persée (b). Le profil simulé d'une sphère singulière isotherme
(SIS) à T = 10 K et une coupe du lobe du télescope de 30m sont
aussi montrés pour comparaison. Une échelle approchée de
densités de colonne correspondantes est donnée au centre.
(D'après Motte & André [3])

33 DSM - DAPNIA Service d'Astrophysique 2001-2003
Formation des étoiles et des planètes
standard de Shu et al. dans les régions de formation
stellaire « en amas », ce qui devrait en principe favoriser
la formation d'étoiles massives (voir plus loin).
Structure en vitesse de la plus jeune
proto-étoile du Taureau
Le travail de thèse d'Arnaud Belloche (soutenu fin 2002
au SAp) a consisté en l'étude détaillée de la cinématique
de plusieurs proto-étoiles de Classe 0 afin de trancher
entre différents modèles d'effondrement protostellaire. Le
grand intérêt des proto-étoiles de Classe 0 est en effet
qu'elles sont si jeunes (moins de ~30000 ans depuis la
formation de l'embryon stellaire central) qu'elles
retiennent encore la mémoire des conditions initiales de
l'effondrement.
Arnaud Belloche a notamment mené une étude
approfondie d'IRAM04191, la plus jeune proto-étoile
connue actuellement dans le nuage du Taureau (André,
Motte, Bacmann 1999, ApJ, 513, L57), à partir de cartes
de spectres de plusieurs transitions de la molécule CS et
de son isotope C34S obtenues avec le radio-télescope de
30m de l'IRAM dans le domaine millimétrique (figure 2).
Il a modélisé les spectres observés à l'aide d'un code de
transfert radiatif de type Monte Carlo (MAPYSO), conçu
par S. Blinder et D. Despois à l'Observatoire de Bordeaux.
Grâce à une étude exhaustive de l'influence des différents
paramètres sur les spectres simulés par le code MAPYSO,
Belloche et al. [5] ont pu, pour la première fois, quantifier
l'amplitude des champs de vitesse d'effondrement et de
rotation de la proto-étoile IRAM04191 (figure 3). Un taux
d'accrétion de 3 x 10-6 M
o/an a ainsi été directement
mesuré. De plus, les résultats mettent clairement en
évidence des mouvements de rotation différentielle et
d'effondrement étendus sur toute l'enveloppe
protostellaire (R
env > 10000 UA). Ils montrent que la
partie interne de l'enveloppe (r < 2000-4000 UA) est en
effondrement et rotation rapide avec conservation du
moment cinétique, alors que la partie externe tourne et se
contracte plus lentement, en subissant probablement des
effets de freinage magnétique. La présence de
mouvements d'effondrement étendus pour une proto-étoile
aussi jeune est incompatible avec le modèle « standard »
de Shu et al. (1987, ARA&A, 25, 23) selon lequel
l'effondrement se développe depuis le centre vers
l'extérieur (« inside-out collapse »). En revanche, un
accord qualitatif a été obtenu avec le modèle magnétique
de Mouschovias et collaborateurs (e.g. Basu &
Mouschovias 1994,ApJ, 432, 720), selon lequel
l'effondrement est amorcé à grand rayon par le mécanisme
de diffusion ambipolaire. Dans le cadre de ce modèle,
l'enveloppe interne - en rotation rapide - d'IRAM04191
s'interprète comme un coeur très partiellement ionisé qui
est en train de se découpler magnétiquement du nuage
moléculaire ambiant et correspond au réservoir de masse
effectif (ici ~0.5 Mo) alimentant la formation de l'étoile
centrale. Belloche et al. [5] concluent que le champ
magnétique joue probablement un rôle majeur pour
limiter, pendant la phase pré-stellaire, la masse des
étoiles se formant dans des nuages comme celui du
Taureau.
La distribution de moment cinétique observée dans
l'enveloppe d'une proto-étoile de type solaire comme
IRAM04191 donne aussi de précieuses informations sur
les conditions initiales de la croissance du disque
d'accrétion proto-planétaire.
Conditions initiales dans les amas
stellaires en formation
De manière plus globale, les caméras de bolomètres
actuelles dans le domaine (sub)millimétrique, comme
MAMBO sur le télescope de 30m de l'IRAM ou SCUBA
sur le JCMT, permettre dorénavant d'obtenir de grandes
mosaïques couvrant toute l'étendue de complexes de
formation stellaire individuels. Des résultats très
prometteurs ont ainsi été obtenus sur la « démographie »
des condensations pré-stellaires dans les régions les plus
proches formant les étoiles en amas. En particulier, des
recensements quasi-complets des condensations pré-
stellaires contenus dans les « proto-amas » de ρ Ophiuchi,
d'Orion B et du Serpent ont pu être faits par notre groupe
(Motte, André, Neri 1998, A&A, 336, 150; Motte et al.
[2]; Kaas et al. [6]). Ces recensements indiquent que la
distribution en masse des condensations pré-stellaires
ressemble fortement à la fonction de masse initiale
(« IMF») des étoiles (figure 4 d'après Motte et al. [2]). Ce
résultat est remarquable car, en revanche, la distribution
en masse des nuages moléculaires eux-mêmes, ainsi que
celle des fragments de faible densité observés en CO à
l'intérieur de ces nuages, diffère sensiblement de l'IMF
Figure 2: Spectres observés avec le télescope de 30m de l'IRAM
en direction de la proto-étoile de Classe 0 IRAM 04191 (le long
de l'axe perpendiculaire au flot) dans la transition optiquement
épaisse CS(2-1) et la transition optiquement mince C34S(2-1).
Des spectres synthétiques calculés avec un code de transfert
radiatif de type Monte-Carlo pour un modèle d'enveloppe
sphérique en effondrement et rotation sont superposés (en
rouge) pour comparaison.. (D'après Belloche et al. [5].)
Figure 3: Propriétés cinématiques de l'enveloppe d'IRAM04191 :
profil radial de la vitesse de rotation (à gauche) et profil de la
vitesse d'effondrement (à droite). Sur chaque panneau, la zone
bleue correspond au domaine compatible avec les observations et
la courbe noire au meilleur modèle d'enveloppe.
(D'après Belloche et al. [5].)

Service d'Astrophysique 2001-2003 DSM - DAPNIA 34
Formation des étoiles et des planètes
des étoiles (e.g. Kramer et al. 1998, A&A, 329, 249). Cela
renforce l'idée que les condensations pré-stellaires
identifiées dans le (sub)millimétrique (figure 4) sont bien
les précurseurs directs de proto-étoiles au sein des nuages
moléculaires. Cela suggère également que la masse des
étoiles se détermine très tôt, par fragmentation du nuage
moléculaire parent, comme dans certains modèles
proposés récemment pour l'origine de l'IMF (e.g. Padoan
& Nordlund 2002, ApJ, 576, 870).
Des tels recensements submillimétriques systématiques de
proto-étoiles et condensations pré-stellaires à grande
échelle dans les complexes moléculaires galactiques sont
amenés à se généraliser dans un avenir proche et
constituent un des programmes scientifiques prioritaires
des caméras de bolomètres SPIRE et PACS qui
fonctionneront autour de 200 µm sur le futur satellite
Herschel de l'ESA (Agence Spatiale Européenne) (cf.
André [7]).
Un des objectifs du satellite Herschel sera d'étendre les
résultats obtenus depuis le sol d'une part vers les plus
petites masses (M < 0.1 Mo) dans le domaine des proto-
naines brunes, et d'autre part vers les plus grandes masses
(M > 10 Mo), en relation avec le problème de la
formation des étoiles massives (voir ci-dessous).
Les phases précoces de la formation des
étoiles massives
Les mécanismes conduisant à la formation des étoiles
massives (de masse M > 8-10 Mo) sont encore moins bien
compris que ceux conduisant aux étoiles de type solaire.
En particulier, on ne sait pas aujourd'hui si les étoiles
massives se forment principalement par effondrement et
accrétion comme les étoiles de faible masse (e.g. McKee
& Tan 2002, Nature, 416, 59), ou plutôt par collisions et
coalescence de proto-étoiles de masse intermédiaire (e.g.
Bonnell et al. 1998, MNRAS, 298, 93). Comme les étoiles
massives jouent un rôle crucial dans le bilan énergétique
et l'évolution physico-chimique des galaxies, comprendre
leur formation est un problème fondamental en
astrophysique.
Contrairement aux étoiles de type solaire, les étoiles
massives n'ont pas de phase pré-séquence principale :
elles arrivent sur la séquence principale alors qu'elles sont
encore en train d'accréter la matière de l'enveloppe
protostellaire qui les entourent. L'intense radiation émise
alors par l'objet central dans le domaine ultraviolet
chauffe puis ionise le gaz de l'enveloppe protostellaire,
entraînant la formation d'une région HII « ultra-
compacte ». Un problème théorique important apparaît
donc car la pression de radiation engendrée lors du
processus devrait stopper l'effondrement de l'enveloppe
protostellaire et empêcher la formation d'une étoile
massive à moins que le taux d'accrétion ne soit 2 à 3
ordres de grandeur plus élevé que les taux d'accrétion
typiques des proto-étoiles de faible masse (e.g. Norberg &
Maeder 2000, A&A, 359, 1025).
Pour résoudre ce problème du point de vue observationnel
et trancher entre les deux grands scénarios proposés pour
la formation des étoiles massives (« accrétion » vs.
« coalescence »), il est nécessaire d'identifier puis
d'étudier en détail les phases précédant l'apparition d'une
région HII. En particulier, on s'attend à ce qu'une phase
pré-stellaire, analogue à celle des étoiles de type solaire
(voir plus haut), n'existe que dans le cadre d'un processus
de formation par « accrétion ». Il est donc primordial de
chercher à mettre en évidence des condensations pré-
stellaires massives. Si elles existent, l'observation de leurs
caractéristiques internes (e.g. température, niveau de
turbulence ...) et des propriétés dynamiques de leur
environnement (e.g. présence ou non de mouvements à
grande échelle et d'interactions à petite échelle ...)
devrait nous renseigner sur les conditions initiales
requises pour la formation d'étoiles massives.
D'autre part, la recherche de proto-étoiles massives s'est
jusqu'ici cantonnée à l'étude systématique d'échantillons
de sources infrarouges lumineuses et enfouies détectées
par le satellite IRAS (e.g. Molinari et al. 1998, A&A, 336,
339; Beuther et al. [8]). La majorité des objets identifiés
de cette façon sont des proto-étoiles évoluées, ayant déjà
formé une région HII. Le gros des proto-étoiles massives
les plus jeunes, qui tout comme les proto-étoiles de Classe
0 de type solaire (André et al. 1993, ApJ, 406, 122)
n’émettent pas de flux infrarouge fort, reste encore à
Figure 4: (a) Image à 850
µ
m du proto-amas NGC2068 obtenue
avec la caméra de bolomètres SCUBA sur le JCMT. Cette image
révèle une trentaine de condensations pré-stellaires.
Figure 4 (b) Distribution de masse cumulée des 70
condensations pré-stellaires identifiées à 850
µ
m dans la région
NGC2068/2071 (Orion B). De manière remarquable et
contrairement au spectre de masse des fragments de nuage
observés en CO, cette distribution de masse suit, au-dessus de ~
1 Mo, la loi de puissance de Salpeter qui caractérise la
distribution de masse initiale (« IMF ») des étoiles.
(D'après Motte et al. [2].)

35 DSM - DAPNIA Service d'Astrophysique 2001-2003
Formation des étoiles et des planètes
découvrir grâce à des recensements complets des
complexes moléculaires de notre Galaxie dans le domaine
submillimétrique. De tels recensements, possibles avec le
futur satellite Herschel, sont une étape indispensable pour
estimer de manière précise les différentes échelles de
temps mises en jeu et permettre, dans un deuxième temps,
des études détaillées à plus haute résolution (par exemple
avec le futur grand interféromètre millimétrique ALMA)
sur des échantillons à la fois représentatifs et
statistiquement significatifs.
Dans l'immédiat, F. Motte et ses collaborateurs ont engagé
des études (sub)millimétriques de plusieurs complexes
moléculaires massifs comme W43 ou Cygnus X avec le
radio-télescope de 10m de Caltech (CSO) et le 30m de
l'IRAM.
Etude détaillée du complexe moléculaire
W43
F. Motte s'est d'abord intéressée à W43, un complexe
moléculaire massif situé à 5.5 kpc du Soleil qui semble
former l'analogue (en miniature) des « super-amas
stellaires enfouis » observés dans les galaxies extérieures
« à flambée de formation d'étoiles » (voir ci-dessous).
Les cartographies du continuum des poussières effectuées
à 1.3mm et 350 µm (figure 5) ont révélé un complexe
filamentaire contenant ~ 50 fragments de nuage ou
« proto-amas » massifs (40-4000 Mo dans ~ 0.25 pc de
diamètre chacun). La grande taille, grande dispersion de
vitesse ∆v ~ 5 km/s et forte densité (nH2 ~ 106 cm-3) de ces
proto-amas suggèrent qu'ils sont d'excellents sites de
formation d'étoiles massives (Motte et al. [9]).
Trois des proto-amas identifiés à 1.3 mm dans le
complexe W43 sont de particulièrement bons candidats
pour contenir des proto-étoiles massives très jeunes, de
type « Classe 0 ». En effet, ils n'ont pas encore développé
de région HII comme en témoigne leur non détection en
infrarouge et en radio centimétrique. En revanche, ils
montrent clairement au moins un signe de la formation
d'étoiles massives telle que l'émission maser du méthanol
ou la présence d'un « coeur chaud » (température ~ 100 K
mesurée par le traceur CH3CN). Comme ces proto-amas
sont constitués pour l'essentiel de gaz et poussières froides
(~ 20 K) n'émettant pas en infrarouge proche et moyen, ils
sont sans doute représentatifs de phases les plus précoces
du processus de formation des étoiles massives (Motte et
al. [9]).
F. Motte et collaborateurs ont récemment obtenu des
cartes de ces trois proto-amas dans plusieurs raies des
molécules HCO+ et CS (figure 6). Les spectres observés
sont auto-absorbés et asymétriques, avec une auto-
absorption décalée vers le rouge, ce qui, par comparaison
avec des observations analogues sur des proto-étoiles
proches bien résolues comme IRAM04191 (cf. figure. 2),
suggère la présence de mouvements supersoniques de
contraction à grande échelle (sur plusieurs parsecs) dans
ces proto-amas (Motte et al., en préparation).
Si ces mouvements globaux entretiennent l'effondrement
gravitationnel des proto-étoiles situées à l'intérieur des
proto-amas, ils correspondent à des taux d'accrétion très
élevés (~ 10-3 M
o/an) qui devraient permettre de former
des étoiles massives par le seul processus d'accrétion.
Recherche de proto-étoiles massives dans
les complexes les plus proches
En collaboration avec Sylvain Bontemps (Obs. de
Bordeaux), F. Motte et collègues ont entrepris l'étude
systématique des complexes moléculaires proches
formant des étoiles massives à moins de 3-4 kpc du Soleil
(catalogue en cours d'élaboration par Bontemps et al. à
partir de cartes d'extinction déduites des données du
relevé infrarouge proche 2MASS). A terme, l'objectif de
ce programme ambitieux est de recenser toutes les proto-
étoiles massives de Classe 0 à l'intérieur de ces
Figure 5: Complexe moléculaire W43 cartographié à 1.3 mm
avec la caméra de bolomètres MAMBO, installée au
radiotélescope de 30m de l'IRAM. Les proto-amas contenant les
proto-étoiles massives de Classe 0 sont indiqués ainsi que les
sources maser et l'association d'étoiles WR/OB.
(D'après Motte et al. [9].)
Figure 6: Signature de la contraction supersonique d'un proto-
amas contenant une proto-étoile massive très jeune. Les spectres
CS(3-2) ont été obtenus au télescope de 30m de l'IRAM. Les
niveaux de couleur et contours représentent un zoom de la carte
montrée en figure. 5. L'analyse des spectres suggère une vitesse
de contraction de ~ 2 km/s sur plus d'un parsec, correspondant à
un taux d'accrétion ~10-3 Mo/an, cent fois plus élevé que celui des
proto-étoiles de faible masse.

Service d'Astrophysique 2001-2003 DSM - DAPNIA 36
Formation des étoiles et des planètes
complexes, grâce à des mosaïques de plusieurs degrés
carrés en continuum (sub)millimétrique.
A l'aide de la toute nouvelle caméra MAMBO-2 (117
bolomètres fonctionnant à 1.3mm au 30m de l'IRAM), F.
Motte et S. Bontemps ont déjà cartographié l'émission
continuum à 1.3mm de l'ensemble du complexe Cygnus X
(3 deg2) situé à 1.7 kpc du Soleil (Motte, Bontemps et al.
en préparation). Il s'agit du premier relevé complet de ce
type à l'échelle d'un nuage moléculaire géant (« GMC »),
effectué avec une résolution spatiale suffisante (~ 0.1 pc)
pour identifier les proto-étoiles massives.
Les résultats partiels et préliminaires d'observations
complémentaires en cours indiquent la présence d'au
moins onze bons candidats proto-étoiles massives très
jeunes. Ce travail a déjà permis de multiplier par trois le
nombre connu de proto-étoiles massives de Classe 0.
Formation stellaire dans les
galaxies proches
Bien qu’ISO ait cessé de fonctionner à la mi-98, la
période 2000-2003 a coïncidé avec l’arrivée à maturité de
notre appareil d’interprétation de l’émission des galaxies
de l’Univers Local collectée par la caméra ISOCAM.
C’est en effet durant cette période que nous avons
consolidé nos méthodes d’analyse et que, l’arrivée dans le
domaine public de toutes les observations aidant, nous
avons pu constituer de larges échantillons de galaxies,
susceptibles d’être analysés de façon statistique.
Diagnostics de formation stellaire à
l’échelle des galaxies
Dans un premier temps, grâce au travail d’Olivier
Laurent, nous avons pu créer des outils de diagnostic
(figure 7) de l’activité des galaxies (Laurent et al. [10]).
En effet nous avons établi que l’émission ISOCAM des
galaxies autres qu’elliptiques peut avoir trois origines
distinctes : le milieu interstellaire diffus qui peut tirer son
énergie des diverses populations stellaires de la galaxie
(voir plus loin), les régions de formation stellaires de type
"starburst" et enfin les régions denses entourant les
disques d’accrétion des noyaux actifs de galaxies. Pour
chacune de ces origines nous avons mis en évidence des
caractéristiques propres du spectre ISOCAM 5-18 µm.
L'émission en provenance du milieu interstellaire diffus
présente les bandes des PAH de manière très contrastée,
superposées à un continuum très faible voire absent. Les
régions de formation stellaire de type "starburst"
présentent au contraire un continuum très fort, augmentant
avec la longueur d'onde duquel les bandes PAHs sont
généralement absentes. L'émission en provenance des
régions centrales des galaxies actives se présente aussi
sous la forme d'un continuum, mais sa pente est moins
forte que celle que peut atteindre le continuum des régions
"starburst" et surtout l'émission est très forte à courte
longueur d'onde (5-6 µm) signalant la présence de
poussières extrêmement chaudes, portées sans doute à la
limite de sublimation par le rayonnement très intense et
dur du noyau actif. Ces méthodes de diagnostic ne
s'appliquent pas qu'aux galaxies prises dans leur ensemble
et elles ont aussi été utilisées pour séparer les différentes
composantes de galaxies composites – "starburst"
entourant un noyau actif – ou en interaction (Le Floc'h et
al. [11]; Le Floc'h et al. [12]; Förster-Schreiber et al.
[13]). Evidemment ces diagnostics sont directement
exportables aux observations qui seront réalisées avec le
télescope de la NASA Spitzer (ex-SIRTF) .
Dans ces diagrammes, les galaxies spirales de l'Univers
Local occupent une zone assez bien définie et qui les
caractérise comme dominées par l'émission du milieu
interstellaire diffus. Cela peut paraître surprenant dans la
mesure où le taux de formation stellaire est assez variable
d'une galaxie à l'autre de l'échantillon ISOCAM. Le
travail d'analyse en profondeur d'Hélène Roussel (Roussel
et al. [14,15,16]) a permis de mieux comprendre les
mécanismes de génération de l'émission ISOCAM des
galaxies spirales et les relations qu'ils entretiennent avec
l'activité de formation stellaire.
Tout d'abord ce travail a permis de montrer que l'émission
ISOCAM des galaxies spirales présentait deux
composantes distinctes: celle en provenance du disque de
la galaxie, et celle en provenance de la région centrale. On
prendra garde de ne pas confondre cette région centrale ni
avec la zone possible d'un noyau actif, absent des galaxies
de l'échantillon, ni avec le bulbe stellaire, en général plus
étendu. Cette région centrale infrarouge est d'autant plus
lumineuse que la galaxie est de type précoce et présente
une barre stellaire, ce qui incline à penser que l'émission
infrarouge est due à une activité de formation stellaire
renforcée, mais pas encore de type "starburst". Pour ce qui
est de l'émission des disques, elle est remarquablement
uniforme d'un disque à l'autre et présente un spectre de
type région diffuse (proéminence des bandes PAH).
L'existence de cette uniformité de l'émission infrarouge
d'un disque à l'autre est surprenante alors que l'échantillon
couvre toute la séquence de Hubble, avec des activités de
formation stellaire variables. C'est en comparant
l'émission ISOCAM avec un traceur de formation stellaire
massive conventionnel – la raie de recombinaison de
l'hydrogène Hα – que l'on comprend ce qui se passe. Il
existe une corrélation très propre et linéaire entre
l'émission Hα et les émissions à 6.7 et 15 µm (figure 8).
Cette corrélation indique que c'est bien l'activité de
formation stellaire qui fournit son énergie à la poussière
observée avec ISOCAM. Mais le régime de formation
Figure 7: Diagrammes diagnostic de l'origine de l'émission des
galaxies observées avec ISOCAM. (D’après Laurent et al. [10].)
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%