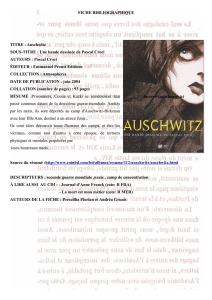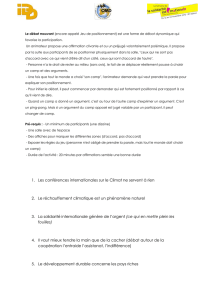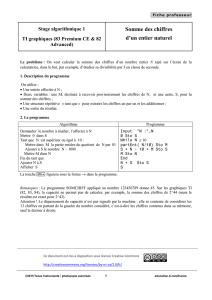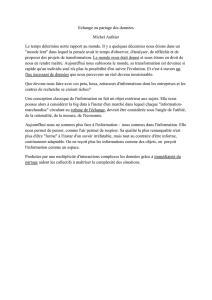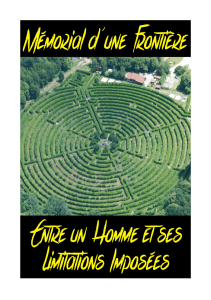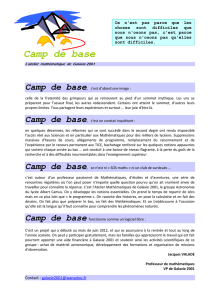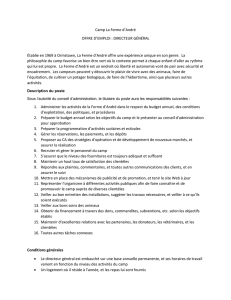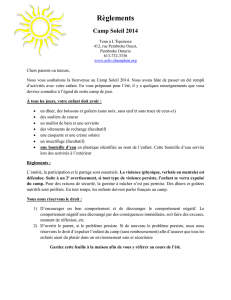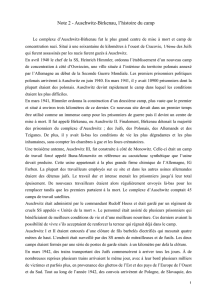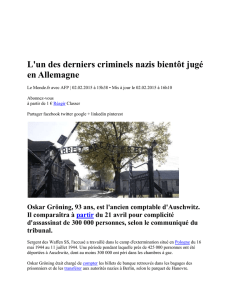Souvenirs d`un quart de siècle d`un jeune de Saint - Forez

Jean Chassagneux
Souvenirs
d'un quart de siècle
d'un jeune de Saint-Jean-Soleymieux
(1922-1948)
Cahier de Village de Forez

2
À la mémoire de
Georges Toupet décédé en juillet 2007
Henri France décédé en septembre 2007
et de tous les anciens qui nous ont quittés
Remerciements
- à Village de Forez qui m'a ouvert ses pages depuis 2000.
- à Joseph Barou qui m'a encouragé dans la recherche de mes souvenirs, à son épouse Colette pour la
relecture et la correction des textes.
Couverture : le vieux village du Crozet en 1920. En haut à gauche la ferme Chassagneux.

3
Devoir de mémoire
La France a célébré à grands frais le 90e anniversaire de l'Armistice du 11 novembre 1918. Les
derniers poilus ont disparu, mais le souvenir reste. Ce n'est pas nous qui avons inventé le devoir de mémoire.
Dans la Bible le psaume 136 évoque les déportés juifs à Babylone en 550 avant le Christ. Ils se souviennent
de leur patrie Jérusalem.
Au bord des fleuves de Babylone
Nous étions assis et nous pleurions
Nous souvenant de Sion.
Aux saules des alentours
Nous avions pendu nos harpes.
C'est là que nos vainqueurs
Nous demandèrent des chansons,
Et nos bourreaux des airs joyeux.
"Chantez-nous, disaient-ils
Quelque chant de Sion."
"Comment chanterions-nous
Un chant du Seigneur
Sur une terre étrangère ?"
Si je t'oublie Jérusalem
Que ma main droite m'oublie !
Je veux que ma langue
S'attache à mon palais
Si je perds ton souvenir,
Si je n'élève Jérusalem
Au sommet de ma joie.

4
Saint-Jean-Soleymieux
Petit séminaire de Montbrison Grand séminaire Saint-Irénée
Auschwitz
Collégiale Notre-Dame de Montbrison (2 juillet 1948)

5
Avant-propos
Les événements sont nos maîtres
Je tiens cette sentence de M. Chambost, ancien directeur de collège, mon voisin et paroissien à
l'Hôpital-sous-Rochefort dans les années 1965. Homme fort sympathique et de grande culture, il avait le don
de poser les bonnes questions : le pourquoi des choses. On était charmé de sa compagnie et on avait
l'impression de devenir un peu plus intelligent en l'écoutant. Il m'a répété plusieurs fois cette phrase : "Les
événements sont nos maîtres." Je ne l'ai pas oubliée et je la crois bien venue en relatant mes souvenirs de
jeunesse.
1 – "Souvenirs"
Village de Forez m'a déjà plusieurs fois ouvert ses pages : lexique de patois, contes et anecdotes en
cette langue, mon regard sur le haut Forez, STO, Auschwitz, Königstein… Ce dernier cahier relatait mon
aventure de jeune contraint à deux ans d'exil en Allemagne. On m'a invité à élargir mon regard sur une
période plus étendue. Ce que je vais réaliser dans ce livret.
Souvenirs… Au pluriel… Personnellement j'ai encore une assez bonne mémoire des événements du
passé, alors que se mélangent confusément ceux des dernières semaines. C'est le lot du grand âge. Un
camarade de STO évoquant naguère cette période me disait : "Je m'en souviens comme si c'était hier." C'est
aussi mon cas en ce qui concerne ces années tragiques. Je vais donc développer mes souvenirs de jeunesse
aussi fidèlement que possible.
Beaucoup se sont perdus en route. Ceux qui ont surnagé, encore très nombreux, sont le reflet de ce
que j'ai vécu. Je m'efforcerai d'être vrai, de ne rien embellir et de ne rien noircir. Je crois sincèrement à la
valeur et à la portée des souvenirs. Il ne faut pas les laisser perdre. "Jérusalem, que ma langue s'attache à
mon palais si je perds ton souvenir", dit le psaume 136. "On n'a pas d'avenir si on n'a pas de passé", a écrit
Fernand Braudel. À 86 ans mon avenir risque d'être assez court. Peu importe. Mes souvenirs permettront
peut-être aux jeunes générations de connaître un peu mieux l'histoire de notre pays. si c'est le cas, j'en serai
satisfait.
2 – "D'un quart de siècle"
Exactement 26 ans : 1922-1948. Voilà des années qui constituèrent une époque charnière, une
rupture entre deux mondes. Ma génération le sent lorsqu'elle évoque 1930 à des gens nés après 1950 et plus
tard. Les jeunes surtout ouvrent des yeux ébahis lorsque nous leur parlons de notre passé. Ils se demandent
dans quel monde nous avons vécu notre enfance. Parfois nous avons l'air de sortir de la préhistoire !...
Mais surtout ce quart de siècle a été dramatique et tourmenté, chez nous, en Europe et dans le
monde. Nous avons vécu la montée inexorable vers la guerre, avec des sentiments de mépris, de haine
souvent, vis-à-vis de nos voisins allemands. Nous avons traversé le conflit avec ces mêmes sentiments
encore exacerbés. Et au bout du chemin nous sommes enfin parvenus à la paix, après avoir réalisé une mue
intérieure qui a fait de nous d'autres hommes. Personnellement je me suis retrouvé serein, sans haine et
pacifié comme beaucoup d'autres. Cela a-t-il été le cas de la majorité ? Je n'ose pas l'affirmer.
Pendant les années tragiques de la guerre des gens, des jeunes, ont fait des choix différents, voire
opposés. Un de mes bons amis d'enfance et de petit séminaire s'est engagé dans la Wehrmacht, a été blessé
devant Moscou, et finalement a dû recourir à l'exil en Egypte. En revanche un collègue du grand séminaire,
Breton pur et dur, faisait partie de la célèbre 2e division blindée de général Leclerc, et il a connu la gloire de
libérer Paris en août 1944.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
1
/
90
100%