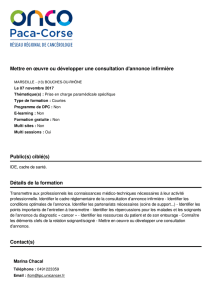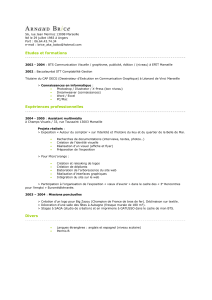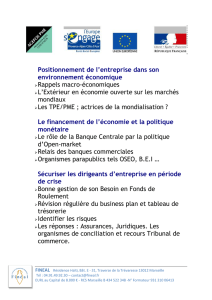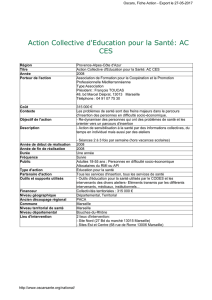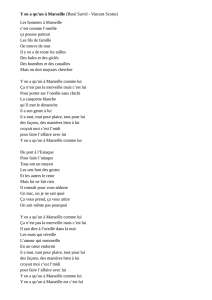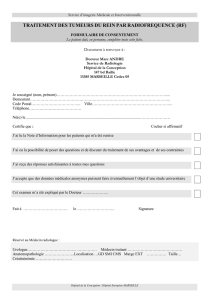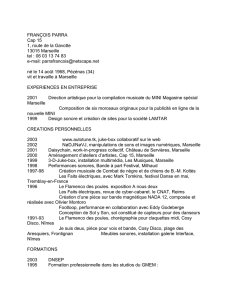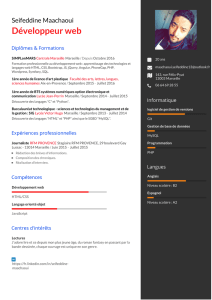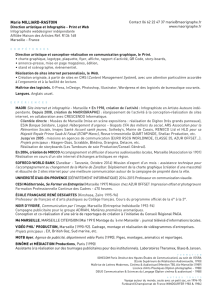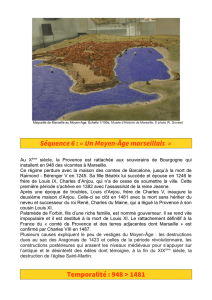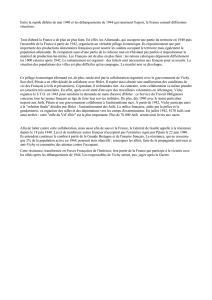téléchargez le dossier pédagogique

ABD Gaston-Defferre
18-20, rue Mirès 13003 Marseille
04 13 31 82 00
www.archives13.fr
Entrée libre
du lundi au samedi 10h - 18h
Crédits photographiques : Guy Bargin ; Site Mémorial du camp des Milles, AD13
1943/1946
Exposition itinérante du Semi des Archives
Libération des Bouches-du-Rhône
Archives départementales
DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Du 20 septembre 2014 au 15 juin 2016

Les archives hors les murs
Les Archives des Bouches-du-Rhône participent très activement aux actions commémoratives du 70e
anniversaire de la Résistance, des débarquements, de la Libération de la France et de la victoire sur le
nazisme.
Dans le cadre de ce cycle mémoriel, le Semi des Archives, espace itinérant ouvert sur les enjeux de
Mémoire et d’Histoire, présente, jusqu’en juin 2016, l’exposition « 1943-1946 : Libération des Bouches-
du-Rhône ».
Sillonnant le département, s’arrêtant dans les communes qui en font la demande, le Semi des Archives
part à la rencontre d’un large public pour expliquer cette période historique pendant laquelle le territoire
de Provence renoue avec la liberté retrouvée.
A travers une centaine de documents issus des archives publiques ou privées, des fonds judiciaires et de
police, des dossiers de dommage de guerre, l’exposition retrace cette époque troublée de fin de guerre et
rappelle que si la Libération fut un immense soulagement, les lendemains demeurèrent difficiles.
Une exposition à voir absolument !
Martine VASSAL
Présidente du Conseil Départemental
des Bouches-du-Rhône
Rédaction du dossier pédagogique : Kaïs Gharsallah
Exposition 1943 – 1946 : libération des Bouches-du-Rhône
Recherche documentaire et conception scientifique : Kaïs Gharsallah, professeur d’histoire au
service éducatif des AD13, Isabelle Langlade-Savi, responsable du secteur éducatif et culturel
des AD13.
Recherches iconographiques : Sonia Mahinc, Sabine Raucoule, chargée des actions pédagogiques
AD13
Conception pédagogique : Kaïs Gharsallah, Sabine Raucoule
Graphisme : Saluces
Impression : Quadrissimo
Numérisation des visuels : Vanessa Barrazza Studio photo Archives départementales des Bouches-
du-Rhône
Le Semi des Archives
Espace itinérant d’exposition, il permet de diffuser et valoriser les archives auprès des établisse-
ments scolaires, mais aussi, lors de festivités à caractère culturel auprès du grand public, et ce
dans toutes les communes des Bouches-du-Rhône.
Le Semi propose une découverte originale des archives, favorisant l’appropriation d’un héritage
culturel local, tout en soulevant des questions d’actualité.
Renseignements et réservations : www.archives13.fr et 04 13 31 82 28

Sommaire
Introduction ........................................................................... p 5
La résistance et la libération ...................................................... p 13
La reconstruction ..................................................................... p 21
Bibliographie .......................................................................... p 23

Introduction
1943 -1946 :
La libération des
Bouches-du-Rhône
Introduction
L’année 1942 est connue pour être l’année noire de la guerre. Au sortir d’un hiver dont la rudesse
s’est fait ressentir par bon nombre d’entre eux, les Français prennent conscience qu’une défaite de
l’Allemagne, bientôt vaincue par la coalition mondiale menée par les États-Unis, le Royaume-Uni
et l’URSS, est une illusion. En effet, en dépit du coup d’arrêt porté à la Wehrmacht devant Moscou
par l’Armée Rouge en janvier 1941, l’offensive allemande permet aux troupes du Reich d’atteindre
le Caucase et la moyenne Volga dès le mois de mai 1942. Dans le même temps, l’Afrika Korps de
Rommel lance l’assaut contre l’Égypte, tandis que les U-Boot font de l’océan Atlantique un espace
fort périlleux pour les navires qui ravitaillent le Royaume-Uni. Enfin, l’échec des débarquements
anglo-canadiens à Saint-Nazaire en mars 1942 et à Dieppe en août 1942, habilement exploité par
les propagandes nazie et vichyste, renforce le sentiment d’invulnérabilité de la Wehrmacht.
Toutefois, la résistance soviétique conduit inexorablement les Allemands à accroître leurs efforts
militaires. Aussi Hitler et son état-major abandonnent-ils la stratégie de la « guerre éclair » au
profit de la « guerre totale », jetant les bases d’une exploitation massive des territoires occupés,
au premier rang desquels, la France. Pour celle-ci, les conséquences de la défaite se font plus
lourdement sentir. Divisé en une « zone occupée » et une « zone non occupée » après l’armistice
conclu le 22 juin 1940, le pays doit faire face au pillage de ses ressources, à la désorganisation de son
économie, à la rétention en Allemagne de 1,8 millions de prisonniers de guerre et au paiement d’une
indemnité de 400 millions de francs par jour au titre des frais d’entretien des troupes d’Occupation.
La pénurie généralisée qui s’installe alors conduit le gouvernement de Vichy à mettre en place un
rationnement qui touche tous les produits de consommation courante et pousse les Français à
recourir au « système D ». Enfin, l’occupant exige que des travailleurs soient envoyés dans les usines
allemandes pour participer à l’effort de guerre. Dans les départements annexés de l’Alsace et de la
Moselle, le service du travail obligatoire (STO) est décrété en mars 1942, tandis que Laval, revenu au
pouvoir, négocie avec Sauckel l’accord conduisant à la mise en place de la Relève en juin 1942. En
septembre 1942, face à l’échec de ce dispositif, Vichy prend à son compte les mesures déjà édictées
par Sauckel pour les territoires occupés et impose le STO aux Français.
P. 5 P. 6
Prédatrices, agressives et vexatoires, ces mesures renforcent l’hostilité à l’égard de l’occupant et
favorisent, en zone occupée, la multiplication d’attentats et d’actes de sabotage toujours plus
audacieux qui provoque le renforcement de l’appareil répressif allemand. De nouvelles garnisons de
soldats sont installées dans des localités jusque-là épargnées ; les réquisitions d’édifices publics
s’accroissent. Par ailleurs, dès le mois d’avril 1942, la Gestapo installe ses Kommando de policiers
auprès de chaque Feldkommandantur. Désormais, le maintien de l’ordre et la répression de la
Résistance sont confiés à la direction de la SS, dont le chef en France, le général SS Karl Oberg,
négocie avec Bousquet, secrétaire général de la Police française de Vichy, un accord de coopération.
C’est finalement d’Afrique du Nord que des nouvelles encourageantes parviennent aux Français : les
Forces Françaises Libres (FFL) du Général Leclerc, parties du Tchad, conquièrent les oasis italiens du
Fezzan ; puis, sous la conduite du général Koenig, elles s’opposent à l’Afrika Korps lors de la bataille
de Bir Hakeim en mai-juin 1942 et apportent un soutien au général Montgomery lors de la bataille
d’El Alamein en octobre-novembre 1942. Enfin, le 8 novembre 1942, les troupes alliées débarquent
en Afrique du Nord.
Toutefois, les espoirs des populations sont rapidement déçus. Loin d’annoncer la libération prochaine
de la France, le débarquement anglo-saxon précipite le franchissement de la ligne de démarcation
par les troupes allemandes qui s’installent dans l’ancienne zone libre. L’occupation devient ainsi
l’ordinaire des habitants du département des Bouches-du-Rhône.
L’aventure de Célestin Tournevis
, extrait d’une bande dessinée évoquant le travail en Allemagne, AD13, 8 W 40

Partie 1 : L’Occupation
I. L’OCCUPATION
Le 8 novembre 1942, dans le cadre de l’opération Torch, les troupes américano-britanniques
débarquent en Afrique du Nord. Dès l’aube, les premières unités prennent pied sur le sol marocain,
dans l’Oranie et l’Algérois. En dépit des protestations du maréchal Pétain qui condamne le
débarquement, et des combats qui opposent les troupes françaises fidèles à Vichy aux Alliés,
un cessez-le-feu est rapidement négocié à Alger entre le commandant du corps expéditionnaire
américain, le général Clark, et l’amiral Darlan, ministre de Vichy. Le 10 novembre, cet accord est
étendu à l’ensemble de l’Afrique du Nord, à l’exception de la Tunisie où des troupes allemandes
débarquent le 12, sans opposition aucune de l’armée de Vichy.
Accueillie avec satisfaction par la population provençale, la nouvelle du débarquement allié
provoque la riposte du commandement allemand dès le 11 novembre : suivant les consignes de
l’opération Anton, la Wehrmacht franchit la ligne de démarcation et envahit la zone sud. Acheminées
par train, les troupes allemandes dépassent Avignon et arrivent à Marseille dans les gares d’Arenc,
du Canet et du Prado. Dans le même temps, des convois composés de plusieurs centaines de
véhicules longent la vallée du Rhône. Dans le département des Bouches-du-Rhône, l’avant-garde
allemande est repérée dans la périphérie de Marseille à 4 heures du matin. La première colonne fait
son entrée dans la ville à 8 heures et traverse les artères principales avant de stationner sur le Prado.
P. 7
Partie 1 : L’Occupation
P. 8
Les troupes transalpines sont associées à l’occupation de la zone sud et semblent livrer une véritable
course de vitesse aux armées allemandes. Les éléments disponibles de la IVe armée traversent la
ligne de démarcation près de Menton le 11 novembre et atteignent Valence dans la nuit du 12 au 13
novembre. Des avant-gardes sont signalées dans les heures suivantes près d’Arles, où elles laissent
un détachement avant d’effectuer un repli sur Aix-en-Provence.
Après avoir donné l’assurance aux autorités de Vichy que Toulon ne serait pas occupée, le
commandement allemand lance l’opération Lila. La ville est investie le 27 novembre tandis que la
flotte se saborde. Au même moment, les casernes de l’armée d’armistice, nombreuses à Marseille,
sont assiégées. Le personnel militaire est ensuite désarmé, du matériel et des munitions sont saisis.
Alors, l’image d’une France indépendante, image largement répandue par la propagande vichyste,
se brise définitivement.
C’est au mois de décembre que le plan de partage de l’ancienne zone libre est définitivement
adopté. Les Allemands s’installent dans les territoires qui longent le Rhône ainsi que sur le littoral
méditerranéen jusqu’à La Ciotat. Ils contrôlent donc l’essentiel du département des Bouches-
du-Rhône. S’ajoutent à ce territoire des zones stratégiques qui s’étendent profondément dans le
département du Var. Les Italiens, quant à eux, doivent se contenter des Alpes-Maritimes, d’une
partie du département du Var et de quelques cantonnements symboliques dans les Bouches-du-
Rhône, notamment près d’Aix-en-Provence, de l’étang de Berre et à Marseille.
De fait, l’occupation ne se fait pas sans heurts. L’arrivée des troupes germano-italiennes
s’accompagne d’incidents nombreux. Qu’il s’agisse d’actes symboliques, telle la dégradation d’un
monument aux morts à Roquevaire, ou de violences physiques, telle la tentative de viol d’une
jeune femme près de Septèmes, l’attitude des soldats inquiète. Une fois encore, contrairement
aux promesses faites par le commandement allemand, des confiscations sont opérées au profit
des occupants. De nombreux édifices publics (écoles, universités) et privés (hôtels, villas) sont
réquisitionnés pour loger la troupe. La Wehrmacht réclame aussi la mise à disposition quotidienne
de 40 camions et n’hésite pas à les confisquer sur la voie publique lors de contrôles routiers. Elle
s’empare des entrepôts portuaires de Marseille et de La Ciotat et contribue à l’extinction presque
totale de l’activité des ports. Enfin, pour leur divertissement, les officiers allemands réclament et
obtiennent gracieusement des places pour assister aux représentations de l’opéra de Marseille.
La pression sur la population s’accentue davantage dans les semaines qui suivent l’installation
allemande. Prenant prétexte d’attentats commis le 3 janvier 1943 à Marseille par les francs-tireurs
et partisans – main d’œuvre immigrée (FTP-MOI) contre les troupes d’occupation, le Reischsfürer-
SS Himmler donne l’ordre de frapper durement la ville qu’il accuse d’être un repaire de « criminels ».
Il réclame non seulement l’arrestation et la déportation dans les camps de concentration en
Allemagne des « saboteurs » mais aussi la destruction des quartiers qui les abritent.
Entrée des troupes allemandes dans les Bouches-du-Rhône, rapport du commissaire principal chargé du service, 12 novembre 1942, AD 13, 76 W 118
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
1
/
15
100%