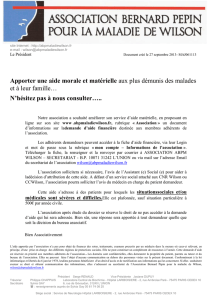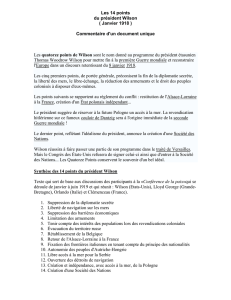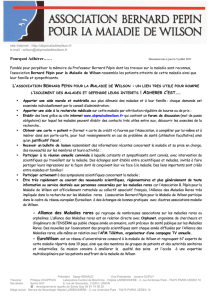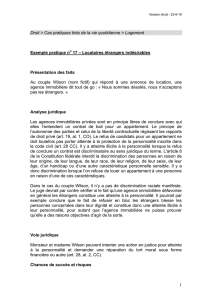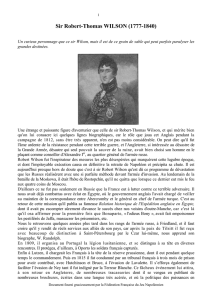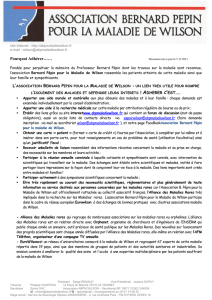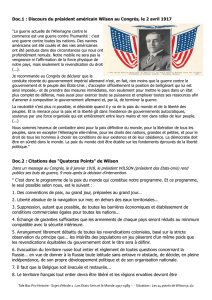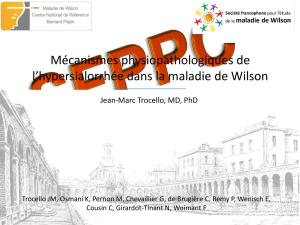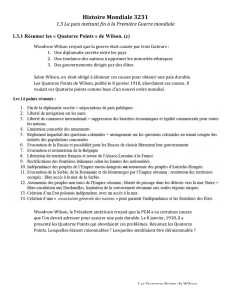Mode d`entrée psychiatrique dans la maladie de Wilson

L’Enc´
ephale (2007) 33, 924—932
journal homepage: www.elsevier.com/locate/encep
CAS CLINIQUE
Mode d’entr´
ee psychiatrique dans la maladie de
Wilson : `
a propos d’un cas `
ad
´
ebut tardif
The onset of psychiatric disorders and
Wilson’s disease
T. Benhamlaa, Y.D. Tirouchea, A. Abaoub-Germain b,∗, F. Theodorea
a15—17, rue du Clos-B´
enard, EPS de Ville-Evrard, secteur 93G06, 93300 Aubervilliers, France
b17, rue Charles-Tillon, 93300 Aubervilliers, France
Rec¸u le 1 avril 2005 ; accept´
ele28ao
ˆ
ut 2006
Disponible sur Internet le 5 septembre 2007
MOTS CL´
ES
Maladie de Wilson ;
Troubles
psychiatriques
polymorphes ;
Autosomie r´
ecessive ;
Anneau de
Kayser-Fleischer ;
Cupr´
emie, cupriurie ;
C´
eruloplasmine ;
Traitement `
a vie
Résumé Décrite en 1912, la maladie de Wilson est une pathologie rare, autosomique réces-
sive, résultant d’une perte de fonction d’une adénosine triphosphatase (ATP7B ou WDNP)
secondairement à une mutation, insertion ou délétion du gène ATP7B situé sur le chromosome
13q14.3—q21.1. Cela entraîne une diminution ou une absence du transport du cuivre dans la
bile et son accumulation dans les organes, en particulier le cerveau. Elle débute sous la forme
d’une maladie hépatique, neurologique ou psychiatrique chez au moins 90 % des patients. Les
formes se révélant au-delà de 50 ans sont rares. Chez certains patients, l’atteinte du système
nerveux central peut être prédominante. La maladie de Wilson peut alors se traduire par des
troubles du comportement, une dépression ou par une psychose impossible à distinguer d’une
schizophrénie ou d’une psychose maniacodépressive. L’association d’une céruloplasmine basse,
d’un anneau de Kayser-Fleischer, d’une cuprémie basse et d’une cuprurie élevée permettent
de poser le diagnostic. En cas d’hémolyse, la cuprémie peut être élevée. L’IRM peut retrou-
ver des anomalies de signal des noyaux gris centraux, de la substance blanche et du tronc.
L’étude génétique est actuellement réalisée de deux fac¸ons. En cas d’antécédent familial par
l’analyse de liaison (dans le cadre du dépistage familial) et par recherche directe de mutation,
c’est-à-dire par diagnostic génotypique direct (différentes mutations peuvent être constatées
au sein d’une même famille, ainsi qu’une diversité d’expression phénotypique d’organe parmi
les membres d’une fratrie porteur de la même mutation). Nous présentons un cas clinique ori-
ginal où l’entrée dans la maladie de Wilson prend la forme d’un tableau de psychose tardive
de l’adulte. Bien que rare, la maladie de Wilson est importante à aborder en psychiatrie car
∗Auteur correspondant.
Adresse e-mail : [email protected] (A. Abaoub-Germain).
0013-7006/$ — see front matter © L’Enc´
ephale, Paris, 2007.
doi:10.1016/j.encep.2006.08.009

Mode d’entr´
ee psychiatrique dans la maladie de Wilson 925
les manifestations psychiatriques peuvent pr´
ec´
eder les troubles somatiques et aider `
a poser le
diagnostic. Nous soulignons l’importance du diagnostic pr´
ecoce d’une pathologie dont l’issue
est fatale en absence d’un traitement sp´
ecifique.
© L’Enc´
ephale, Paris, 2007.
KEYWORDS
Wilson’s disease;
Polymorphous
psychotic disorder;
Autosomal recessive;
Kayser-Fleischer’s
ring;
Ceruloplasmin;
Treatment for life
Summary Wilson’s disease is an infrequent, autosomic recessive pathology, resulting from a
loss of function of an adenosine triphosphatase (ATP7B or WDNP), secondarily to a change (more
than 60 are described currently), insertion or deletion of the ATP7B gene located on the chro-
mosome 13q14.3—q21.1, which involves a reduction or an absence of the transport of copper in
the bile and its accumulation in the body, notably the brain. Wilson’s disease is transmitted by
an autosomic recessive gene located on the long arm of chromosome 13. The prevalence of the
heterozygote is evaluated at 1/90 and the homozygote at 1/30,000. Consanguinity, frequent
in the socially geographically isolated populations, increases the prevalence of the disease.
The toxic quantities of copper, which accumulate in the liver since early childhood and per-
haps before, remain concentrated in the body for years. Hence, cytological and histological
modifications can be detected in the biopsies, before the appearance of clinical or biological
symptoms of hepatic damage. The accumulation of copper in the liver is due to a defect in the
biliary excretion of metal and is accompanied invariably by a deficit in ceruloplasmin; protein
synthesized from a transferred ATP7B gene, which causes retention of the copper ions in the
liver. The detectable cellular anomalies are of two types: hepatic lesions resulting in acute
hepatic insufficiency, acute hepatitis and finally advanced cirrhosis and lesions of the central
nervous system responsible for the neurological and psychiatric disorders. In approximately
40—50% of the patients, the first manifestation of Wilson’s disease affects the central nervous
system. Although copper diffuses in the liver towards the blood and then towards other tissues,
it has disastrous consequences only in the brain. It can therefore cause either a progressive
neurological disease, or psychiatric disorders.
Wilson’s disease begins in the form of a hepatic, neurological, or psychiatric disease in at least
90% of the patients. In some rare cases, the first manifestations of the disease can be psychiatric
which, according to the literature, accounts for only 10% of the cases. The disease can be
revealed by isolated behavioral problems, an irrational syndrome, a schizophrenic syndrome,
or a manic-depressive syndrome. Damage to the central nervous system can be more severe,
thus, several differential diagnoses have been discussed:
•a psychotic disorder of late appearance;
•a depressive state;
•a mental confusion disorder.
The clinical syndrome is complex. Indeed, it is the polymorphism, which dominates in the des-
cription of the psychiatric demonstrations of the disease. This can lead to prejudicial diagnostic
wandering, particularly since heavy sedative treatment may be required to suppress behavioral
problems.
Clinically, Wilson’s disease generally appears between the age of 10 and 20. It rarely remains
masked until after the age of 40. The first manifestations are hepatic (40% of the cases), neuro-
logical (35%) or psychiatric (10%). The inaugural disorder can finally take on a haematological,
renal, or mixed form in approximately 15% of the cases. We have detailed the principal clini-
cal elements. In approximately 40—50% of the patients, the first manifestation of the disease
affects the central nervous system, where it can cause either a progressive neurological disease,
or psychiatric disorders.
The ophthalmologic disorder is dominated by Kayser-Fleischer’s ring, representing a green
or bronze colored ring on the periphery of the cornea. It occupies the higher pole of the cor-
nea, then the lower pole, and extends to the whole circumference. It is generally only visible
under examination with a slit lamp. It disappears on average within 3—5 years following copper
chelating therapy. Kayser-Fleischer’s ring has been described other than in Wilson’s disease,
in exceptional cases of prolonged cholestasis. On haematological level, the hyperhaemolysis
is due to the toxicity of the ionic copper, released massively in the plasma by hepatocellular
necrosis. The other manifestations can be found in the following organs: renal, osteoarticular,
cardiac, endocrine, cutaneous, and in the teguments.
Until 1952, the diagnosis was evoked only on clinical symptomatology. It can henceforth be
marked unambiguous, even in the absence of any symptom, by the description of a ceruloplas-
min plasma concentration of less than 200 ml/l, and of a Kayser-Fleischer’s ring. Hepatic copper
on sample is constantly increased during the disease (from 3 to 25 mol/g of dry weight). On the

926 T. Benhamla et al.
other hand, the absence of a reduction in the plasma ceruloplasmin does not make it possible to
exclude the diagnosis. Conversely, a reduction in ceruloplasmin can exist other than in Wilson’s
disease (nephritic syndrome, malabsorption syndrome, or severe hepatic insufficiency).
Kayser-Fleischer’s ring is quasiconstant among patients with neuropsychiatric demonstrations
(thus, its absence represents a very strong argument against the diagnosis). It can on the other
hand be lacking during hepatic forms, and in this case, its absence is not an argument against the
diagnosis. Magnetic resonance imaging can reveal abnormal signals of the grey cores. A genetic
study is conducted by liaison analysis in the event of a family history of the disease.
When it is not treated, Wilson’s disease induces lesions of the tissues, the outcome of which is
always fatal. Treatment relies on the regulation of copper chelation, which improves the prog-
nosis, and zinc, which captures the copper in a nontoxic form. The severe psychiatric disorders
observed during Wilson’s disease may require tranquilizers, but care should be taken because
of potential neurological or hepatic side effects. Lithium seems an interesting treatment and
remains theoretically indicated, taking into account the scarcity of the extrapyramidal symptoms
and the hepatic dysfunction among patients at the stage of cirrhosis, since it is not metabolized
in the liver.
Although rare, it is important to approach Wilson’s disease in psychiatry because the psychiatric
manifestations can precede the somatic disorders and help to pose the diagnosis. We stress the
importance of the early diagnosis of the pathology, the outcome of which is fatal in the absence
of specific treatment.
© L’Enc´
ephale, Paris, 2007.
Introduction
La maladie de Wilson est une affection h´
er´
editaire au cours
de laquelle un d´
efaut de l’excr´
etion biliaire du cuivre
conduit `
a son accumulation excessive dans l’organisme.
Cette accumulation se manifeste presque exclusivement par
des anomalies h´
epatiques et neuropsychiques. En 1912, Wil-
son [24] donna le nom de «d´
eg´
en´
erescence lenticulaire
progressive »`
a un syndrome familial rare et toujours fatal
de l’enfance, constamment associ´
e`
a une cirrhose du foie
et responsable de troubles psychomoteurs graves. Wilson
pr´
evoyait que le foie se r´
ev`
elerait ˆ
etre `
a l’origine de ce qu’il
nomma «l’agent pathog`
ene »de la maladie [21]. Celui-ci fut
identifi´
e comme ´
etant le cuivre en 1948.
Bien que cette affection soit rare, il est important
de connaˆ
ıtre ses manifestations. En effet, le diagnostic
´
evoqu´
e peut ˆ
etre rapidement confirm´
e par des investiga-
tions simples. Nous rapportons dans cet article l’histoire
d’un patient pr´
esentant des manifestations psychiatriques
inaugurales de la maladie de Wilson.
Vignette clinique
En janvier 2000, Monsieur B., 53 ans, est accompagn´
e par
sa famille aux urgences psychiatriques du centre hospita-
lier universitaire de Constantine (Alg´
erie). Il pr´
esente des
troubles du comportement ´
evoluant depuis plusieurs mois.
La famille rapporte un changement progressif d’attitude
du patient. Depuis environ six mois, Monsieur B. s’isole,
reste mutique plusieurs heures, se met en retrait de la vie
familiale. Cette modification du comportement est d’abord
discr`
ete, Monsieur B. vit en famille dans une zone rurale, il
est mari´
eetp
`
ere de trois enfants. La notion de consangui-
nit´
e des parents de Monsieur B. est rapport´
ee. Il n’existe
pas d’ant´
ec´
edents psychiatriques personnels ni familiaux
connus. Monsieur B. poursuit son activit´
e professionnelle, il
est employ´
e dans une usine de mat´
eriaux plastiques depuis
une trentaine d’ann´
ees. Depuis trois semaines, les troubles
du comportement s’aggravent, Monsieur B. pr´
esente une
bizarrerie, des crises d’agitation inexpliqu´
ees, une inversion
du rythme nycth´
em´
eral, une inapp´
etence alimentaire. Ses
propos sont incompr´
ehensibles pour l’entourage. Monsieur
B. passe ses journ´
ees, en partie, prostr´
e`
a l’int´
erieur de son
domicile.
L’examen `
a l’admission retrouve une pr´
esentation fig´
ee,
un ´
etat de perplexit´
e anxieuse. `
A l’entretien le contact
est laborieux, les r´
eponses sont laconiques mais le patient
est vigilant, l’orientation dans l’espace est pr´
eserv´
ee mais
perturb´
ee dans le temps. Des troubles de la m´
emoire sont
not´
es `
a type d’amn´
esie lacunaire et r´
etrograde. L’humeur
est triste avec un ralentissement psychomoteur av´
er´
eet
des id´
ees suicidaires. Les propos spontan´
es sont incoh´
erents
(n´
eologismes) sans organisation d´
elirante v´
eritable. Mon-
sieur B. est admis dans un service de psychiatrie en urgence.
Le diagnostic de trouble psychotique probable est retenu.
L’examen somatique `
a l’admission note une h´
epatom´
egalie
et un syndrome ict´
erique discret. Un bilan organique com-
plet est prescrit, un traitement `
a base de psychotropes est
instaur´
e (antid´
epresseur : amitryptiline, 80 mg/jour et neu-
roleptique : halop´
eridol, 10 mg/jour).
L’´
evolution clinique r´
ev`
ele un tableau tr`
es fluctuant au
cours des premiers jours d’hospitalisation, non am´
elior´
e par
la chimioth´
erapie. Une semaine apr`
es l’admission, Monsieur
B. pr´
esente des h´
emorragies digestives hautes de moyenne
abondance `
a type d’h´
emat´
em`
ese imposant son transfert
en service de m´
edecine. L’examen clinique retrouve un
patient ict´
erique avec une h´
epatom´
egalie, des troubles neu-
rologiques `
a type de tremblements des extr´
emit´
es et un
syndrome c´
er´
ebelleux. L’exploration paraclinique met en
´
evidence une an´
emie h´
emolytique avec un test de Coombs
n´
egatif, des varices oesophagiennes et une gastropathie
hypertensive `
a la fibroscopie digestive haute. La ponc-
tion biopsie du foie et son analyse anatomopathologique
d´
ec`
ele une cirrhose h´
epatique install´
ee, avec un taux anor-
malement ´
elev´
e de cuivre au niveau des h´
epatocytes. La

Mode d’entr´
ee psychiatrique dans la maladie de Wilson 927
cupr´
emie et la cuprurie dos´
ees secondairement sont au-
dessus des valeurs physiologiques (cupr´
emie `
a75mol/l et
cuprurie `
a10mol/l). Le taux de c´
eruloplasmine est alors
de 13 mg/dl. L’examen ophtalmologique `
a la lampe `
a fente
r´
ev`
ele l’anneau de Kayser-Fleischer. Le diagnostic de mala-
die de Wilson est ´
etabli.
Un traitement curateur par d-p´
enicillamine est pro-
pos´
e, l’´
evolution `
a trois mois retrouve une r´
egression des
´
el´
ements neurologiques, en particulier des tremblements.
En revanche chez Monsieur B., les complications de la
cirrhose telles que l’ascite et les h´
emorragies digestives
perdurent. L’´
evolution psychiatrique `
a cours terme est
d´
efavorable avec peu d’am´
elioration clinique `
a trois mois :
le tableau est marqu´
e par des troubles du comportement
variables, des ´
el´
ements de la s´
erie psychotique peu modifi´
es
par un traitement psychotrope bien conduit, une confusion
mentale fluctuante. Le patient issu d’un milieu rural ´
eloign´
e
du centre hospitalier universitaire ne s’est pas pr´
esent´
e aux
consultations ult´
erieures malgr´
e les sollicitations par cour-
rier.
Discussion
Chez certains sujets, la maladie de Wilson peut ˆ
etre r´
ev´
el´
ee
par des troubles du comportement isol´
es, un syndrome
d´
ementiel, un syndrome schizophr´
enique ou un syndrome
maniacod´
epressif. Nous y reviendrons dans la description
des manifestations cliniques g´
en´
erales de la maladie de Wil-
son. Chez Monsieur B., les premi`
eres manifestations de la
maladie de Wilson sont psychiatriques, ce qui repr´
esente
selon la litt´
erature seulement 10 % des cas. L’atteinte du
syst`
eme nerveux central a ´
et´
e, semble-t-il, isol´
ee au d´
ebut,
ainsi le patient a ´
et´
e hospitalis´
e en psychiatrie car plusieurs
diagnostics diff´
erentiels se discutaient :
•un tableau de psychose d’apparition tardive devant l’ˆ
age
du sujet (53 ans), l’´
evolution insidieuse des troubles,
les bizarreries du comportement, l’agitation nocturne. Il
n’apparaissait pas cependant d’organisation d´
elirante ni
d’´
el´
ements dissociatifs ;
•un ´
etat d´
epressif, ´
evoqu´
e devant la pr´
esence d’une tris-
tesse, d’un retrait, d’un mutisme, de troubles du sommeil
et de l’app´
etit, et des vell´
eit´
es suicidaires (crit`
eres DSM
IV de d´
epression majeure) ;
•un tableau de confusion mentale, ´
evoqu´
e devant la
d´
esorientation temporospatiale, les troubles mn´
esiques.
Le tableau clinique est complexe, c’est en effet le
polymorphisme qui domine dans la description des manifes-
tations psychiatriques de la maladie. Cela peut conduire `
a
une errance diagnostique pr´
ejudiciable, d’autant plus qu’un
traitement s´
edatif important peut ˆ
etre n´
ecessaire pour
juguler les troubles du comportement. Wilson d´
ecrivait en
1912 une «grande variabilit´
e des alt´
erations mentales, `
ala
fois dans leur intensit´
e et leur forme »[24]. L’auteur pensait
que les symptˆ
omes psychiatriques «formaient une impor-
tante, quoique peut-ˆ
etre pas int´
egrante, partie du tableau
clinique »et il commentait d`
es lors que «les symptˆ
omes psy-
chotiques ne sont pas transitoires, alors que les d´
esordres
affectifs sont fr´
equents mais variables »[24]. Dans ce cas cli-
nique, le diagnostic est tardif, `
a l’occasion d’une h´
emorragie
digestive signant une maladie de Wilson `
a un stade avanc´
e
(cirrhose compliqu´
ee). Les donn´
ees de la litt´
erature rap-
portent actuellement un d´
elai moyen de deux ans entre
l’apparition des premiers symptˆ
omes et le diagnostic de
la maladie. Ainsi, Prashanth et al. [18], dans une ´
etude
r´
etrospective concernant 140 patients, rapportent l’analyse
d’un ´
echantillon de patients s´
ev`
erement atteints par la
maladie (11 filles, 18 garc¸ons). L’ˆ
age moyen d’apparition des
premiers symptˆ
omes est 11,5 ans (±6,4) et l’ˆ
age moyen dans
l’´
echantillon au moment du diagnostic est 13,3 ans (±7,0).
Par ailleurs, la maladie de Wilson se manifeste le plus
souvent entre 10 et 20 ans, rarement `
aunˆ
age aussi avanc´
e
que chez Monsieur B. La maladie est rare, voire exception-
nelle apr`
es 40 ans. Bellary et Vian Thiel [5] rapportent en
1993 deux cas cliniques `
ar
´
ev´
elation tardive, avec une mode
d’entr´
ee h´
epatique (chez une femme de 42 ans) ou neurolo-
gique (chez un patient de 56 ans). L’auteur souligne la raret´
e
des formes qui se r´
ev`
elent `
aunˆ
age aussi avanc´
e. L’histoire
clinique de Monsieur B. nous permet d’attirer l’attention
sur une maladie rare, qui peut se r´
ev´
eler tardivement, au-
del`
a de 50 ans, et dont le diagnostic est relativement facile.
Chez les patients qui pr´
esentent une maladie psychiatrique,
l’existence d’un d´
eficit en c´
eruloplasmine pose le diagnostic
de maladie de Wilson confirm´
e par la d´
etection de l’anneau
de Kayser-Fleischer `
a l’examen `
a la lampe `
a fente.
La maladie de Wilson, bien que rare, a toute son
importance en psychiatrie car sa psychopathologie et ses
manifestations psychiatriques peuvent pr´
ec´
eder les troubles
somatiques et orienter le diagnostic. Par ailleurs, ces mani-
festations peuvent r´
egresser apr`
es un traitement ch´
elateur
du cuivre ; mais plus le diagnostic est tardif, plus les chances
de r´
egression sont faibles [8]. En raison de sa raret´
e, le
diagnostic est rarement pos´
e. Nous proposons d`
es lors de
d´
etailler cette pathologie g´
en´
etique peu courante.
´
Epidemiologie et pathog´
enie
Maladie h´
er´
editaire du m´
etabolisme du cuivre, la maladie
de Wilson est transmise par un g`
ene autosomique r´
ecessif
localis´
e sur le bras long du chromosome 13. Elle touche
les sujets ayants deux all`
eles d’ad´
enosine triphosphatase
(ATP7B mut´
es) et se caract´
erise par l’accumulation de quan-
tit´
es excessives de cuivre dans le foie, le syst`
eme nerveux
central, les yeux et d’autres organes [19].
Ce g`
ene anormal semble pr´
esent dans tous les groupes
ethniques ; la pr´
evalence des porteurs h´
et´
erozygotes est
´
evalu´
ee `
a 1/90 et celle des porteurs homozygotes `
a
1/30 000. La consanguinit´
e, fr´
equente dans les populations
g´
eographiquement ou socialement isol´
ees, augmente la
pr´
evalence de la maladie. Les quantit´
es toxiques de cuivre,
qui s’accumulent dans le foie d`
es la petite enfance et peut-
ˆ
etre avant, restent concentr´
ees dans cet organe pendant
des ann´
ees [19]. Ainsi, les modifications cytologiques et his-
tologiques peuvent ˆ
etre d´
etect´
ees dans les pr´
el`
evements
biopsiques avant l’apparition de symptˆ
omes cliniques ou bio-
logiques d’atteinte h´
epatique.
L’accumulation du cuivre dans le foie est due `
aund
´
efaut
de l’excr´
etion biliaire du m´
etal et s’accompagne invariable-
ment d’un d´
eficit en c´
eruloplasmine ; prot´
eine synth´
etis´
ee
`
a partir d’un g`
ene ATP7B mut´
e, ce qui entraˆ
ıne la r´
etention
des ions cuivres dans le foie. Le d´
efaut d’excr´
etion biliaire

928 T. Benhamla et al.
Tableau 1 R´
esum´
e des donn´
ees de patients atteints de maladie de Wilson, de porteurs h´
et´
erozygotes et de sujets normaux
[9].
Groupe C´
eruloplasmine s´
erique Concentration h´
epatique en cuivre
Nombre de
patients
Moyenne ±´
ecart-type
(mg/dl)
Nombre de
patients
Moyenne ±´
ecart-type
(g/g de poids sec)
Maladie de Wilson
Pr´
esymptomatique 31 3,6 ±5,3 36 983,5 ±368
Symptomatique 84 5,9 ±7,1 33 588,3 ±304
Porteurs h´
et´
erozygotes 95 28,4 ±8,5 14 117,0 ±51
Sujets normaux 180 30,7 ±3,5 16 31,5 ±6,8
du cuivre d´
etermine une accumulation de cuivre dans les
tissus, qui est `
a son tour responsable des manifestations
cliniques de la maladie de Wilson. La c´
eruloplasmine plas-
matique est normalement comprise entre 0,20 et 0,35 g/l.
Elle est inf´
erieure `
a 0,10 g/l chez 70 % des patients atteints
de la maladie de Wilson. Elle est comprise entre 0,10 et
0,20 g/l chez 25 % d’entre eux et normale dans 5 % des cas.
La cuprurie des vingt-quatre heures est comprise entre 3
et 5 mol/l/24 h (normalement inf´
erieure `
a2mol/l/24 h)
(Tableau 1).
Anatomopathologie
Les anomalies cellulaires d´
etectables sont de deux ordres
[4] : les l´
esions h´
epatiques et les l´
esions du syst`
eme nerveux
central.
Les l´
esions h´
epatiques
Les l´
esions histologiques du foie apparaissent pr´
ecocement,
d`
es l’enfance. Les premi`
eres anomalies visibles en micro-
scopie optique sont la pr´
esence de noyaux h´
epatocytaires
clairs, riches en glycog`
ene et une st´
eatose macrov´
esiculaire.
`
A un stade avanc´
e de la maladie, il apparaˆ
ıt une hyper-
plasie des cellules de Kupffer, des infiltrats inflammatoires
et une fibrose portale et p´
eriportale. Dans les formes
r´
ev´
el´
ees par une insuffisance h´
epatique aigu¨
e, on observe
une n´
ecrose des h´
epatocytes, des corps de Mallory et par-
fois une st´
eatose microv´
esiculaire. Dans la plupart des cas,
une cirrhose est d´
ej`
a constitu´
ee. Dans d’autres cas, la
fibrose ´
evolue vers une cirrhose micro ou macronodulaire
sans que les infiltrats inflammatoires et la n´
ecrose soient
tr`
es marqu´
es.
Les l´
esions du syst`
eme nerveux central
Lorsque les manifestations neurologiques existent, l’aspect
ext´
erieur du cerveau est le plus souvent normal. `
Ala
coupe, le putamen est constamment atteint. Il peut ˆ
etre
le si`
ege d’une cavitation. L’atrophie du pallidum, du noyau
caud´
e, de la substance blanche et du cortex est plus
inconstante. L’examen microscopique met en ´
evidence une
prolif´
eration diffuse d’astrocytes anormaux constituant la
glie d’Alzheimer de Type II, plus marqu´
ee au niveau du
putamen, du pallidum et du noyau caud´
e. `
A un stade tar-
dif, on peut observer une prolif´
eration gliale, une atrophie
diffuse, un ´
epaississement de l’endoth´
elium des capillaires,
une d´
eg´
en´
erescence spongieuse et une cavitation.
Manifestations cliniques
Cliniquement, la maladie de Wilson peut apparaˆ
ıtre d`
es
l’ˆ
age de trois ans [1] et se manifeste le plus souvent entre 10
et 20 ans. Rarement, elle reste masqu´
ee jusqu’apr`
es 40 ans.
Les premi`
eres manifestations sont h´
epatiques (40 % des cas),
neurologiques (35 %) ou psychiatriques (10 %). Le tableau
inaugural peut enfin prendre une forme h´
ematologique,
r´
enale ou mixte dans environ 15 % des cas [9]. Nous d´
etaillons
les ´
el´
ements cliniques principaux.
Les manifestations h´
epatiques
Elles peuvent se traduire par une insuffisance h´
epatique
aigu¨
e, une h´
epatite aigu¨
e et une cirrhose compliqu´
ee.
Insuffisance h´
epatique aigu¨
e
L’insuffisance h´
epatique aigu¨
e est un mode de r´
ev´
elation
rare et grave de la maladie de Wilson. Elle s’observe
essentiellement chez les enfants, les adolescents ou les
adultes jeunes. Elle se caract´
erise par l’installation brutale
d’un ict`
ere intense, d’une ascite, d’une fi`
evre et parfois
d’une enc´
ephalopathie. Des signes de maladie chronique
du foie sont associ´
es : consistance dure du foie, angiomes
stellaires, circulation veineuse collat´
erale. L’anneau de
Kayser-Fleischer peut ˆ
etre absent `
a ce stade de la mala-
die. Les aminotransf´
erases sont mod´
er´
ement ´
elev´
ees. Une
an´
emie h´
emolytique `
a test de Coombs n´
egatif est constante.
En absence de traitement, l’´
evolution se fait habituelle-
ment vers la mort en quelques jours ou semaines. Un tableau
similaire peut ˆ
etre observ´
e chez les patients stoppant bru-
talement leur traitement au long cours par les ch´
elateurs du
cuivre.
H´
epatite aigu¨
e
Il s’agit alors d’une asth´
enie et d’un ict`
ere progressive-
ment croissant, auxquels peuvent s’associer fi`
evre, douleurs
abdominales, arthralgies, voire am´
enorrh´
ee.
Cirrhose compliqu´
ee
Bien que la cirrhose se constitue `
a un stade tr`
es pr´
ecoce de
la maladie, elle ne devient cliniquement patente qu’`
aun
stade plus tardif (entre 20 et 40 ans). Les signes d’atteinte
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
1
/
9
100%