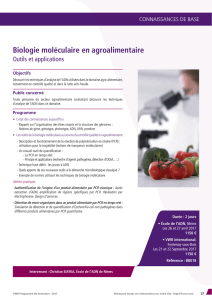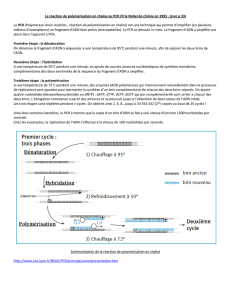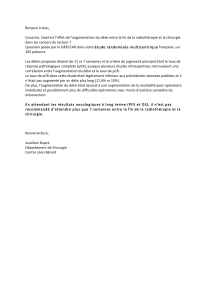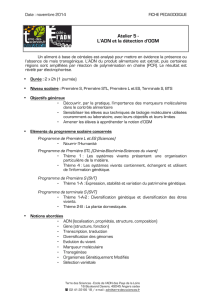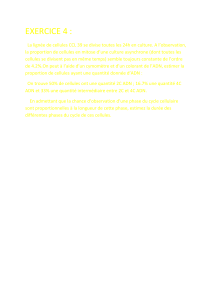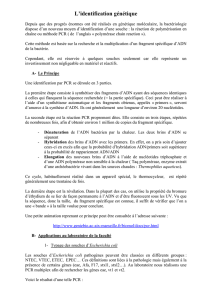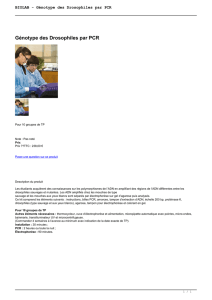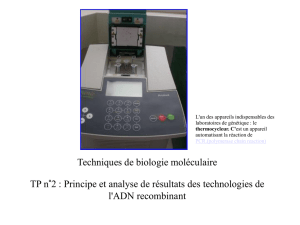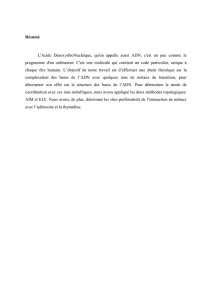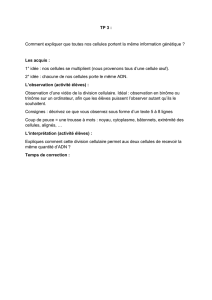Module 2 - EU-RL GMFF

WORLD HEALTH ORGANIZATION
REGIONAL OFFICE FOR EUROPE
WELTGESUNDHEITSORGANISATION
REGIONALBÜRO FÜR EUROPA
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE
BUREAU REGIONAL DE L’EUROPE
ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЕВРОПЕЙСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ БЮРО
Analyse d’échantillons alimentaires pour la
présence d’organismes génétiquement modifiés
Module 2
Présentation du manuel, méthodes de travail et
introduction au cours
M. Querci

Présentation du manuel, méthodes de travail et introduction au cours 2
Analyse d’échantillons alimentaires pour la présence d’organismes génétiquement modifiés Module 2
Table des matières
Module 2
Présentation du manuel, méthodes de travail et
introduction au cours
COMMENT DETECTER LES OGM 3
AVANTAGES INHERENTS ET LIMITATIONS DES APPROCHES BASEES SUR L’ADN ET SUR LES
PROTEINES 4
REMARQUES GENERALES ET PRESENTATION DU MANUEL 7
REFERENCES 11

Présentation du manuel, méthodes de travail et introduction au cours 3
Analyse d’échantillons alimentaires pour la présence d’organismes génétiquement modifiés Module 2
Comment détecter les OGM
Comme indiqué précédemment, les végétaux transgéniques se caractérisent par
l’insertion d’un nouveau gène (ou d’un nouvel groupe de gènes) dans leur génome.
Les nouveaux gènes sont ensuite transcrits et la nouvelle protéine est exprimée.
Ceci donne au végétal une nouvelle caractéristique telle que la résistance à certains
insectes ou la tolérance aux herbicides. La base de tout type de technologie de
détection d’OGM consiste à exploiter la différence entre la variété non modifiée et la
plante transgénique. Ceci peut se faire en détectant le nouvel ADN transgénique qui
a été introduit ou la nouvelle protéine exprimée ou, si la protéine joue le rôle
d’enzyme, en procédant à une analyse chimique pour détecter le produit de la
réaction enzymatique.
Deux approches scientifiques sont généralement utilisées aujourd’hui pour détecter
la modification génétique dans des cultures telles que le soja, le blé, le coton et
d’autres. L’une d’elles, ELISA (essai d’immunoabsorption enzymatique), implique la
recherche de la présence de protéines spécifiques en exploitant la spécificité de
liaison entre l’antigène exprimé et l’anticorps cible ; l’autre, la PCR (réaction de
polymérisation en chaîne), repose sur la détection de nouvelles séquences d’ADN
insérées dans le génome de plantes cultivées. Ces méthodes révèlent l’absence ou
la présence d’OGM dans l’échantillon, mais peuvent aussi fournir une indication sur
la quantité (pourcentage) présente dans un échantillon testé.
La première méthode validée au niveau de l’UE était une technique de contrôle
basée sur la PCR qui permettait de détecter la plupart des OGM actuellement
approuvés pour la commercialisation (Lipp et al., 1999). Mise au point par Pietsch et
al. (1997), cette méthode repose sur la détection des séquences de contrôle qui
accompagnent le gène nouvellement introduit, en l’occurrence le promoteur 35S et le
terminateur nos. La validation a été coordonnée par l’Unité Produits Alimentaires et
Biens de Consommation de l’IPSC du Centre Commun de Recherche, et exécutée
en collaboration avec l’Institut des Matériaux et des Mesures de Référence (IRMM)
du CCR, qui était responsable de la production de matériaux de référence certifiés.
Comme indiqué ci-dessus, des efforts de recherche ont été également dirigés vers le
développement de méthodes reposant sur les protéines. Une méthode très
spécifique à l’examen du soja Roundup Ready® basée sur le test ELISA a été
validée (Lipp et al., 2000), tandis que d’autres ont été mises au point
(http://mbg.jrc.ec.europa.eu/home/ict/methodsdatabase.htm).

Présentation du manuel, méthodes de travail et introduction au cours 4
Analyse d’échantillons alimentaires pour la présence d’organismes génétiquement modifiés Module 2
Avantages inhérents et limitations des approches basées sur l’ADN
et sur les protéines
L’approche basée sur l’ADN
L’utilisation des méthodes analytiques basées sur la technologie PCR pour détecter
des séquences d’ADN associées aux OGM est de plus en plus courante.
La PCR permet d’amplifier sélectivement des fragments spécifiques d’ADN qui se
trouve en faible quantité dans un mélange complexe d’autres séquences d’ADN.
Dans la PCR, les petits éléments d’ADN complémentaires sont appelés des amorces
et s’utilisent en paires. Ces amorces sont conçues pour s’hybrider sur des sites de
reconnaissance de séquence complémentaires situés sur le brin opposé du gène
d’intérêt. Par le biais d’une série de cycles thermiques différentiels répétitifs, un
enzyme de polymérase d’ADN aide à répliquer et à amplifier la séquence de manière
exponentielle entre la paire d’amorces. Ces gènes amplifiés sont enfin soumis à une
électrophorèse sur gel standard de manière à pouvoir en détecter la présence en se
basant sur la détermination de leur taille.
Diverses méthodes basées sur la PCR ont été élaborées dans le but de détecter et
de quantifier les OGM dans des espèces cultivées pour l’alimentation humaine et
animale. La détermination de l’identité génétique permet, en outre, la ségrégation et
la traçabilité (préservation de l’identité) sur toute la chaîne d’approvisionnement des
cultures GM.
Afin de pouvoir détecter les OGM, il est essentiel de connaître le type de modification
génétique, notamment la constitution moléculaire du gène introduit et les éléments
régulateurs connexes (promoteurs et terminateurs). Une quantité minimale du
matériau d’échantillon contenant un ADN intact comportant le gène cible s’impose
pour pouvoir procéder à l’analyse.
La PCR est une technique de laboratoire qui nécessite un personnel formé et un
équipement spécialisé.
Les caractéristiques principales du diagnostic PCR sont, entre autres, les suivantes :
- Il peut être extrêmement sensible, capable de détecter une ou plusieurs répliques
d’un gène ou d’une séquence cible d’intérêt dans le matériel génétique complet d’un
organisme (ou génome). Cette sensibilité élevée a pour résultat que des taux de
contamination accidentelle très faibles peuvent produire de faux positifs. En
conséquence, il est très important de veiller à prévenir toute contamination croisée.

Présentation du manuel, méthodes de travail et introduction au cours 5
Analyse d’échantillons alimentaires pour la présence d’organismes génétiquement modifiés Module 2
- Par rapport aux essais immunologiques (synthèse de l’amorce par rapport à la
production d’anticorps), il requiert un temps de développement par réactif
relativement limité.
- La plupart des réactifs nécessaires sont disponibles dans le commerce et peuvent
être aisément obtenus auprès d’un grand nombre de fournisseurs. Une licence est
toutefois parfois réclamée afin de pouvoir utiliser certains de ces réactifs dans des
applications diagnostiques commerciales.
- L’analyse de l’échantillon prend environ un jour.
- La PCR peut établir une distinction entre divers types de modification génétique
(également appelés « événements de transformation ») si elle est correctement
développée. Les méthodes diagnostiques permettant d’identifier des événements de
transformation spécifiques requièrent un temps de développement et des efforts de
validation supplémentaires.
L’approche basée sur les protéines
La méthode de test basée sur les protéines utilise des anticorps spécifiques à la
protéine d’intérêt. Le test ELISA détecte ou mesure la quantité de protéine d’intérêt
présente dans un échantillon, lequel peut en contenir diverses autres. Le test ELISA
utilise un anticorps unique pour établir la liaison avec la protéine spécifique, un
second anticorps pour amplifier la détection (facultatif) et un anticorps conjugué à un
enzyme dont le produit génère une réaction colorée facile à visualiser et à quantifier
en la comparant à une courbe standard de la protéine d’intérêt.
Pour être correct, l’essai doit être exécuté par un personnel dûment formé sur un
équipement spécialisé.
Les caractéristiques principales du test ELISA sont les suivantes :
- Une moins grande sensibilité que la PCR et donc un moins grand risque de « faux
positifs » induits par de faibles niveaux de contamination.
- Des coûts en amont élevés pour le développement des essais et la génération des
anticorps et des protéines de référence.
- Un coût peu élevé par échantillon à partir du moment où les réactifs sont
développés.
- Il ne peut établir de différence entre des modèles et des modes d’expression
différents entre divers événements transgéniques exprimant des caractéristiques
protéiniques similaires.
- Les méthodes basées sur les protéines ont un temps de production important pour
le développement des réactifs et la mise au point de la méthode.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
1
/
11
100%