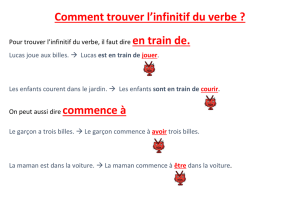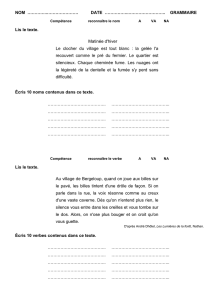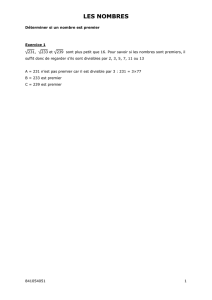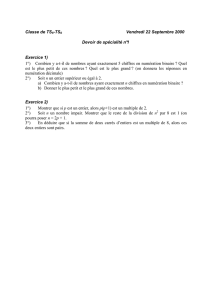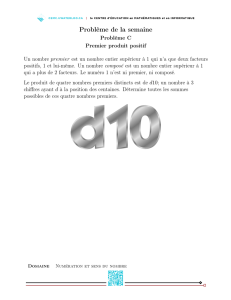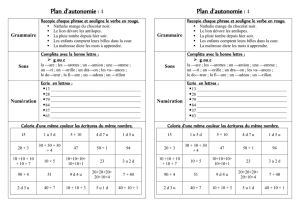Mathématiques Cycle 2 : Didactique et Apprentissages CP-CE1
Telechargé par
gelade.andre

Formation MEF1 – S2-
Didactique des mathématiques
MATHEMATIQUES CYCLE 2
Le cycle 2 commence en dernière année de maternelle et emprunte donc à celle-ci sa
pédagogie. Nous traiterons ici des classes de CP et CE1 uniquement.
Les quatre domaines autour desquels s’organisent les programmes du cycle, comme les
programmes du cycle3 plus tard, sont :
1- Nombres et calcul
2- Géométrie
3- Grandeurs et mesures
4- Organisation et gestion des données
* * * * *
Connaissance des nombres et calcul constituent les objectifs prioritaires du CP et du CE1.
Mais c’est bien la numération qui est au cœur de ces apprentissages et constitue la clé du
cycle 2.
1) Nombres et calcul
A l’issue du cycle 2, l’élève doit être capable de :
- écrire, nommer, comparer, ranger les nombres entiers naturels inférieurs à 1 000
- calculer : addition, soustraction, multiplication
- diviser par 2 et par 5 des nombres entiers inférieurs à 100 (dans le cas où le quotient exact est entier)
- restituer et utiliser les tables d’addition et de multiplication par 2, 3, 4 et 5
- calculer mentalement en utilisant des additions, des soustractions et des multiplications simples
A) Connaissance des nombres
A l’issue du Cycle 2, les élèves doivent connaître les nombres inférieurs à 1000.
- fin CP nombres jusqu’à 100
- fin CE1 nombres jusqu’à 1000
La connaissance attendue est fondamentalement différente de la connaissance acquise en
maternelle car elle ne repose plus sur la simple mémorisation d’une suite de mots désignant
chacun une quantité spécifique. Désormais, pour l’élève, connaître les nombres signifie :
- être capable, toujours, d’en restituer la suite (la « comptine »),
- savoir dénombrer des collections données
- être capable de comparer et de ranger les nombres
- connaître les décompositions additives des nombres < 20 (CP)
- savoir les lire et les écrire (y compris sous dictée)
Lorsque la liste des nombres à connaître s’allonge, la mémorisation d’une liste de mots-
nombres comme le recours aux symbôles (constellations)

Les nombres servent à désigner, cardinal ou rang, et à anticiper.
La désignation se rapporte au vécu et à l’expérience, l’anticipation se rapporte davantage
au conçu.
Il faut distinguer clairement l’usage des mots–nombres et le recours aux symboles
(constellations) puis aux signes (les chiffres) en étant conscient qu’utiliser des nombres en
tant que désignation ou anticipation n’est pas connaître le système décimal.
Le passage de la GS au CP conduit assez brutalement l’élève du nombre : [12], à la
numération (une dizaine et deux unités…).
Numération
Sommes-nous au clair sur la différence entre chiffre et nombre ?
Combien de mots-nombres différents sont nécessaires pour écrire les nombres de 0 à
9999 ? 24 !
Qu’est-ce que la numération ?
C’est sur la numération que repose la connaissance des nombres au-delà de la comptine
connue en fin de GS.
C’est dire que l’apprentissage de la numération est l’apprentissage majeur en début de
cycle 2 puisque c’est lui qui conditionne l’entrée dans la compréhension de l’écriture des
nombres et leur lecture.
La numération est par ailleurs le socle de toutes les activités de calcul réfléchi sur les
nombres.
Les techniques opératoires notamment que l’on va demander aux enfants d’acquérir et de
maîtriser reposent sur la compréhension des principes et du fonctionnement de notre
système de numération.
La numération impose un dénombrement organisé.
Comment compte l’enfant qui arrive au CP ?
- dénombrement et association du nombre correspondant dans la comptine numérique.
Là où les élèves de maternelle pouvaient dénombrer les collections avec des procédures
personnelles, à l’entrée au CP, il leur est demandé d’organiser leur dénombrement en
constituant des groupes d’objets (dizaines) et le nombre n’est plus donné « brut » en
référence à la comptine numérique, il doit être décomposé en :
nombre de dizaines + nombre d’unités
Or cette contrainte, n’arrive pas en réponse à une difficulté ou à une situation de blocage,
mais apparaît très tôt à propos de nombres que l’enfant connaît et utilise déjà couramment.
Connaissance des nombres Calcul

Numération
Numération = code, convention d’écriture
Chiffre ≠ Nombre Chiffre = signe / Nombre = quantité
Valeur positionnelle des chiffres =
La quantité signifiée dépend de la place dans l’écriture du nombre
On ne compte plus forcément des unités : 740 : 7 = centaines, 4 = dizaines…
Création de collections référentes intermédiaires : dizaines, centaines…
La dénomination des nombres présente un ensemble de régularités /irrégularités qui
rendent plus difficile l’accès à l’écriture et à la lecture des nombres.
De zéro à seize, on a un mot différent pour chaque nombre.
Et pour dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze et seize, le nom du nombre ne fait
pas référence au codage dizaine/unité alors que ce codage est en œuvre.
…Mais les mots dix-sept, dix-huit, dix-neuf font référence au codage !!
Puis viennent vingt, trente, quarante, cinquante, soixante…mots nouveaux, avant
soixante-dix, quatre vingt et quatre vingt dix qui introduisent par leur nom de
nouvelles sources de confusion :
soixante dix = soixante + dix,
mais quatre vingt = 4 x vingt !!
et que dire de quatre vingt dix (4 x20 +10) !!!
B) Calcul
Opérations mentales sur les nombres
Sans support tangible des quantités signifiées
Abstraction
Numération et calcul Rôle / obstacle de la numération
La numération introduit des contraintes formelles pour le calcul :
Logique du dénombrement logique de codage
9 + 23 = ?
Logique de dénombrement L’enfant regroupe les collections, dénombre la nouvelle entité.
Logique de calcul Comment associer les 2 nombres ? codage du résultat ?
Chaque chiffre est considéré pour sa valeur cardinale apparente, mais aussi
pour sa valeur positionnelle.
Pb des techniques opératoires
Nous devons tout d’abord nous demander quand introduire ces techniques.

Quel temps laisser aux procédures personnelles avant de proposer aux élèves les techniques
opératoires codifiées ?
Quel est l’intérêt et le but de ces TO ?
Et quel danger peut-il y avoir à les introduire trop tôt ?
Cohabitation « manipulations-dénombrement » /TO : avantages ? inconvénients ?
Opérations avec retenue lisibilité pour le jeune enfant de cette pratique ?
Nous réfléchirons aussi aux techniques opératoires elles-mêmes : Sont-elles équivalentes en
terme d’apprentissage ?
CALCUL MENTAL
Une pratique régulière et organisée du calcul mental est essentielle : le calcul automatisé et
le calcul réfléchi vont doter les élèves des premiers automatismes utiles à l’utilisation des
nombres.
Calcul et capacité à anticiper (pouvoir donner le résultat d’une action sans avoir à la réaliser.)
calcul automatisé (tables d’addition, de multiplication…)
connaissance des doubles, des moitiés
calcul réfléchi
Repose notamment et pour une bonne part sur la maîtrise de la numération et
une bonne connaissance des nombres, leurs relations, leurs décompositions…
- ajouter 9 ajouter 10 et retirer 1
RESOLUTION DE PROBLEMES
La résolution de problèmes qui contribue à construire le sens des opérations fait l’objet d’un
apprentissage progressif et est un moyen, pas une fin en soi.
Il est important au cours de ce cycle2, de laisser une grande place aux procédures
personnelles de résolution qui sont ensuite comparées les unes aux autres, mises en forme
(écriture mathématique) et validées ou invalidées.
Les situations additives et soustractives devraient être abordées simultanément afin de
mettre en évidence la réversibilité de ces deux opérations.
a + b = c
C’est la place de l’inconnue qui détermine la nature exacte du problème.
3 types de problèmes :
a) transformation d’états : Ei / transf / Ef
- rechercher l’état final est le plus simple, donne le sens,
- rechercher l’état initial, plus difficile
b) compositions d’états : E1/E2 (perles, collier)
c) comparaisons d’états : E1 écart E2 (comparer 2 prix, 2 âges…)
Suivant le domaine des mathématiques utilisé :
– numérique
– géométrique

– logique
– mesure
Suivant l’usage qui est fait des problèmes :
– problèmes de recherche (pour aborder une nouvelle notion ou permettre l’élaboration de
solutions originales) ;
– problèmes destinés à l’utilisation d’acquis antérieurs dans des situations d’application et
de réinvestissement ;
- problèmes destinés à l’utilisation de plusieurs connaissances dans des situations de
décontextualisation.
Les différentes catégories de problèmes additifs et soustractifs : Typologie de G. Vergnaud
(Cette catégorisation provient de la typologie des structures additives de G. Vergnaud.)
1. Recherche de l’état final connaissant la transformation positive et l’état initial.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
1
/
9
100%