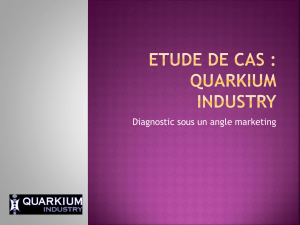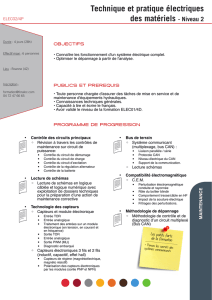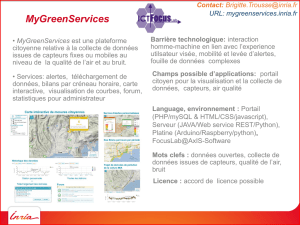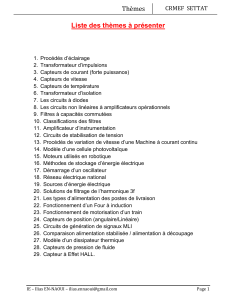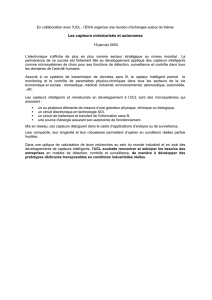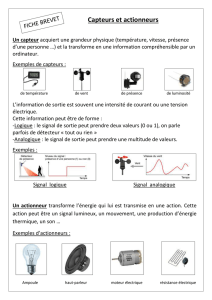Analyse Fonctionnelle Interne Moteur Industriel : Approche FAST et Schéma-blocs
Telechargé par
Junior ALLODJI

Analyse Fonctionnelle Interne du Dispositif de Surveillance et de Commande d’un Moteur Industriel à
Distance : Approche FAST et Schéma-blocs
Introduction
Dans le contexte de l’industrie 4.0 et de la modernisation constante des infrastructures manufacturières,
la surveillance et la commande à distance des moteurs industriels constituent un enjeu majeur en
termes d’efficacité, de maintenance prédictive et de sécurité des opérateurs. Un système de
télésurveillance performant doit permettre de remonter, en temps réel ou presque, des données
relatives à l’état du moteur (température, vibrations, courant, etc.), d’en diagnostiquer les anomalies de
façon automatisée et de commander le système à distance de façon sécurisée. L’enjeu est double :
répondre pleinement au besoin exprimé par l’exploitant (disponibilité accrue, coût de la maintenance
optimisé, réduction des incidents), tout en s’assurant que les réponses techniques répondent à des
exigences industrielles strictes (précision, sécurité, robustesse, disponibilité, évolutivité…).
L’analyse fonctionnelle interne (AFI) s’impose comme le socle de la conception d’un tel dispositif. Elle
vise à transformer un besoin recueilli (fonctions de service) en fonctions techniques mesurables et
vérifiables, c’est-à-dire en solutions matérielles et logicielles concrètes. Nous utiliserons principalement
la méthode FAST (Function Analysis System Technique) et la représentation schéma-blocs pour clarifier
et structurer la décomposition fonctionnelle du système. Cette approche mettra en lumière l’articulation
entre les fonctions principales attendues, leurs sous-fonctions, les finalités de chaque bloc fonctionnel,
et les solutions mises en œuvre dans le respect des contraintes industrielles.
I. Cadre, Objectifs et Principes Méthodologiques
1.1 Rappel du Cadre de l’Analyse Fonctionnelle Interne
L’AFI se situe en aval de l’analyse fonctionnelle externe (AFE). Alors que l’AFE détaille le besoin sous
forme de fonctions d’usage et de service, en lien avec le contexte d’utilisation, l’AFI se concentre sur le
“comment” : elle identifie les fonctions techniques internes au produit ou système, qui concrétisent la
satisfaction du besoin.
Les objectifs de l’AFI sont multiples :
Organiser la solution autour de ses chaînes fonctionnelles (information, énergie, matière).
Identifier toutes les fonctions techniques et leurs solutions constructives.
Garantir la vérifiabilité et la mesurabilité de chaque fonction mise en œuvre.
Anticiper les blocages, redondances ou incohérences de conception.
Faciliter la gestion et la traçabilité : toute évolution technique ou changement du besoin peut
ainsi être répercuté sur l’ensemble des choix constructifs.
1.2 Synthèse des Normes et Principes du FAST

Le diagramme FAST est normé (ex. : NF EN 1325-1), il traduit logiquement les fonctions de service en
sous-fonctions puis en solutions techniques concrètes, selon une démarche du « pourquoi » vers le «
comment ». Les principes de construction et de lecture sont les suivants :
Lecture du diagramme de gauche à droite : chaque fonction répond à la question « Comment la
fonction d’amont est-elle réalisée ? ».
Lecture de droite à gauche : chaque fonction technique répond à la question « Pourquoi cette
fonction est-elle assurée ? ».
Axe vertical : représente les fonctions réalisées en simultané, sans présumer de leur ordre
temporel mais de leur égalité fonctionnelle.
Exprimer chaque fonction par un verbe d’action à l’infinitif, suivi d’un complément mesurable.
Cette décomposition logique et systématique permet de visualiser la “chaîne fonctionnelle” complète
(du besoin jusqu’aux pièces ou solutions techniques), de s’assurer d’une bonne exhaustivité
fonctionnelle et de justifier l’existence de chaque sous-système.
1.3 Utilité et Portée de la Représentation schéma-blocs
Le schéma-blocs (ou diagramme-bloc) offre une vision synthétique de l’enchaînement des flux
(information, énergie, matière) entre les différentes entités fonctionnelles du système. Les blocs
symbolisent des sous-systèmes ou fonctions distinctes, reliées par des flèches représentant les signaux
ou flux échangés. Cette représentation est particulièrement précieuse pour :
Mettre en perspective les interactions complexes (bouclages, asservissements, redondances…).
Localiser les points sensibles de criticité, d’entrée/sortie ou de possible défaillance.
Définir précisément les frontières du système (interface avec l’utilisateur, réseau, énergie…).
Dans la suite, nous déclinerons l’analyse fonctionnelle interne selon la méthode FAST, puis proposerons
un schéma-bloc détaillé.
II. Identification des Fonctions Techniques : Approche FAST
2.1 Expression du Besoin Initial et Fonctions de Service
Besoin exprimé : Mettre en place un dispositif de surveillance et de commande à distance d’un moteur
industriel, intégrant :
Recueil en continu des paramètres de santé du moteur (température, vibration, courant).
Algorithme de diagnostic pour détection des anomalies.
Interface utilisateur de commande à distance.
Transmission fiable et sécurisée des données et ordres, avec gestion des alertes.
Fonctionnement robuste, sûr, précis, évolutif, répondant aux normes industrielles.

Fonctions principales de service :
FP1 : Surveiller l’état du moteur à distance.
FP2 : Diagnostiquer les anomalies de fonctionnement du moteur.
FP3 : Commander le moteur à distance.
FP4 : Garantir la disponibilité, la sécurité et la robustesse du système.
FP5 : Permettre l’interopérabilité avec le SI industriel (communication et alimentation).
Chacune de ces fonctions principales va être déployée en fonctions techniques, puis en sous-fonctions et
solutions matérielles/logicielles.
2.2 Tableau FAST Fonctionnel (Synthèse)
Surveil
ler et
comma
nder à
distanc
e un
moteur
industri
el
Fonction
de
service
Fonction
Technique
(action)
Sous-fonction
technique
Solution
constructive ou
bloc
Critère /
Mesure
Contraint
es
Surveille
r l’état
du
moteur
Mesurer la
température
moteur
Acquérir la
température
Capteur
Pt100/TC,
interface
Précision,
t90,
plage,
robustess
e
IP, ATEX,
redondanc
e
Mesurer les
vibrations
Acquérir les
vibrations
MEMS/accélérom
ètre/piézo
Bande
passante,
précision,
IP
Durée vie,
maintenan
ce facile
Mesurer le
courant
Acquérir le
courant
Capteur à effet
Hall, TI
Hystérésis
, temps
réponse
Montage
sans
coupure
Diagnost
iquer les
anomali
es
Analyser
signaux
capteurs
Prétraiter/filtre
r/décaler
Algorithme sur
µC/FPGA
Latence,
précision,
taux FP
Temps
réel,
consum
CPU
Détecter
signatures de
défaut
Appliquer algo
diagnostic
FFT, IA, MCSA,
seuils
Seuil
alarme,
FDR, FPR
Validation,
auto-
apprentiss
age
Comman
der à
distance
Générer
ordres de
marche/arrêt/
variation
Transmettre
commande
Interface
réseau/IoT, relais
Rdt
communi
cation,
sécurité
Authentifi
cation,
QoS,
temps

Agir sur le
moteur
Actionner
contacteur/var
Relais, variateur,
API
Temps de
commutat
ion,
sécurité
CE, SIL,
ATEX
Sécuriser
le
système
Isoler, filtrer,
alimenter
Gestion
alimentation
Double alim,
module
redondant
MTBF,
surveillan
ce défaut
Norme
industrie,
redondanc
e
Surveiller
fonctionneme
nt
Watchdog,
supervision
Algorithme
embarqué
Temps de
réaction,
logs,
alertes
SSI,
traçabilité
Commun
iquer
Échanger
données et
ordres
Convertir,
transmettre,
recevoir
Module IoT
(MQTT,
Modbus…)
Débit,
latence,
sécurité,
redondan
ce
CEM,
cybersécu
rité, SLA
Acquitter,
journaliser
Logger, ui,
rapport
Cloud, base
interne, IHM
Trace,
logs,
accès
utilisateur
GDPR,
traçabilité,
temps réel
Ce tableau représente la structuration hiérarchique du FAST : pour chaque fonction principale, on
détaille les fonctions techniques et solutions, avec critères mesurables et contraintes d’architecture.
Explication détaillée :
Mesurer la température moteur : On utilise généralement des capteurs PT100, PT1000 ou
thermocouples, dont les temps de réponse, la précision, les plages de températures, et
l’adaptabilité aux ambiances ATEX, sont des critères industriels majeurs.
Mesurer les vibrations : On privilégie les MEMS pour leur coût et leur facilité d’intégration, ou
des accéléromètres piézoélectriques pour des fréquences élevées ou des environnements
sévères.
Mesurer le courant moteur : Les capteurs à effet Hall ou transformateurs d’intensité isolés
permettent la lecture fiable du courant, indispensable pour diagnostic électrique (par exemple
via l’analyse MCSA).
Prétraitement et diagnostic : L’algorithme, embarqué sur microcontrôleur/FPGA ou en edge,
extrait les caractéristiques (FFT, signature spectrale, IA supervisée) et déclenche les alertes en
cas d’anomalie. Les critères sont la latence du diagnostic, la précision, taux de fausse
alarme/absence.

Commande moteur : L’interface de commande (passerelle IoT/SCADA, relais, variateur, API)
assure la réception, la traduction et l’application des ordres distants, avec obligation de sécurité,
d’acquittement et de réponse rapide封.
Alimentation et sécurité : Alimentation redondée (modules dédiés, diodes, MOSFET),
surveillance des alimentations, gestion des plans de secours, conformité aux normes CE, ATEX et
SIL3 garantissent la robustesse du système (MTBF élevé).
Communication : L’intégration de protocoles robustes (MQTT, Modbus TCP/RTU, Profinet, OPC-
UA, etc.), la gestion des droits d’accès, le chiffrement SSL/TLS et l’analyse comportementale
(SIEM), sont essentiels.
Fusion des données capteurs : Le système peut inclure une couche de fusion de données, type
filtres de Kalman, pour optimiser la détection d’anomalie par la combinaison de plusieurs
sources (température, vibration, courant).
III. Schéma-blocs Fonctionnel Interne du Dispositif
3.1 Principes de la Représentation schéma-blocs
Le schéma-blocs du dispositif visualise les flux entre sous-systèmes depuis la prise des données jusqu’à
l’action de commande, en passant par le traitement, le diagnostic, la transmission et la sécurisation. Il
distingue chaînement de l’information, de l’énergie et du contrôle.
Composition typique d’un schéma-blocs :
Blocs principaux :
o Bloc capteurs (température, vibration, courant)
o Bloc d’acquisition, conversion et mise en forme
o Bloc de traitement, diagnostic et décision (edge computer, µC, FPGA)
o Bloc interface de communication IoT/SCADA
o Bloc commande locale (actionneurs, relais, variateur)
o Bloc alimentation du système (redondante)
o Bloc sécurité/supervision
Flux principaux :
o Signaux physiques (T, V, I) → signaux électriques numérisés
o Données numérisées → algorithme de diagnostic
o Ordres de commande issus du cloud / IHM utilisateur → commande matérielle du
moteur
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
1
/
13
100%