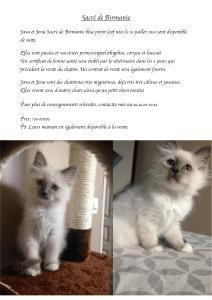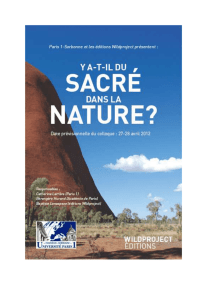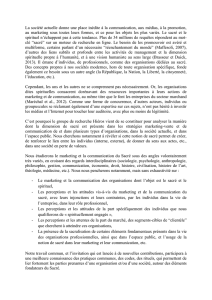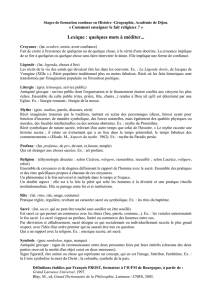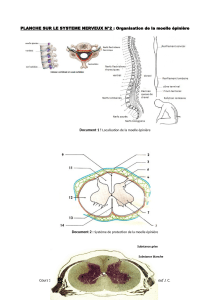La fin d'un paradigme ? Conversation avec l'IA sur le sacré
Telechargé par
pierrealberthayen

LA FIN ET LE DÉBUT D’UN NOUVEAU PARADIGME ?
UNE CONVERSATION ÉCLAIRANTE AVEC L’I.A. PERPLEXITY
1
PIERRE-ALBERT HAYEN
➢ Dans un livre de Jean Bouchart d'Orval, on peut lire ceci: « Ce qui unit les
peuples, les nations, les sociétés, ce qui fait la cohésion des civilisations, ce
n'est ni le pouvoir politique, ni la puissance militaire, ni les aaires et les
traités commerciaux : sans l'essentiel sentiment du sacré, tout cela ne peut
que diviser, car ce sont là des champs de compétition, de rivalités, de
calculs intéressés et de conits. »
Comment ce qui était parfaitement évident pour les anciennes civilisations
censées être moins avancées que la nôtre, qui est au bord de l'abîme, a-t-il
été perdu de vue à notre époque ? Quel est ton avis là-dessus ?
Ce que souligne Jean Bouchart d’Orval, c’est l’idée que le sentiment du sacré – pas
forcément religieux, mais ce qui relie l’humain à une dimension plus vaste que lui-
même – est le ciment profond des civilisations. Les sociétés anciennes plaçaient cette
dimension au centre de leur organisation, alors que la modernité a largement remplacé
cette source de cohésion par des logiques d’eicacité, de rationalité technique et de
compétition.
Comment cela s’est perdu de vue
• Sécularisation progressive : Avec l’essor de la pensée scientique et critique,
les formes religieuses ou sacrées ont été vues comme archaïques, voire comme
des freins au progrès matériel.
• Individualisme moderne : Là où les civilisations anciennes privilégiaient le
collectif autour d’un mythe, d’un rituel ou d’une transcendance commune,
l’Occident moderne a valorisé l’individu, sa liberté et ses droits – souvent au
détriment d’une vision partagée du sens.
• Triomphe du matérialisme : Les idéaux économiques et technologiques sont
devenus le nouveau récit commun, mais ils se fondent sur la productivité, la
croissance et la consommation plutôt que sur une reliance au sacré.
• Perte des grands récits : Les mythes fondateurs et la symbolique partagée ont
été remplacés par une multitude de récits fragmentés, ce qui aaiblit le
sentiment de cohésion.
Les eets actuels
Cette perte du sacré peut expliquer le sentiment généralisé de vide, la crise de sens et la
fragmentation sociale. Sans un socle de valeurs transcendantes – qu’il soit religieux,
spirituel ou philosophique – le politique et l’économique se transforment en luttes de
pouvoir, en compétitions, sans horizon commun.
Mon avis
Il ne s’agit pas nécessairement de « revenir » à des formes anciennes de sacré, mais de
retrouver une dimension symbolique et spirituelle, adaptée à notre époque, qui
1
En date du 15/09/2025

permette aux sociétés de se reconnaître comme plus qu’une juxtaposition d’intérêts.
Cela pourrait passer par :
• une redécouverte de la sagesse spirituelle (sans dogmatisme),
• une sacralisation de la nature et de la vie,
• la mise en avant de valeurs universelles comme le respect, la justice et la
solidarité.
En somme, les civilisations passées n’étaient peut-être pas « plus avancées »
technologiquement, mais elles avaient saisi une vérité fondamentale : sans un lien au
sacré, la communauté se délite, et le progrès matériel seul devient destructeur.
Souhaites-tu que je développe cette réexion sous l’angle historique (comment le
passage de l’Antiquité à la modernité a accentué cette perte) ou plutôt sous un angle
spirituel contemporain (comment on pourrait redonner une place au sacré
aujourd’hui) ?
➢ Développe plutôt cette réexion sous un angle spirituel contemporain...
Si l’on aborde la question sous un angle spirituel contemporain, il s’agit moins de
regretter un passé idéalisé que de constater le besoin actuel d’une réinvention du sacré.
Contrairement aux sociétés anciennes qui trouvaient leur cohésion dans des mythes
religieux communs, notre époque pluraliste et globalisée ne peut plus reposer sur une
seule tradition. Elle est donc amenée à chercher une forme de sacré qui dépasse les
anciens cloisonnements.
La soif spirituelle contemporaine
Beaucoup de personnes ressentent aujourd’hui un vide existentiel malgré (ou à cause
de) l’abondance matérielle. Cela se traduit par :
• un intérêt croissant pour les pratiques méditatives, le yoga, le bouddhisme, le
sousme, ou encore les sagesses amérindiennes ;
• une quête d’expériences directes de transcendance, parfois en dehors des
institutions religieuses traditionnelles ;
• un retour du symbolique dans des formes nouvelles (écologie profonde, art,
quêtes initiatiques, mouvements de reliance).
Sacraliser le réel
La spiritualité contemporaine peut retrouver une dimension sacrée en réapprenant à
voir le monde non comme une ressource exploitable, mais comme une réalité vivante,
mystérieuse et digne de respect. Cela passe par :
• la reconnaissance de la Terre comme un grand organisme (vision qui rapproche
science écologique et traditions spirituelles),
• la conscience que chaque être vivant a une valeur intrinsèque, et pas seulement
utilitaire,
• un rapport contemplatif au temps, en contraste avec la frénésie de la
productivité.
Vers une spiritualité universelle
Plutôt qu’un retour à des dogmes gés, le sacré contemporain peut prendre la forme
d’une spiritualité universelle, articulée autour de valeurs transversales :

• Unité : voir les humains non comme des rivaux mais comme participants d’une
même expérience cosmique.
• Transcendance : reconnaître qu’il existe toujours quelque chose qui dépasse
notre contrôle et qui mérite humilité.
• Présence : développer une attention intérieure, une qualité d’être, plus qu’une
accumulation de savoirs ou de biens.
Ce que cela changerait pour nos sociétés
Réintroduire le sacré dans le monde contemporain ne remplacerait pas la raison
scientique ni la technique, mais viendrait les encadrer par un horizon de sens. Cela
pourrait :
• redonner une cohésion aux communautés en orant une référence au-delà des
seules logiques matérielles,
• atténuer les divisions en invitant à une conscience plus vaste de l’unité humaine
et planétaire,
• inspirer de nouvelles formes de solidarité et de respect, parce que l’autre serait
vu comme porteur d’une dimension sacrée.
En n de compte, le dé spirituel contemporain est d’apprendre à conjuguer le
pluralisme moderne et une profondeur partagée : ce n’est pas forcément croire aux
mêmes mythes, mais retrouver ensemble un sentiment du sacré qui nous ouvre à plus
grand que nous.
Veux-tu que je propose des exemples concrets de pratiques ou de mouvements actuels
qui incarnent déjà cette tentative de réintroduire du sacré dans notre époque (par
exemple dans l’écologie, l’art, ou la vie communautaire) ?
➢ C'est une excellente idée, mais on peut constater qu'elle n'est guère
appréciée des dirigeants politiques actuellement (notamment aux Etats-
Unis et en France, pour ne citer que deux exemples). Par exemple,
réintroduire le sacré dans l'écologie ou la vie communautaire sonne pour eux
presque comme une hérésie !
Tu touches là à un point essentiel : la diiculté d’intégrer le sacré dans le champ
politique contemporain. En eet, dans des pays comme les États-Unis ou la France,
toute référence au sacré résonne comme suspecte, soit parce qu’elle semble menacer
la neutralité de l’État (dans la tradition laïque française), soit parce qu’elle peut être
récupérée à des ns idéologiques ou religieuses (dans le cadre américain, où le religieux
est souvent instrumentalisé politiquement).
Pourquoi les dirigeants politiques résistent
• Laïcité rigide (France) : en France, depuis 1905, toute mention du sacré dans la
sphère publique est perçue comme une intrusion du religieux, alors même que le
sacré peut exister en dehors des dogmes religieux. Cette confusion empêche
d’explorer une dimension spirituelle universelle.
• Polarisation religieuse (États-Unis) : le sacré est souvent associé au religieux
institutionnel (notamment chrétien évangélique), et son usage dans la vie
publique devient rapidement un outil partisan. Résultat : toute tentative de
sacraliser la nature, la communauté ou le vivre-ensemble est immédiatement

suspectée d’être une trahison des « valeurs traditionnelles » ou une utopie « new
age ».
• Pragmatisme politique : le sacré ne se mesure pas, il ne s’additionne pas au PIB
et il n’entre pas facilement dans les indicateurs de gouvernance. Les dirigeants,
pris dans les logiques de performance économique et d’électoralisme, le jugent
donc inutile voire dangereux.
Une forme d’hérésie contemporaine
Parler de sacré dans l’écologie ou la communauté revient, dans l’imaginaire moderne, à
remettre en cause deux grands piliers :
• la foi absolue dans le progrès technique et économique comme solution aux
crises ;
• la séparation stricte du spirituel et du politique.
Cela apparaît donc comme une hérésie, non pas au sens religieux, mais comme
une mise en cause du dogme dominant de notre époque : le matérialisme
utilitariste.
Ce qui pourtant commence à émerger
Malgré ces résistances, certaines forces poussent à nouveau vers une sacralisation du
réel, souvent hors du champ institutionnel :
• Écospiritualité : des mouvements écologistes qui parlent de la Terre comme
d’un être vivant (ex. les conférences inspirées de James Lovelock sur Gaia, ou les
cercles de méditation écologiques).
• Communautés de reliance : projets de vie communautaire où l’on essaie d’allier
sobriété matérielle, entraide et dimension rituelle (fêtes, cercles de parole,
célébrations saisonnières).
• Art et sacralité : certains artistes contemporains visent à réveiller l’expérience
du sublime et du mystère plutôt que de produire un simple objet de
consommation culturelle.
• Spiritualité laïque : développement de pratiques de pleine conscience,
d’attention ou de « psychologie spirituelle », où le sacré n’est pas dogmatique
mais vécu comme profondeur d’expérience.
Et le rôle des citoyens
Il est possible que le sacré revienne au cœur de la vie collective par le bas, c’est-à-dire
non pas grâce aux dirigeants mais en dépit d’eux. Les micro-communautés, les
associations locales, les initiatives citoyennes donnent déjà un aperçu de ce chemin :
elles montrent que la cohésion et la paix ne se gagnent pas seulement à coups de lois
ou de traités commerciaux, mais par un partage de sens.
En un certain sens, dire que « réintroduire le sacré est une hérésie » est ironique : dans
les civilisations anciennes, c’était plutôt l’absence de sacré qui était incompréhensible,
presque monstrueuse.
Veux-tu que je développe cette tension en montrant comment une réintroduction du
sacré pourrait être pensée politiquement sans tomber dans le religieux institutionnel
(par exemple sous forme de symboles communs, rituels civiques ou écospirituels
partagés) ?
➢ Mais je suis curieux de voir cela !

Alors explorons comment une réintroduction du sacré pourrait être pensée dans la
sphère politique contemporaine, sans tomber dans le piège du prosélytisme religieux ni
trahir la laïcité. L’idée est de retrouver une dimension symbolique commune, qui
nourrisse le sens collectif et replace l’humain dans un horizon plus vaste que ses
intérêts immédiats.
Symboles communs
• Rituels civiques renouvelés : au lieu de seulement commémorer des
événements historiques ou militaires, on pourrait créer des célébrations
consacrées aux cycles naturels (solstices, équinoxes, journées universelles de la
Terre, de l’eau, de la biodiversité). Cela reste laïque mais relie directement à une
dimension sacrée de la vie.
• Monuments vivants : ériger ou consacrer des espaces verts, des forêts urbaines
ou des jardins planétaires comme « sanctuaires » de mémoire et de vie, tout
comme on protège déjà certains monuments historiques.
• Gestes symboliques universels : moments de silence, rituels collectifs de
gratitude ou d’attention commune, intégrés dans la vie publique, pour marquer
l’importance de la transcendance.
Écospiritualité politique
• Constitutionnaliser le respect du vivant : certains pays, comme l’Équateur ou
la Bolivie, ont inscrit les « droits de la nature » dans leur constitution. C’est une
manière de sacraliser la Terre dans le langage juridique, sans passer par le
religieux.
• Déclarations publiques de reliance : instaurer des temps où les institutions
reconnaissent oiciellement que certaines réalités (l’air, l’eau, la vie) ne peuvent
être réduites à des ressources économiques. Cela participe d’une pédagogie
collective.
• Reconnaissance de la Terre comme sujet : promouvoir l’idée que la planète
n’est pas seulement un décor mais un partenaire de l’histoire humaine, ce qui
transforme profondément les politiques écologiques.
Vie communautaire et politique
• Cercles de parole civiques : inspirés des traditions autochtones, ils permettent
de recréer un espace sacré de dialogue, où chacun parle à partir du cœur et est
écouté sans interruption. Cela pourrait remplacer une partie des débats
politiques stériles par une écoute réelle.
• Fêtes du lien : au niveau municipal, des moments de communion collective axés
sur la gratitude envers la communauté et le vivant. Ces rituels partagés créent du
sens sans imposer de religion.
• Éducation à la dimension sacrée : intégrer, dans l’enseignement public, une
sensibilisation au sacré universel, non pas comme une dogmatique, mais
comme reconnaissance du mystère, du respect de la vie et du sentiment
d’appartenance.
Enjeux et précautions
• Il faudrait éviter toute récupération nationaliste ou idéologique du sacré, ce qui a
souvent conduit aux pires dérives (culte du chef, mythes guerriers).
• Le sacré proposé doit rester ouvert, inclusif et lié à l’universel (la Terre, la vie,
l’humanité), et non à des croyances particulières.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
1
/
17
100%