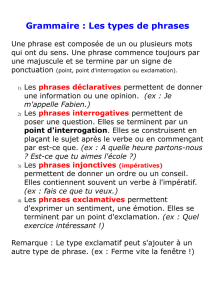Guide Pédagogique Taoki et compagnie CP - Méthode de Lecture Syllabique
Telechargé par
manon.tournaillon

Méthode de lecture syllabique
CP
Isabelle CARLIER
Professeur des écoles
Angélique LE VAN GONG
Professeur des écoles
Guide
pédagogique

Responsable de projet : Delphine DEVEAUX
Création de la maquette de couverture : Estelle CHANDELIER
Illustration de la couverture : Patrick CHENOT
Création de la maquette intérieure : Estelle CHANDELIER
Mise en pages : TYPO-VIRGULE
Fabrication : Nicolas SCHOTT
ISBN : 978-2-01-116555-8
© Hachette Livre 2010, 43 quai de Grenelle, 75905 Paris Cedex 15.
Tous droits de traduction, de reproduction et d’adaptation réservés pour tous pays.
Le Code de la propriété intellectuelle n’autorisant, aux termes des articles L. 122-4 et L. 122-5, d’une part, que les « copies ou reproductions strictement réservées
à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective », et, d’autre part, que « les analyses et les courtes citations » dans un but d’exemple ou
d’illustration, « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite ».
Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, sans autorisation de l’éditeur ou du Centre français de l’exploitation du droit de copie
(20, rue des Grands-Augustins – 75006 Paris), constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code pénal.

3
Avant-propos
Avant-propos
Ce guide pédagogique apporte les compléments péda-
gogiques nécessaires à la mise en œuvre des activités
du manuel et des cahiers d’exercices de la méthode de
lecture Taoki et compagnie.
L’ORGANISATION
DU GUIDE PÉDAGOGIQUE
Le guide pédagogique est divisé en deux parties, comme
le manuel : une partie « Apprentissage du code » et une
partie « Lecture ».
Chaque leçon d’apprentissage du code est proposée sur
deux jours, au cours desquels le son, son graphème,
le déchiffrage et les lectures de mots, de phrases et de
texte sont progressivement abordés.
Parmi les neuf extraits de textes de littérature jeunesse
de la partie « Lecture » du manuel sept sont étudiés sur
deux jours. Une seule journée est consacrée à la bande
dessinée dont le texte est plus court. Le dernier texte,
œuvre complète, est proposé sur quatre jours étant don-
né sa longueur et sa richesse lexicale. Nous avons choisi
de ne pas imposer de moment précis pour l’exploitation
de ces textes. Nous avons seulement indiqué la période
de l’année à partir de laquelle ceux-ci sont lisibles par
les élèves. L’enseignant a ainsi toute liberté de choisir le
moment favorable pour les étudier en classe.
Le déroulement de l’exploitation du manuel a été conçu
dans le souci d’alterner les formes et les modalités de
travail. En effet, une progression cohérente a été mise
en place dans nos séances en suivant une construction
identique :
– découverte et observation ;
–
étude du code (discrimination auditive, puis visuelle) ;
– observation et étude de la langue ;
– entraînement ;
– réinvestissement et formalisation.
Dans chaque ensemble d’activités, nous alternons les
formes de travail : collectif, individuel, à l’écrit, à l’oral.
Pour faire le lien avec la découverte du monde, des prolon-
gements sont proposés en fi n de leçon ainsi qu’une biblio-
graphie permettant à l’enseignant d’enrichir le thème.
L’APPRENTISSAGE DU CODE
L’apprentissage du code se fait par l’étude de 54 sons.
Chaque leçon du manuel est construite autour d’un son :
de sa discrimination auditive à la découverte du gra-
phème, de la formation de syllabes au déchiffrage de
mots, de phrases et enfi n à la lecture de textes.
◆ L’exploitation de la scène
La scène illustrée représente l’histoire des personnages
qui accompagneront les élèves tout au long de l’année.
Hugo et Lili, deux enfants de 6 ou 7 ans et leur ami
Taoki, le dragon venu d’un monde imaginaire, vont vivre
et partager avec les élèves des aventures très variées,
tout au long de l’année. La scène (et son poster) sera
l’occasion de suivre ces épisodes et de débattre collecti-
vement de ce qui leur arrive.
Les thèmes abordés sont très divers : dans les premiers
mois, ils sont volontairement proches des enfants et de
leur quotidien (la maison, l’école, le sport…) et devien-
nent plus éloignés au fi l du temps (les voyages, les châ-
teaux forts…). L’objectif est d’impliquer les élèves et de
susciter leur intérêt tout en développant leur curiosité
et en élargissant leur culture.
C’est à partir de la scène, clé de voûte de l’apprentis-
sage du code, que les élèves seront amenés à observer,
à s’exprimer, à construire et anticiper tout en dévelop-
pant leur langage oral. Ce travail collectif permettra de
créer du sens en élaborant des hypothèses sur l’histoire,
hypothèses qui seront ou non confortées lors de l’étude
du texte. L’observation de la scène permettra également
de travailler un vocabulaire thématique qui pourra être
étayé dans les leçons suivantes sur le même thème ou
dans les prolongements proposés en fi n de leçon.
C’est aussi dans la scène illustrée que les élèves pour-
ront rechercher les dessins des mots comportant le son
étudié.
Les 30 premières scènes sont proposées en format pos-
ter : elles correspondent aux sons simples des deux pre-
mières périodes de l’année. L’affi chage du poster peut
faciliter le travail oral de tout le groupe classe.
◆ L’étude du code
Étape importante, la phonologie permet à l’élève de
développer et de travailler son écoute. C’est pourquoi
nous avons choisi de commencer systématiquement
les leçons par un travail spécifi que de phonologie qui
a pour fonction d’entraîner les élèves à écouter le son
afi n de se l’approprier et de pouvoir le réinvestir lors
de la séance.
• La discrimination auditive
Chaque séance commence par un travail de discrimi-
nation auditive du son étudié. Tout au long de l’année,
le nouveau son est introduit par des moyens différents :
des comptines, des devinettes, des phrases. L’objectif
est d’habituer les élèves à écouter et à repérer le son ré-
pété. Une fois le son repéré suivent des exercices oraux
de discrimination (jeu du pigeon vole, du Maharadjah,
du marché de Rodomodo, du magasin de Mariette…).
Les élèves découpent les mots en syllabes pour discri-
miner le son à l’intérieur des mots.
C’est dans le cahier d’exercices (1 ou 2) que les élèves
complètent cette discrimination auditive par d’autres
activités : la recherche de mots contenant le son, le clas-
sement « je vois / j’entends », la recherche de mots in-
trus…
• La discrimination visuelle
Une fois l’écoute et le repérage du son à l’oral établis, la
graphie est introduite. Les élèves vont pouvoir associer
un phonème à un graphème. Un mot repère est alors
proposé, c’est le mot étiquette qui servira de référence
aux élèves.
Le travail sur l’écriture et le sens d’écriture de la lettre
étudiée est alors mené, avec la possibilité d’utiliser le
cahier d’écriture de la méthode. Il est indispensable de
faire effectuer les gestes aux élèves dans l’espace pour
qu’ils perçoivent avec leur corps le sens de la graphie
avant de passer aux contraintes du cahier. Cette recon-

4
naissance de la graphie est ensuite travaillée et exploi-
tée dans le cahier d’exercices (1 ou 2) avec des travaux
de reconnaissance de lettres et des classements.
• La lecture de syllabes, de mots et de phrases
Passer du son à la graphie est l’étape importante de l’ap-
prentissage de la lecture qui va permettre aux élèves
de comprendre et d’accéder au déchiffrage. Au fur et
à mesure de l’étude des sons, ils vont pouvoir associer
des lettres pour former des syllabes, puis des mots,
jusqu’aux phrases et aux textes.
Le travail d’association commence dès l’étude du pre-
mier son consonne. Le choix de la progression des sons
s’est porté en premier sur les consonnes longues, plus
faciles à tenir par les élèves pour comprendre le méca-
nisme d’association d’une consonne avec une voyelle.
Dès que l’élève est capable de lire des syllabes, il pour-
ra lire des mots, puis des phrases, en fonction des sons
étudiés.
Tous les mots proposés à la lecture dans le manuel et les
cahiers d’exercices sont lisibles par les élèves en fonc-
tion de la progression de l’étude des sons.
Le travail de déchiffrage et de lecture en collectif au
tableau permet de canaliser les attentions et une réelle
recherche de groupe. La relecture dans le manuel est
un moment de réinvestissement individuel. Même s’il
s’agit des mêmes mots, les élèves sont alors confrontés
à leurs acquis et à leurs lacunes. Cette relecture indi-
viduelle permet aussi à l’enseignant de circuler et de
constater les diffi cultés de certains.
• Les mots outils
Les mots outils apparaissent dès les premières leçons.
Même s’ils ne sont pas déchiffrables directement, ils
sont nécessaires pour enrichir les constructions des
phrases et la structuration des histoires de Taoki. Il est
indispensable que les élèves les lisent sans hésitation
et apprennent leur orthographe, soit à la fi n de chaque
étude de son, soit lors des révisions.
• Le passage à l’écrit
On ne peut dissocier le décodage de l’encodage. Pour ce
faire, il est indispensable que l’écriture soit travaillée
dans le même temps que l’acquisition des sons et le dé-
chiffrage de syllabes. Dans un premier temps, ces acti-
vités d’écriture se présenteront sous la forme de dictées
de syllabes, puis de dictées de mots et de phrases.
Si ce travail est encore simple en début d’année, il
prend ensuite une importance croissante pour habituer
les élèves au passage à l’écrit. Des exercices de formes
variées dans les cahiers d’exercices de la méthode com-
plètent les propositions faites au cours des séances du
guide.
◆ L’histoire de Taoki
Le texte de « l’histoire de Taoki » vient clore chaque
séance d’apprentissage du code. Il met en scène les per-
sonnages et raconte ce qu’il se passe dans l’histoire et
ce qui est représenté sur la scène illustrée. Il permet
de faire du sens, de conforter ou non les hypothèses
émises par les élèves lors de l’observation de la scène,
de faire des liens entre le texte et l’illustration et de
faire comprendre aux élèves que l’écrit peut compléter
une image.
Le texte de l’histoire permet un réinvestissement des
sons déjà étudiés. Chaque mot est lisible. Des mots ou-
tils sont parfois introduits pour enrichir les phrases. Le
texte ne cesse de s’allonger tout au long de l’année, au
fur et à mesure de l’avancement dans la progression de
l’étude des sons et de l’évolution des capacités de lec-
ture et de compréhension des élèves.
Un travail spécifi que est proposé dans les cahiers
d’exercices 1 et 2 sur le texte de « l’histoire de Taoki ».
Les activités sont variées, mais toutes concernent la
compréhension de l’histoire : des vrai / faux, des textes
à corriger, des phrases à compléter, à relier, à barrer,
à numéroter, des questions sur le texte… Ce type de
travail permet à l’enseignant de vérifi er la bonne com-
préhension qu’ont les élèves de l’histoire.
◆ L’observation de la langue
Comme indiqué dans les Programmes 2008, les élèves
doivent avoir observé et repéré un certain nombre de
constructions grammaticales à l’issue du CP, notam-
ment :
– la phrase et la ponctuation ;
– les classes de mots : le nom, l’article, le verbe et une
première approche du pronom en tant que substitut du
sujet ;
– le genre et le nombre des noms ;
– le passé, le présent, le futur.
Nous avons choisi de travailler ces quelques points
de grammaire au travers des leçons du manuel, sans y
consacrer une rubrique spécifi que mais en les instillant
dans les phrases proposées. Par contre, dans les Cahiers
d’exercices 1 et 2, les points de grammaire sont traités
spécifi quement dans la rubrique « J’observe la langue »
et font l’objet d’exercices particuliers et d’un travail
oral et écrit en classe.
Les phases d’étude de la langue restent du domaine de
l’imprégnation. Il est nécessaire de répéter le plus sou-
vent possible lors des lectures des « histoires de Taoki »
le questionnements sur la phrase (majuscule en tête et
point fi nal), le genre et le nombre des mots, le verbe et
les marques du pluriel afi n de sensibiliser les élèves à
ces points de grammaire qui seront développés en tant
que tels en CE1.
◆ Les prolongements
Pour aider l’enseignant à créer des liens avec la décou-
verte du monde et les autres domaines des Programmes
comme l’Instruction civique et morale ou les Arts vi-
suels, une rubrique « Pour aller plus loin » est propo-
sée à la fi n de chaque leçon. Elle répertorie quelques
activités possibles pour enrichir le thème abordé. Une
bibliographie complète ce dispositif, en proposant des
documentaires à mettre à la disposition des élèves ou
des albums pour développer le plaisir de lire.
◆ La différenciation
Chaque fois que cela nous a paru utile, des proposi-
tions d’activités de différenciation et de remédiation
complètent les séances : pour remédier aux diffi cultés
des élèves moins à l’aise, mais aussi pour permettre aux
élèves plus à l’aise de continuer à progresser dans leur
apprentissage.

5
LA PRODUCTION D’ÉCRITS
L’apprentissage de la lecture et celui de l’expression
écrite sont complémentaires et indissociables, l’un et
l’autre s’enrichissant mutuellement. Écrire un mot re-
quiert la même analyse et la même synthèse que le dé-
chiffrage. C’est pourquoi la progressivité des cahiers
d’exercices 1 et 2 amène les élèves à écrire, notamment
au travers des projets d’écriture associés à « l’histoire
de Taoki ».
Il est également proposé dans les cahiers d’exercices 1
et 2 des projets d’écriture plus conséquents. Par le
biais du questionnement, elles ont pour fonction de
dégager les caractéristiques d’un type d’écrit différent :
sa fi nalité, sa mise en page, sa structure, son vocabu-
laire. Cette étude permet de dégager la « silhouette »
du texte, qui sert ensuite de base à la production d’écrit.
Les élèves vont ainsi pouvoir se l’approprier. Par le
cheminement proposé et par les propositions orales
recueillies par l’enseignant, les élèves sont guidés
dans l’écriture de leur projet. La qualité de la pré-
sentation doit être l’objet d’une attention constante.
Les productions réalisées pourront par la suite faire
l’objet d’une lecture ou d’une présentation à d’autres
classes ou aux parents sous forme d’affi che, par
exemple.
LES TEXTES DE LECTURE
La seconde partie du manuel propose des extraits de
littérature de jeunesse, ainsi que des documentaires.
Ces textes, gradués dans la diffi culté de lecture, peu-
vent être lus en fonction de la progression des sons, le
premier étant lisible à partir de la période 3. Ils permet-
tent d’aborder un genre littéraire, d’ouvrir les horizons
de lecture des élèves pour ne pas lire uniquement les
« histoires de Taoki » et de leur donner le goût de la
lecture.
Sur les neuf textes proposés, cinq sont issus de la liste
du ministère de l’Éducation nationale pour le cycle 2,
dont l’un est présenté dans son intégralité. Nous avons
choisi de varier les types d’écrit : documentaires, al-
bums, récits, théâtre…
Chaque séance d’exploitation propose d’alterner l’ob-
servation du texte et de ses illustrations, le déchiffrage
et la compréhension. Les élèves vont ainsi pouvoir réin-
vestir ce qu’ils ont appris dans l’étude du code.
Des photofi ches sont proposées en fi n de guide pour
compléter cette étude de textes.
Nous avons eu à cœur de rendre la lecture accessible à
tous pour qu’elle devienne un plaisir.
Les auteurs
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
 129
129
 130
130
 131
131
 132
132
 133
133
 134
134
 135
135
 136
136
 137
137
 138
138
 139
139
 140
140
 141
141
 142
142
 143
143
 144
144
 145
145
 146
146
 147
147
 148
148
 149
149
 150
150
 151
151
 152
152
 153
153
 154
154
 155
155
 156
156
 157
157
 158
158
 159
159
 160
160
 161
161
 162
162
 163
163
 164
164
 165
165
 166
166
 167
167
 168
168
 169
169
 170
170
 171
171
 172
172
 173
173
 174
174
 175
175
 176
176
 177
177
 178
178
 179
179
 180
180
 181
181
 182
182
 183
183
 184
184
 185
185
 186
186
 187
187
 188
188
 189
189
 190
190
 191
191
 192
192
 193
193
 194
194
 195
195
 196
196
 197
197
 198
198
 199
199
 200
200
 201
201
 202
202
 203
203
 204
204
 205
205
 206
206
 207
207
 208
208
 209
209
 210
210
 211
211
 212
212
 213
213
 214
214
 215
215
 216
216
 217
217
 218
218
 219
219
 220
220
 221
221
 222
222
 223
223
 224
224
 225
225
 226
226
 227
227
 228
228
 229
229
 230
230
 231
231
 232
232
 233
233
 234
234
 235
235
 236
236
 237
237
 238
238
 239
239
 240
240
 241
241
 242
242
 243
243
 244
244
 245
245
 246
246
 247
247
 248
248
 249
249
 250
250
 251
251
 252
252
 253
253
 254
254
 255
255
 256
256
 257
257
 258
258
 259
259
 260
260
 261
261
 262
262
 263
263
 264
264
 265
265
 266
266
 267
267
 268
268
 269
269
 270
270
 271
271
 272
272
 273
273
 274
274
 275
275
 276
276
 277
277
 278
278
 279
279
 280
280
 281
281
 282
282
 283
283
 284
284
 285
285
 286
286
 287
287
 288
288
1
/
288
100%
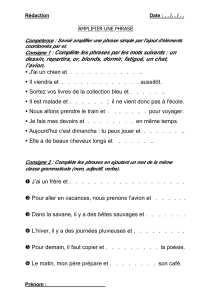
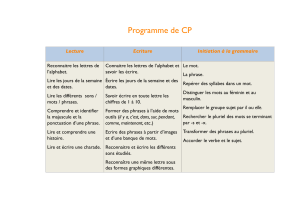
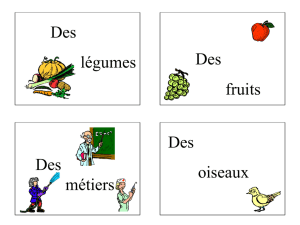
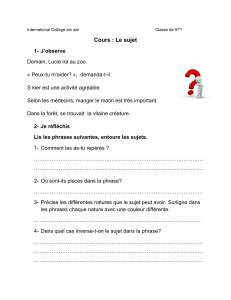


![révisions [k] [s] [z] – Exercices CM1](http://s1.studylibfr.com/store/data/007647580_1-d0ac28f4c67655ab45f51e9cf8de5896-300x300.png)