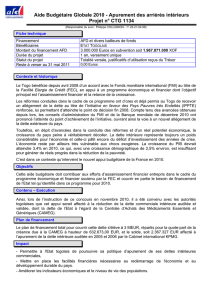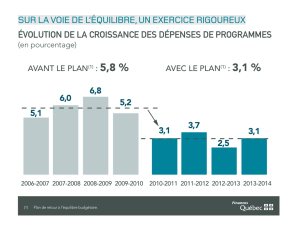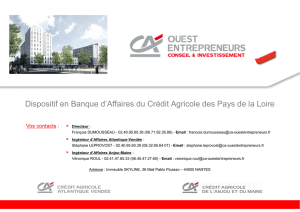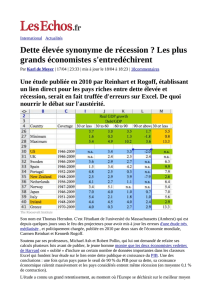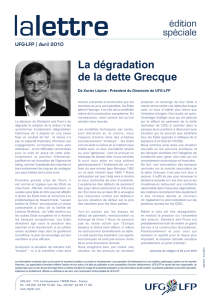1
La TVA remboursable, aussi appelée crédit de TVA, désigne la portion de la taxe sur la
valeur ajoutée (TVA) que l’entreprise a payée sur ses achats (biens ou services) et qu’elle
peut récupérer si cette TVA est supérieure à celle collectée sur ses ventes.
📘 Principe général de fonctionnement
Une entreprise collecte la TVA sur ses ventes (TVA collectée).
Elle paie de la TVA sur ses achats ou ses dépenses (TVA déductible).
Si la TVA déductible est plus élevée que la TVA collectée, l’entreprise est en crédit de
TVA.
Dans ce cas, elle peut demander le remboursement de la différence ou la reporter sur la
période suivante.
� Exemples concrets
1. Entreprise exportatrice
o Elle vend des biens à l’étranger : ses ventes sont exonérées de TVA.
o Mais elle paie de la TVA sur les achats (matières premières, services).
o Elle peut demander le remboursement de cette TVA, puisqu'elle n’a pas pu la compenser
par des ventes taxées.
2. Investissements importants
o Une start-up achète du matériel coûteux (ordinateurs, machines).
o Elle n’a pas encore généré de ventes.
o Elle est donc en crédit de TVA et peut en demander le remboursement pour améliorer sa
trésorerie.
3. Entreprises dans le bâtiment
o Un artisan achète des matériaux avec TVA.
o S’il fait peu de ventes ce mois-là, il peut aussi se retrouver en crédit de TVA.
📍 Bon à savoir Le remboursement se fait auprès de l'administration fiscale, via une
demande spécifique. Les règles peuvent varier selon les pays, notamment en Afrique
francophone.
La dette fiscale, c’est l’ensemble des impôts et taxes qu’une personne (physique ou morale)
doit à l’administration fiscale et qu’elle n’a pas encore réglés. Cela peut concerner des
retards de paiement, des redressements fiscaux, ou des montants dus à la suite d’un contrôle.
Quelques exemples de dette fiscale
1. Retard de paiement d'impôt
o Une entreprise doit payer la TVA le 15 du mois.
o Elle ne paie que le 25 : les montants dus + pénalités constituent une dette fiscale.
2. Non-paiement de l’impôt sur le revenu
o Un commerçant déclare ses revenus mais ne paie pas l’impôt correspondant.
o L’impôt devient une dette fiscale jusqu'à régularisation.
3. Redressement fiscal
o L’administration fait un contrôle et constate un manque à gagner.
o Elle réclame des arriérés d’impôts → cette somme devient une dette fiscale.
4. Amendes et majorations
o En cas de déclaration incomplète ou fausse, des pénalités sont ajoutées.
o Ces pénalités s’ajoutent à la dette fiscale.

2
💬 À noter : En cas de dette fiscale, l’administration peut mettre en œuvre des mesures de
recouvrement : saisies, mises en demeure, voire poursuites judiciaires. Certaines juridictions
permettent aussi d’étaler la dette ou de négocier un plan de règlement.
La guerre commerciale, c’est un bras de fer économique entre pays qui utilisent des droits
de douane, des quotas ou des restrictions pour protéger leurs industries nationales ou
exercer une pression politique. Elle peut bouleverser les équilibres mondiaux, ralentir la
croissance, et créer des tensions diplomatiques.
🔥 Conséquences sur l’économie mondiale
Ralentissement de la croissance : Les échanges internationaux diminuent, ce qui freine la
production et l’investissement. La Banque mondiale estime que les tensions commerciales
ont réduit la croissance des pays émergents de 0,5 à 0,8 point en 2019.
Inflation : Les droits de douane augmentent les prix des produits importés, ce qui pèse sur
le pouvoir d’achat des consommateurs.
Perturbation des chaînes d’approvisionnement : Les entreprises doivent revoir leurs
fournisseurs, entraînant des retards et des surcoûts.
Instabilité financière : Les marchés réagissent aux annonces de sanctions ou de
représailles, créant de la volatilité.
🇪🇺 Impact sur l’économie européenne
Exportations pénalisées : L’accord du 27 juillet 2025 entre Trump et l’UE impose un tarif
moyen de 15 % sur 70 % des biens européens exportés vers les États-Unis, notamment dans
l’automobile, les semi-conducteurs et les produits pharmaceutiques.
Pression sur les PME : Les petites entreprises exportatrices ont du mal à absorber les
surcoûts, perdant des parts de marché.
Inflation importée : Les hausses de prix touchent aussi les consommateurs européens,
notamment dans les secteurs du luxe et de la santé.
Reconfiguration industrielle : Certaines entreprises européennes relocalisent leur
production aux États-Unis pour éviter les droits de douane.
� Exemples récents (2025)
Trump relance la guerre commerciale : Nouveaux droits de douane de 25 à 50 % sur les
importations du Mexique, du Canada, de la Chine et de l’UE.
Réactions en chaîne : Le Canada impose 25 % de taxes sur des produits américains comme
la bière et les appareils électroménagers. La Chine envisage une plainte à l’OMC.
Effets sur les marchés : Wall Street chute, Amazon perd de la valeur, et les annonces de
licenciements augmentent aux États-Unis.
Industries touchées en France : Les vins, spiritueux et produits pharmaceutiques sont
particulièrement vulnérables aux surtaxes américaines.
📌 Conclusion La guerre commerciale est un jeu à somme négative : tout le monde y perd
en compétitivité, en stabilité et en croissance. Elle pousse les pays à revoir leurs alliances,
leurs chaînes de production et leurs stratégies économiques.

3
La diminution des échanges internationaux freine la croissance économique en limitant
les débouchés, les investissements, l’innovation et la productivité. Voici comment cela se
manifeste, avec des exemples récents :
🔄 Moins d’exportations = moins de revenus
Exemple : Allemagne (2023–2024) En raison des tensions commerciales et de la baisse de
la demande chinoise, les exportations allemandes ont chuté de 6 %. Résultat : ralentissement
du PIB, baisse de l’activité industrielle et montée du chômage dans les secteurs exportateurs.
🏭 Perturbation des chaînes de valeur mondiales
Exemple : Guerre en Ukraine La guerre a désorganisé les chaînes d’approvisionnement
en énergie et en céréales. Les pays dépendants des importations russes ou ukrainiennes ont
vu leurs coûts de production grimper, ce qui a freiné leur croissance.
Exemple : COVID-19 Les confinements mondiaux ont réduit les flux de marchandises. Les
entreprises ont dû ralentir leur production faute de composants, comme dans l’automobile
ou l’électronique.
💸 Moins d’investissements étrangers
Les échanges favorisent la confiance et la stabilité. Quand ils diminuent, les investisseurs
deviennent frileux.
Exemple : Afrique subsaharienne (2022) La baisse des échanges mondiaux a entraîné une
chute des investissements directs étrangers, réduisant les projets d’infrastructure et
d’industrialisation.
� Moins d’innovation et de transfert technologique
Le commerce international permet aux pays d’accéder à des technologies avancées.
Exemple : Restrictions sur les semi-conducteurs (2024) Les limitations imposées par les
États-Unis à l’exportation de puces vers la Chine ont ralenti le développement de certaines
industries chinoises, affectant leur compétitivité mondiale.
📊 Effets globaux sur la croissance
Selon Les Échos, la croissance du commerce international devrait rester plus lente que celle
du PIB mondial pendant la décennie à venir, en raison de la régionalisation des échanges et
des tensions géopolitiques.
Cela signifie que les pays devront miser davantage sur leur marché intérieur, ce qui est plus
difficile pour les économies émergentes.
Le pétrole représente 90 % des exportations et 50 % des revenus de l’État en République
du Congo parce qu’il est la principale ressource économique du pays, tant en volume
qu’en valeur. Voici comment cela fonctionne concrètement :
📦 Pourquoi 90 % des exportations ?
Le Congo exporte principalement du pétrole brut, notamment les qualités Djéno Blend,
Nkossa Blend, et Yombo.

4
Ces exportations sont acheminées via le terminal de Djéno, qui centralise 95 % de la
production nationale.
Les autres secteurs exportateurs (bois, minerais, agriculture) restent marginaux en
comparaison.
En 2019, le pays produisait environ 339 000 barils/jour, ce qui le plaçait au 3ᵉ rang en
Afrique subsaharienne, derrière le Nigeria et l’Angola.
💰 Pourquoi 50 % des revenus de l’État ?
L’État congolais perçoit des revenus via :
o Les contrats de partage de production : une part du pétrole extrait revient directement à
l’État.
o Les impôts et taxes sur les compagnies pétrolières.
o Les dividendes de la SNPC (Société nationale des pétroles du Congo), qui commercialise
la part étatique.
En 2014, le pétrole représentait 80 % des recettes budgétaires. Ce chiffre a baissé à 50 %
dans la loi de finances 2021, en raison de la chute des prix du baril et du déclin naturel des
champs.
� Exemple concret
En 2025, la SNPC a présenté au Parlement des projets comme Marine XXIXA et NANGA
V, visant à augmenter la production nationale pour maintenir les recettes pétrolières à un
niveau élevé.
Ces projets sont essentiels pour compenser la baisse naturelle des anciens gisements et
soutenir les finances publiques.
📌 Conclusion Le pétrole est à la fois le p poumon commercial et le levier budgétaire
du Congo. Tant que l’économie reste peu diversifiée, cette dépendance structurelle au
pétrole rend le pays vulnérable aux chocs extérieurs (prix du baril, géopolitique, climat).
En 2023, la dette publique totale de la République du Congo était estimée à environ
12 971 milliards de FCFA, soit 99 % du produit intérieur brut (PIB)2. Cela signifie que
le pays est quasiment endetté à hauteur de toute sa richesse annuelle produite.
� Composition de la dette
Dette extérieure : 47,12 % du total (environ 6 110 milliards FCFA)
Dette intérieure : 52,88 % du total (environ 6 861 milliards FCFA)
📈 Évolution récente
Année
Dette totale (milliards FCFA)
Dette (% du PIB)
2021
8 130,56
116,05 %
2022
8 149,54
93,77 %
2023
12 971
99,01 %
Ces chiffres montrent une légère amélioration en 2022, suivie d’une remontée en 2023, liée
à de nouveaux emprunts et à la reprise post-COVID2.

5
📌 Pourquoi cette dette est importante ?
Elle limite la capacité de l’État à investir dans les secteurs sociaux (éducation, santé).
Elle rend le pays vulnérable aux fluctuations des prix du pétrole, principale source de
revenus.
Elle nécessite des négociations régulières avec le FMI et les créanciers pour éviter le
surendettement.
La dette extérieure de la République du Congo est composée de plusieurs éléments,
chacun représentant une source ou une forme d’emprunt contracté à l’international. Voici
les principales composantes :
🏦 1. Dette multilatérale
Dette contractée auprès d’organismes internationaux :
FMI (Fonds monétaire international)
Banque mondiale (IDA, BIRD)
Banque africaine de développement (BAD)
Banque arabe pour le développement économique en Afrique (BADEA)
Ces prêts sont souvent à taux préférentiels et accompagnés de programmes de réforme
économique.
🤝 2. Dette bilatérale
Dette contractée auprès d’États étrangers :
Club de Paris : regroupe des pays créanciers comme la France, l’Allemagne, le Japon, etc.
Club de Londres : créanciers privés ou commerciaux
Autres accords bilatéraux avec des pays comme la Chine, l’Inde ou le Koweït
💼 3. Dette commerciale ou privée
Emprunts auprès de banques internationales ou d’investisseurs privés
Obligations souveraines émises sur les marchés financiers
Crédits fournisseurs pour des projets d’infrastructure
4. Dette garantie par l’État
Prêts contractés par des entreprises publiques ou des provinces, mais garantis par l’État
central
Souvent utilisés pour financer des projets stratégiques (routes, énergie, télécoms)
📉 Risques associés
Taux de change : la dette est souvent libellée en devises étrangères (USD, EUR, CNY), ce
qui expose le pays à des fluctuations
Service de la dette : le remboursement annuel peut absorber une part importante du budget
national
 6
6
 7
7
1
/
7
100%