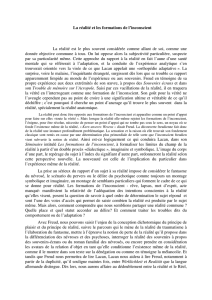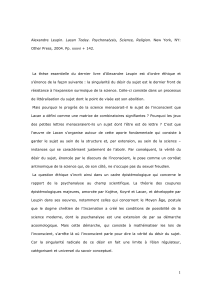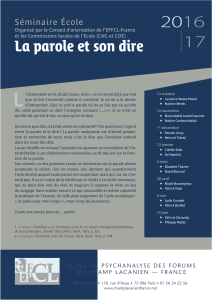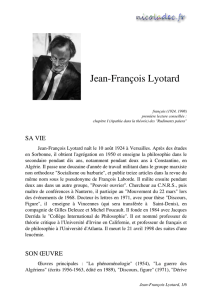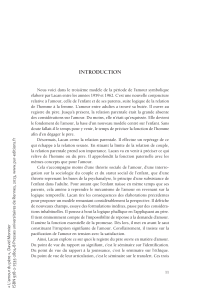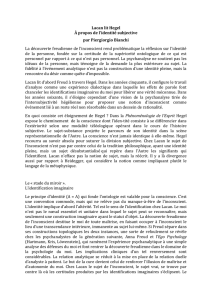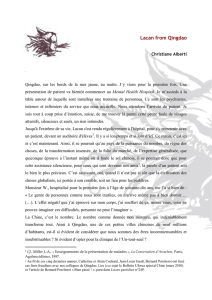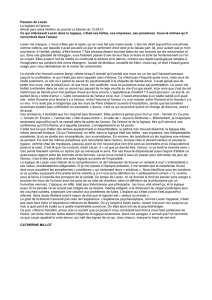Lyotard et le langage : Inconscient, Discours et Philosophie
Telechargé par
Corinne Enaudeau


Table des matières
Remerciements
Liste des abréviations des œuvres de Jean-François Lyotard
Introduction. C. Enaudeau, Des articulations du langage
« On ne joue pas avec le langage »
J.-M. Salanskis, Langage, désir et analyse
M. Olivier, Transcendance ou immanence du langage : un problème méthodologique ou métaphysique ?
Ch. Murgier, Lyotard et les conceptions grecques du logos
S. Nordmann, Rétorsion du temps et rétorsion du langage : la référence au hassidisme chez Lyotard
R. Trimçev, L’ordre du conflit. La métaphore du jeu chez Jean-François Lyotard
Consensus et différend
G. Raulet, Jeux de langage. Le tournant communicationnel et la communauté intraitable
I. Aubert, Entente et différend. Lyotard et Habermas : état des lieux d’une rencontre manquée
A. Niederberger, Reconnaissance ou méconnaissance ? Lyotard critique de la pensée (néo-)hégélienne
de la société
L. Kahn, Consensualité et postmodernité : d’un lissage psychanalytique du différend lyotardien
F. Fruteau de Laclos, L’enfance comme sensus communis. Lyotard et la pragmatique infra-langagière
Droit à la parole, droit au silence
G. Bernard, Langage et pouvoir. Le silence équivoque ou le paradoxe de la réalité
J.-F. Rey, La parole reconnaissante : langage et justice dans Le Différend
Cl. Pagès, Lyotard et le silence
R. Peleg, Le langage comme reste et comme rémanence : lire Lyotard avec Paul Celan
F.-D. Sebbah, La phrase du témoin
Désarticulations du langage
C. Enaudeau, Du langage de l’inconscient : Lyotard et Lacan
A. Gualandi, Voix, corps, langage. Réflexions quasi-psychanalytiques autour de J.-F. Lyotard
G. Bennington, Lyotard à même le langage
G. Sfez, Le langage à l’instant critique
Index des noms
Index des notions
Les auteurs

Corinne Enaudeau
Du langage de l’inconscient : Lyotard et Lacan
I – La rencontre
On peut penser que le langage et ses contraintes régissent plus que la vie consciente,
qu’ils participent à la formation de mouvements psychiques inconscients, hypothèse d’autant
moins invraisemblable que la « cure par la parole » peut desserrer l’étau de pathologies
psychiques douloureuses. Mais cela autorise-t-il à penser que l’inconscient est « structuré
comme un langage1 » ? Cette thèse a fait la célébrité de Jacques Lacan et lui a accordé le
statut périlleux du plus philosophe des psychanalystes et d’un philosophe enfin psychanalyste.
Se demander comment Lyotard a reçu la leçon de Lacan, c’est devoir situer la question au-
delà des frontières départageant les champs disciplinaires. Car, outre leurs emprunts respectifs
aux sciences humaines, Lacan et Lyotard lestent l’examen du rapport entre langage et
inconscient d’enjeux philosophiques dont Freud, quant à lui, se méfiait, soucieux qu’il restait
de la légitimation clinique de la spéculation.
Lyotard a dû commencer à lire Lacan en 1964, année durant laquelle il a assisté à son
séminaire. Il ne semble pas avoir suivi les déplacements des thèses lacaniennes postérieurs à
1971, date de la parution de Discours, figure, même si la référence (souvent implicite) à
Lacan traverse toute son œuvre. Dans l’élaboration de sa pensée, Lyotard aura fait de ce
dernier à la fois un adversaire et un allié. L’adversaire est celui qui inféode l’inconscient à
l’« ordre symbolique » ; l’allié celui qui le soustrait à cet ordre en réservant au « réel » une
dimension insignifiable. Sous l’apparente contradiction de ces deux aspects de l’inconscient
lacanien apparaît déjà la difficulté à affirmer un inconnaissable sans l’arrimer de quelque
manière à l’ordre langagier. Même si Lyotard pense autrement le langage que ne le fait Lacan,
il lui faut, à lui aussi, ajointer le discours et ce qu’il exclut. Pour Lacan, le signifiant est
l’anneau qui relie le langage et l’inconscient, la lettre vide de sens attrapée dans le discours de
l’autre à laquelle le désir inconscient s’accroche et qu’il ne cesse de déplacer pour tenter de
s’identifier lui-même. Ce que vise pourtant le désir c’est l’impossible, c’est d’approcher un
réel absolu étranger au langage, dont on est pourtant d’avance éjecté pour être né dans les
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 J. Lacan, Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse [1964], noté Quatre concepts…, Paris, Seuil,
Points Essais, 1973, p. 28. Cf. aussi : Écrits, Paris, Seuil, 1966, p. 838 et 866.

mots, c’est d’annuler le manque qui laisse le désir aimanté par une « Chose » excédant, outre
tout signifié mais aussi tout signifiant, tout objet d’investissement possible. Le réel
insignifiable, irreprésentable, hors formes, est bien, pour Lyotard, le seul inconscient véritable
au sein du dispositif lacanien2. Car le discours inconscient, quant à lui, dans lequel le désir
chercherait le sens du manque qui le constitue comme désir, Lacan l’aurait plutôt construit,
aux yeux de Lyotard, pour imposer une acception inédite du « sujet ». « Sujet inconscient »
qui, contrairement à l’ego, ne parle pas, mais est parlé par une chaîne signifiante qui « cause »
mais ne dit rien. Lacan tient en effet le langage pour un réseau différentiel de signifiants sans
signifiés, donné a priori. Signifiants qui, agrafés dans les paroles de l’autre, relayent la course
du désir inconscient et en déterminent la scansion. Ainsi seul le « symbolique » ferait exister
le « sujet » du désir – le sujet qu’est le désir – en le marquant au sceau des signifiants dans
lesquels il se cherche.
L’ajointement du langage et de l’inconscient se pense tout autrement pour Lyotard.
L’agir désordonné de la pulsion ou, plus tard, le pâtir d’un affect mutique sont la matière
informe que l’ordre de la représentation – image ou discours – exclut par principe. Cette part
inconsciente où s’enferme la violence silencieuse d’une puissance (la pulsion) ou d’une
impuissance (l’affect inconscient) est un « extrême réel3 » qui, selon Lyotard, préoccupe la
pensée, dans sa gravité du moins. Pensée qui habite l’art et la philosophie pour autant qu’ils
tentent de faire droit à ce reste laissé par toute articulation, en dépit de l’impossibilité de
principe à lui donner une forme, verbale au premier chef.
De l’une à l’autre des deux approches, le point de vue se déplace : c’est la clinique des
psychoses qui sert de fil phénoménal à l’hypothèse de Lacan ; c’est l’œuvre de l’art qui
oriente celle de Lyotard. Il reste que le rapport entre l’inconscient et le langage finira par être
pris, chez ce dernier, dans une tension analogue à celle affectant ce rapport chez le premier.
Lacan peut affirmer d’un même geste que « l’inconscient c’est le discours de l’Autre » et que
« l’inconscient est […], le réel en tant qu’impossible à dire4 ». Quant à Lyotard, il peut
rappeler en 1997 que le nom de Freud « signifie [pour lui] qu’il y a du reste et qu’il n’est pas
vrai que le discours peut venir à bout de ce reste », et se demander pourtant en 1989 : « quid
de l’inconscient en termes de phrases5 ? ». L’hypothèse d’une « phrase-inconscient » ou d’une
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 Péré, p. 29.
3 J.-F. Lyotard (entretien avec Gérald Sfez), « L’extrême réel », Rue Descartes n°12-13, Paris, Albin Michel,
1995, p. 204.
4 Écrits, op. cit., p. 16 et 379.
5 R. Beardsworth, « Freud, Energy and Chance A Conversation with Jean-François Lyotard » [noté
Beardsworth], Teknema 5, 1999, en ligne : http://tekhnema.free.fr/5Beardsworth.html [consulté le 18-10-2016] ;
tr. fr. inédite R. McKeon, revue par L. Kahn. ; Misère, p. 65.

« phrase-affect » semblerait pourtant une révision très lourde de la pensée de Lyotard, si elle
devait proprement intégrer dans une configuration langagière, aussi excentrique soit-elle, le
« reste » censé lui demeurer étranger. D’autant que cette hypothèse suppose une acception
hétérodoxe du langage (tenu pour l’archipel éclaté des « il y a » que sont les « phrases »), dont
Discours, figure faisait justement grief à Lacan, même si son hérésie était autre.
II – La bataille
Partons de ce que Lacan demande au langage pour y ancrer l’inconscient. « La loi du
langage », dit Lacan, s’impose d’emblée à l’existence humaine. Elle fait qu’on nomme chaque
nouveau-venu, qu’on lui demande d’entrer dans le pacte social et qu’on le charge ainsi de
toutes sortes d’héritages. Le « symbolique » qualifie, dans sa plus simple acception, ce pacte
langagier6 qui unit les communautés humaines. Mais « la loi du langage » est, pour Lacan,
bien plus que cela. Elle est un ordre au double sens du terme : une organisation et un
commandement. Parler, c’est se soumettre aux contraintes phonétiques, sémantiques,
syntaxiques qui, dans chaque langue, ordonnent le discours selon des ruptures et des
combinaisons lui assurant intelligibilité et donc signification. Selon Saussure que Lacan cite7,
la discrétion de la langue tient à l’opposition de « phonèmes » exclusifs les uns des autres,
discriminant les « signifiants » (tels les deux sons a différenciant tache et tâche) et du même
coup les « signifiés » des termes. Mais alors que ces deux faces du signe sont, pour Saussure,
aussi indissociables que le recto et le verso d’une feuille de papier, Lacan les désolidarise et
fait de la seule distinction entre signifiants la structure de toute langue. Et ce, au motif que le
sens d’un mot, son signifié, est variable, voire contradictoire, qu’il n’est jamais donné, mais
se cherche dans le renvoi aux autres signes auxquels ce terme est relié dans la chaîne parlée.
Le sens des énoncés se relance ainsi dans le ricochet d’un signifiant sur l’autre, sans trouver
d’appui dans la signification propre de chaque mot. Pour justifier ce découplage des deux
faces du signe, Lacan invoque l’apprentissage de la parole : l’enfant recevrait une masse de
signifiants dont, seul, le jeu de renvoi lui permettrait d’approcher les signifiés, au demeurant
toujours ambigus. Des significations différentes viennent en effet « glisser8 » successivement
sous un même signifiant sans jamais pouvoir y rester amarrées. Ce découplage, très lourd de
conséquences quant à la désignation des objets et donc à l’appréhension de la réalité,
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6 Écrits, op. cit., p. 272.
7 Pour ce qui suit, cf. ibid., p. 493-528.
8 Ibid., p. 502 ; J. Lacan, Les Psychoses [1955-1956], Paris, Seuil, 1981, p. 135.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
1
/
16
100%