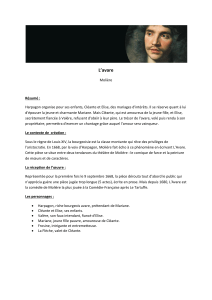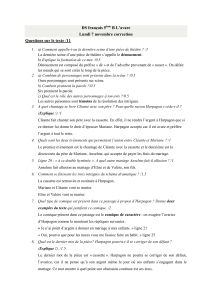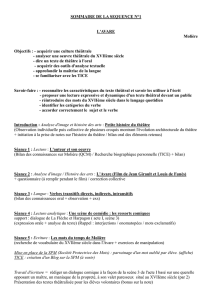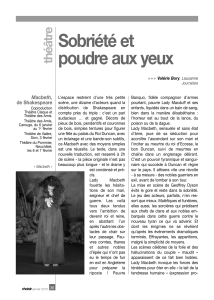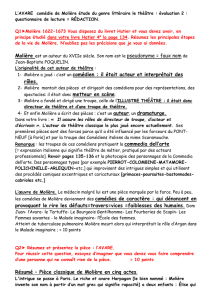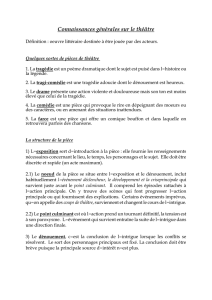Hatier 2022 • Œuvres & Thèmes • L’Avare de Molière • guide pédagogique
Page 1 sur 27
L’Avare, de Molière
Guide pédagogique par Hélène Potelet et Michelle Busseron
PRÉSENTATION DE L’OUVRAGE 2
1. L’avant-texte 2
2. Le texte et le carnet de lecture 2
3. Les activités autour de l’œuvre 2
4. Le groupement thématique 2
AVANT LA LECTURE 3
Aborder le thème de l’avarice par les arts 3
Formuler des hypothèses de lecture 3
CARNET DE LECTURE 4
Questions sur l’acte I 4
Questions sur l’acte II 9
Questions sur l’acte III 12
Questions sur l’acte IV 16
Questions sur l’acte V 19
ACTIVITÉS 22
Bilan de lecture : faire le point sur la pièce 22
Oral jouer une scène de l’Avare 23
Langue : étudier la langue de Molière 23
GROUPEMENT THÉMATIQUE : LA FIGURE DE L’AVARE (LITTÉRATURE ET ARTS)24
1. Un être méfiant et cruel 24
2. Un être avide de posséder 25
3. Un tyran domestique 26
Questions de synthèse 27

Hatier 2022 • Œuvres & Thèmes • L’Avare de Molière • guide pédagogique
Page 2 sur 27
PRÉSENTATION DE L’OUVRAGE
La pièce de Molière L’Avare peut être étudiée
en classe de 5e en lien avec l’objet d’étude
« Avec autrui : famille, amis, réseaux ».
L’objectif est de comprendre la complexité
des relations avec autrui (attachements et
tensions). Elle est également étudiée en classe
de 4e en lien avec l’objet d’étude « Individu
et société : confrontations de valeurs ».
L’objectif est alors de comprendre que
la structure et le dynamisme de l’action
dramatique ont partie liée avec les conflits,
et de saisir quels sont les intérêts et les valeurs
que ces conflits mettent en jeu.
1. L’avant-texte
L’avant-texte comporte : une entrée artistique
liée à l’époque ou au thème de l’œuvre ; des
repères historiques et culturels accompagnés
d’une frise chronologique ; une biographie
de Molière et une courte présentation de la pièce ;
un point sur le théâtre à l’époque de Molière
et sur le genre de la comédie ; des informations
sur les sources et la postérité de la pièce.
Muni de tous ces éléments, l’élève est ensuite
invité à formuler des hypothèses de lecture
en prenant en compte l’illustration de couverture
et les informations fournies sur la quatrième
de couverture de l’ouvrage.
2. Le texte et le carnet
de lecture
Le texte est donné intégralement et comporte des
notes qui éclairent le sens de mots ou
d’expressions difficiles. Le carnet de lecture
comporte cinq questionnaires constitués des
éléments suivants :
• un échange des premières impressions,
à partir desquelles on bâtira le sens du texte ;
• une rubrique « Vérifier sa lecture », sous forme
de QCM, de vrai ou faux, ou de remise dans
l’ordre des actions ;
• une rubrique « Analyser le texte » (l’élève est
conduit à s’approprier les spécificités du genre
théâtral : dialogue, monologue, répliques, apartés,
coup de théâtre, relations entre les personnages
et à analyser la dimension comique de la pièce) ;
• une rubrique « Retenir l’essentiel »,
souvent présentée sous forme de schéma
ou de carte mentale, qui permet de faire
le point sur l’étude ;
• parfois quelques courtes questions
de vocabulaire ou de grammaire ;
• une étude d’images à partir de différentes
mises en scène (Frédérique Lazarini en 2017,
Catherine Hiegel en 2009, Jean Vilar en 1952)
et d’une photographie extraite du film réalisé
en 1979 par Jean Girault avec Louis de Funès
dans le rôle d’Harpagon.
3. Les activités autour
de l’œuvre
Elles permettent de revenir sur l’ensemble
de l’œuvre et constituent un bilan final.
Elles proposent :
• un point sur la pièce (personnages, dimension
comique) ;
• des activités d’oral (s’entraîner à exprimer
des émotions, jouer une scène) ;
• des exercices de langue en lien avec le langage
théâtral (lexique du conflit, types de phrases,
construction et sens des didascalies) ;
• deux exercices d’écriture (écrire une autre scène
de L’Avare, rédiger une scène de quiproquo).
4. Le groupement
thématique
Il est organisé autour de la figure de l’avare
dans la littérature et les arts, et regroupe
des documents (textes et images) allant de Plaute
à Picsou.
Il est suivi de questions de synthèse :
• un point sur les textes du groupement ;
• des exercices de langue (synonymes du mot
« avare », lexique de la richesse et de la pauvreté) ;
• un exercice d’écriture (imaginer la suite
d’un texte) ;
• une proposition de débat (épargner
ou dépenser ; avare, radin ou économe).

Hatier 2022 • Œuvres & Thèmes • L’Avare de Molière • guide pédagogique
Page 3 sur 27
AVANT LA LECTURE
Aborder le thème de l’avarice par les arts
Un défaut que la morale condamne
1 a. La parabole de l’homme riche est une parabole de Luc. Elle dit que la soif de biens terrestres est
une folie car on ne peut attendre le bonheur des biens matériels, le bien le plus précieux étant la vie,
donnée par Dieu. La parabole ne condamne pas la richesse en soi, mais l’avarice et le désir d’accumuler
de façon égoïste ; elle incite au partage.
Les adjectifs qui caractérisent l’homme riche et avare sont : maigre, âgé, sévère.
b. Les objets qui permettent d’identifier l’homme comme un avare sont : les pièces examinées
à la lumière de la bougie, des livres de compte, des papiers divers.
2 a. La lumière vient de la bougie, symbole de la vie qui se consume.
b. Elle met en valeur l’homme riche et avare.
c. L’homme est enfermé sur lui-même et obsédé par sa richesse, son avarice est bien perçue comme
condamnable.
Un défaut dont on se moque
3 a. Harpagon (Louis de Funès) est vêtu d’une veste rouge bordée d’une collerette blanche.
Il est sur le point d’enterrer sa cassette dans son jardin. Il regarde fébrilement devant lui pour s’assurer
que personne ne le voit. L’éclairage met en valeur la cassette et la mine soucieuse d’Harpagon.
b. Harpagon ne semble préoccupé que par sa cassette à laquelle il est agrippé.
c. Il est rendu ridicule par l’outrance de son comportement : geste nerveux, regard exorbité, expression
inquiète.
Formuler des hypothèses de lecture
1 a. et b. La parole est aux élèves.
2 L’illustration de couverture
a. L’avare peint sur la couverture est un homme d’un certain âge, plutôt richement vêtu (veste brodée,
chapeau, perruque, collerette).
b. Il est représenté tenant une cassette serrée contre lui qu’il agrippe de ses mains.
c. L’homme a un regard malicieux et narquois, il semble satisfait d’être en possession d’une petite fortune.
Sans doute, rencontrera-t-il quelque obstacle ; mais il sera prêt à tout si quelqu’un en veut à son argent.
d. On laissera les élèves émettre des hypothèses.
3 La quatrième de couverture donne une image plutôt inquiétante du personnage : un père qui veut
imposer à ses enfants des mariages d’argent. On peut se demander si la pièce sera finalement si comique.
Mais la citation : « La peste soit de l’avarice et des avaricieux ! » par sa tonalité familière, laisse à penser
que l’on a affaire à une comédie.
Les élèves échangeront à propos des hypothèses qu’ils auront émises (manifestations de la cruauté
d’Harpagon tempérée certainement par des gags comiques).

Hatier 2022 • Œuvres & Thèmes • L’Avare de Molière • guide pédagogique
Page 4 sur 27
CARNET DE LECTURE
Questions sur l’acte I
ÉCHANGER SES IMPRESSIONS
1 On s’appuiera sur les réactions des élèves.
Au début de la pièce, le personnage d’Harpagon se montre plutôt inquiétant.
C’est un vieil avare inflexible et égoïste qui tyrannise ses enfants et son valet.
Toutefois, on peut déjà déceler le caractère ridicule du personnage, notamment face à La Flèche.
VÉRIFIER SA LECTURE
2
a. Valère est le frère d’Élise.
→
Faux, Valère est son amant.
b. Élise est la sœur de Cléante.
→
Vrai
c. Harpagon est le père d’Élise et de
Cléante.
→
Vrai
d. Mariane est une domestique.
→
Faux, Mariane est une jeune fille pauvre
qui loge non loin de la maison d’Harpagon.
3 a. La Flèche est le valet de Cléante.
b. Harpagon annonce à ses enfants qu’il va épouser Mariane.
c. Valère fait semblant d’approuver les idées d’Harpagon.
d. Harpagon chasse La Flèche parce qu’il le soupçonne de lui avoir volé de l’argent.
ANALYSER LE TEXTE
Les scènes d’exposition (scènes 1 et 2)
4 a. Les intrigues amoureuses
Les couples amoureux sont :
– Valère et Élise ;
– Cléante et Mariane.
b. Élise et Valère se sont rencontrés lors d’un naufrage : Valère a sauvé Élise d’une noyade et leurs
sentiments sont nés à ce moment-là.
Cléante a fait la connaissance de Mariane qui se trouve être depuis peu sa voisine : elle « loge depuis peu
en ces quartiers » (scène 2, l. 39-40).
c. Élise et Cléante n’ont pas tenu leur père informé de leur vie amoureuse car ils craignent
qu’il ne s’oppose à leur union par son avarice extrême et son caractère tyrannique.
d. Harpagon constitue un obstacle pour ses enfants. Cléante est gêné dans ses amours par l’avarice
de son père qui le maintient dans la pauvreté. Il souhaiterait venir en aide à Mariane qui est une jeune fille
peu fortunée. Il cherche à emprunter de l’argent en secret pour fuir avec elle.
L’amour d’Élise et de Valère est un amour caché. Élise craint que son père ne s’oppose à leur union
tant souhaitée.

Hatier 2022 • Œuvres & Thèmes • L’Avare de Molière • guide pédagogique
Page 5 sur 27
5 Le portrait d’Harpagon
Le spectateur apprend par Valère qu’Harpagon est avare au plus haut point (« l’excès de son avarice »,
scène 1, l. 66). Il fait mener une vie austère à sa famille (« la manière austère dont il vit avec ses enfants »,
scène 1, l. 66-67). Cléante évoque également « la dureté de son humeur » (scène 2, l. 90).
6 La stratégie de Valère
a. Les mots « masque » (scène 1, l. 79) ; « je me déguise » (l. 80) ; « quel personnage je joue » (l. 80-
81) appartiennent au champ lexical du jeu théâtral et de la dissimulation.
b. Valère s’est fait engager comme intendant par Harpagon. Il compte ainsi approcher la jeune femme
et lui faire la cour : « et vous a réduit, pour me voir, à vous revêtir de l’emploi de domestique de mon
père » (scène 1, l. 55-57). Valère feint donc d’entrer dans le jeu d’Harpagon et le flatte pour obtenir
ses bonnes grâces. Les termes appartenant au champ lexical du masque et du théâtre témoignent ainsi
du rôle qu’il joue.
Maître et valet (scène 3)
7 Le jeu d’Harpagon et de La Flèche
a. Harpagon veut faire avouer à La Flèche un méfait qu’il n’a pas commis.
b. Pour dire ce qu’il pense, La Flèche fait des commentaires sur Harpagon en aparté mais il s’arrange
pour qu’il les entende en partie (« Ah ! qu’un homme comme cela mériterait bien ce qu’il craint !
et que j’aurais de joie à le voler ! », l. 55-56 ; « La peste soit de l’avarice et des avaricieux ! », l. 64).
Ce sont les réactions d’Harpagon qui prouvent qu’il les a entendus (« Qu’est-ce que tu parles de voler ? »,
l. 59 ; « qu’est-ce que tu dis d’avarice et d’avaricieux » l. 67).
On étudiera à cette occasion le principe de la double énonciation théâtrale : au théâtre, les répliques
sont destinées à la fois au(x) personnages(s) présent(s) sur scène mais aussi et surtout, au public.
Lorsqu’il y a aparté, la réplique est censée n’être entendue que du public. Dans cette scène, on l’a vu,
les apartés sont en partie entendus par le personnage, ce qui rend la situation d’énonciation plus subtile.
c. Les trois adjectifs qui caractérisent La Flèche sont : insolent, habile, moqueur. On notera que La Flèche
est le valet type de comédie, dans la lignée de ceux de la commedia dell’arte.
8 Le comique
• Comique de caractère : Harpagon apparaît comme un monomaniaque obsédé par l’argent ; il fait preuve
d’une méfiance anormale : « Je tremble qu’il n’ait soupçonné quelque chose de mon argent. » (l. 27-28) ;
« Ces grands hauts-de-chausses sont propres à devenir les receleurs des choses qu’on dérobe » (l. 51-53) ;
« Allons, rends-le-moi sans te fouiller » (l. 93).
Sa conduite outrée suscite le rire.
• Comique de gestes : la scène est animée. Harpagon tourne autour de La Flèche pour se livrer
à une fouille aussi minutieuse que ridicule (« Il fouille dans les poches de La Flèche », l. 62-63).
La Flèche effectue un jeu de mains amusant. Harpagon a des mimiques de colère, tandis que La Flèche
prend un air naïf « Vous avez de l’argent caché « ? (l. 31).
• Comique de mots : La réplique « Les autres » (l. 45), par son absurdité, dénote la manie obsessionnelle
d’Harpagon. On peut relever d’autres exemples de comique de mots : injures (« maître juré filou, vrai
gibier de potence » (l. 2-3) ; « pendard » (l. 9) ; « coquin » (l. 32) ; « va-t’en à tous les diables » (l. 99) ;
« Je te baillerai de ce raisonnement-ci par les oreilles » (l. 37-38) ; « Je te rosserai » (l. 86) ; répétition
(« avarice », « avaricieux », l. 64 et 72).
• Comique de situation : Harpagon s’expose aux sarcasmes de son propre valet qui use habilement
de l’aparté. Harpagon se trahit lui-même en apprenant à La Flèche ce qu’il tient le plus à garder secret :
« Ne serais-tu point homme à aller faire courir le bruit que j’ai chez moi de l’argent caché ? – Vous avez
de l’argent caché ? » (l. 28-31).
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
1
/
27
100%