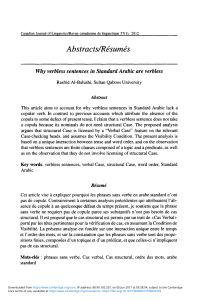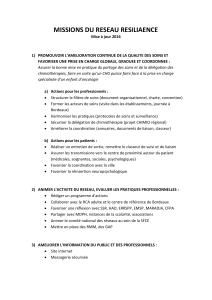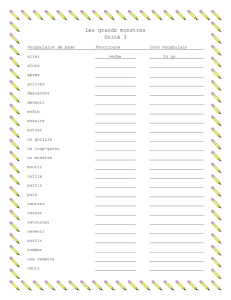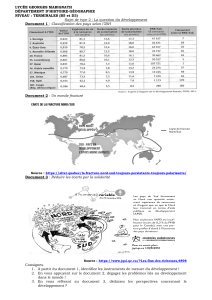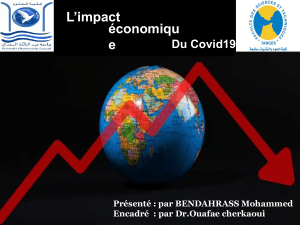Canadian Journal of Linguistics/Revue canadienne de linguistique 47(3/4): 123-150, 2002
Le concept de reseau social dans une
communaute acadienne rurale
LOUISE BEAULIEU
Universite de Moncton
et
WLADYSLAW CICHOCKI
University of New Brunswick
1. INTRODUCTION
L'application du concept de reseau social a la sociolinguistique fournit un outil
interessant pour analyser la variation linguistique dans une communaute. En effet,
I'etude des liens que tissent les individus dans differents domaines tels que la
famille, les amis et les collegues de travail permet aux sociolinguistes de proposer
des explications de la variation et du changement linguistique qui completent
celles avancees a partir des approches traditionnelles qui mettent l'emphase sur la
stratification sociale.
Dans les premieres etudes a faire usage du concept de reseau social (Bortoni-
Ricardo
1985;
Cheshire 1982; Gal 1979; Milroy 1980, par exemple), la variation
linguistique est correlee avec le niveau d'integration des individus dans la com-
munaute et les degres d'integration sont dermis par les termes «reseau ouvert))
et«reseau ferme». Cependant, des travaux plus recents (Eckert 2000; Edwards
1992;
Labov 2001; Lippi-Green 1989; Milroy et Wei 1995) montrent que dans
certaines communautes, des domaines d'affiliation sociale connus sous le nom
de ((liens faibles» sont aussi pertinents que le niveau d'integration dans la com-
munaute quand il
s'agit
d'expliquer la variation linguistique. En consequence, la
distinction entre reseau ouvert et reseau ferme a evolue en une discussion mettant
en jeu les liens faibles {weak ties) qui sont le propre des reseaux ouverts et les
«liens forts»(strong ties) qui caracterisent les reseaux fermes.
Les premieres etudes sociolinguistiques portant sur les liens forts montrent
que ce type d'affiliation sert a maintenir ou a renforcer les normes linguistiques
d'une communaute (Milroy 1992), mais les travaux subsequents suggerent que
les liens faibles ont aussi un role a jouer dans la variation linguistique. De
fait, il semble que
1'influence
des liens faibles sur la variation est beaucoup plus
importante que ne l'avaient envisage au depart les sociolinguistes.
available at https://www.cambridge.org/core/terms. https://doi.org/10.1017/S0008413100022921
Downloaded from https://www.cambridge.org/core. Tufts Univ, on 15 Mar 2018 at 17:09:35, subject to the Cambridge Core terms of use,

124 CJL/RCL
47(3/4),
2002
La recherche pertinente a
ce
propos met en evidence divers aspects du role des
liens faibles dans la variation linguistique. La plupart des etudes montrent qu'a
des groupes particuliers — determines par la nature des liens des individus qui
composent ces groupes dans divers reseaux d'affiliation sociale — sont associes
des choix linguistiques specifiques (Milroy et Wei 1995, par exemple). II semble
que parmi les differents types de liens, les affiliations sociales et occupationnelles
a I'exterieur du voisinage immediat ont une influence particulierement marquee
sur les choix linguistiques des individus (Edwards 1992:109) et que ce genre de
contacts est de premiere importance dans le processus d'innovation linguistique
(Lippi-Green 1989:224). Dans une etude de la variation dans un High School
de la banlieue de Detroit au Michigan par exemple, Eckert (2000) montre que
le groupe des «burnouts» dont le reseau social est oriente vers un continuum
urbain, suburbain — qui transcende les affiliations delimitees par le groupe d'
age,
l'appartenance institutionnelle et les frontieres municipales (p.
50)
— utilise plus
de variantes associees a des changements vocaliques recents
(p.
130)
que le groupe
des «jocks» dont les pratiques sont determinees par les normes institutionnelles
qui valorisent un reseau limite a la population de 1'institution, au groupe d'age de
l'individu et a la participation aux activites de l'ecole (p. 51).
Plus recemment, Labov (2001:364) tente de preciser le role des liens faibles
dans le changement linguistique a partir d'une analyse de certaines variables
vocaliques a Philadelphie. Ce chercheur est amene a conclure que«The leaders of
linguistic change who have emerged from the Philadelphia study show an unusual
combination of centrality with a high frequency of social interaction outside their
immediate locality.» En d'autres mots, une combinaison de liens forts et de liens
faibles. II poursuit en proposant que «Weak ties may not only serve as pipelines
for the influence of the regional standard, but also as channels through which the
mounting tide of linguistic change engulfs an entire city.» Les liens faibles sont
done de premiere importance dans les processus d'innovation et de changement
linguistique (Milroy et Milroy 1992:204).
La presente etude est une analyse exploratoire qui reexamine un cas de vari-
ation morphosyntaxique pour lequel le reseau social
s'est
montre etre un facteur
des plus significatifs (Beaulieu 1995). En regardant de plus pres l'application du
concept de reseau social, nous approfondirons l'etude des differences qui existent
entre les sujets qui ont des liens forts, ceux qui ont des liens faibles a I'interieur de
la communaute et ceux qui ont des liens faibles a I'exterieur de la communaute.
Ces differences dans la nature de
1'affiliation
sociale des individus sont utilisees
pour analyser
1'absence
ou la presence de que dans les expressions en tete des
propositions adverbiales tensees —
comme
(que), quand
{que),
si (que) et, a seule
fin de comparaison, parce
(que)
—
dans
une variete de francais parle dans une
communaute acadienne du nord-est du Nouveau-Brunswick (Canada). L'objet
de la presente etude est done d'elucider le role que jouent differents domaines
d'affiliation — lies aux liens forts et aux liens faibles a I'interieur et a I'exterieur
available at https://www.cambridge.org/core/terms. https://doi.org/10.1017/S0008413100022921
Downloaded from https://www.cambridge.org/core. Tufts Univ, on 15 Mar 2018 at 17:09:35, subject to the Cambridge Core terms of use,

BEAULIEU et CICHOCKI 125
de la communaute—dans la definition du reseau social et dans
1'explication
de la
variation morphosyntaxique.
Cet article est organise comme
suit.
A la section
2,
nous decrivons brievement
la communaute linguistique a
1'etude
et le corpus de langue utilise dans les
analyses. La section 3 presente la variable linguistique ainsi que la variation
et la section 4 porte sur des analyses de la variation a partir d'un modele de
regie variable. La section 5 decrit la structure des reseaux sociaux et notre
operationnalisation du concept de liens forts et de liens faibles. Finalement, la
section 6 presente le role des divers types de liens dans l'explication de la variation
morphosyntaxique.
2.
LA COMMUNAUTE LINGUISTIQUE ET LE CORPUS
La communaute linguistique qui fait l'objet d'etude est une petite ville de peche,
Shippagan, situee dans le nord-est du Nouveau-Brunswick (Canada), dans une
region connue sous le nom de peninsule Acadienne. II
s'agit
d'une
communaute
rurale relativement isolee qui se trouve a environ 250 kilometres au nord de
Moncton, le centre urbain d'importance le plus pres.
Dans la peninsule Acadienne, les moteurs de l'economie sont le secteur des
peches et
1'exploitation
de la tourbe—deux industries a caractere saisonnier.
C'est
done dire que dans cette region, les possibilites d'emploi a plein temps
sont limitees et la majorite de la population connait annuellement une periode de
chomage relativement longue. Les individus qui sont employes a temps complet
sur une base annuelle (moins de 50
%
de la population active, d'apres Statistique
Canada, Recensement de 1996) sont les travailleurs independants et les employes
du secteur des services, gouvernementaux ou autres.
Dans cette communaute, comme partout ailleurs, les activites socio-econo-
miques des residents determinent en majeure partie les liens sociaux que ces
individus entretiennent a l'interieur et a l'exterieur de leur localite (Hojrup 1983;
Milroy
1992;
Milroyet
Wei
1995). Etantdonnel'isolementgeographiquedu nord-
est du Nouveau-Brunswick, en general dans cette region, les salaries-chomeurs
tissent des liens etroits et presque exclusifs dans les groupes lies aux valeurs de la
communaute (la famille, les voisins, les amis et les collegues de la region), alors
que les professionnels et les employes des services publics ont un reseau social
plus diversifie qui inclut des relations dans des groupes lies a un espace social,
culturel et linguistique plus large que leur cercle intime et souvent plus large que
la communaute.
Au niveau linguistique, la plupart des residents de Shippagan et des envi-
rons sont unilingues francophones (97,41 %) et dans cette region du Nouveau-
Brunswick,
1'assimilation
linguistique est pratiquement inexistante contrairement
a la realite de la plupart des regions acadiennes de Test du Canada (Statistique
Canada, Recensement
de
2001).
Iln'estdoncpasetonnantdeconstaterqu'ilexiste
des differences regionales importantes entre les varietes de francais parle dans les
available at https://www.cambridge.org/core/terms. https://doi.org/10.1017/S0008413100022921
Downloaded from https://www.cambridge.org/core. Tufts Univ, on 15 Mar 2018 at 17:09:35, subject to the Cambridge Core terms of use,

126 CJL/RCL
47(3/4),
2002
diverses communautes acadiennes du Canada atlantique (voir Flikeid 1988; King
1988;
Peronnet 1995; Peronnet et al. 1998 pour un apercu de ces varietes).
Les donnees linguistiques utilisees dans la presente etude proviennent d'un
corpus de langue recueilli aupres de
16
informateurs et informatrices de Shippagan
(Beaulieu 1995). II
s'agit
d'un corpus de 96 heures de langage spontane, stratifie
d'apres le sexe des sujets, deux groupes d'age (20 a 32 ans et 38 a 54 ans), deux
niveaux de scolarite (absence d'un diplome d'etudes secondaires ou etudes post-
secondaires) et deux types de reseau social — huit sujets ont un reseau social qui
correspond plus ou moins a la definition traditionnelle de reseau ferme et huit ont
un reseau ouvert. Dans la moitie des entrevues de ce corpus, tous les individus
presents etaient des locuteurs natifs de francais acadien du nord-est du Nouveau-
Brunswick (situation intra-groupe) alors que dans les autres entrevues, l'un des
individus presents etait un locuteur d'une autre variete de francais (situation extra-
groupe). Pour les fins de la presente etude, 48 heures de donnees provenant de ce
corpus ont ete utilisees.
Des informations relatives a la nature des affiliations sociales de ces locuteurs
et locutrices ont aussi ete colligees a partir de deux sources d'information: les
reponses a un questionnaire d'entrevue portant sur la nature et la frequence des
liens des sujets dans neuf domaines d'affiliation et une grille d'auto-observation
repertoriant les interactions quotidiennes des sujets pendant une periode d'une
semaine (Beaulieu 1995). Ces donnees ont servi a la quantification du reseau
social des sujets; qu'il s'agisse du facteur reseau social utilise dans
1'analyse
de
type regie variable discutee a la section 4 ou du concept plus detaille de liens forts
et de liens faibles presente a la section 5. Avant de regarder en detail ces analyses,
il est necessaire de decrire la variable linguistique et la variation a l'etude, ce qui
fait l'objet de la prochaine section.
3. LA VARIABLE LINGUISTIQUE ET LA VARIATION
Comme nous l'avons mentionne dans 1'introduction, la variable linguistique qui
nous interesse est
1'absence
ou la presence de que dans les sequences en tete
des propositions adverbiales tensees. Nous examinerons cette variation dans les
propositions adverbiales qui debutent par comme, quand et si, et dans le but
d'etablir une comparaison, nous discuterons aussi des adverbiales en parce que.
Ces quatre types de propositions adverbiales (comme,
quand,
si et parce que) ont
ete selectionnes pour des raisons bien precises.
D'abord, dans le corpus utilise, il
s'agit
des formes qui ont les plus hautes
frequences parmi toutes les adverbiales: dans 48 heures de donnees, chacune a
plus de 450 occurrences, alors qu'on compte moins de 100 occurrences pour les
autres adverbiales (pendant que, avant que, a cause que, etc.). On sait que des
frequences elevees s'averent un avantage important lors du traitement statistique
des donnees.
available at https://www.cambridge.org/core/terms. https://doi.org/10.1017/S0008413100022921
Downloaded from https://www.cambridge.org/core. Tufts Univ, on 15 Mar 2018 at 17:09:35, subject to the Cambridge Core terms of use,

BEAULIEU et CICHOCKI 127
De plus, en francais normatif
et
en francais acadien du nord-est du Nouveau-
Brunswick (dorenavant
FANENB),
ces formes presentent un contraste interessant.
En francais
normatif,
les sequences en tete des propositions adverbiales con-
tiennent
toutes
le morpheme que
si
ce n'est des trois formes simples
comme,
quand
et si. Au contraire, en FANENB, les formes comme, quand et si peuvent aussi etre
construites avec le morpheme que {comme que, quand que et si que) et toutes
les expressions en tete des adverbiales peuvent apparaitre sans ce morpheme. En
somme, en francais normatif comme, quand
et si
apparaissent toujours seules (sans
que) et les autres expressions, incluantparce, sont obligatoirement accompagnees
du morpheme que; alors qu'en FANENB, tous les subordonnants en tete des pro-
positions adverbiales peuvent prendre
l'une
ou
1'autre
de ces formes. Le FANENB
presente done une variation entre les formes en que (dorenavant«variantes
que)))
et les formes sans que (dorenavant«variantes zeros), tel qu'illustre en (1).
(1) a. II a fait 5a {comme/commequ'} il voulait.
b.
{Quand/quand qu'} ils nous ont
vus,
ils ont arrete.
c. {Si/si qu'} il vient, elle va lui donner.
d.
C'est
{parce/parce qu'} on n'a
pas
voulu le faire que vous avez parle
?
Etant donne I'emploi categorique des formes en francais normatif et l'influence
possible de cette norme sur le comportement langagier, nous avons choisi, du
moins pour le moment, de traiter les adverbiales en comme {que), quand
{que)
et
si
{que)
comme si elles constituaient un groupe different des adverbiales en parce
{que).
Quant a la nature de la variation dans les sequences en tete des propositions
adverbiales du FANENB, il
s'agit
d'un phenomene morphosyntaxique. D'apres
1'analyse
linguistique de la structure des propositions adverbiales du FANENB
presentee par Beaulieu et Balcom (2002), les propositions adverbiales de cette
variete sont
des
constructions formees d'
une
preposition
{comme,
quand,
si,
parce,
etc.) suivie
d'une
projection du complementeur, e'est-a-dire une proposition
qui debute par le complementeur que. Selon cette analyse, la variation entre
les variantes que et les variantes zero dans les adverbiales du FANENB resulte
de la sous-specification du complementeur Q, ce qui permet aux prepositions
[iinterrogatif] de c-selectionner le complementeur Q (une variante nulle), ou de
selectionner le complementeur par defaut que. En somme, la variation dans les
propositions adverbiales resulte d'un choix au niveau de la morphosyntaxe.
Les donnees utilisees pour analyser cette variation consistent en 7 748
exemples de propositions debutant par comme,
quand,
si et parce releves dans
48 heures de langage spontane provenant du corpus decrit a la section 2. Les
frequences d'occurrence de ces formes sont presentees au tableau 1.
D'
apres les donnees au tableau 1, environ
6
000 occurrences parmi les propo-
sitions adverbiales du corpus debutent par les prepositions comme, quand et si,
et en moyenne,
35 %
d'entre elles sont suivies de que. La preposition quand est
celle que Ton retrouve le plus souvent en cooccurrence avec que (44%), puis
available at https://www.cambridge.org/core/terms. https://doi.org/10.1017/S0008413100022921
Downloaded from https://www.cambridge.org/core. Tufts Univ, on 15 Mar 2018 at 17:09:35, subject to the Cambridge Core terms of use,
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
1
/
28
100%