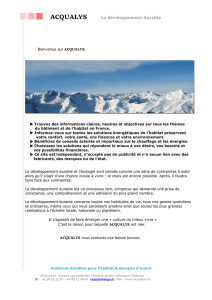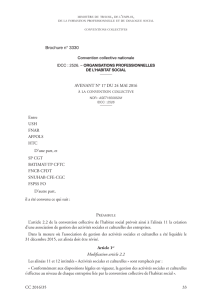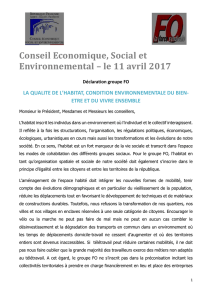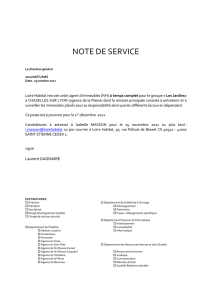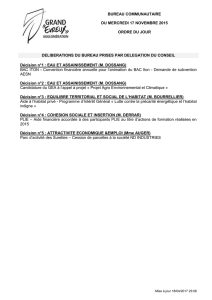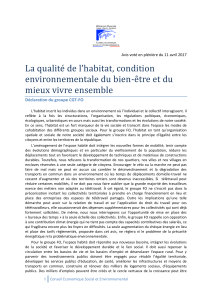Ressources de géographie pour les enseignants
Habitat (humain)
Pour la notion d'habitat en écologie, voir : Habitat écologique
Ne pas confondre avec : Habiter (notion)
En géographie, l'habitat peut être défini comme l'organisation des habitations sur un espace
donné. L'habiter renvoie à la capacité des acteurs à organiser les espaces multiples qui
composent leur habitat, aux pratiques de vie qu'en ont les individus et les groupes qui
l'occupent. La question du logement n'épuise pas celle de l'habitat mais elle s'y inscrit. Il y a des
habitats sans logement, ceux des sans-abri par exemple.
L’habitat étant au sens strict l’espace dans lequel vit une espèce, le terme a été
particulièrement employé par la géographie classique, et ce dès la fin du XIXe siècle. La question
de l’habitat, et notamment de l’habitat rural, fut même une des rares notions à être définie par
un congrès international de géographie (Congrès du Caire de 1928), ce qui témoigne de
l’importance du concept. Ainsi, jusqu’aux années 1960, la géographie classique a privilégié une
approche descriptive de cet habitat (ses formes, sa localisation…) ; le terme a donc été la
plupart du temps suivi d’une épithète le caractérisant (habitat rural ou urbain, groupé, dispersé
ou isolé, perché ou littoral …).
L’étude de l’habitat est donc indissociable de celle de la répartition du peuplement et a
longtemps donné lieu à des études détaillées sur la disposition des habitations dans les villages
(habitat groupé ou dispersé), au calcul d’un coefficient de dispersion à l’échelle d’une maille
administrative. Dans la géographie classique, l’étude de l’architecture des maisons était
révélatrice des genres de vie et de l’adaptation des sociétés aux contraintes et aux possibilités
du climat et du relief.
De nos jours, l’étude de l’habitat en géographie prend des formes très différentes selon l’échelle
à laquelle on se place. Dans une géographie actuelle beaucoup plus sensible aux phénomènes
multiscalaires, l’étude de l’habitat et de ses contrastes peut être interprétée comme l’une des
formes les plus visibles des inégalités sociales. Comme dans la célèbre photographie de Tuca
Vieira (Théry, 2015) ou dans celles du projet Unequal scenes, les contrastes entre niveaux de
richesse se traduisent de façon très concrète dans l’apparence des logements. L’un des
programmes de l’ONU pour réduire les écarts de développement s’appelle ainsi UN-Habitat
(siège à Nairobi, nom complet : Programme des Nations unies pour les établissements humains).
À l’échelle de l’agglomération et à celle du quartier, l’habitat est révélateur à la fois des écarts
de richesse et d’un certain nombre de processus : logiques d’évitement, ségrégation,
ghettoïsation et son exact opposé la clubbisation, gentrification ou paupérisation, ne peuvent
être saisies qu’en croisant un certain nombre d’observations factuelles, parmi lesquelles l’étude
des formes d’habitat (et de leurs évolutions) est incontournable. Certaines de ces formes,
représentatives d’une époque, d’une politique urbaine et d’un rapport de force entre les classes
sociales, sont aisément reconnaissables : centre historique, quartier haussmannien, grands
ensembles, lotissement pavillonnaire, bidonville… Pourtant, chaque archétype masque une très
grande variété dont il peine à rendre compte : ainsi, certains quartiers de grands ensembles
« réussis » ont réussi à conserver une forme de mixité sociale et ne correspondent pas aux
clichés qui leur sont attachés (Martin-Brelot, 2023). Pour ne prendre qu’un autre exemple, le
lotissement est, en France, le produit d’une histoire réglementaire qui se reflète dans les
générations successives de quartiers pavillonnaires (Herrmann, 2018).
1 - 2
https://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/habitat

Aux échelles les plus fines, la géographie de l’habitat, revisitée après les confinements liés au
covid 19, devient une géographie des microterritoires de l’habiter, faisant une large place à
l’étude des spatialités du quotidien. Des thèses récentes ont ainsi étudié l’intériorisation de la
privation de liberté dans le rapport à l’espace des détenus placés sous surveillance électronique
(Ollivon, 2018) ou l’ambivalence des utilisateurs d’appareils connectés à domicile (Perrat, 2023).
(ST) 2005. Presque entièrement réécrit (JBB, SB et CB) en septembre 2023.
Références citées
Herrmann Lou, « Le lotissement en France : histoire réglementaire de la construction d’un
outil de production de la ville »,
Géoconfluences
, avril 2018.
Martin-Brelot Hélène (2023), « Une ZUP réussie. Portrait du quartier Bellevue à Brest par ses
habitants »,
Géoconfluences
, mars 2023.
Ollivon Franck (2018),
La prison chevillée au corps. Pour une approche géographique du
placement sous surveillance électronique. Université de Lyon.
Perrat Jean-François (2023).
Les spatialités de la vie privée à l’ère numérique - Usages et
perceptions de la domotique et du logis connecté
. Géographie. École normale supérieure de
Lyon
Théry Hervé (2015), « Une photo pour penser les
inégalités »,
Justice spatiale
|
spatial justice
, n° 7 janvier 2015, http://www.jssj.org/
Vieira Tuca,
Paraisópolis
, photographie de 2004 sur l’album du photographe en ligne.
Pour compléter avec Géoconfluences
En France
Le glossaire du dossier Des territoires en mutation
Le glossaire du dossier Espaces ruraux et périurbains, populations, activités, mobilités
François Madoré, « Nouveaux territoires de l'habiter en France : les enclaves résidentielles
fermées », 2006.
Christophe Imbert, Julie Chapon et Madeleine Mialocq, « L’habitat informel dans l’ouest de
l’Ariège : marginalité ou alternative à la norme ? », mars 2018.
Lou Herrmann, « Le lotissement en France : histoire réglementaire de la construction d’un
outil de production de la ville », avril 2018.
Ailleurs dans le monde
Octavie Paris, « Les cortiços à Salvador de Bahia, entrer dans un logement caractéristique
des villes brésiliennes »,
Géoconfluences
, mars 2018. Habiter dans un cortiço (logement collectif
ancien et vétuste en centre-ville) à Salvador de Bahia.
Alice Moret, « Une "gated community low cost" au Brésil : le logement social, du droit à la
ville à la distinction sociale ? », image à la une de
Géoconfluences
, avril 2018. Habiter un
quartier résidentiel fermé à Florianopolis au Brésil.
Tomoko Kubo, « Les cités-jardins au Japon : entre urbanisme occidental et hybridation
locale », octobre 2017. Habiter dans une cité-jardin dans la grande couronne de Tokyo au Japon.
Marie Gibert, « Les territoires du sacré, le sacre du territoire. Religion, urbanité, société :
l’exemple de Katmandou »,
Géoconfluences
, 2008. Habiter à Kathmandou, dans les maisons étroites
de la cité ou dans une maison moderne en périphérie
2 - 2
https://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/habitat
1
/
2
100%