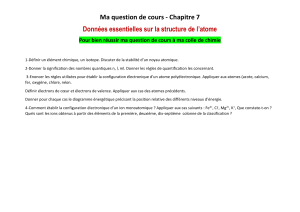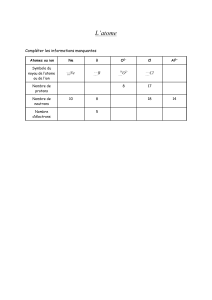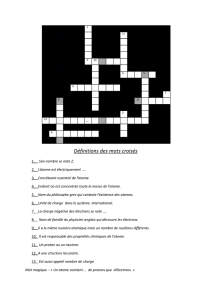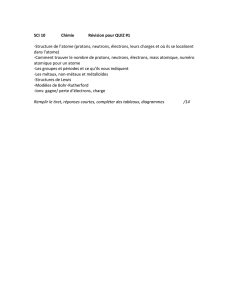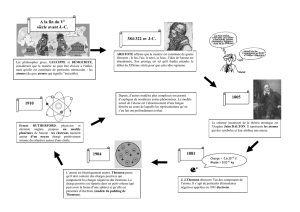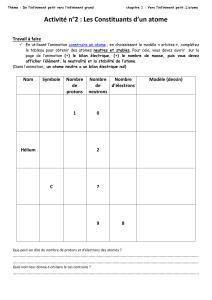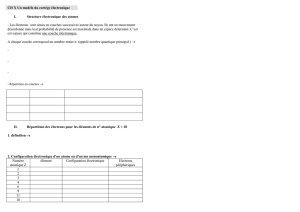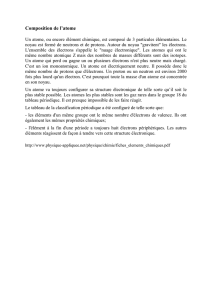Cours, Activités,
et Exercices
d'application
Physique
Chimie
TC
Semestres : 1 et 2
Pr. Abderrahim FILALI
Conforme au cadre référentiel de
ministère de l’éducation nationale
Matière : Physique
Niveau : T.C.F
Prof : Abderrahim FILALI
Cours N° 1 :
Partie N° 1 : Mécanique
Lycée : Al Azhar
Année scolaire : 2020-2021
La gravitation universelle
Introduction :
Isaac Newton affirme que tous les corps ayant une masse sont en interaction
sur terre et dans l’espace : c’est l’attraction gravitationnelle, appelée aussi la
gravitation universelle. Elle permet d’expliquer le mouvement des planètes
autour du soleil.
- Qu’est-ce que la gravitation universelle ?
- Comment expliquer le mouvement des planètes autour du soleil ?
1. Echelle des longueurs :
1. Ecriture scientifique :
L’écriture scientifique d’un nombre X s’écrit sous la forme du produit : a.10n
Tel que a est un nombre décimal : 1≤ 𝑎 <10 et n est un nombre positif ou négatif.
Exemple :
2. Ordre de grandeur :
L’ordre de grandeur d’un nombre est la puissance de 10 la plus proche de ce nombre dans l’écriture scientifique X = a.10n
- Si 1≤ 𝑎 <5 : l’ordre de grandeur est égal à 10n
- Si 5≤ 𝑎 <10 : l’ordre de grandeur est égal à 10n+1
Exemple :
Remarque :
- On utilise l’ordre de grandeur pour n’importe quelle grandeur physique (longueur, temps, masse, …)
- On utilise l’ordre de grandeur (des longueurs) pour déterminer la position de la distance sur l'échelle de longueurs
et de la comparer avec d'autres distances.
3. Multiples et sous –multiples du mètre :
Dans le système international d’unités (S.I) ; l’unité de longueur est le mètre (m). On exprime souvent les longueurs avec
des multiples ou des sous-multiples de mètre.
Remarque :
- Unité Astronomique (𝑼.𝑨) est la distance moyenne entre le centre de la Terre et le centre du Soleil tel que :
𝟏 𝑼.𝑨=𝟏𝟓𝟎. 𝟏𝟎𝟔 𝒌𝒎.
- Année Lumière (𝑨.𝑳) est la distance parcourue par la lumière au cours d’une année avec la vitesse 𝑪=𝟑.𝟏𝟎8 𝒎/𝒔
dans le vide tel que : 𝟏 𝑨.𝑳 ≈ 𝟗,5. 𝟏𝟎𝟏𝟓 𝒎.
1
4. Echelle de distances :
Pour explorer et décrire l’univers, les physiciens construits une échelle des longueurs de l’infiniment petit (atome) vers
l’infiniment grand (galaxie). Cet axe est gradué en puissance de 𝟏𝟎.
Exemple :
On place ces distances sur l’axe de l’échelle des distances.
2. La gravitation universelle :
C’est en 1687 que Newton explique le mouvement des planètes et des satellites en affirmant que tous
les corps s’attirent mutuellement selon la loi d’interaction gravitationnelle.
1. Enonce de loi de la gravitation universelle (loi de Newton) :
Deux corps s’attirent mutuellement à cause de leur masse, exercent l’un sur l’autre des forces attractives
de même valeur.
2. Formulation mathématique de loi de Newton :
L’interaction gravitationnelle entre deux corps ponctuels A et B de masses respectives mA et mB, séparés d’une distance
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
d=AB, est modélisée par des forces d’attraction gravitationnelles attractives 𝐹
𝐴/𝐵 et 𝐹𝐵/𝐴 telle que :
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝐹𝐴/𝐵 : La force exercée par le corps A sur le corps B.
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝐹𝐵/𝐴 : La force exercée par le corps B sur le corps A.
Ces deux forces ont :
- La même ligne d’action (direction) : c’est la droite (AB).
- Des sens opposés : vers le corps qui exerce la force.
- La même intensité : 𝐹𝐴/𝐵 = 𝐹𝐵/𝐴 = F (en Newton noté N)
mA : masse de corps A en Kg
mB : masse de corps B en Kg
d : distance entre le A et B en mètre noté m
G : constance de gravitation sa valeur est : G=6,67.10-11 N.m2 .Kg-2
Remarques :
- Cette loi est aussi valable pour des corps volumineux présentant
une répartition sphérique de masse (même répartition de masse
autour du centre de l’objet). C’est le cas des planètes et des étoiles,
dont la distance d est celle qui sépare leurs centres.
2
- Pour un corps ponctuel (S) de masse 𝒎S à l’altitude 𝒉 par rapport
à la surface de la Terre, on a :
MT la masse de la terre.
ms la masse du corps.
RT rayon de la terre.
Application 1 :
1. Calculer l’intensité de la force d’attraction universelle s’appliquant entre deux corps A et B de masses respectives :
mA = 1Kg et mB = 10 Kg distants de d= 20cm. On donne : G=6,67.10-11 N.m2 .Kg-2
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Représenter les deux forces à une échelle adaptée.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Poids d’un corps :
1. Définition :
⃗⃗⃗ d’un corps 𝑺 de masse 𝒎 est la force d’attraction universelle qu’il subit lorsqu’il est situé au voisinage de
Le poids 𝑃
la Terre, appliquée par la Terre sur lui.
2. Caractéristique du poids :
- Point d’application : le centre de gravité du corps.
- Droite d’action : droite passant par le centre de gravité du cops et le centre de la terre.
- Sens : dirigé vers le centre de la terre.
- Intensité : P = m.g avec g s’appelle intensité du champ pesanteur, s’exprime en N.Kg-1
On écrit aussi : ⃗⃗⃗
𝑃 = m .𝑔 telle que 𝑔 le vecteur de la pesanteur.
3. Expression de l’intensité de pesanteur :
Si on néglige l’influence du mouvement de la terre (mouvement de rotation
sur elle-même et autour de soleil) sur les corps situé au voisinage de la terre.
On peut dire que le poids de l’objet est simplement la force d’attraction
gravitationnelle exercée par la terre sur l’objet c’est-à-dire : Ph = FT/S
gh : l’intensité de la pesanteur à l’altitude h en (N.kg-1)
MT : la masse de la Terre en (kg)
RT : le rayon de la Terre en (m)
h : la distance entre la surface de la Terre et le corps en (m)
Sur la surface de la terre on pose h=0 donc la pesanteur sur la surface g0 est :
On a :
Donc en remplaçant dans la première formule :
3
Application 2 :
Données : intensité de la pesanteur au sol : 𝒈 = 𝟗,8 𝑵.𝒌𝒈−𝟏 ; 𝑹𝑻=𝟔𝟑𝟖𝟎 𝒌𝒎 ; 𝑴𝑻=𝟓,98.𝟏𝟎𝟐𝟒 𝒌𝒈 ; G=6,67.10-11 N.m2 .Kg-2
1. Quelle est la valeur 𝑷 du poids d’une boule de masse 𝒎= 𝟖𝟎𝟎𝒈, posée sur le sol ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Quelle est la valeur de la force gravitationnelle 𝑭 exercée par la Terre sur la même boule ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….………………………
3. Comparer ces deux forces et conclure.
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Application 3 :
Un satellite artificiel de la terre a une masse de 80 Kg.
On donne : intensité de la pesanteur au sol : 𝒈 = 𝟗,8 𝑵.𝒌𝒈−𝟏 ; 𝑹𝑻=𝟔𝟑𝟖𝟎 𝒌𝒎 ; 𝑴𝑻=𝟓,98.𝟏𝟎𝟐𝟒 𝒌𝒈 ; G=6,67.10-11 N.m2 .Kg-2
1. Quel est le poids du satellite au sol ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. Quel est le poids du satellite lorsqu’il est à 18 km d’altitude ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….………………………
Application 4 :
Données : masse de la lune 𝑀𝐿 = 7,35 1022 kg ; rayon de la lune 𝑅𝐿 = 1,75 106 𝑚
1. Déterminer l’intensité de pesanteur 𝑔0 sur la surface de la lune.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….………………………
2. En déduire le poids d’un astronaute de masse m=70kg sur la surface de la lune.
………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
𝑔
3. A quelle altitude h par rapport à la surface de la lune on trouve la relation : 𝑔ℎ = 40 ?
Avec 𝑔ℎ L’intensité de pesenteur à altitude h par rapport à la surface de la lune.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….………………………
4
Matière : Physique
Niveau : T.C.F
Prof : Abderrahim FILALI
Cours N° 2 :
Partie N° 1 : Mécanique
Lycée : Al Azhar
Année scolaire : 2020-2021
Exemples d'actions mécaniques
Introduction :
La notion de force est indispensable pour aborder la mécanique classique
(Newtonienne) et grâce aux forces que l’on peut étudier l’équilibre des
systèmes matériels ou déterminer la nature et les caractéristiques de leurs
mouvements.
- Qu’est-ce qu’une force et comment la représenter ?
- Comment classifier ces forces ?
1. Notion d’action mécanique – Notion de force :
1. Notion d’action mécanique :
Le mouvement ou la forme d’un corps sont influencés par les actions mécaniques exercées sur celui-ci par d’autres corps.
Une action mécanique peut :
- mettre en mouvement un corps.
Effet dynamique
- modifier la trajectoire d’un corps.
- maintenir en équilibre un corps.
Effet statique
- déformer un corps.
Une action mécanique est toujours exercée par un objet (l’acteur) sur un autre objet (le receveur).
Exemple :
2. Modélisation d’une action mécanique par une force :
Une action mécanique se modélise par un vecteur force noté 𝐹⃗ dont les caractéristiques sont les suivantes :
- point d’application : point où l’action s’exerce sur le corps.
- direction : droite selon laquelle l’action s’exerce.
- sens : sens selon lequel l’action s’exerce.
- intensité : la valeur de la force en Newton (On la mesure par un dynamomètre).
2. Classification des forces :
Pour la classification des forces on doit déterminer le système étudié.
1. Forces extérieures et forces intérieures :
- Force extérieure : est toute force exercée sur le système (le receveur) par un objet (acteur) n’appartient pas au système.
- Force intérieure : est toute force exercée par une partie de système sur une autre partie du système.
Exemples :
- Système étudié : { le corps (S) }
La force 𝐹⃗ exercée par le fil sur la corps (S) est une force extérieure.
- Système étudié :{ le corps (S) + le fil }
La force 𝐹⃗ exercée par le fil sur la corps (S) est une force intérieure.
1
2. Forces à distance et force de contact :
- Force à distance : est toute force exercée par un corps sur un autre corps sans qu’aucun contact ne soit nécessaire avec lui.
- Force de contact : est toute force exercée par un corps sur un autre corps qui est en contact avec lui :
* sur un point ou une surface très restreinte, dite localisée.
* sur une surface qui ne peut pas considérée comme un point, dite répartie.
Exemples :
- Le poids du corps et la force magnétique sont des forces à distance.
- Le contact entre le fil et le corps S se fait en un point A : il s’agit
d’un contact localisé.
- Le contact entre le livre et la table se fait sur la totalité d’une surface,
c’est un contact réparti.
3. Exemples des forces :
1. Réaction du plan :
La réaction du plan 𝑅⃗⃗ est une force répartie exercée par un support sur la partie de la surface du solide qui est en contact
avec lui.
a. Cas de contact sans frottement :
Si le contact se fait sans des frottements, et soit le solide immobile ou en
mouvement, la réaction du plan reste perpendiculaire à la surface de contact.
b. Cas de contact avec frottement :
Si le contact se fait avec des frottements, la réaction du plan n’est pas
perpendiculaire à la surface de contact (inclinée d’un angle 𝝋 par rapport
à la normale au sens contraire du mouvement).
On décompose 𝑅⃗⃗ en deux forces :
⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝑅
𝑁 : la composante normale qui s’oppose à l’enfoncement du corps dans le support.
⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝑅𝑇 : la composante tangentielle ou force du frottement notée 𝑓⃗.
On appelle coefficient de frottement :
2. Tension du fil – Tension du ressort :
⃗⃗ est la force qui exerce le fil (ou ressort) sur un autre corps
Tension du fil (ou ressort) 𝑇
en contact localisé avec lui.
Application 1 :
Une personne faisant glisser le wagon avec une corde sur la route.
1. Donner le bilan des forces exercées sur le wagon.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. Compléter le tableau de classification suivant :
2
Application 2 :
Un pendule se compose d’une boule de fer de masse m=0,5kg accrochée à l’extrémité
d’un fil dont l’autre extrémité fixée à un support fixe. Lorsqu’on approche un aimant
le pendule dévie comme l’indique la figure ci-contre.
1. Faire l’inventaire des forces appliquées sur la boule.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
2. Sachant que le module de la tension du fil est T=4N, et le module de la force magnétique est F=3N.
⃗⃗ et 𝐹⃗ .
a. Donner les caractéristiques de 𝑃⃗⃗ (poids du corps), 𝑇
On prend : g =10 N/Kg
Les vecteurs forces
point d’application
direction
Sens
Intensité
𝑃⃗⃗
⃗⃗
𝑇
𝐹⃗
𝑏𝑜𝑢𝑙𝑒
⃗⃗ et 𝐹⃗ . (avec une échelle convenable).
b. Représenter sur le schéma les vecteurs forces 𝑃⃗⃗, 𝑇
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..…………………………
c. Classifier les fores précédentes.
3. En considérant le système {boule+ aimant}, parmi les forces précédentes, donner les forces intérieures et extérieures
à ce système.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Application 3 :
Un cube (S) de masse m = 0,50 kg est maintenu en équilibre sur un plan incliné
à l'aide d'un ressort. L'axe de ce ressort est parallèle à la ligne de plus grande pente
du plan. On suppose que le contact entre le cube et le plan se fait sans frottement.
1. Faire le bilan des forces qui s’exercent sur le solide et les représenter sur la
figure sans tenir compte de l’échelle (sans tenir compte de l’intensité de ces forces).
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………
2. On suppose maintenant que le cube (S) glisse sur le plan incliné avec frottement
sous l’action de deux force : 𝑃⃗⃗ le poids et 𝑅⃗⃗ la réaction du plan tel que l'intensité de
la force de frottement est RT = f = 3 N et la force normale RN = 4 N.
a. Représenter sur le schéma les vecteurs forces 𝑃⃗⃗ et 𝑅⃗⃗.
b. En appliquant le théorème de Pythagore, calculer l’intensité de 𝑅⃗⃗ .
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
3
c. Déterminer K le coefficient de frottement.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
d. Déduire φ l’angle de frottement.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Force pressante – Notion de pression :
a. Force pressante :
- Expérience :
- On perse un trou sur la paroi d’une bouteille en plastique remplie d'eau.
- On perse un trou sur la paroi d’un ballon de baudruche gonflé.
- Observation :
- L’eau exerce une force perpendiculaire sur les parois de la bouteille.
- L’air exerce une force perpendiculaire sur les parois du ballon de baudruche.
Ces forces appelées des forces pressantes.
- Conclusion :
La force pressante une force de poussée exercée lors du contact entre un solide ou un fluide (un gaz ou un liquide)
et un autre corps. Leurs caractéristiques :
- Point d’application : Il s’agit d’une force répartie en surface et l’on peut considérer que
sa résultante s’applique au centre de la surface de contact.
- Direction : Elle s’exerce suivant une direction perpendiculaire à la surface de contact.
- Sens : Il s’agit d’une force de poussée, elle s’exerce du liquide vers le corps.
- Intensité : Elle dépend de la pression et de la surface de contact.
2. Notion de pression :
La pression est une grandeur macroscopique correspond à la force pressante appliquée sur une surface pressée, définie
par la relation :
D’autres unités de pression :
Le bar (𝟏 𝒃𝒂𝒓=𝟏𝟎𝟓 Pa)
L’hectopascal (𝟏 𝒉𝑷𝒂=𝟏𝟎𝟐 𝑷𝒂)
;
;
L’atmosphère (𝟏 𝒂𝒕𝒎=𝟏𝟎𝟏𝟑𝟐𝟓 𝑷𝒂)
Le centimètre de mercure (𝟕𝟔 𝒄 𝒎-𝑯𝒈=𝟏𝟎𝟏𝟑𝟐𝟓 𝑷𝒂)
L’atmosphère terrestre est constituée d’un mélange gazeux : l’air qui est formé essentiellement
de dioxygène et de diazote. La pression de l’air qui nous entoure sur les corps en contact avec elle
s’appelle la pression atmosphérique. Sa valeur normale est de : P𝒂𝒕𝒎=𝟏 𝒂𝒕𝒎=𝟏𝟎𝟏𝟑𝟐𝟓 𝑷𝒂.
La pression atmosphérique diminue avec l’altitude.
Pour mesuré la pression d’un gaz on utilise le manomètre.
Pour mesuré la pression atmosphérique on utilise le baromètre.
Application 4 :
La figure ci-contre représente un récipient cylindrique contenant un gaz sous la pression P =1,5 bar.
On donne : le diamètre du récipient D =8cm
1. Représenter 𝐹⃗ le vecteur de la force pressante appliquée par le gaz sur la base du récipient.
2. Calculer F l’intensité de la force pressante appliquée par le gaz sur la base du récipient.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
4
Niveau : T.C.F
Matière : Physique
Prof : Abderrahim FILALI
Partie N° 1 : Mécanique
Cours N° 3 :
Le mouvement
Lycée : Al Azhar
Année scolaire : 2020-2021
Introduction :
Le mouvement d’un corps n’est pas le même pour tous les observateurs.
Pour décrire la trajectoire d’un mobile, il est nécessaire de préciser le solide
de référence par rapport auquel le mouvement est étudié .la vitesse du
déplacement fournit également des renseignements importants.
- Comment peut-on décrire un mouvement ?
- La vitesse d’un corps possède certainement des informations sur le
mouvement, comment ? et quelles sont ses caractéristiques ?
1. Relativité du mouvement :
Activité :
Un bus roule lentement dans une ville. Ahmed (A) est assis dans le bus, Basma (B)
marche dans l'allée vers l'arrière du bus pour faire des signes à Charif (C) qui est au
bord de la route.
1. Compléter le tableau ci-dessous en disant si X est en mouvement ou immobile
par rapport à Y :
2. Que nécessite l’étude d’un mouvement ?
L'étude des concepts de mouvement ou de repos nécessite de déterminer le corps de référence par rapport auquel elle
s’effectue.
Conclusion :
- Le mouvement d'un corps ne peut être étudié que par rapport à un solide de référence (référentiel). L'état de mouvement
ou de repos d'un corps dépend du référentiel choisis.
- On dit qu’un corps est en mouvement par rapport à un autre corps pris comme référentiel si sa position change par rapport
à ce référentiel.
1. Référentiel :
Le référentiel est un corps solide indéformable et fixe par rapport auquel en étudier le mouvement
d’un corps. Exemple de référentiel :
- Référentiel terrestre :
Il est construit à partir de n’importe quel solide de référence lié à la terre (le solide doit être fixe
par rapport à la terre).
On les utilisera pour étudier tout mouvement à la surface de la terre.
- Référentiel géocentrique :
Il est définit par le centre de la terre et 3 axes dirigés vers 3 étoiles lointaines (Deux de ces
étoiles sont l'Etoile Polaire et Beta du Centaure). On considère que ce sont des étoiles fixes, les
axes sont donc fixes. Il est utilisé pour décrire le mouvement de la lune ou des satellites artificiels.
1
- Référentiel héliocentrique :
Le référentiel héliocentrique est défini par le centre de gravité du soleil et
des étoiles lointaines considérées comme fixes (ces 3 axes sont dirigés vers
les mêmes étoiles lointaines que pour le référentiel géocentrique).
Il est utilisé pour décrire le mouvement des astres du système solaire.
2. Repérage de mouvement :
Pour décrire avec précision le mouvement d’un point il faut déterminer un repère d’espace et un repère de temps.
a. Repère d’espace :
Pour repérer la position du mobile dans le référentiel choisi on utilise un repère d’espace. C’est un système d’axes muni
d’une base constituée de 1, 2 ou 3 vecteurs unitaires et un point origine O lié au référentiel.
x (l’abscisse), y (l’ordonnée) et z (la cote) sont les coordonnées du vecteur position dans le repère R orthonormé.
Lorsque le point M se déplace, les coordonnées (x,y,z) varient avec le temps.
b. Repère de temps :
- Pour décrire le mouvement d'un point du corps, il faut déterminer les dates des moments pendant lesquels ce point occupe
certaines positions.
- La date est le moment précis où un événement s'est produit. Pour le déterminer, il est nécessaire de définir un repère de
temps qu’est constitué d’une origine arbitraire (prend la valeur 𝒕= 𝟎) et un sens positif orienté du passé vers la future.
L’unité du temps est la seconde s.
- On associe à chaque position de point M du solide un instant ou une date t.
- La durée est l’intervalle de temps entre le début et la fin d'un événement (elle est toujours positive) : ∆𝑡 = tf - ti
3. Trajectoire :
La trajectoire d’un point est l’ensemble des positions successives que ce point occupe
au cours de son mouvement.
- Si la trajectoire est une droite, le mouvement est rectiligne.
- Si la trajectoire est un cercle, le mouvement est circulaire.
- Si la trajectoire est une courbe, le mouvement est curviligne.
Remarque : La trajectoire d’un point dépend du référentiel d’étude.
2. La vitesse :
1. La vitesse moyenne :
La vitesse moyenne Vm d’un mobile est le quotient de la distance parcourue d par la durée de parcourt Δt :
2
Application 1 :
Un train (TGV) parcourt une distance d = 450 Km en une durée de Δt =1ℎ23min20s.
1. Calculer sa vitesse moyenne en (m.s−1) puis en (Km.ℎ−1).
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Le même train parcourt à la même vitesse une distance d’= 630 Km. Quelle est la durée du parcourt ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
2. La vitesse instantanée :
La vitesse instantanée d'un mobile M est la vitesse que peut prendre
ce mobile à un instant t donné.
Caractéristiques du vecteur vitesse instantanée ⃗⃗⃗
𝑉𝑖 :
- Origine : la position Mi du mobile à l’instant 𝑡𝑖 .
- Direction : la tangente de la trajectoire en Mi.
- Sens : le sens du mouvement.
- Norme : On utilise la méthode d’encadrement suivante :
pour une trajectoire rectiligne :
pour une trajectoire curviligne :
Application 2 :
On considère deux enregistrements du mouvement d’un point d’un autoporteur mobile sur une table à coussin d’air.
L’intervalle de temps s éparant deux positions successives est 𝜏 = 40 ms.
1. Calculer la vitesse instantanée de M aux positions M1 et M4 (pour chaque enregistrement).
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Représenter aux mêmes positions les vecteurs vitesses instantanées en utilisant une échelle convenable.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
3
3. Mouvement rectiligne uniforme :
1. Définition :
⃗ = 𝑐𝑡𝑒
⃗⃗⃗⃗⃗⃗ .
Un solide est animé d’un mouvement rectiligne uniforme si et seulement si le vecteur vitesse est constant 𝑉
(garde la même direction, le même sens et la même norme) au cours du mouvement.
Remarque :
Lors d'un mouvement rectiligne uniforme, la vitesse
instantanée est égale à la vitesse moyenne 𝑽=𝑽𝒎
2. Équation horaire du mouvement rectiligne uniforme :
L’équation horaire du mouvement rectiligne uniforme est la relation entre x l’abscisse d'un point du corps mobile dans
le repère d’espace (𝑶,𝑖) et 𝒕 la date d’observée le point du corps mobile dans le repère de temps (les deux repères sont
associés au référentiel), c.-à-d. l'équation de la fonction affine 𝒙 =(𝒕), on l’exprime sous la forme :
Remarque :
- Si le mobile se déplace dans le même sens que l’axe Ox : Vx = + V.
- Si le mobile se déplace dans le sens contraire que l’axe Ox : Vx = -V.
Application 3 :
Au cours du mouvement rectiligne d’un autoporteur (S), on a obtenu l’enregistrement suivant :
L’intervalle du temps qui sépare deux points consécutifs est 𝜏 =40 ms.
1. Quelles la nature du mouvement de (S) ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Déterminer la valeur de la vitesse de (S) à la position M2.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. Compléter le remplissage du tableau sachant qu’à l’instant t=0 le mobile passe par la position M2.
4. Tracer la courbe x = f(t) à l’échelle suivante :
5. Déduire l’équation horaire du mouvement.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..…
4
4. Mouvement circulaire uniforme :
1. Définition :
Le mouvement d’un point mobile est dite circulaire uniforme si la trajectoire est circulaire et la valeur de la vitesse
instantanée est constante.
2. Vitesse angulaire :
La vitesse angulaire est la vitesse de rotation d’un point.
Soit un point M décrivant une trajectoire circulaire de rayon R.
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ du point balaie un angle 𝜃 pendant la durée Δt.
le vecteur position 𝑂𝑀
La vitesse angulaire moyenne est :
3. Période et fréquence :
a. Période :
La période est la durée pour effectuer un tour complet de la trajectoire circulaire à vitesse constante.
L’unité de période en (S.I) est la seconde (s).
b. Fréquence :
La fréquence est le nombre des tours complets dans une seconde.
L’unité de fréquence est Hertz (Hz) (1Hz correspond un tour dans une seconde).
Application 4 :
Le plateau d’un tourne-disque a un diamètre d=30,0 cm et tourne à 33,3 tours/min.
1. Quelle est la nature du mouvement d’un point du plateau dans le référentiel terrestre.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Trouver la vitesse angulaire du plateau dans le référentiel terrestre en rad/s.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. Calculer la vitesse linéaire d’un point de la périphérie du plateau dans le référentiel terrestre.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….
4. Calculer la période et la fréquence de ce mouvement.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Quelle est la distance parcourue par un point de la périphérie du plateau en 5 minutes.
……………………………………………………………………………….………………………………………………….
5
Niveau : T.C.F
Prof : Abderrahim FILALI
Cours N° 4 :
Matière : Physique
Partie N° 1 : Mécanique
Lycée : Al Azhar
Année scolaire : 2020-2021
Le principe d’inertie
Introduction :
Après le lancer du palet de curling, il est soumis à deux forces qui se
compensent. Son centre d’inertie garde un mouvement rectiligne uniforme
tant qu’il ne heurte aucun obstacle.
- Qu’est-ce que c’est qu’un centre d’inertie ? Comment trouver sa position ?
- Par quel principe peut-on expliquer cette observation ?
- Est-ce qu’un mouvement nécessite toujours des forces ?
- Est-ce qu’une force est nécessaire pour entretenir un mouvement rectiligne
uniforme ?
1. Effet d’une force sur le mouvement d'un corps :
Activité 1 :
On considère les mouvements suivants :
1. Donner l’expression de Σ⃗⃗⃗𝐹 a somme des vecteurs de force appliqués au corps en mouvement dans chaque figure.
⃗ et Σ⃗⃗⃗𝐹 sur les figures (1, 2, 3), et nous concluons lorsque le mouvement du corps est : rectiligne –
2. En comparant 𝑉
curviligne – circulaire ?
3. Dans quel cas le corps est pseudo-isolé mécaniquement et déduire leur nature du mouvement ?
4. Un corps peut-il être en mouvement en l'absence de force ?
Conclusion :
Une force qui s'exerce sur un corps peut le mettre en mouvement, modifier sa trajectoire ou / et modifier sa vitesse.
Pour un référentiel terrestre, si un corps est soumis à des forces compensées (c'est-à-dire Σ⃗⃗⃗𝐹 = ⃗0), cela ne signifie pas
nécessairement l'absence de mouvement.
Le corps peut être dans l’un des deux cas :
Système isolé : Un système est mécaniquement isolé s'il n'est soumis à aucune force.
Système pseudo-isolé : Un système est pseudo-isolé si les effets des forces extérieures auxquelles il est soumis se
compensent.
1
2. Centre d’inertie d’un corps solide :
Activité 2 :
Nous envoyons un autoporteur en rotation sur une table à coussin d’air horizontale équipé de deux détonateurs dont l'une
est fixée au point B de la périphérie du autoporteur et l'autre au point A de l'axe de sa symétrie verticale. Et on obtient
l'enregistrement suivant :
1. Comparer entre les trajectoires des deux points A et B.
La trajectoire du B est curviligne tandis que la trajectoire du A est rectiligne.
2. Quelle est la nature du mouvement A ? Déduire la nature du mouvement des points de l'axe de la symétrie verticale
d’autoporteur passant par A.
La trajectoire de A est rectiligne et que les distances parcourues au cours d'une même période sont égales, le mouvement du
point A est rectiligne uniforme, ceci s'applique à tous les points de l'axe de symétrie verticale d’autoporteur passant par A.
3. Si nous imaginons un autoporteur pouvant se déplacer sur différentes faces sur
une table horizontale. Lorsque l’autoporteur se déplace sur la face EF, le mouvement
des points de l'axe de symétrie verticale (Δ) est rectiligne uniforme et lorsque
l’autoporteur se déplace sur la face FM, le mouvement des points de l'axe de symétrie
verticale (Δ’). Que remarquez-vous ?
On remarque que le point d'intersection des axes (Δ) et (Δ’) est le seul point dont
le mouvement est toujours rectiligne uniforme quelle que soit la face sur laquelle se
déplace l’autoporteur.
Conclusion :
Chaque corps solide a un point spécial et unique appelé
centre d’inertie du corps solide et noté G qui se distingue
aux autres points par un mouvement spécial : c'est le point
d'intersection des axes de symétrie.
Lorsque ce corps est pseudo-isolé mécaniquement pour
un référentiel terrestre, leur centre d’inertie 𝑮 est en
mouvement rectiligne uniforme.
3. Le principe d’inertie :
Activité 3 :
Nous envoyons l’autoporteur sur une table horizontale afin qu'il effectue un mouvement de translation rectiligne.
et on obtient l'enregistrement suivant :
1. Comparer entre les mouvements des deux points A et M. Quelle est la nature du mouvement de G centre d’inertie de
l’autoporteur ?
2
llll
2. Faire l’inventaire des forces appliquées sur l’autoporteur pendant le mouvement. Déterminer la somme vectorielle
de ces forces ?
3. Si on choisit le référentiel lié au point A, est-ce que les deux conditions
sont vérifiées ?
Conclusion - Enoncé du principe d’inertie :
Dans un référentiel Galiléen, le centre d'inertie G d'un système isolé (ne soumis à aucune force) ou pseudo-isolé (soumis
à une force résultante nulle Σ⃗⃗⃗𝐹 = ⃗0) est :
- Soit immobile : ⃗⃗⃗⃗
𝑉𝐺 = ⃗0
⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ≠ ⃗0
- Soit en mouvement rectiligne uniforme : ⃗⃗⃗⃗
𝑉𝐺 = 𝑐𝑡𝑒
Remarques :
- Un référentiel dans lequel le principe d'inertie est vérifié est dit galiléen.
- Le principe d’inertie ne s'applique que dans un référentiel Galiléen.
- Le mouvement global est le mouvement du centre d’inertie d’un corps
- Le mouvement des autres points du corps par rapport mouvement des autres points au G centre d’inertie du corps
est le mouvement spécial.
Application 1 :
Une parachutiste saute depuis un hélicoptère en vol stationnaire à 2000m d’altitude. Elle
commence par se laisser tomber verticalement sans ouvrir son parachute. Sa vitesse augmente
rapidement jusqu’à atteindre 30m/s. Elle ouvre alors son parachute et en quelques instants sa
vitesse passe de 30m/s à 5m/s, puis se stabilise. Elle descend alors avec un mouvement rectiligne
uniforme jusqu’au sol.
Donnée : La masse de parachutiste et son équipement : m = 100kg ;
g = 9,8N / kg.
1. En utilisant le texte, indique quelles sont les différentes phases du saut ?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
2. Dresser l’inventaire des forces qui s’exercent sur l’ensemble {parachutiste + parachute} quand le parachute est ouvert.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Pour chaque phase du saut, préciser si les forces se compensent ou non.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Dans le cas où elles se compensent, représenter les forces sur un schéma, sans tenir compte de l’échelle.
5. Déterminer l'intensité de chaque force dans le cas où elles se compensent.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
3
4. Centre d’inertie d’un système matériel :
1. Centre de masse :
Le centre de masse C d’un système matériel est le barycentre de tous les points matériels formant ce système.
Considérons un ensemble des points matériels Ai, de masse mi. Leur centre d’inertie C est donne par la relation suivante :
2. Relation barycentrique :
D’où :
: la relation barycentrique
Application 2 :
On considère un système de deux corps (S1) et (S2) de masse respectivement m1=200 g
et m2 =100, Les deux corps sont lies par une liaison rigide de masse négligeable.
La distance entre G1 centre d’inertie de (S1) et G2 centre d’inertie de (S2) est G1G2 =90 cm.
Déterminer le centre d’inertie G du système S = {S1 + S2}.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
4
Matière : Physique
Niveau : T.C.F
Prof : Abderrahim FILALI
Cours N° 5 :
Partie N° 1 : Mécanique
Lycée : Al Azhar
Année scolaire : 2020-2021
Equilibre d’un solide soumis à deux forces
Introduction :
L’eau est un liquide. si on met un objet dans l’eau, soit il flotte, soit il coule.
- Par exemple, Pourquoi les bateaux flottent-ils sur l’eau ?
- Quelles sont les conditions pour qu’un objet soumis à deux forces soit en
équilibre ?
1. Conditions d’équilibre d’un solide soumis à deux forces :
Lorsqu’un solide est sous l’action de deux forces ⃗⃗⃗
𝐹1 et ⃗⃗⃗⃗
𝐹2 en équilibre alors :
- La somme vectorielle de deux forces est nulle
.
.Cette condition est nécessaire pour que son centre d’inertie G soit au repos.
- Les deux forces ont la même direction. Cette condition est nécessaire pour
l’absence de rotation du corps autour de lui-même au cas où la première loi
est vérifiée.
2. Force exercée par un ressort :
1. Tension d’un ressort :
Le ressort est un corps solide déformable (susceptible d’allongé ou de comprimé).
Lorsque le ressort est déformé (allongé ou comprimé) il exerce une force sur le corps agissant.
⃗ . (Tension du ressort est une force de rappel).
Cette force est appelée tension du ressort et notée 𝑇
2. La relation entre la tension de ressort et son allongement :
Activité :
On considère un ressort à spires non jointives, de masse négligeable accroché à un support.
On suspend à son autre extrémité libre, des masses marquées (m) différents, le ressort
s’allonge d’un allongement Δl = 𝑙𝑓 − 𝑙0
On mesure à chaque fois la longueur finale 𝑙𝑓 du ressort. On obtient les résultats suivants :
1. Faire l’inventaire des forces extérieures qui s’exercent sur la masse marquée.
2. La masse maquée est-elle en équilibre ? Donner la relation entre T la tension du ressort et P l’intensité du poids.
Puis représenter ces forces en précisant l’échelle utilisée.
1
3. Quelle est la longueur initiale 𝑙0 du ressort ?
4. Compléter le tableau ci-dessus, on prendra g = 10 N/Kg.
5. Sur un papier millimétré, tracer la courbe qui représente la variation de T en fonction de Δl : T = f (Δl).
6. Déduire la relation mathématique entre la tension du ressort T et son
allongement Δl.
Conclusion :
- Chaque ressort est caractérisé par une grandeur physique appelée raideur K, son unité est N /m.
⃗ est la force exercée par le ressort sur un solide lorsqu’il est déformé
- La tension du ressort 𝑇
⃗ :
- Les caractéristiques de 𝑇
* Point d’application : le point de contact entre le ressort et le corps.
* La ligne/ la droite d’action : celle du ressort.
* Le sens : sens opposé à celui de la déformation.
* L’intensité :
Application 1 :
On réalise l'équilibre d'un corps (C) à l'aide d'un ressort de constante de raideur K=50N.m-1 et d'un
dynamomètre Comme l'indique la figure ci-contre. à l'équilibre l'aiguille de dynamomètre indique
la valeur 6N.
1. Nommer les forces qui agissent sur le corps (C) ?
……………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………….…
2. Donner la condition d’équilibre de corps (C).
…………………………………………………………………………………………………………..
3. Déterminer les valeurs de ces forces et les représenter sur le schéma suivant l’échelle (1cm
3N)
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
4. En déduire la masse m du corps (C).
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….
2
5. Donner la relation entre la valeur de la force exercée par le ressort et son allongement Δl.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Calculer Δl.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
7. Déduire 𝑙0 la longueur initiale du ressort sachant que la longueur finale 𝑙𝑓 = 27 cm.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
On donne l’intensité de champ de pesanteur : g = 10 N.kg-1
3. Poussée d’Archimède :
1. Mise en évidence la poussée d’Archimède dans les liquides :
On réalise les expériences ci-dessous :
- l’expérience N°1 : on mesure le poids d’une masse au repos et non immergée.
- l’expérience N°2 : on mesure le poids d’une masse au repos et immergée dans de l’eau.
1. Que remarque-t-on ?
La force exercée sur la masse est moins forte.
2. Que peut-on en conclure ?
Il existe une autre force agissant sur la masse qui vient atténuer son poids.
C’est la poussée d’Archimède, notée FA.
2. Valeur de la poussée d’Archimède :
- On remplit un bécher de versée jusqu’au rebord. (Étape 1)
- Puis on immerge un solide de volume V connu. (Étape 2)
- Enfin, on mesure la masse du volume d’eau déplace. (Étape 3)
On donne :
g = 9,81 N/kg ;
ρeau = 1000 kg/m3
Volume d’eau déplace est : V=150 cm3.
1. Calculer le poids du volume d’eau déplace.
2. Calculer le produit ρeau . V. g
3. Comparer les deux résultats.
4. Que peut-on en conclure ?
3. Caractéristique de La poussée d'Archimède :
- Point d’application : C le centre de la portion immergée dans le fluide
- Direction : la droite verticale passant par le point d’application C.
- Sens : du bas vers le haut
- Intensité : FA = ρ. V. g
3
Remarque :
Pour un corps solide homogène immergé totalement (A) ou
partiellement (B) dans un liquide. Le centre de poussée et
le centre de gravité de la partie immergée de solide en liquide.
Application 2 :
Un pavé flotte à la surface de l’eau. Ses dimensions sont : hauteur : 20cm ; longueur : 60cm ;
largeur : 20cm.
On donne : ρeau = 1000 kg/m3 ;
g = 10 N/kg
1. Déterminer le système étudié.
…………………………………………………………………………………………………….
2. Faire le bilan des forces agissant sur le système.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Le pavé émerge sur une hauteur de 3cm. Calculer le volume de la partie immergée.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Calculer l’intensité de la poussée d’Archimède appliquée au pavé.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Déduire la valeur du poids du pavé.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Calculer la masse du pavé.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
7. Calculer le volume du pavé.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
8. Préciser le matériau constituant ce pavé.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
4
Matière : Physique
Niveau : T.C.F
Prof : Abderrahim FILALI
Cours N° 6 :
Partie N° 1 : Mécanique
Lycée : Al Azhar
Année scolaire : 2020-2021
Equilibre d'un solide soumis à trois forces non parallèles
Introduction :
Le grimpeur de montagne est en équilibre sous l’action de trois forces ; son
poids et les forces de contact appliquées par le fil et la surface de la montagne.
- Quelles conditions doivent vérifier ces trois forces pour que le grimpeur
reste en équilibre ?
- Quel est l’effet des forces appliquées par la surface de la montagne sur
les pieds du grimpeur ?
1. Conditions d’équilibre d’un solide soumis à deux forces :
Activité 1 :
Une plaque en polystyrène (S) de masse négligeable est maintenue en équilibre
par trois dynamomètres comme l’indique la figure.
1. Citer les forces extérieures agissant sur la plaque (S), puis déterminer
la force qu’on peut négliger son intensité devant les intensités des autres.
2. Remplir le tableau des caractéristiques des forces exercées sur la plaque.
3. Prolonger au crayon, sur le document expérimental, les lignes d’action de ces trois forces vers l’intérieur de la plaque,
Que remarquez-vous ?
4
4. Les droites d’action sont-elles coplanaires ?
5. En choisissant une échelle convenable, représenter les trois forces
⃗⃗⃗
𝐹1 , ⃗⃗⃗⃗
𝐹2 et ⃗⃗⃗⃗
𝐹3 .
Voir la figure.
6. Trouver la relation vectorielle entre les trois forces ⃗⃗⃗
𝐹1 , ⃗⃗⃗⃗
𝐹2 et ⃗⃗⃗⃗
𝐹3 par
deux Méthodes : méthodes graphique et méthode analytique.
1
- Méthodes graphique :
On représente la somme vectorielle de trois forces ⃗⃗⃗
𝐹1 , ⃗⃗⃗⃗
𝐹2 et ⃗⃗⃗⃗
𝐹3 . On obtient une ligne polygonale fermée. Donc on constate
⃗⃗⃗
⃗⃗⃗⃗
⃗⃗⃗⃗
que la somme vectorielle de ces trois forces 𝐹1 , 𝐹2 et 𝐹3 est égale au vecteur nul :
- Méthode analytique :
Dans un repère orthonormé déterminons les coordonnées de chaque force
(l’échelle étant : 1cm
2N)
Conclusion :
Lorsqu’un corps solide soumis à trois forces non parallèles est en équilibre, alors :
- La somme vectorielle des trois forces est nulle Σ𝐹 = ⃗⃗⃗
𝐹1 + ⃗⃗⃗⃗
𝐹2 + ⃗⃗⃗⃗
𝐹3 = ⃗0 ou la ligne polygonale de trois forces est fermée.
Cette condition est nécessaire pour que le centre d’inertie 𝑮 du corps solide soit en repos.
- Les droites d’action de trois forces sont coplanaires et concourantes. Cette condition est nécessaire pour l'absence de
rotation du corps autour de lui-même si la première condition est vérifiée.
2. Application : Equilibre d’un solide (soumis à trois forces) sur un plan horizontal :
Activité 2 :
Sur un plan de bois horizontal, on met un morceau de bois (𝐒) de masse
⃗ par un dynamomètre
𝒎 =𝟒𝟎𝟎 𝒈, et on applique sur lui une force 𝑇
⃗
𝑇
parallèle au plan de bois de sorte que le morceau (𝐒) reste en équilibre.
On donne 𝒈 =𝟏𝟎 𝑵.𝒌𝒈−𝟏
1. Faire le bilan des forces appliquées au morceau de bois (𝐒).
⃗ et ⃗⃗⃗
2. Représenter 𝑇
𝑃 sans tenir compte de l’échelle. puis tracer
la ligne polygonale de ces forces. et déduire la nature de
contact entre le plan et le morceau (𝐒).
Le morceau (𝑺) est en équilibre, donc la ligne polygonale est
fermée et les lignes d’action sont coplanaires et concourantes.
Puisque la direction 𝑅⃗ est inclinée par rapport à la normal d'un
⃗
𝑇
⃗
𝑇
angle 𝛗, alors le contact entre le plan et le morceau (𝑺) se fait avec frottement.
3. Déterminer l’expression de l’intensité 𝑹 en fonction de m,g et T avec une méthode graphique (ligne polygonale).
D’après théorème de Pythagore on a : R = √𝑃2 + 𝑇 2 = √(𝑚𝑔)2 + 𝑇 2
4. Déterminer l’expression des intensités 𝑹𝑵 et 𝑹𝑻 en fonction de m,g et T avec une méthode analytique (projection).
= mg
5. Donner en fonction de 𝑹𝑵 et 𝑹𝑻 l’expression de R , 𝛗 (angle de frottement) et k (coefficient de frottement).
2
6. Les résultats expérimentaux de cette expérience sont indiqués dans le tableau ci-dessous. Compléter le tableau
et expliquer comment le corps reste en équilibre malgré la force de traction⃗⃗⃗𝑇 appliquée par le dynamomètre.
L'équilibre du corps est dû à la présence de la force de frottement où 𝑹𝑻 = T lorsque T < T𝒎 même s’il existe une force
de traction. et lorsque T > T𝒎 le corps sera hors équilibre où 𝑹𝑻 = T𝒎.
7. Déterminer T𝒎 l'intensité de force maximale à laquelle le corps reste en équilibre, 𝝋𝟎 l'angle de frottement statique
et 𝑲𝟎=𝐭𝐚𝐧𝝋𝟎 le coefficient de frottement statique auquel le corps se déséquilibre.
à partir de tableau, on trouve : T𝒎= 𝟐 𝑵 , 𝝋𝟎=𝟐𝟔,𝟓° ,
𝑲𝟎= 𝒕𝒂𝒏𝝋𝟎= 𝒕𝒂𝒏𝟐𝟔,𝟓= 𝟎,𝟓
Conclusion :
⃗ force de traction, sur un plan horizontal grossière
Un solide soumis à trois forces : 𝑃⃗ son poids, , 𝑅⃗ réaction du plan et 𝑇
(l’existence de frottement) soit :
- en équilibre :
T < T𝒎
;
φ < φ0
- en mouvement : T > T𝒎
;
φ > φ0
Application 1 :
Un solide (S) est maintenu en équilibre sur un plan incliné lisse comme le montre
la figure ci-contre :
1. Représenter les forces qui s’exercent sur (C).
2. Donner la condition de l’équilibre de (C).
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
3. La constante de raideur est k = 100N/m.
a. Déterminer la valeur de la tension du ressorts sachant qu’il se comprime à
l’équilibre de 6cm.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
b. Déterminer la masse m de (C) ainsi que la valeur de la réaction 𝑅⃗ du plan.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
On donne : g = 10N.kg-1 ; 𝛼 = 30°
3
Application 2 :
On considère un solide (S), de masse m=200 g , accroché à un ressort (R) et un fil (F),
comme l’indique la figure ci-contre . Le ressort, de constante de raideur K = 40 N.m-1,
est incliné d’un angle α= 30°, par rapport à la verticale. On prendra g = 10 N .Kg -1
1. Faire le bilan des forces qui s’exercent sur le solide et les représenter sur la figure
sans souci d’échelle
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
2. Trouver l’intensité F de la force appliquée par le fil sur le solide, en construisant la ligne polygonale des forces.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Déterminer R la tension du ressort :
a. En appliquant le théorème de Pythagore.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
b. Par méthode analytique / arithmétique (méthode de projection) en utilisant un repère approprié.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
c. Par méthode géométrique en utilisant une échelle convenable.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Déduire allongement Δl du ressort à l’équilibre.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Déterminer la longueur finale lf du ressort à l’équilibre sachant que sa longueur initiale est l0 = 20 cm.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
4
Matière : Physique
Niveau : T.C.F
Prof : Abderrahim FILALI
Cours N° 7 :
Partie N° 1 : Mécanique
Lycée : Al Azhar
Année scolaire : 2020-2021
Equilibre d’un solide susceptible de tourner autour d’un axe fixe
Introduction :
Une personne désirant desserrer un boulon de roue utilise une clé à manche
télescopique. Elle exerce une force sur le manche de la clé afin d’entrainer
le boulon dans le mouvement de rotation autour de son axe.
- Comment une force peut faire tourner un solide mobile autour d’un axe fixe ?
Et quelle est la grandeur physique qui caractérise cet effet ?
- Quelle condition nécessaire doit satisfaire un corps solide mobile autour d’un
axe fixe pour garder son équilibre ?
1. Effet d’une force sur la rotation d’un solide :
Activité 1 :
Pour ouvrir ou fermer la porte on applique la force⃗⃗⃗𝐹 , la porte va tourner autour de l'axe vertical (𝜟) en passant à travers
les charnières
1. Quelle force est capable de tourner la porte autour de l'axe (𝜟) ?
La force qui peut de tourner la porte autour de l'axe (Δ) est la force ⃗⃗⃗⃗
𝐹3
2. Quelle est la condition que doit vérifier la ligne d’action de la force pour avoir un effet sur la rotation de la porte ?
La force a un effet rotatif lorsque sa ligne d’action n'est pas parallèle à l'axe et ne se croise pas avec lui.
3. Comment l'intensité de la force variée lorsqu'on approche de l'axe de rotation (𝜟) pour ouvrir ou fermer la porte ?
L'intensité de la force augmente lorsqu'on approche de l'axe de rotation (𝜟).
Conclusion :
La force de ⃗⃗⃗𝐹 a un effet de rotation sur un corps solide qui peut tourner autour d'un axe fixe (𝜟) si sa ligne d’action
n'est pas parallèle à l'axe (Δ) et ne se croise pas avec lui.
La force qu’on choisit pour tourner un corps solide augmente lorsqu'on approche de l'axe de rotation (𝜟).
On distingue l'effet de rotation de la force ⃗⃗⃗𝐹 par une grandeur physique qu’on appelle le moment de force⃗⃗⃗𝐹 par rapport
à l'axe (Δ), et on note : 𝑀∆ (𝐹 ).
2. Moment d’une force par rapport à un axe fixe :
Activité 2 :
On réalise l'expérience suivante :
La plaque peut tourner autour de l’axe (Δ).
On suspend au point P un corps lie à un dynamomètre qui exerce
sur la plaque une force ⃗⃗⃗𝐹 .on exerce de l’autre cote une autre force,
pour rétablir l’équilibre de la plaque, on change l’intensité ou bien
la direction de force et on indique les
résultats dans le tableau suivant :
1
1. Compléter le tableau.
Voir le tableau
2. Que remarquez-vous lorsqu’on éloigne le dynamomètre de l’axe ?
Lorsque la distance d augmente (on éloigne le dynamomètre de l’axe) l’intensité de la force augmente diminue.
3. Que peut-on dire du produit F .d ?
Le produit F.d reste constante il s’appelle le moment de la force ⃗⃗⃗𝐹
Conclusion :
Le moment d’une force 𝐹 par rapport a un axe (Δ) est le produit de l’intensité F de cette force et la distance d séparant la
direction de la force et l’axe de rotation. Il est notée 𝑀∆ (𝐹 ) est vaut :
Son unité en (SI) est 𝑵.𝒎.
Le moment de force⃗⃗⃗𝐹 est une grandeur algébrique.
Pour déterminer le signe de moment on choisit arbitrairement un sens positif de rotation se solide.
Application 1 :
Une tige OA homogène de longueur L, de centre de masse G et de masse m
est mobile autour d’un axe horizontale (Δ) passant pat le point O.
Cette tige est maintenue en équilibre par la force 𝐹
1. Déterminer 𝑀∆ (𝐹 ) en fonction de F , L et 𝛽.
……………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
⃗ ) en fonction de m , g , L et 𝛼.
2. Déterminer 𝑀∆ (𝑃
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………
2
3. Equilibre d’un corps solide pouvant tourner autour d'un axe fixe :
Activité 3 :
Une tige homogène de masse m = 120 g, de longueur L = 120 cm
est mobile autour d'un axe horizontal passant par le point O. Cette tige
est maintenue en équilibre par la tension⃗⃗⃗⃗⃗
𝑇2 d'un dynamomètre et la
⃗⃗⃗1 d'un fil tendue par le poids 𝑃
⃗⃗⃗1 d'une masse m1= 100g.
tension 𝑇
On néglige les frottements sur l'axe.
1. Faire l’inventaire des forces qui s’exercent sur la tige à l’équilibre.
Les représenter qualitativement sur le schéma.
Le système étudié : { La tige }
⃗⃗⃗1 tension du fil , ⃗⃗⃗⃗⃗
Le bilan de forces : 𝑃⃗ son poids , 𝑅⃗ réaction d’axe (Δ ) , 𝑇
𝑇2 tension du dynamomètre.
2. Calculer le moment de chaque force de sorte que le sens positif est correspondant au sens d’aiguille de montre.
𝑀∆ (𝑃⃗) = 0 et 𝑀∆(𝑅⃗) = 0 ; car les lignes d’actions de 𝑃⃗ et 𝑅⃗ se croisent avec l'axe (Δ).
⃗⃗⃗1 ) = + 𝑇1 . 𝑑1 = + m. g . 𝑑1 = + 0,12 . 10 . 0,5 = + 0,6 𝑵.
𝑀∆ (𝑇
⃗⃗⃗2 ) = - 𝑇2 . 𝑑2 = - 2 . 0.3 = - 0,6 𝑵.𝒎
𝑀∆ (𝑇
3. Calculer la somme algébrique des moments de toutes les forces appliquées à la barre. Conclure.
⃗⃗⃗1 ) + 𝑀∆(𝑇
⃗⃗⃗2 ) = 0 + 0 + 0,6 - 0,6 = 0
∑ 𝑀∆ (𝐹 ) = 𝑀∆ (𝑃⃗) + 𝑀∆(𝑅⃗) + 𝑀∆(𝑇
la somme algébrique de moments de toutes les forces appliquées à la tige est nulle.
Données : T2 = 2 N , g = 10 N .Kg-1 ,
𝑑1 = 50 cm ,
𝑑2 = 30 cm
Conclusion :
- Le théorème des moments :
Lorsqu’un solide mobile autour d’un axe fixe est en équilibre, la somme algébrique
des moments des forces qui agissent sur le solide est nulle :
- Conditions d’équilibre :
Lorsqu’un solide en rotation autour d’un axe fixe est en équilibre, deux conditions doivent être satisfaites.
⃗⃗⃗ : immobilité du centre d’inertie.
- La somme vectorielle de forces est nulle Σ 𝐹 = 0
- La somme algébrique de moments est nulle ∑ 𝑀∆ (𝐹 ) = 0 : absence de rotation autour de l’axe.
Application 2 :
Une tige OA homogène de masse m = 2 kg et de longueur L est mobile autour
d’un axe fixe (Δ) horizontal passant par O.
Pour maintenir la tige dans sa position d’équilibre horizontale, on fixe
l’extrémité A à l’aide d’un fil inextensible.
On donne : g =10N.kg-1
1. Faire le bilan des forces exercées sur la tige. Représenter ces forces.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Exprimer le moment par rapport à l’axe (Δ) de chacune des forces appliquées à la tige.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
3. En appliquant le théorème des moments à la tige, déterminer la valeur de la tension de fil T.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
3
4. Moment d’un couple de force :
1. Notion de couple de forces :
Pour tourner le volant d’une voiture, on exerce deux forces parallèles de même intensité
et dans de sens contraires : On dit que l’on applique au volant un couple de forces.
On appelle couple de forces l’ensemble de deux forces ⃗⃗⃗
𝐹1 et ⃗⃗⃗⃗
𝐹2 , de même valeur F, de même
direction, de sens contraire et de droites d’action différentes.
2. Moment d’un couple de force :
Le moment d’un couple de force ne dépend pas de la position de l’axe de rotation
mais seulement de la distance deux lignes d’action.
3. Couple de torsion :
Un pendule de torsion est un solide suspendu à un fil vertical, le centre de masse
étant sur l’axe du fil, l’autre extrémité du fil étant maintenue fixe dans un support.
Quand le solide tourne autour de l’axe du fil, celui-ci réagit à la torsion en exerçant
des forces de rappel équivalentes à un couple dont le moment par rapport à l’axe est
proportionnel à l’angle de torsion :
La constante C dite Constante de torsion dépend de la longueur et du diamètre du
fil et de la nature du matériau constituant le fil.
Application 3 :
Soit une barre homogène AB, de longueur L=50cm, suspendue en son milieu à un fil
métallique de constante de torsion C et dont l’autre extrémité est fixée à un support.
⃗⃗⃗1 et 𝐹
⃗⃗⃗⃗2 .
On applique à la barre un couple de deux 𝐹
Dont l’intensité commune vaut F=2N. La barre tourne alors d’un angle 𝜃=8° et le fil
se tord autour de l’axe (∆).
A l’équilibre de la tige AB, les lignes d’actions des deux forces ⃗⃗⃗
𝐹1 et ⃗⃗⃗⃗
𝐹2 restent
constamment perpendiculaires à la barre et appartiennent à son plan horizontal.
1. Faire l’inventaire des forces appliquées sur la barre dans son nouvel état d’équilibre.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Trouver l’expression du moment du couple des deux forces 𝑀∆ en fonction de F et L.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
3. En appliquant le théorème des moments sur la barre AB, trouver l’expression de moment du couple de torsion MC par
rapport à l’axe (∆).
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
4. En déduire l’expression de la constante de torsion C du fil métallique en fonction de F, L et . Calculer C.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
4
Niveau : T.C.F
Prof : Abderrahim FILALI
Cours N° 8 :
Matière : Physique
Lycée : Al Azhar
Partie N° 2 : Electricité
Année scolaire : 2020-2021
Le courant électrique continu
Introduction :
Tous les appareils et les composants électriques qui nous entourent,
fonctionnent avec un courant électrique.
- Qu’est-ce qu’un courant électrique ?
- Comment peut-on mesurer son intensité ?
1. Phénomène d’électrisation - Deux types d’électricité :
Activité 1 :
Frotter une règle plastique sur de la laine. L’approcher de petits morceaux de papier posés sur la table.
1. Qu’observe-t-on ?
Les bouts de papier sont attirés.
2. S’agit-il d’une action de contact ou d’une action à distance ?
Une action à distance.
3. S’agit-il d’une attraction ou d’une répulsion ?
Attraction.
4. Quel est le nom de ce phénomène ?
Ce phénomène est appelé électrisation par frottement.
Conclusion :
Certaines corps (peigne, règle, stylo, ....), lorsqu’on les frotte, sont susceptibles de provoquer des phénomènes surprenants :
ils deviennent capable d’attirer des petits corps légers on dit qu’ils sont électrisés par frottement.
Activité 2 :
1. On approche une baguette en verre frottée avec un morceau de laine à une baguette
en ébonite frottée (figure 3). Que remarquez-vous ?
On remarque qu'il y a une attraction entre les baguettes de verre et d'ébonite frottées.
2. On approche deux baguettes en ébonite frottées l’une de autre (figure 4).
Que remarquez-vous ?
On remarque qu'il existe une répulsion entre les deux baguettes en ébonite frottées.
3. Conclure qu'il y avait deux types d'électricité.
L’attraction de la baguette en verre avec la baguette en ébonite indique qu'elles portent
une électricité différente. Tandis que la répulsion les deux baguettes en ébonite indique
qu’elles portent la même électricité.
4. Quand les interactions sont-elles attractives et quand sont-elles répulsives ?
Les interactions sont attractives entre les charges électriques différentes et les
interactions sont répulsives entre les charges électriques du même type.
3
Conclusion :
Par convention, l’électricité qui apparaît sur le bâton de verre est de l’électricité positive,
alors que celle qui apparaît sur le bâton d’ébonite frotté est de l’électricité négative.
Des charges électriques de même signe se repoussent. Des charges de signes contraires
s’attirent.
L’électrisation par frottement résulte d’un transfert d’électrons d’un corps vers un autre.
- Un corps charge positivement possède un défaut d’électrons.
- Un corps charge négativement possède un excès d’électrons.
1
2. Nature du courant électrique :
5
1. Nature du courant dans les conducteurs métalliques :
Activité 3 :
on réalise le montage (le circuit) représenté ci-contre dont on associé en série un
générateur G, une lampe L, un moteur M et un interrupteur K.
1. On ferme l’interrupteur 𝑲. Que remarquez-vous ? Que concluez-vous ?
Lorsqu’on ferme l’interrupteur K, la lampe brille (s’allume), le moteur tourne.
Ce qui indique le passage du courant électrique dans le circuit.
2. Quels sont les porteurs de charge (particules chargées) responsables du passage du courant électrique dans les métaux ?
Les porteurs de charges électriques dans les métaux sont des électrons libres.
3. Représenter sur le circuit électrique le sens conventionnel de courant électrique et le sens du mouvement de porteurs
de charges électriques.
Voir le schéma.
6
Conclusion :
Par convention, le courant électrique se déplace de la borne plus vers la borne moins
à l'extérieur du générateur.
Le courant électrique dans les conducteurs métalliques est dû à un déplacement des
électrons qui circulent de la borne moins vers la borne plus à l’extérieur du générateur.
2. Nature du courant dans les électrolytes :
Activité 4 :
On met dans un tube de forme U un mélange de solution aqueuse de sulfate de
cuivre II (Cu2+, SO42-) et la solution de permanganate de potassium (K+, MnO4-).
On émerge deux électrodes de graphite à chaque extrémité du tube et on les
connecter à un générateur électrique comme l’indique la figure ci-contre.
Au bout d’une durée, on observe l’apparition d’une coloration violette à côté de
l’anode (électrode associée au pôle positif du générateur) et la coloration bleue à
côté de la cathode (électrode associée au pôle négatif du générateur).
1. Quelle est la couleur caractéristique des ions cuivre II : Cu2+ ?
Les ions Cu2+ sont caractérisés par la couleur bleue. (Les ions SO42- sont incolores
en solutions).
2. Quelle est la couleur caractéristique des ions permanganate : MnO4- ?
Les ions MnO4- sont caractérisés par la couleur violette. (Les ions K+ sont incolores
en solutions).
3. Déterminer l’espèce chimique qui s’est déplacée vers la cathode et l’espèce chimique qui s’est déplacée vers l’anode ?
- L’apparition de la couleur bleu à côté de la cathode indique que les ions Cu2+ sont déplacés vers la cathode.
- L’apparition de la couleur violet à côté de l’anode indique que les ions MnO4- sont déplacés vers l’anode.
4. Qu'est-ce qu’un électrolyte ?
Un électrolyte est une solution ionique (elle contient des ions), elle conduit le courant électrique.
5. Quels sont les porteurs de charge responsables du passage du courant électrique dans les électrolytes ?
Les porteurs de charges électriques dans les électrolytes sont des ions.
6. Représenter sur le circuit électrique le sens conventionnel de courant électrique et le sens du mouvement de porteurs de
charges électriques (électrons et ions).
Voir le schéma.
8
Conclusion :
Le courant électrique dans les conducteurs métalliques est dû à un déplacement
des ions (cations et anions) :
- les cations (ions positifs) se déplacent dans le sens conventionnel du courant électrique.
- les anions (ions négatifs) se déplacent en sens inverse du courant électrique.
X+
Y-
2
3. Intensité du courant électrique continu :
1. Quantité d’électricité :
La quantité d’électricité Q est une quantité de charges électriques déplacées par des porteurs de charges (électrons, ions).
On définit la quantité d’électricité Q par la relation suivante :
Dans le système international d’unités (S. I), Q est exprimée en Coulomb (C).
Remarque :
- Si les porteurs de charges sont des électrons e : 𝛼 = 1 ; Alors : Q = N. e
- Si les porteurs de charges sont des ions Xa+ ou Ya- : 𝛼 = a ; Alors : Q = N. a. e avec : a ∈ N*
2. Intensité du courant électrique continu :
L’intensité du courant électrique à travers un conducteur est la quantité
d’électricité Q qui traverse la section du conducteur par unité de temps (seconde) :
9
Remarque : Le courant électrique est appelé continu s’il maintient la même intensité et le même sens avec le temps.
Application 1 :
Une quantité d'électricité Q=2,4 C passe en un point d'un fil en 12 secondes.
1. Calculer le nombre d'électrons N passant à travers les fils pendant cette durée.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Calculer l'intensité du courant 𝑰 qui circule dans le fil.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
On donne : 𝒆 = 𝟏,6 .𝟏𝟎−𝟏𝟗𝑪
Application 2 :
Dans une solution de chlorure de cuivre II on immergé 2 électrodes liées à un générateur de courant électrique continu
d’intensité I = 3,2 A.
1. Dessiner le montage électrique correspondant en représentant le sens de déplacement des porteurs de charges
(les électrons et les ions).
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Calculer N le nombre des ions de cuivre II Cu2+ et N' le nombre des ions chlorure Cl- qui se sont déplacés pendant
2 minutes.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
3
4. Mesure de l’intensité du courant électrique :
L’intensité du courant électrique est mesurée à l’aide d’un appareil électrique appelé
Ampèremètre symbolisé dans le circuit par :
L’ampèremètre c’est un appareil polarisé, il se branche en série dans le circuit électrique tel que le courant électrique
entre du pôle A ou pôle (+) et sort du pôle COM ou pôle (-), pour que la valeur de l’intensité du courant soit positive.
On distingue deux types d’ampèremètres : les ampèremètres à aiguille et les ampèremètres numériques ou multimètre.
L’ampèremètre contient plusieurs calibres :
Pour éviter de détériorer l’ampèremètre, il faut choisir le meilleur calibre possible en procédant de la manière suivante :
- On commence par utiliser le calibre le plus grand existant sur l’ampèremètre.
- On choisit le calibre sur lequel l’aiguille s’arrête le plus loin possible vers la droite du cadran.
1. Ampèremètre à aiguille :
L’intensité du courant mesurée est donnée par la relation suivante :
- Incertitude absolue :
La mesure de l’intensité du courant électrique est accompagnée avec une incertitude absolue
provoquée par l’appareil, il est déterminé par la relation suivante :
a : la classe de l’appareil. Elle est donnée par le fabriquant dans un coin
de l’appareil.
La classe de l’appareil est donnée par le fabriquant dans un coin de l’appareil.
L’intensité de du courant mesuré s’écrit :
Im : intensité mesurée du courant
Remarque : Si la classe de l’appareil est plus petite, alors l’appareil est plus précis.
- Incertitude relative ou précision de mesure :
Définie par le quotient :
∆𝐼
𝐼
Elle représente la précision de mesure de cet appareil (plus qu'elle est petite plus que la précision de la mesure est grande).
Elle est donnée généralement sous forme d’un pourcentage %
Application 3 :
La figure ci-dessous représente l'image du port de l'ampèremètre.
1. Déterminer le calibre utilisé.
…………………………………………………………………………………
2. Déterminer la valeur de l’intensité.
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….
3. Calculer la quantité d'électricité traversant une section du circuit pendant Δ𝒕 = 𝟏𝟎 𝒔.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Déduire le nombre d'électrons passant par cette section pendant cette durée.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Calculer l’incertitude absolue et encadrer l'intensité du courant.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….……………
6. Déduire la précision de mesure.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
4
11
2. Ampèremètre numérique :
L’ampèremètre numérique (ou multimètre) donne directement la valeur de l’intensité de
courant électrique sur l’écran.
- Incertitude absolue :
𝐼𝑚
∆𝐼 = 100
+ 1UR
Déterminée par la relation suivante :
Où : Im représente la valeur indiquer par l’appareil numérique (intensité mesurée du courant).
: 1UR : représente incertitude absolue égale à 1 au dernier chiffre significatif de la valeur Im.
(Par exemple : si Im =1.6 A : 1UR= 0,1A
;
si Im =1.64 A : 1UR= 0,01A)
- Incertitude relative ou précision de mesure :
est
∆𝐼
qui représente la précision de mesure de cet appareil.
𝐼
5. Propriétés du courant électrique :
1. Propriétés du courant électrique dans un circuit en série :
12
Activité 5 :
On réalise le circuit en série suivant avec deux lampes différentes et on mesure
l’intensité du courant en plusieurs points du circuit, et on obtient :
Résultats : I1 = 780,1 mA , I2 = 780,2 mA , I3 = 780,1 mA
1. Que remarquez-vous ?
On remarque que : I1 = I2 = I3
2. Que concluez-vous ?
L’ampèremètre indique la même valeur d’intensité quelle que soit sa position, alors l’intensité du courant est la même
en tous les points d’un circuit en série.
Conclusion :
Dans un circuit électrique en série, l’intensité du courant électrique est la même en tous points.
2. Propriétés du courant électrique dans un circuit en parallèle - Loi des nœuds :
On réalise le circuit électrique en parallèle suivant, composé de : Générateur G,
13
Lampe 1, Lampe 2, interrupteur K et trois ampèremètres et on mesure l’intensité
du courant électrique dans les différentes branches du circuit, et on obtient :
Résultats : I1 =780 mA , I2= 364 mA , I3 =416 mA
1. Que représentent les points A et B ?
Les points A et B sont des nœuds.
2. Que remarquez-vous ?
On remarque que : I1 = I2 + I3
3. Que concluez-vous ?
L’intensité du courant électrique qui entre par le nœud 𝑨 est égale à la somme des intensités des courants qui sortent
de ce nœud. C’est la loi des nœuds.
Conclusion :
- Un nœud : est un point de connexion qui relie au moins trois fils électriques.
- La loi des nœuds : La somme des intensités des courants qui arrivent à un nœud est égale
à la somme des courants qui en repartent :
Exemple :
5
Application 4 :
On considère le circuit de la figure ci-contre :
1. Préciser sur la figure :
a. Le sens des électrons ainsi que le sens conventionnel du courant électrique dans
chaque branche.
b. Le montage des ampèremètres permettant la mesure des intensités de courant
traversant L1, L2 et L.
2. Le cadran de chaque ampèremètre contient 100 divisions et sont tous utilisés avec le même calibre 1A.
- L’aiguille de l’ampèremètre mesurant l’intensité I du courant électrique traversant L indique 85div.
- L’aiguille de l’ampèremètre mesurant l’intensité I1 du courant électrique traversant L1 indique 68div.
a. Calculer I et I1.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
b. En déduire l’intensité I2 du courant qui traverse L2.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
c. Quel est le nombre de divisions indiqué par l’ampèremètre mesurant I2.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Application 5 :
On considère le circuit de la figure ci-contre :
1. Sachant que la quantité d’électricité Q qui traverse la section du fil AF pendant
une minute est Q = 30 C.
a. Calculer le nombre d’électrons qui traverse cette section pendant la même durée.
………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..
b. En déduire la valeur de l’intensité du courant I1qui traverse la lampe L1.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
2. L’ampèremètre A comporte 100 divisions et possède les calibres suivant : 5 A ; 1 A ; 300 mA ; 100 mA.
a. Quel est le calibre le plus adapté pour la mesure de l’intensité I1 ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
b. Devant quelle division l’aiguille de l’ampèremètre s’arrête-t-elle ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
3. L’intensité débité par le générateur est I = 0,8 A.
a. Quels sont les points qui sont considérés comme des nœuds ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
b. Indiquer le sens du courant dans chaque branche.
c. Déterminer les valeurs des intensités qui traversent les lampes L2, L3 et L4.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
6
Matière : Physique
Niveau : T.C.F
Prof : Abderrahim FILALI
Lycée : Al Azhar
Partie N° 2 : Electricité
Année scolaire : 2020-2021
La tension électrique
Cours N° 9 :
Introduction :
Tous les appareils et les composants électriques qui nous entourent,
fonctionnent avec une tension électrique.
- Qu’est-ce qu’une tension électrique ?
- Comment peut-on la mesurer ?
1. Tension électrique :
1. Notion de tension électrique :
Chaque point d’un circuit se caractérise par son état électrique appelé potentiel électrique,
il est noté V et s’exprime en Volts.
La circulation de courant électrique d’un point A vers un autre B est dû à la différence de
potentiel entre ces deux points, On dit qu’il Il y a une tension électrique entre A et B.
La tension électrique UAB entre deux points A et B d’un circuit est égale à la différence de potentiel électrique entre ces
deux points :
UAB = VA - VB
Remarques :
La tension est une grandeur algébrique mesurable.
UAB = VA - VB = - ( VB - VA ) = - UBA
donc :
UAB = - UBA
2. Représentation de la tension électrique :
La représentation conventionnelle de la tension UAB entre les points A et B d’un
dipôle AB, est définie par une flèche dirigée de B vers A.
2. Mesure de la tension électrique :
On peut mesurer la tension électrique à l’aide :
- d’un voltmètre (à aiguille ou numérique)
- d’un oscilloscope.
Le voltmètre est représenté par le symbole normalisé :
Pour mesurer la tension électrique entre deux points A et B d’un circuit, le voltmètre doit être
monté en dérivation (en parallèle) entre ces deux points, et le courant doit rentrer par la borne
« V » du voltmètre et sortir par sa borne « COM ».
1. Voltmètre à aiguille :
La tension mesurée est donné par la relation suivante :
U=
Incertitude absolue :
∆U =
𝑪 . 𝒂
𝟏𝟎𝟎
𝑪. 𝒏
𝒏𝟎
Avec a : la classe de l'appareil indiquée sur le cadran
Incertitude relative ou précision de mesure :
∆𝐔
𝑼
représente la précision de mesure de cet
appareil elle s’exprime généralement en pourcentage %.
1
Application 1 :
1. On désire mesurer la tension 𝑼𝑨𝑩 à l'aide d'un voltmètre.
a. Représenter le voltmètre dans le circuit pour mesurer 𝑼𝑨𝑩.
b. Représenter la tension 𝑼𝑨𝑩.
2. Le port du voltmètre mesurant la tension continue 𝑼𝑨𝑩 et le suivant :
Le calibre utilisé est 𝒄 = 𝟑𝟎 𝑽 et Classe de l’appareille est a =1,5
a. Déterminer la valeur de la tension 𝑼𝑨𝑩.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
b. Calculer l’incertitude absolue et encadrer la tension 𝑼𝑨𝑩.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
c. Déduire la précision de mesure.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Voltmètre numérique :
Le Voltmètre numérique (ou multimètre) donne directement la valeur de la tension électrique
sur l’écran.
Incertitude absolue :
∆U =
𝑼𝒎
+ 1UR
𝟏𝟎𝟎
Où : Um représente la valeur indiquer par l’appareil numérique (tension mesurée).
1UR : représente incertitude absolue égale à 1 au dernier chiffre significatif de la valeur Um.
Incertitude relative ou précision de mesure :
∆𝐔
𝑼
représente la précision de mesure de cet appareil.
3. Mesure de la tension électrique par l’oscilloscope :
L'oscilloscope est un appareil électrique permettant
de visualiser et de mesurer la tension électrique entre
les bornes d’un dipôle dans un circuit.
Pour mesurer la tension entre les bornes d’un générateur,
on branche la borne positive du générateur à l’entrée Y1
de la voie (1) de l’oscilloscope et la borne négative à la
masse, on obtient un trait lumineux horizontal déplacé
vers le haut par nombre Y de divisions, et en connaissant
la valeur de la sensibilité verticale exprimé en V / div.
La tension entre les bornes du générateur est :
U = Y .SV
Sv ou Sy : la sensibilité verticale de l’oscilloscope
en Volt/div.
Exemple :
2
Application 2 :
On considère le circuit ci-contre.
1. Déterminer la tension visualisée sur l'oscilloscope.
……………………………………………………………………………………………….
2. Déterminer le signe de la tension mesurée.
……………………………………………………………………………………………………………….
3. Calculer la tension mesurée sachant que le déplacement vertical de la ligne lumineuse
est y = -3div et la sensibilité verticale de l'appareil est SV = 4V/div.
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
3. Propriétés de la tension électrique :
1. Propriétés de la tension électrique dans un circuit en série - Loi de l’additivité des tensions :
Activité 1 :
On réalise le circuit en série suivant, composé de : Générateur G, Lampe 1,
Lampe 2, et trois voltmètres.
On mesure la tension électrique aux bornes de chaque dipôle, on obtient :
UAB = 12 V , UAC = 6,5 V , UCB = 5,5 V
1. Que remarquez-vous ?
On remarque que : UAB = UAC + UCB
2. Démontrer théoriquement que : UAB = UAC + UCB
3. Que concluez-vous ?
Dans un circuit en série, la tension électrique UAB est la somme de toutes les tensions entre les bornes des dipôles montés
en série entre les deux points A et B. C’est la loi d’additivité des tensions.
Conclusion :
La loi d’additivité des tensions : La tension entre deux points dans une partie d'un circuit électrique est égale à la somme
des tensions entre les bornes des appareils montés en série entre ces deux points.
2. Propriétés de la tension électrique dans un circuit :
On réalise le circuit électrique en parallèle suivant, composé de :
Générateur G, Lampe 1, Lampe 2, et trois voltmètres.
On mesure la tension électrique dans les différentes branches du circuit,
on obtient :
UPN =6 V , UAB = 6 V ,
UCD= 6 V
1. Que remarquez-vous ?
On remarque que : UPN = UAB = UCD
2. Démontrer théoriquement que : UPN = UAB = UCD
3
3. Que concluez-vous ?
Dans un circuit en parallèle, les tensions électriques sont égales pour les appareils branchés parallèles.
Conclusion :
Les tensions aux bornes de dipôles montés en dérivation (en parallèle) sont égales.
Application 3 :
1. On considère le circuit électrique ci-contre. Pour mesurer la tension UDE, nous
utilisons un voltmètre dont le cadran comporte 150 divisions. Lors de l'utilisation
du calibre c = 15V, l'aiguille s'arrête sur la division 120.
a. Indiquer sur la figure l’emplacement du voltmètre pour mesurer UDE.
b. Calculer la valeur de tension UDE
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
2. On utilise l'oscilloscope pour mesurer la tension UBC. Lorsque nous utilisons la sensibilité verticale SV = 2V/div,
la ligne lumineuse se déplace vers le haut de par 2 divisions.
a. Indiquer sur la figure l’emplacement d’oscilloscope pour mesurer UBC.
b. Calculer la valeur de la tension UBC.
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
c. Déduire la valeur de la tension UAB et représenter les trois tensions.
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
d. Relier E à la terre avec un fil de grande section. Trouver les potentiels électriques de A, B, C et D.
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
4. Tension variable :
1. Définitions :
- Une tension est dite variable si elle prend différentes valeurs au cours du temps.
- La tension est appelée alternative si elle prend des valeurs positives puis négatives alternativement.
- La tension est périodique lorsqu’elle est répétée de manière similaire et régulière sur des périodes du temps successives
et égales.
4
2. Exemples des tensions variables :
3. Caractéristiques d’une tension alternative sinusoïdale ;
La tension alternative sinusoïdale est caractérisée par :
- Amplitude ou La tension maximale Umax : c'est la valeur maximale de la
tension variable. Elle s’exprime en Volt V, et elle se détermine par la relation :
avec : Sv ou Sy : la sensibilité verticale.
Um = y. Sy
y : nombre de divisions équivalent de Umax
- La tension efficace Ueff : c'est la valeur indiquée par l'ampèremètre lorsqu'on l'utilise pour mesurer la tension variable. Elle
s’exprime en Volt V, elle est liée à la tension maximale par la relation suivante :
Ueff =
𝐔𝐦
√𝟐
- La période T : est le plus petite durée au bout de laquelle le signal se reproduit de manière identique. Elle s’exprime en
seconde s, et elle se détermine par la relation :
T = x. Sx
avec : SH ou Sx : la sensibilité horizontale.
x : nombre de divisions équivalent de T
- La fréquence f : correspond au nombre de périodes par seconde, elle s’exprime en Hertz (Hz). Elle est liée
à la tension maximale par la relation suivante :
f=
𝟏
𝑻
Application 4 :
1. Quel est le type de la tension visualisée sur l'écran
de l’oscilloscope ?
………………………………………………………………
…………………………………………………………………
2. Quelle est la valeur de la tension maximale ?
…………………………………………………………..….
……………………………………………………………..
3. Quelle est la valeur efficace de cette tension ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
4. Quelle est la valeur de la période ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Calculer la fréquence de ce signal.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….…….
5
Matière : Physique
Niveau : T.C.F
Prof : Abderrahim FILALI
Cours N° 10 :
Partie N° 2 : Electricité
Lycée : Al Azhar
Année scolaire : 2020-2021
Association des conducteurs ohmiques
Introduction :
Les conducteurs ohmiques sont des composantes largement utilisées dans les
appareils électriques.
- Qu’est-ce qu’un conducteur ohmique ?
- Quel est le paramètre qui caractérise le conducteur ohmique ? et comment
varier ce paramètre quand on associé des conducteurs en série et en parallèle ?
1. Le conducteur ohmique :
1. Définition :
Le conducteur ohmique (résistor) est un dipôle passif caractérisé par une grandeur physique s’appelle la résistance, notée R.
L’unité de la résistance d’un conducteur ohmique en (SI) est Ohm notée Ω.
Le symbole normalisé utilisé en électricité pour représenter un conducteur ohmique est le suivant :
On peut mesurer la tension électrique à l’aide d’un ohmmètre ou multimètre.
2. Caractéristique d'un conducteur ohmique - La loi d’Ohm :
Activité 1 :
On réalise le montage ci-contre avec un générateur 0 – 12 V et un conducteur
ohmique de résistance R= 200 Ω.
On fait varier la tension aux bornes du générateur et pour chaque valeur de la
tension U aux bornes du conducteur ohmique, on relève l’intensité I du courant
électrique qui le traverse. On obtient :
1. Tracer le graphe U= f(I) Voir le grave ci-contre.
2. Qu’observe-t-on ? Que peut-on déduire pour l’équation de la droite ?
On observe que le graphe obtenu est linéaire (droite passe par l’origine du repère).
Donc : l’équation de la droite s’écrit comme la suite : U = k .I
Avec : k : le coefficient directeur de la droite.
3. Trouver la valeur de k le coefficient directeur de la droite. Que remarquez-vous ?
Que concluez-vous ?
On constate que : k = R
L’équation de la droite s’écrit comme la suite : cette relation U = R.I s’appelle loi d’Ohm d’un conducteur ohmique
et le graphe s’appelle la caractéristique du conducteur ohmique.
Conclusion – La loi d’Ohm :
La tension U aux bornes d’un conducteur ohmique de résistance R est égale au produit
de la résistance R par l’intensité du courant I qui le traverse :
Remarque :
La conductance G d’un conducteur ohmique est l’inverse de sa résistance R.
L’unité de G est siemens (S).
3. Résistance d’un fil métallique :
La résistance d’un fil métallique dépend de sa longueur L, de sa section S et de la nature
du matériau qui le constitue.
1
Application 1 :
Nous voulons fabriquer un chauffage électrique de puissance 𝑷=𝟐𝟎𝟎 𝑾 fonctionne sous la tension 𝑼=𝟓𝟎 𝑽 par bobinage
du fil de longueur 𝓵=𝟏𝟐 𝒎 autour d’un cylindre.
1. Calculer 𝑰 l’intensité du courant qui traverse le chauffage électrique.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Calculer 𝑹 la résistance du fil.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Trouver la valeur de 𝝆 la résistivité du fil sachant que son diamètre 𝒅=𝟎,𝟓 𝒎𝒎
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. Associations de Conducteurs Ohmiques :
100
200
1. Association en série :
Activité 2 :
On considère deux conducteurs ohmiques de résistances R1 et R2montés
en série. Ils sont les deux traversés par courant de même intensité I.
Par un multimètre, on mesure la résistance de chaque conducteur et R
la résistance équivalente à l'assemblage de ces conducteurs ohmiques.
On obtient : R1=100 Ω , R2 = 200 Ω , R= 300 Ω
1. Comparer R avec R1 + R2.
R = R1 + R2
2. Démontrer théoriquement que : R = R1 + R2
300
3. Que concluez-vous ?
La résistance équivalente à l’association en série de deux conducteurs ohmique est la somme de la résistance de chaque
conducteur ohmique seul.
Conclusion :
Généralisation : Dans le cas de branchement en série de
N conducteurs ohmiques, la résistance équivalente est :
200
100
2. Association en parallèle (en dérivation) :
Activité 3 :
On considère deux conducteurs ohmiques de résistances R1 et R2 montés
en parallèle. L’intensité du courant dans la branche principale est I.
chaque conducteur est traversé par un courant d’intensité différente I1 et I2
Par un multimètre, on mesure la résistance de chaque conducteur et R
la résistance équivalente à l'assemblage de ces conducteurs ohmiques.
On obtient : R1=100 Ω , R2 = 200 Ω , R= 66,6 Ω
66.6
2
1
1
1
1. Comparer R avec R1 + R2
On a :
donc :
1
1
1
2. Démontrer théoriquement que : R = R1 + R2
et
G = G1 + G2
3. Que concluez-vous ?
La conductance équivalente à l’association en dérivation de deux conducteurs ohmique est la somme de la conductance
de chaque conducteur ohmique seul.
Conclusion :
Généralisation : Dans le cas de branchement en dérivation de N conducteurs ohmiques,
la résistance équivalente est :
Application 2 :
Calculer 𝑹𝒆𝒒 la résistance équivalente de l’association de conducteurs ohmiques
schématisée ci-contre :
On donne : R1 = 40 Ω ; R2 = 60 Ω
;
R3 = 50 Ω
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………1…………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Application 3 :
I1
P
N
On considère le circuit de la figure ci-contre :
Donnée : R1 = 60 Ω ; R2 = 60 Ω ; R3 = 30 Ω ; UPN = 10 V
1. Calculer 𝑹𝒆𝒒 la résistance équivalente entre A et C.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
2. Déduire la valeur de I1 l’intensité du courant principale.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Calculer la valeur de la tension UBC.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Déduire la valeur de la tension UAB et les intensités I2 et I3.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….…………
3
3. Utilisation des conducteurs ohmiques :
1. Rhéostat :
Le rhéostat est un conducteur ohmique constitué d'un fil en alliage de fer et de nickel,
sa section fixe, enroulé autour d'un cylindre isolé. Le rhéostat a trois bornes, les deux
bornes 𝑨 et 𝑩 fixes et la borne 𝑪 variable, s’appelle le curseur, On symbolise le rhéostat
(𝑹𝒉) par :
Remarques :
- Le rhéostat peut s'utiliser comme résistance variable. En déplaçant le curseur sur le conducteur résistif, on fait varier
la valeur de la résistance entre les bornes A et C ou entre B et C.
- Le rhéostat est utilisé dans un circuit électrique soit pour varier le courant passant dans le circuit lorsqu'il est branché
en série avec les autres composants, soit pour varier la tension lorsqu'il est utilisé comme diviseur de tension (en parallèle)
entre les bornes d’un dipôle.
2. Diviseur de tension :
Pour obtenir un générateur de tension variable à partir d'un générateur de tension continue
on réalise un montage expérimental appelé diviseur de tension.
Pour avoir un diviseur de tension on monte un rhéostat en dérivation avec un générateur
de tension continue.
On appelle 𝑼𝑨𝑩 tension d'entrée et 𝑼𝑪𝑩 tension de sortie.
En déplaçant le curseur C du rhéostat, la tension de sortie UCB est variable.
3. Relation du diviseur de tension :
Application 4 :
Le montage est ici constitué de 3 résistances en série :
1. Ecrire la relation liant U3, R3 et I.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Faire de même entre U, R1, R2, R3 et I.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Ecrire la relation liant U3 à U et aux résistances.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Calculer U3
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Donnée :
U=5 V
; R1=150 k Ω ;
R2=1,2 M Ω ;
R3=68 k Ω
4
Niveau : T.C.F
Prof : Abderrahim FILALI
Cours N° 4 :
Matière : Chimie
Partie N° 2 : Les constituants de la matière
Lycée : Al Azhar
Année scolaire : 2020-2021
Le modèle de l’atome
Introduction :
Toute la matière qui nous entoure est composée d’atomes.
- Qu’est-ce qu’un atome ?
- Quels sont ses constituants ?
1. Evolution de modèle de l’atome :
400 ans avant J.-C. le philosophe grec Démocrite a considéré que la matière est constituée de petits
grains indivisibles qu’il appelle atomes .Cette imagination restait dominante jusqu'à l'arrivée de
Dalton en 1803 (physicien britannique) qui a supposé l’existence des atomes de formes sphériques
et qu'il en existe plusieurs types qui peuvent expliquer les propriétés de la matière.
En 1897, le britannique Thomson a proposé un modèle de l’atome dans lequel l'atome est une
boule électriquement neutre remplie d’une substance chargée positivement et d’électrons charges
négativement.
En 1907 Thomson demande à son élève Rutherford de vérifier l'exactitude de son modèle
atomique qui à l'aide de sa célèbre expérience dans laquelle il a bombardé une mince feuille d’or
un faisceau de particules alpha il a mis en évidence l'existence du noyau atomique et il a proposé
le modèle planétaire de l’atome : Un noyau positif chargé positivement autour duquel gravite des
électrons.
En 1913 le modèle de Bohr considère les électrons tournent autour du noyau selon des orbites de
rayon défini, pas tous identiques et pas tous contenus dans le même plan.
Le modèle actuel de l'atome est donné en 1925 par deux savants : Schrödinger et Louis de Broglie :
ils ont admis que la notion d’orbite n’a plus de sens pour un électron dans un atome. Les électrons
forment un nuage qui entoure le noyau, ils tournent autour du noyau de façon aléatoire et
désordonnée. On parle de chance de trouvé l’électron à une distance donnée du noyau
(modèle probabiliste).
2. Structure de l'atome :
1. Constituants de l’atome :
L’atome est constitué d’un noyau autour duquel tournent des électrons :
a. Le noyau :
Il est constitué de particules élémentaires appelées : nucléons, qui sont de deux sortes :
les protons et les neutrons.
- Le proton p est une particule élémentaire de masse 𝒎𝑷 = 𝟏,673.𝟏𝟎−𝟐𝟕𝒌𝒈 et porte une
charge électrique positive 𝒒𝑷 = 𝒆 =𝟏,.𝟏𝟎−𝟏𝟗𝑪.
- Le neutron n est une particule élémentaire de masse 𝒎𝒏=𝟏,675.𝟏𝟎−𝟐𝟕𝒌𝒈 et
électriquement neutre 𝒒𝒏=𝟎 𝑪.
b. Les électrons :
Un électron 𝒆− est une particule très peu massive 𝒎𝒆−= 𝟗,1.𝟏𝟎−𝟑𝟏𝒌𝒈 et pourvue d'une charge électrique négative de
𝒒𝒆− = - 𝒆 = - 𝟏,𝟔.𝟏𝟎−𝟏𝟗𝑪
Remarque :
C : est le symbole du Coulomb unité de charge électrique.
e =𝟏,6. 𝟏𝟎−𝟏𝟗𝑪 : appelée la charge élémentaire.
1
2. Notation symbolique d’un atome
On représente le noyau d’un atome (et lui-même) par le symbole suivant :
X : représente le symbole de l’élément chimique.
A : nombre de nucléons (protons + neutrons) ou nombre de masse.
Z : nombre de protons ou nombre de charges, on l’appelle aussi numéro atomique.
Remarques :
- Le nombre de neutrons du noyau est : N = A – Z
- Les deux nombres A et Z sont suffisants pour caractériser un noyau.
Exemples :
3. La masse d’un atome :
La masse de l’atome est la somme de la masse de ses différents constituants :
La masse de l’atome est concentrée dans son noyau. Donc on peut néglige la masse des électrons devant celle des protons
(soit 𝒎𝒑 ≈ 𝒎𝒏 ≈ 𝒎nucléon ≈ 𝟏,7.𝟏𝟎−𝟐𝟕𝒌𝒈). Alors la masse approchée de l’atome est égale à :
4. Neutralité électrique (ou électroneutralité) de l'atome :
- L’atome est électriquement neutre c’est-à-dire la charge électrique totale de l’atome est nulle : 𝑸atome = 0 C
- Le noyau comporte Z protons de charge électrique e. Donc sa charge électrique totale est : 𝑸𝒏𝒐𝒚𝒂𝒖 = +𝒁.𝒆
- Si a le nombre des électrons. Donc la charge totale des électrons est : 𝑸électrons = - a.𝒆
On a : 𝑸atome = 𝑸𝒏𝒐𝒚𝒂𝒖 + 𝑸électrons = 0
D’où : +𝒁.𝒆 - a.𝒆 = 0
Alors : a = Z
Donc le nombre d'électrons d'un atome autour de son noyau est égale au nombre de protons dans le noyau.
Application 1 :
Compléter le tableau ci-dessous :
Atome
35
17𝐶𝑙
27
𝑍𝐴𝑙
𝐴
26𝐹𝑒
Nombre de
nucléons
Nombre de
protons
Nombre de
neutrons
Nombre
d’électrons
Charge du
noyau
Charge des
électrons
Charge de
l’atome
13
30
Application 2 :
Le symbole de l'élément chimique Cuivre est : 63
29𝐶𝑢
1. Déterminer la composition (nombre de protons, de neutrons et d’électrons) de cet atome.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Calculer la charge du noyau de l’atome de cuivre.
On donne : 𝒆 = 𝟏,𝟔.𝟏𝟎−𝟏𝟗𝑪
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. Déterminer la masse approximative d’un atome de cuivre.
On donne : 𝒎𝑷 = 𝟏,𝟕.𝟏𝟎−𝟐𝟕𝒌𝒈
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
2
Application 3 :
Une boule de papier d’aluminium de masse m = 1,13g contient 2,5×1022 atomes d’aluminium. La charge du noyau portée
par un atome d’aluminium est : Qnoyau = 2,08 × 10−18C.
1. Déterminer la masse d’un atome d’aluminium, et déduire le nombre de nucléons A de cet atome.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Déterminer le numéro atomique Z de l’atome d’aluminium.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Donner la représentation symbolique de l’atome d d’aluminium.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Dimensions d’un atome :
3. L’élément chimique :
1. Définition :
L’élément chimique est l’ensemble des entités chimiques caractérisées par le même numéro atomique Z.
Chaque élément chimique est représenté par un symbole chimique.
Exemples :
2. Les isotopes :
Les isotopes sont des atomes dont les noyaux possèdent le même numéro atomique Z et diffèrent par leur nombre de
masse A.
Exemple : les isotopes de l’élément de carbone :
3. les ions monoatomiques :
Un ion monoatomique résulte d’un atome qui a gagné ou perdu un ou plusieurs électrons.
- Un atome qui perd des électrons acquiert une charge positive, il se forme un ion positif s’appelle cation.
Exemples : Na+ ; Mg2+ ; Al3+.
- Un atome qui gagne des électrons acquiert une charge négative, il se forme un ion négatif s’appelle anion.
Exemples : F− ; Cl − ; O2−
Application 4 :
Compléter le tableau ci-dessous :
Ion
23
+
11𝑁𝑎
32 2−
16𝑆
27 3+
𝑍𝐴𝑙
Atome
Charge d’ion
Nombre de
nucléons
Nombre de
protons
Nombre de
neutrons
Nombre
d’électrons
10
3
4. Conservation de l’élément chimique :
Activité :
- Transformation 1 : l’action de l’acide nitrique sur le métal cuivre.
ion de cuivre II : Cu2+.
- Transformation 2 : réaction entre les ions de cuivre II et la soude.
hydroxyde de cuivre II : Cu(OH)2 .
- Transformation 3 : déshydratation par chauffage d’hydroxyde de cuivre II.
monoxyde de Cuivre : CuO.
- Transformation 4 : réaction de carbone avec monoxyde de cuivre
métal cuivre (Cu).
Conclusion :
Au cours des transformations chimiques, il y a un changement dans l'identité des objets réactifs sans modification des
éléments chimiques.
En général, nous disons, les éléments chimiques sont conservés au cours des transformations chimiques.
4. Répartition électronique d’un atome :
1. Couches électroniques :
Les électrons d’un atome se répartissent dans des couches électroniques. Chaque couche
électronique est repérée par une lettre K, L, M pour les atomes Z≤18
2. Règles de remplissage des couches électroniques :
Première règle : Une couche électronique ne peut contenir qu'un nombre limité d'électrons.
- La couche K (première couche) peut contenir un maximum de 2 électrons.
- La couche L (deuxième couche) peut contenir un maximum de 8 électrons.
- La couche M (troisième couche) peut contenir un maximum de 8 électrons (seulement pour les éléments tels que 𝒁≤𝟏𝟖).
Deuxième règle : Le remplissage des couches électroniques s'effectue en commençant par la couche K. Lorsqu'elle est
saturée (pleine) on remplit la couche L et ainsi de suite.
3. Structure électronique de l'atome :
La structure électronique de l'atome décrit la distribution des électrons de cet atome dans différentes couches.
La structure électronique est composée des lettres correspondant aux couches K, L, M. Les lettres sont écrites entre
parenthèse. On indique le nombre d’électrons qu’elles contiennent en exposant haut à droite.
Exemples :
Remarques :
- La dernière couche de la structure électronique contenant des électrons est appelée la couche externe.
- Les autres couches occupées par des électrons sont nommées couches internes.
- Les électrons de la couche externe appelés électrons de valence.
- Si la couche externe d’un élément (atome ou ion) est saturée, on dit que cet élément est stable.
Application 5 :
Le numéro atomique de l’élément soufre est : Z =16
1. Ecrire la répartition des électrons de l’atome de soufre.
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. Indiquer la (ou les) couche(s) interne(s) et la couche externe.
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. Combien d’électrons l’atome de soufre a-t-il dans sa couche externe.
……………………………………………………………………………………………………………………….
4
Application 6 :
1. La structure électronique de l'atome de chlore Cl est : (K)2(L)8(M)7. Le noyau de cet atome possède 18 neutrons.
a. Déterminer le nombre d’électrons de cet atome.
………………………………………………………………………………………………………………………
b. Quel est le nombre d’électrons de valence (ou électrons externes).
………………………………………………………………………………………………………………………
c. La couche externe est-elle saturée ou non ? Justifier votre réponse.
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
d. Quel est le numéro atomique Z (nombre de protons) de cet atome ? Justifier votre réponse.
……………………………………………………………………………………………………………………….
e. Déduire A le nombre de nucléons A.
……………………………………………………………………………………………………………………….
f. Donner la représentation symbolique de l’atome de Chlore Cl.
……………………………………………………………………………………………………………………….
2. Le schéma ci-contre montre le passage d’un atome de chlore à ion chlorure.
a. Donner la structure électronique de l’ion chlorure.
…………………………………………………………………
b. Ion chlorure est-il stable ou non ? Justifier votre réponse ?
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
c. Donner le symbole de l’ion chlorure.
…………………………………………………………………
d. Ion chlorure est-il cation ou anion ? Justifier votre réponse ?
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
Application 7 :
Un atome inconnu possède12 neutrons et deux électrons sur sa couche externe M.
1. Déterminer la configuration électronique de cet atome.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Déterminer le numéro atomique Z de cet atome.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Déterminer la charge électrique du noyau.
On donne : 𝒆 = 𝟏,𝟔.𝟏𝟎−𝟏𝟗𝑪
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Déterminer A le nombre de nucléons.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Donner la représentation symbolique de cet atome sachant que son symbole chimique est Mg.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
6. L’ion formé par cet atome résulte de la perte de deux électrons de la couche externe. Donner la structure électronique
de cet ion.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
7. Déterminer la charge électrique portée par cet ion. S’agit-il d’un cation ou d’un anion ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
8. Ecrire la formule chimique de cet ion.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
5
Matière : Chimie
Niveau : T.C.F
Prof : Abderrahim FILALI
Cours N° 5 :
Partie N° 2 : Les constituants de la matière
Lycée : Al Azhar
Année scolaire : 2020-2021
La géométrie de quelques molécules
Introduction :
Tout ce qui nous entoure est constitué de matière, la matière est composée
de molécules plus ou moins complexes, composés elles-mêmes d’atomes.
- Qu’est-ce qu’une molécule ?
- Pourquoi et selon quels critères ces molécules se forment-elles ?
- Comment représenter une molécule ? Ou bien comment déterminer
la géométrie d’une molécule dans l’espace ?
- Y a-t-il des règles ou des modèles permettant d’expliquer cette géométrie ?
1. Règles de Duet et de l'Octet :
1. Stabilité des gaz rares :
Activité :
1. Ecrire la structure électronique des éléments suivantes : L'hélium He (Z=2), le néon Ne (Z=10) et l'argon Ar (Z=18)
La structure électronique est : 𝑯𝒆∶ (𝑲)2 ,
𝑵𝒆∶ (𝑲)2(𝑳)𝟖 , 𝑨𝒓∶ (𝑲)𝟐(𝑳)𝟖(𝑴)𝟖.
2. La couche externe de chaque atome est-elle saturée ou non ?
La couche externe de chaque atome est saturée car elle contient le nombre maximum d'électrons.
3. Comment appelés ces éléments ?
Ces éléments appelés des gaz rares (ou nobles).
4. Ecrire la structure électronique de l'atome de lithium 𝑳𝒊 (𝒁=𝟑) et l'atome de chlore 𝑪𝒍 (𝒁=𝟏𝟕). Les deux atomes ont-ils
une stabilité chimique ?
La structure électronique est : 𝑳𝒊∶ (𝑲)2(𝑳)𝟏 , 𝑪𝒍∶ (𝑲)𝟐(𝑳)𝟖(𝑴)𝟕
Les deux atomes sont instables parce que leurs couches externes sont insaturées.
5. Ecrire la structure électronique des ions 𝑳𝒊+ et 𝑪𝒍−. Sont-ils caractérisés par la stabilité chimique ?
La structure électronique est : 𝑳𝒊+∶ (𝑲)2 , 𝑪𝒍−∶ (𝑲)2(𝑳)𝟖(𝑴)𝟖
Les ions sont stables car leurs couches externes sont saturées.
Conclusion :
Les gaz rares (qu'on appelle gaz nobles) ne participent pas à des réactions chimiques, ils sont chimiquement stables,
leurs couches externes sont saturées. (Exemples : l’hélium, l'argon le néon …..).
Les éléments chimiques instables se transforment et s’associent, de façon à augmenter leur stabilité : ils cherchent toujours
à acquérir la structure électronique d’un gaz rare de numéro atomique le plus proche.
2. Énoncé des règles :
- La règle du «Duet» : Au cours des transformations chimiques, les éléments chimiques de numéro atomique (Z ≤ 4)
évoluent de manière à avoir la structure électronique du Hélium He∶ (K)2. Ils ont alors deux électrons sur leur couche
externe.
- La règle de l’«Octet» : Au cours des transformations chimiques, les éléments chimiques de numéro atomique (4 < Z ≤18)
évoluent de manière à avoir la structure électronique de plus proche gaz rare dans le tableau périodique des éléments
(de Néon Ne∶ (K)2(L)8 ou Argon Ar ∶ (K)2(L)8(M)8). Ils portent donc 8 électrons sur leur couche externe.
3. Application sur les ions monoatomiques stables :
Les ions monoatomiques sont stables car ils vérifient les règles de Duet et de l’Octet.
Exemples :
1
2. Représentation des molécules selon le modèle de Lewis :
1. Définition de la molécule :
La molécule est un ensemble d’atomes reliés entre eux par une ou plusieurs liaisons chimiques, appelées liaisons covalents.
Exemple : la molécule de méthane CH4 est constituée d’un atome de carbone et 4 atomes d’hydrogène.
2. La liaison covalente :
Une liaison covalente est une liaison chimique dans laquelle les deux atomes se partagent deux électrons (chaque atome
fournissant un électron) de leurs couches externes afin de former un doublet d’électrons liant les deux atomes.
On représente la liaison covalente entre deux atomes par un trait.
Types de liaisons covalentes :
- Liaison covalente simple : H − H
- Liaison covalente double : O = O
- Liaison covalente triple : N ≡ N
3. La représentation de Lewis d'une molécule :
La représentation de Lewis d’une molécule est une représentation des atomes et de tous les doublets
d’électrons (liants et non-liants) de cette molécule.
Méthode de détermination de la représentation de Lewis d’une molécule :
- Écrire la structure électronique de chaque atome.
- Déterminer le nombre global 𝑛𝑡 d’électrons de couches externes de chaque atome dans la molécule.
- Déterminer le nombre global 𝑛𝑑 de doublets d’électrons : 𝑛𝑑 =
𝑛𝑡
2
- Déterminer le nombre 𝑛𝐿 de liaisons covalentes que doit établir l’atome pour acquérir une structure en octet (8 – p) ou
en duet (2 – p) suivant la règle à laquelle il est soumis avec p nombre d’électrons pour saturer la coucher externe.
- Déterminer le nombre 𝑛𝑑′ de doublets non liants de chaque atome : 𝑛𝑑′ =
𝑝 −𝑛𝐿
2
Exemples :
2
3. Notion d'isomérie :
1. Types de formules :
- Formule Brute : Indique le nombre et la nature des atomes des différents constituants chimiques de la molécule.
- Formule semi-développée : Indique le type de liaisons entre les atomes principaux.
- Formule développée : à partir du modèle de Lewis, nous obtenons la formule développée en supprimant les paires
électroniques non liantes.
Exemple :
2. Isomères :
On appelle isomères toute espèce chimique ayant la même formule brute mais correspondre plusieurs formules
semi-développées différentes (des propriétés physiques ou chimiques différentes).
Exemple :
4. Géométrie des molécules :
1. Géométrie spatiale des molécules :
Les doublets liants et non liants se repoussent (charge négative) et la disposition spatiale d'une molécule est liée à cette
répulsion, de façon à ce qu'ils soient le plus loin possible. On trouve souvent un atome central relié par d'autres atomes
par des liaisons covalentes.
Exemples :
2. Représentation de Cram :
La représentation de Cram donne un aperçu de la configuration spatiale des atomes qui composent une molécule. Elle fait
apparaître les liaisons en perspective :
Liaison située dans le plan de la feuille.
Liaison située en avant du plan de la feuille.
Liaison située en arrière du plan de la feuille
Exemples :
3
Application 1 :
Le tétrachloréthane ou tétrachlorure de carbone est un composé chimique chloré de formule brute : CCl 4
Donner la représentation de Lewis de la molécule, et celle de Cram. On donne : Z(C)= 6 et Z(Cl)=17
Molécule
Structure
électronique
𝑛𝑡
𝑛𝑑
𝑛𝑑′
𝑛𝐿
Représentation Représentation
de Lewis
de Cram
Application 2 :
On considère la molécule avec la formule brute suivante : C2H6O.
On donne : Z(H)= 1 ; Z(C)=6 et Z(O)=8
1. Proposer un modèle de Lewis de la molécule pour la chaine d'atomes suivante : C─C─O.
2. La même question pour la chaine d'atomes suivante : C─O─C.
Molécule
Structure
électronique
𝑛𝑡
𝑛𝑑
𝑛𝑑′
𝑛𝐿
Représentation de Lewis
C─C─O
C─O─C
3. Que conclure pour la molécule étudiée.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Application 3 :
Voici le modèle moléculaire de la molécule d'amino-acetonitrile.
1. Donner sa formule brute.
……………………………………………………………………………………
2. Donner sa représentation de Lewis.
Molécule
Structure
électronique
𝑛𝑡
𝑛𝑑
𝑛𝐿
𝑛𝑑′
Représentation
de Lewis
3. Représenter sa formule développée.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Représenter sa formule semi-développée.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
4
Matière : Chimie
Niveau : T.C.F
Prof : Abderrahim FILALI
Cours N° 6 :
Partie N° 2 : Les constituants de la matière
Lycée : Al Azhar
Année scolaire : 2020-2021
Classification périodique des éléments chimiques
Introduction :
Dès le début du 19 ème siècle, les éléments chimiques deviennent
de plus en plus nombreux, ce qui a poussé les scientifiques à
essayer de les classer, de les regrouper et de trouver un moyen de
les agencer.
- Comment les éléments chimiques sont-ils regroupés ?
- Quelle est l’utilité de la classification périodique des éléments
chimiques ?
1. Classification périodique des éléments chimiques :
1. Classification périodique selon Mendeleïev :
Depuis l’antiquité, on connaissait déjà quelques éléments chimiques comme le cuivre, l’or, le fer,
l’argent, le soufre…
Dès le début du 19ème siècle, les éléments chimiques deviennent
de plus en plus nombreux, ce qui a poussé les scientifiques à essayer
de les classer, de les regrouper et de trouver un moyen de les agencer.
Plusieurs tentatives de classification sont identifiées, mais aucune
n’est satisfaisante.
Dans l'année 1860, un jeune chimiste russe Dimitri Ivanovitch
Mendeleïev (1834-1907), dans une lointaine université à
Saint-Pétersbourg, propose une première classification périodique des
éléments chimiques qui contenait 63 éléments qui étaient connus à
l’époque, en les rangeant par deux critères principaux :
- Classer les éléments chimiques par ordre de masses atomiques
croissantes.
- Les éléments chimiques figurant dans une même colonne présentent
des propriétés chimiques semblables (similaires).
Mendeleïev prévoyait l’existence d’éléments chimiques inconnus à
l’époque, où il plaçait à ses places un point d’interrogation ( ? ). Ils ont
été découverts plus tard et leurs propriétés étaient identiques à celles déjà
prévu par Mendeleïev. Comme le Germanium, découvert en 1886.
2. Classification moderne :
a. Tableau périodiques des éléments chimiques :
1
- La classification périodique comporte 118 éléments chimiques.
- La classification périodique comporte 18 colonnes et 7 lignes.
- Les éléments chimiques sont classés par numéro atomiques Z croissant.
- Les éléments dont les atomes ont le même nombre d’électrons sur leur couche externe sont placés dans la même colonne.
- Les éléments d’une même colonne forment une famille.
- Les atomes ayant le même nombre de couches électroniques occupées se trouvent sur une même ligne appelée période.
b. Tableau périodique simplifié :
La figure ci-dessous présente une classification simplifiée des 18 premiers éléments.
2. Les familles chimiques :
1. Définition :
Une famille chimique est constituée de l’ensemble des éléments chimiques appartenant à une même colonne de la
classification périodique.
Les éléments appartenant à une même famille chimique possèdent des propriétés chimiques similaires.
Les éléments d’une même colonne (donc même famille) possèdent le même nombre d’électrons sur leur couche externe.
2. Noms et propriétés des familles chimiques :
a. Familles des alcalins :
Elle rassemble les éléments de la première colonne mis à part l’hydrogène.
Exemples : Sodium : Na , Lithium : Li , Potassium : K…..
- Ils ont un électron sur leur couche externe qu’ils perdent facilement pour donner des ions sous forme 𝑿+ : Li+ , Na+ , K+…
- Réagit avec le dioxygène de l'air O2 nous obtenons des composés ioniques sous forme 𝑿𝟐𝑶 : 𝑳𝒊𝟐𝑶 , 𝑵𝒂𝟐𝑶 , 𝑲𝟐𝑶 …
- Réagit fortement avec l'eau 𝑯𝟐𝑶 et produit du Dihydrogène 𝑯𝟐.
b. Familles des alcalino-terreux :
Elle rassemble les éléments de la deuxième colonne.
Exemples : Béryllium : Be , Magnésium : Mg …..
- Ils ont 2 électrons sur leur couche externe qu’ils perdent facilement pour donner des ions sous forme 𝑿2+ : Mg2+, Ca2+…
- Ils sont oxydés pour former des composés ioniques sous forme 𝑿𝑶 comme : 𝑩 , 𝑴𝒈𝑶 , 𝑪𝒂𝑶 …
c. Familles des halogènes :
Elle rassemble les éléments de la septième colonne.
Exemples : Fluor F , Chlore Cl .....
Ils ont 7 électrons sur leur couche externe et vont donc facilement en gagner un pour former des ions sous forme 𝑿- : F-, Cl- Ils forment des molécules binaires sous forme 𝑿𝟐 comme : 𝑭𝟐 et 𝑪𝒍𝟐 ….
d. Familles des gaz rares :
Elle contient les éléments de la huitième colonne.
Exemples : Hélium He , Néon Ne , Argon Ar …….
- Ils sont stables car leurs couches externes sont saturées.
- Ils se caractérisent par une très grande stabilité chimique, incolores à l'état naturel.
2
Application 1 :
1. Le magnésium Mg est dont le numéro atomique est égal à 12.
a. Ecrire la formule électronique de l’atome de magnésium.
………………………………………………………………………………………………………………………………..
b. Quelle est sa couche externe ?
………………………………………………………………………………………………………………………………..
c. Sur quelle ligne du tableau de la classification périodique se trouve-t-il ?
……………………………………………………………………………………………………………………………….
d. A quelle colonne du tableau de la classification périodique appartient-il ?
………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Le béryllium Be est un élément chimique placé juste au-dessus du magnésium dans le tableau de la classification
périodique.
a. En déduire la formule électronique de l’atome de béryllium et le numéro atomique de cet élément.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
b. Un atome de béryllium à un nombre de masse A = 9. Combien comporte-t-il de protons.de neutrons et d’électrons.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Application 2 :
L’atome de magnésium Mg se trouve dans deuxième colonne et la troisième période.
1. Donner le numéro atomique Z de cet atome.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Donner la configuration électronique de l’atome de magnésium.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Combien d’électrons possède l’atome de magnésium sur sa couche externe.
……………………………………………………………………………………………………………………………….…
Application 3 :
La couche électronique externe d'un atome est la couche (M). Elle comporte 1 électron.
1. Dans quelle ligne et quelle colonne de la classification périodique se situe l'élément chimique correspondant ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Donner son numéro atomique et l'identifier.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Quel ion monoatomique est susceptible de se former à partir de cet atome ? Justifier.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Citer deux éléments appartenant à la même famille. Nommer cette famille.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Comparer les propriétés chimiques de ces éléments.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Application 4 :
Un cation a pour formule électronique (K)2 (L)8.
1. Est-il stable ? Pourquoi ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Sachant qu'il porte une seule charge élémentaire, déterminer la formule électronique de l'atome dont il dérive et identifier
l'élément correspondant.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Donner les numéros de colonne et de ligne (période) de cet élément dans le tableau de classification périodique.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
3
Matière : Chimie
Niveau : T.C.F
Prof : Abderrahim FILALI
Partie N° 3 : Transformation de la matière
Cours N° 7 :
Lycée : Al Azhar
Année scolaire : 2020-2021
La mole – Quantité de matière
Introduction :
On peut dénombrer le nombre de molécules de saccharose contenues dans
un échantillon du sucre par l’utilisation de la notion de mole.
- Qu’est-ce qu’une mole ?
- Comment peut-on compter le nombre de molécules d’une substance chimique ?
1. La mole :
Activité :
On mesure la masse d’un clou de fer par une balance électronique. On obtient : m =112 g.
On considère que le clou ne contient que des atomes de fer 56
26𝐹𝑒.
Données :
mp = mn = 1,66.10-27 Kg ; me = 9,11.10-31 Kg
1. Déterminer la composition (nombre de protons, de neutrons et d’électrons) d’atome de fer 56
26𝐹𝑒.
26 protons ; 30 neutrons ; 26 électrons.
2. Calculer la masse d'un atome de fer 56
26𝐹𝑒.
m(Fe) =26.mp + 30.mn + 26.me = 9,354 10-26Kg
3. Déduire 𝑵 le nombre d'atomes de fer 56
26𝐹𝑒 trouvé dans le clou. Que peut-on déduire ?
N=
𝑚
112 .10−3
=
𝑚(𝐹𝑒)
9,354 .10−26
≈ 12 . 1023
;
112
une petite masse de fer contient un nombre très grand des atomes.
Conclusion :
Le nombre d’atomes contenu dans un échantillon est très grand, pour cela les chimistes ont défini une unité qui permet
de manipuler des nombres moins grands. Cette unité s’appelle la mole.
1. Le nombre d’Avogadro :
On prend un échantillon de carbone 126𝐶 de masse 𝒎=𝟏𝟐 𝒈.
La masse d'un atome de carbone 126𝐶 est : m(𝑪)=𝟏,𝟗𝟗𝟐𝟔𝟔𝟐.𝟏𝟎−𝟐𝟑𝒈.
Cet échantillon contient un nombre 𝓝 atome de carbone 126𝐶 tel que :
𝑚
12
NA = 𝑚(𝐶) = 1,992662. 10−23 ≈ 6,02 . 1023
Ce nombre 𝓝A =𝟔,02.𝟏𝟎𝟐𝟑 est appelé le nombre d'Avogadro.
2. Définition de la mole :
Une mole de particules (atomes, molécules, ions) est définie comme un ensemble de NA particules identiques.
Avec NA : le nombre d’Avogadro. Le symbole de la mole est : mol.
Exemple : Calculer le nombre des moles trouvés dans le clou de fer (Activité précédent).
𝑁
12 .1023
n = 𝑁 = 6,02 .1023 ≈ 2 mol
𝐴
2. La masse molaire :
1. Masse molaire atomique :
La masse molaire atomique M(x) d’un élément chimique X est la masse d’une mole de cet élément, elle est donnée par
le tableau périodique. Elle s’exprime en g .mol-1.
On peut déterminer la masse molaire atomique d’un élément chimique X par la relation suivante : M(x) = m(X) .NA
avec : m(X) la masse d’un atome d’élément chimique X en (g) et NA : constante d’Avogadro en (mol-1)
1
Exemple : Calculer la masse molaire atomique d’oxygène.
On donne : m(O) = 2,658. 10-23 g ; NA = 6,02. 1023 mol-1
M(C) = m(C) .NA = 2,658. 10-23 g. 6,02. 1023 mol-1 = 16 g .mol-1
2. Masse molaire moléculaire :
La masse molaire moléculaire d'une molécule est la somme des masses molaires atomiques des atomes qui constituent
cette molécule.
Exemple : Déterminer les masses molaires moléculaires des molécules suivantes : CH4 , NH3 , H2O, C4H10 et H2SO4
On donne : M(N) = 14 g .mol-1 ; M(S) = 32 g .mol-1
M(CH4) = M(C) + 4. M(H) = 12 + 4.1 = 16 g .mol-1
M(NH3) = M(N) + 3. M(H) = 14 + 3.1 = 17 g .mol-1
M(H2O) = 2. M(H) + M(O) = 2. 1 + 16 = 18 g .mol-1
M(C4H10) = 4. M(C) + 10. M(H) = 4.12 + 10.1 = 58 g .mol-1
M(H2SO4) = 2. M(H) + M(S) + 4. M(O) = 2.1 + 32 + 4.16 = 98 g .mol-1
3. Quantité de matière :
1. Définition :
La quantité de matière d'un échantillon est le nombre de moles que contient cet échantillon, c'est une grandeur notée n,
son unité est la mole (mol). Elle est définit par la relation suivante :
n : Quantité de matière en (mol)
N : Nombre d’entités chimiques (molécules, atomes ou ions)
NA : Constante d’Avogadro NA = 6,02. 1023 mol-1
2. Relation entre la quantité de matière et la masse :
La quantité de matière d’un échantillon de masse 𝒎 (𝑿) composé par une espèce chimique 𝑿 de masse molaire 𝑴 (𝑿) est
donnée par la relation suivante :
n : Quantité de matière en (mol)
m(X) : Masse en (g)
M(X) : Masse molaire en (g.mol-1)
Exemple : Calculer la quantité de matière de fer dans le clou (Activité précédent). On donne M(Fe) =A= 56 g.mol-1
n(Fe)=
𝑚(𝐹𝑒) 112
=
= 2 mol
𝑀(𝐹𝑒)
56
Application 1 :
1. Calculer la masse molaire moléculaire du saccharose de formule C12H22O11.
On donne : M(H) = 1 g .mol-1 ; M(C) = 12 g .mol-1 1 ; M(O) = 16 g .mol-1 ; NA = 6,02. 1023 mol-1
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Déterminer la quantité de matière de saccharose pour une masse de saccharose m = 5 g.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Déduire le nombre de molécules de saccharose.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
2
Remarque :
𝑚
- La masse volumique d’un corps solide ou liquide est donnée par la relation suivante : 𝜌 = 𝑉
- La densité d’un corps solide ou liquide est donnée par la relation suivante : 𝑑 =
Donc :
𝜌
𝜌𝑒𝑎𝑢
m=𝜌.V
𝜌 = d . 𝜌𝑒𝑎𝑢
n : Quantité de matière en (mol)
m : Masse du corps en (g)
M : Masse molaire du corps en (g.mol-1)
V : Volume du corps en (L)
𝜌 : Masse volumique du corps en (g.L-1)
𝜌𝑒𝑎𝑢 : Masse volumique de l'eau 𝜌𝑒𝑎𝑢 = 1000 g.L-1
d : Densité du corps (sans unité)
Application 2 :
Calculer la quantité de matière contenue dans un volume V =10mL de linalol C10H18O de masse volumique 𝜌 =0,9g.mL−1
On donne : M(H) = 1 g .mol-1 ; M(C) = 12 g .mol-1 1 ; M(O) = 16 g .mol-1
……………………………………………………………………………………………….…………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….…………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Quantité de matière d’un gaz :
1. Volume molaire des gaz :
Le volume molaire 𝑉𝑚 d’un gaz est le volume occupé par une mole de ce gaz dans les conditions de pression et de
température données. Il s’exprime en L.mol-1.
2. Loi d’Avogadro-Ampère :
Dans les mêmes conditions de pression et de température, tous les gaz ont le même volume molaire.
- Dans les conditions ordinaires de température et de pression (P =1 atm ; 𝜃=20°C) : le volume molaire est 𝑉𝑚 = 24 L.mol-1
- Dans les conditions normales de température et de pression (P =1 atm ; 𝜃=0°C) : le volume molaire est 𝑉𝑚 = 22,4 L.mol-1
3. Relation entre la quantité de matière et le volume :
La quantité de matière d’un gaz 𝑿 est donnée par la relation suivante :
n : Quantité de matière en (mol)
V : Volume de gaz en (L)
𝑉𝑚 : Volume molaire en (L.mol-1)
Application 3 :
On considère un flacon de dichlore Cl2 de 1L .il est rempli de dichlore dans les conditions ou le volume molaire vaut
𝑉𝑚 = 24 L.mol -1.
1. Calculer le nombre de moles de dichlore.
……………………………………………………………………………………………….…………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
2. En déduire la masse de dichlore contenu dans dans le flacon. On donne M(Cl) = 35,5 g.
…………………………………………………………………………………………………………..………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
3
4. Equation d’état d’un gaz parfait :
Un gaz est dit parfait si les interactions entre les molécules qui le constituent sont très faibles.
Equation d’état du gaz parfait est :
P : Pression du gaz en pascal (Pa) ; 𝟏 𝒃𝒂𝒓 =𝟏𝟎𝟓 Pa et 𝟏 𝒂𝒕𝒎 =𝟏𝟎𝟏𝟑𝟐𝟓 𝑷𝒂
V : Volume du gaz en pascal (m3) ; 1L = 10-3 m3
n : Quantité de matière en (mol)
T : Température absolue en Kelvin (K) ; (𝑲) = (°𝑪) + 𝟐𝟕𝟑
R : Constante des gaz parfait ; R = 8,.314 (SI)
Remarque :
La densité d’un gaz par rapport à l’air est donnée par la relation suivante : 𝑑 =
𝑀
29
La densité d est une grandeur sans unité.
Application 4 :
A la température θ=15°C et sous la pression P =150 bar on remplit une bouteille de volume interne V=15L
de dihydrogène H2 gazeux .on considère ce gaz comme étant un gaz un gaz parfait.
On donne : la constante des gaz parfait R=8,314(SI)
; M(H)=1g/mol
;
1bar =1,00 .105 Pa
1. Calculer la quantité de matière du dihydrogène.
…………………………………………………………………………………………………………..………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. En déduire sa masse.
…………………………………………………………………………………………………………..………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………………………………….…
Application 5 :
Un flacon de volume V = 0,80 L renferme une masse m = 1,41 g de propane gazeux C3H8.
On donne : M(C) = 12,0 g.mol-1 ;
M(H) = 1,0 g.mol-1
1. Calculer la masse molaire M du propane.
…………………………………………………………………………………………………………..………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………………………………….…
2. En déduire la densité du propane gazeux.
…………………………………………………………………………………………………………..………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. Déterminer la quantité de matière n de propane contenu dans le flacon.
…………………………………………………………………………………………………………..………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….
4. Calculer le volume molaire Vm du propane dans les conditions de l’expérience.
…………………………………………………………………………………………………………..………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
4
Matière : Chimie
Niveau : T.C.F
Prof : Abderrahim FILALI
Cours N° 8 :
Partie N° 2 : Transformation de la matière
Lycée : Al Azhar
Année scolaire : 2020-2021
La concentration molaire
Introduction :
Souvent dans la vie quotidienne, et suivant nos besoins on dissout dans l’eau
des espèces chimiques (solides ou liquides) avec des quantités notables et
parfois précises.
- Quelle est la grandeur qui caractérise la solution préparée, et comment on
détermine cette grandeur ?
- Comment procéder expérimentalement pour préparer une solution contenant
une quantité de matière donnée d’une espèce chimique ?
1. Solution aqueuse :
Une solution est un mélange homogène obtenue par dissolution d'une espèce chimique dans un liquide appelé solvant,
(l'espèce chimique dissoute est appelée soluté).
- le soluté peut-être : un solide, un liquide ou un gaz.
- le solvant peut-être : l'eau ou un liquide organique (comme l’alcool, le cyclohexane….).
Lorsqu'on prépare une solution en utilisant l'eau comme solvant, la solution obtenue est appelée solution aqueuse.
Exemple :
En dissolvant quelques cristaux de chlorure de sodium (soluté) dans l'eau (solvant), on obtient un mélange homogène
qu'on appelle solution aqueuse de chlorure de sodium.
2. La concentration molaire :
La concentration molaire C d'une espèce chimique en solution est égale à la quantité de matière de cette espèce présente
dans 1 litre de solution. Elle est donnée par la relation suivante :
Application 1 :
On dissout une masse de 17,1 g de glucose C6H12O6 dans de l’eau de façon à obtenir un volume de V =500 mL de solution
d’eau sucrée. On donne M(C6H12O6)=180 g.mol-1
Quelle est la concentration molaire du glucose) dans cette solution ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….…
3. La dilution d’une solution :
1. Principe de la dilution :
Diluer une solution aqueuse consiste, en lui ajoutant de l’eau distillé, à obtenir une solution moins concentrée.
La solution que l’on dilue est appelée solution initiale ou solution mère.
La solution obtenue est appelée solution finale ou solution fille.
1
2. Relation de dilution :
Lors d’une dilution, le volume V augmente donc la concentration molaire du soluté diminue, mais sa quantité de matière
ne change pas (reste constante).
Au cours de la dilution, la quantité de matière du soluté se conserve, donc : 𝑛𝑖 = 𝑛𝑓
Alors :
(relation de dilution)
avec : 𝑉𝑓 = 𝑉𝑖 + 𝑉𝑒
𝑉𝑒 : Volume de l’eau ajouté
On définit le facteur de dilution F par la relation :
Si F=10 : On dit que la solution est diluée 10 fois.
Application 2 :
1. On dissout m=1,17 g de chlorure de sodium NaCl dans V1=100 mL d’eau distillée, on obtient une solution S1.
On donne : M(Na)=23 g/mol ; M(Cl)=35,5 g/mol
a. Dire quelles substances représentent le soluté et le solvant.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..…..
b. Calculer la concentration molaire en chlorure de sodium de la solution (S1).
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..…..
…………………………………………………………………………………………………………………………………
2. On ajoute à la solution (S1) un volume Ve d’eau distillée, on obtient une solution (S2) de concentration molaire
C2= 0,02 mol.L-1.
a. Calculer le volume d’eau ajoutée Ve.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..…..
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..…..
b. Déterminer F le facteur de dilution.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..…..
3. Protocole d’une préparation de solution par dilution :
2