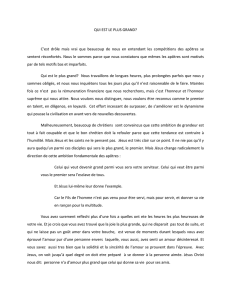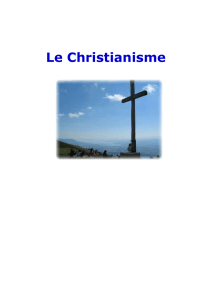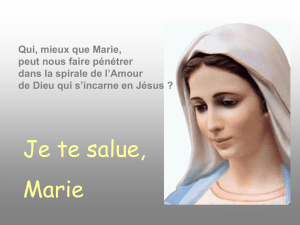L’Esprit du Christianisme (2018 - le "testament" de Joseph Moingt)
(les phrases en italiques sont extraites du livre)
La religion est essentiellement conformiste, plus préoccupée de piété et de morale, plus orientée vers le
sacré que vers l'humain, et en fin de compte plus soucieuse des fins éternelles de l'homme et insuffisamment
de ses fins temporelles et terrestres.
La foi chrétienne est d'une tout autre nature : elle est d’abord « appel à la liberté, à s'affranchir de l'opinion
publique, des mœurs et coutumes de la société et du temps où on vit et, souvent, des traditions familiales ».
Cette foi, contrairement à la religion, se situe clairement du côté de l'humain en ne cessant d'inventer de
nouvelles manières de prendre soin de tout l'homme et de tout homme, cherchant sans discontinuer
comment atteindre une universalité toujours plus grande.
La vie de Jésus à travers le nouveau Testament
La figure de Marie est fondatrice de la libération de la femme en particulier et des croyants en général à
l’égard des servitudes et contraintes dans lesquelles la société et la religion tendent à les enfermer ; Jésus
a repris dans sa prédication les accents "révolutionnaires" du cantique (Magnificat) de sa mère, même s’il a
pris ses distances avec elle, prisonnière du clan car ses frères ne croyaient pas en lui et le traitaient de fou.
Sans conflit avec elle, il ne pouvait cependant pas la couper du soutien familial…
Matthieu tient à assurer le peuple juif que Jésus est envoyé pour "sauver le peuple de ses péchés" au titre
de ses "origines : fils de David
1
, fils d’Abraham" proclamées dès les premiers mots et attestées par sa
généalogie. L’objectif de Luc est le même puisqu’il fait dire à Marie par l’ange Gabriel, qui lui annonce la
naissance d’un fils : "le seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père ; il règnera pour toujours sur la
famille de Jacob". Luc est universaliste car il remonte la généalogie jusqu’à "Seth, fils d’Adam, fils de Dieu"
et Matthieu nous informe, en présage de la conversion des païens que des savants avaient été avertis de la
naissance d’un "roi des Juifs" et que Jésus échappa au massacre en se réfugiant en Égypte d’où Dieu le fit
revenir comme le patriarche Joseph.
Le Prologue de Jean montre le Logos
2
« près de Dieu » et non « tourné vers Dieu » car il est tourné vers
l’homme, vers son avenir de Christ, vers nous.
La passion de Jésus n’est pas imputable aux désobéissances de l’homme qu’elle viendrait réparer ; elle n’est
pas définie comme une œuvre de rachat, mais de création. Cette vision de la passion comme un acte
constructif voue le chrétien à poursuivre l’œuvre du Christ : achever cette création
3
, la remettre dans son vrai
sens et unir tous les peuples dans un esprit de fraternité.
Alors que la mission des Douze est de faire des disciples, la dernière volonté de Jésus de confier
mutuellement Jean et sa mère accrédite celui-ci comme son représentant authentique et son porte-parole :
puisque sa mère est devenue la sienne, il peut se présenter comme un autre Jésus et aucune communauté
ne peut contester son autorité.
La distinction sociologique entre autorité et pouvoir a permis aux exégètes de traduire autrement "tout pouvoir
vient de Dieu" (Rm13,2) : elle autorise la désobéissance aux lois de l’État sans entraîner le rejet du pouvoir
en place
4
.
Le « ministère de la réconciliation » (2 Co 5,17–18) incombe à tous ceux que Dieu a réconciliés avec lui. Il
ne consiste pas dans des actes de religion puisque Paul affirme que le Christ « a aboli la loi et ses
commandements avec leurs observances (pour) ainsi créer en lui, à partir du juif et du païen, un seul homme
1
Alors que Jésus ne s’est jamais réclamé de l’héritage de David ni intéressé à restaurer son trône (JM)
2
Nom choisi par Jean pour l’introduire dans le monde grec "éclairé", rétif aux légendes des fils de Dieu, qui était le seul à s’ouvrir à l’évangile
après le refus des Juifs (JM)
3
Offrir le pouvoir d’échapper à la finitude (JM)
4
Cela fait écho à la distance prise par J Ellul avec l’interprétation légaliste de l’Institution ecclésiale (bb)

nouveau » (Ep 2,15)
L’esprit de Dieu
Au début des Actes des apôtres, Luc décrit la venue de l’Esprit Saint par une scène grandiose, réplique de
la terrifiante révélation de Dieu au peuple hébreu sur le Sinaï.
Jésus comptait sur l’Esprit, qu’il désignait comme "l’autre Paraclet" (Jn14,16) pour regrouper ses disciples
atterrés par sa condamnation et dispersés par sa mort, les consoler, les relever, les regrouper, leur rendre
confiance en lui et les remettre en marche pour conduire sa mission à son terme. C’est pourquoi je préfère
parler d’une "émergence" plutôt que d’une "descente glorieuse" depuis les hauteurs du ciel.
Ce que le dogme nomme l’incarnation, soit l’habitation de Dieu en Jésus, ne s’achève pas à sa mort, mais à
la communication aux humains de l’Esprit de Jésus, qui est le vrai sens et la vraie finalité de l’incarnation, et
qui s’effectue par la résurrection de Jésus.
Le Salut a deux faces : la victoire sur la mort remportée par Jésus et le fruit de vie que la foi produit dans
l’humanité en œuvrant à l’expulsion de la haine et à la réconciliation des hommes entre eux.
C’est pourquoi son annonce par les apôtres n’a pas fait appel aux mythes de l’Institution ecclésiale depuis
qu’elle s’est mise en remorque du judaïsme : un descendant royal tombé du ciel dans le ventre d’une vierge ;
un fils éternel de Dieu incarné pour expier l’injure faite à son Père depuis la nuit des temps ; l’eucharistie un
sacrifice rappelant aux hommes leur dette envers Dieu et la menace qui pèse sur eux.
Tout est vrai dans le Salut annoncé par les apôtres : Jésus est un vrai homme tiré de l’histoire par un père
et une mère et passé de la mort à la vie en Dieu pour que nous puissions être à notre tour adoptés en lui par
Dieu ; le Salut est la vraie salutation de Dieu aux hommes et le bonheur qu’ils se souhaitent et se donnent
mutuellement en se réconciliant entre eux ; la victoire de Jésus sur la mort est pour tous les hommes, même
non chrétiens, la voie d’accès à la vie éternelle ; l’eucharistie, exempte de toute inquiétude et menace,
exprime notre gratitude envers Jésus pour avoir ouvert la maison de Dieu à tous ceux qui reçoivent les autres
à leur table.
Aujourd’hui comme hier, la foi chrétienne énonce son identité en affirmant que Jésus est le Christ, c’est-à-
dire la révélation de l’esprit de Dieu se découvrant à l’esprit de l’homme comme la vérité dont il est l’image.
C’est pourquoi la foi refuse de se reconnaître dans l’irrationnel d’une lointaine tradition qui s’imposerait à elle
autant par sa longévité que par son incompréhensibilité appelée « mystère ».
L’Esprit de Dieu n’incite pas les humains à obéir aux préceptes de Dieu, à l’honorer, à chanter ses louanges,
à lui offrir des dons, bref, à pratiquer une religion, mais à traiter les autres humains comme leurs frères,
surtout s’ils sont faibles et dans le besoin.
Le Saint Esprit, remarquait saint Augustin au Ve siècle, n’a rien en « propre », il est et il n’a que ce qui est «
commun » au Père et au Fils puisque chacun d’eux est Saint et Esprit, et il se désolait de ne pas savoir dire
ce qu’est son origine appelée « procession », ni ce qui la différencie d’une génération. Plaignons les pauvres
théologiens mis au défi d’expliquer en quoi le Saint Esprit « complète la Trinité » comme les Pères aimaient
le dire, sinon qu’il faut bien un 3e pour faire 3…
L’évangile de Jean dit que Jésus était depuis sa naissance et est devenu Fils de Dieu par sa résurrection en
deux sens différents : il l’était en tant qu’homme envoyé de Dieu pour annoncer au monde le projet salutaire
de Dieu, et il l’est devenu par sa victoire sur la mort comme vivant en Dieu de la vie éternelle de Dieu vers
qui il attire la multitude des hommes par le don de son Esprit.
Les premiers chrétiens
Alors que les prêtres juifs approchaient de Dieu quand ils lui présentaient les offrandes des fidèles, les
chrétiens vivaient réellement en sa présence et lui rendaient un culte spirituel, "s’offrant eux-mêmes en
sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu" (Rm12,1). C’est pourquoi ils parlaient d’"eucharistie" (louange de
grâce), remerciement adressé à Dieu qui leur donnait de se présenter devant lui comme des fils sortis de
tutelle et libérés de la "surveillance" de la Loi (Ga4,1à7).
Ces chrétiens avaient reçu la consécration la plus haute qui soit, non de main d’hommes, mais de l’Esprit

Saint lui-même, qui avait fait d’eux à la fois le temple, le ministre et la victime qui s’offrait. Ils n’avaient donc
nul besoin d’un intermédiaire sacerdotal.
Le passage de la religion, juive ou païenne, à la foi chrétienne se faisait sous le mode d’un contrat social,
d’une nouvelle alliance des hommes entre eux et avec Dieu, et de l’émergence du sujet humain, revendiquant
dans la société la liberté que Dieu lui reconnaissait à son égard.
Le mot "religion", en passant du judaïsme ou du paganisme au christianisme, ne signifia plus "relecture et
reconduction" (relegere) d’un rite ou d’un rituel légué par la tradition, mais l’acte de "se relier" (religare) par
le lien spirituel de la foi et de l’amour.
Plaçant l’intériorité de la foi au-dessus des pratiques publiques et obligatoires des religions, le christianisme
autorisait les sociétés politiques à "se séculariser"
5
…
Au IIe siècle, où le concept de sacrement n’avait pas été élaboré, les écrivains chrétiens étaient unanimes à
célébrer la liberté d’esprit qu’ils devaient au christianisme qui les a affranchis des liens soumettant les
hommes aux lois, coutumes, contraintes et services de la famille, société, cité, État et fait d’eux « l’âme du
monde » et « des citoyens de l’univers », aptes à guider l’humanité vers la perfection que Dieu lui destine.
Les communautés chrétiennes étaient anarchiques au sens où elles n’étaient liées à aucune société
naturelle, politique ou religieuse. Pour éviter de passer, au regard de la loi romaine, pour une « secte », elles
préféraient se définir de manière philosophique comme « l’école du Logos », de la vraie rationalité ou du
discours de Sagesse. Le débat intellectuel tenait une bonne place dans leurs réunions, auxquelles
participaient aussi des païens. Ces « groupes de parole », fonctionnant depuis les apôtres, définissaient un
type d’Église et de vie chrétienne qui relevait authentiquement de l’évangile.
L’hérésie gnostique
Le marcionisme associait le dieu mauvais (ou au moins imparfait et limité) au dieu créateur de l'ancien
Testament et le dieu bon au Christ. Dans la seconde moitié du IIe siècle, quand la "gnose" a submergé les
pourtours de la Méditerranée, les chrétiens n’ont pas accepté que "ce nouveau dieu » ait attendu si
longtemps et abandonné à la mort éternelle les humains des temps antérieurs. Néanmoins, le besoin de
définir une "règle de foi en Dieu le Père tout-puissant", créateur de l’univers, donna naissance au Credo-
symbole-des-apôtres
6
.
Le nom de « Père tout-puissant » était réservé chez les Grecs au Dieu suprême des païens, Zeus, « père
des dieux et des hommes », bien avant qu’il ne fût attribué à YHWH dans la bible hébraïque. Avec Jésus,
Dieu n’est plus vu en tant que juge et maître tout-puissant des hommes dont il est le créateur, mais comme
Sauveur et dispensateur de la vie éternelle au bénéfice de tous les hommes qu’il aime comme ses enfants.
On change de monde, de réalités, de temps, d’espace, et aussi d’Alliance
7
: Jésus a dévoilé de quelle façon
le Père est « tout-puissant » dans le crucifié sortant et nous faisant sortir avec lui du séjour des morts.
L’Institution ecclésiale
À la fin du IIe siècle, elle tira argument de la constance des apôtres et de certains évangélistes à se réclamer
du Dieu de la Bible et à la citer en toute occasion pour ériger l’unité des deux Testaments en règle de la foi
chrétienne. L’Institution ecclésiale inscrivit alors dans ses archives les livres de l’AT et ceux du NT qui
consonnaient avec l’AT ; la peur de la nouveauté fut à l’origine de l’orthodoxie
8
, qui ramena la "juste pensée"
de la foi à ses plus anciennes attestations.
Il en est résulté un assujettissement du nouveau Testament à l’ancien, au détriment d’une conception juste
du salut apporté par Jésus. C’était pourtant l’arrière-fond des débats entre Jésus et "les Juifs" (ses
contradicteurs dans l’évangile de Jean) et l’objet constant des discussions entre Paul et ses adversaires
pharisiens ou chrétiens judaïsants. L’évangile fut donc inféodé à l’ancienne Loi.
5
« Le christianisme est la religion de la sortie de la religion » (Marcel Gauchet)
6
Insuffisant pour authentifier la foi chrétienne car il y manque la visée du salut universel, fondée sur la fraternité humaine. (JM)
7
La Loi de Moïse passait sous silence l’universalité de la révélation divine et du Salut de l’humanité entière (JM)
8
Autorité religieuse qui impose ce qu’il faut croire et en quels termes (JM)

Avant l’arrivée à Rome du 1er évêque consacré au début du IIIe siècle, le 1er prêtre - Hippolyte de Rome,
évêque intrigant et anti-pape – établit un culte liturgique, sépara les clercs des laïcs, réduisit au silence les
ministres de la parole connus par les lettres de Paul, fit dresser un autel dans les églises, en réserva l’accès
au clergé et transforma le repas eucharistique en messe à laquelle les fidèles répondaient amen quand ils y
étaient invités par l’évêque…
Le christianisme a donc subi un double tournant, religieux et sacrificiel, le second se produisant dans le
sillage du premier. Il s’installa en tant que « culte et communauté » pour honorer et adorer Dieu et s’organise
en tant qu’institution sociale à finalité cultuelle disposant d’une hiérarchie
9
capable d’uniformiser et de se
faire respecter par un État à la mesure des services qu’elle lui rendait. Le « jour du Seigneur » devint un
sacrifice d’expiation et de réparation pour les péchés. Ce changement d’ère fit passer le christianisme d’un
climat marqué par la liberté et la joie
10
vers un autre, où dominait le tragique et la peur
11
. L’engagement à
marcher avec Jésus fut remplacé par le rite de l’immersion baptismale et le repas fraternel en souvenir du
Christ par la formule de consécration de l’eucharistie sur un autel.
La différence visible entre judaïsme et christianisme, qui se situait sur le plan de la foi, se trouva dorénavant
réduite à des rites distincts.
Le christianisme
La résistance constante des laïcs a permis au christianisme de "sortir de la religion" parce qu’il ne vise pas
dominer la société par la religion mais émancipe l’homme, reconnu fils de Dieu, de toute forme de servitude.
Il affronte aussi bien la religion que la société laïque, l’une comme l’autre désireuses de soumettre l’individu
à sa domination exclusive. Dans cette lutte pour la reconnaissance de sa liberté, le chrétien est porteur de
la dignité du sujet humain et l’oppose à toute oppression émanant de la société en général et, d’abord, de la
société politique que l’histoire montre unie depuis toujours à la religion pour réprimer les explosions de
l’individualisme.
L’humanisme évangélique, qui est l’esprit du christianisme, s’est ainsi répandu dans le monde occidental
bien avant que les hommes de la Renaissance ne mettent au goût du jour les « humanités », dont la culture
s’est vite définie comme un humanisme. Devenu philosophique et perdant le sens de Dieu, il glissa vers
l’individualisme et, de nos jours, vers l’antihumanisme encourageant un petit nombre d’individus, plus
puissants et plus riches, à l’emporter sur la masse des faibles et des miséreux, et peut-être à les éliminer au
profit de ceux sur lesquels on grefferait des prothèses et des puces pour les gonfler d’intelligence numérique
jusqu’à les élever – en réponse à l’idéal chrétien de divinisation - à la dignité de robots…
Quand on évoque l’accroissement de la déchristianisation de la société, ce n’est pas à la diminution des
pratiques religieuses qu’il faudrait faire référence, mais à la perte du sens de la fraternité !
Faire Église autrement
Une Église désencombrée du conformisme qui voile son visage évangélique, davantage immergée dans le
monde pour lui communiquer la Bonne Nouvelle, à l’écoute de l’Esprit qui gémit dans la création (Rm8,23).
L’évangile doit être annoncé par des laïcs émancipés de l’ordre sacré, afin d’être écoutés par un monde sorti
de toute religion, mais demeurés en lien avec l’Église universelle (les autres chrétiens), pour montrer que
son appel émane du Christ dont elle est le corps. Les fidèles désireux de parler au monde se réuniront dans
des lieux non affectés au culte, où ils pourront accueillir des personnes d’autres religions ou qui ont rompu
tout lien religieux. Ils s’entretiendront avec elles des problèmes de la vie courante des uns et des autres et
de leur environnement, à la lumière de l’évangile, et partageront un repas fraternel. Cela n’empêchera pas
9
Présidence de chaque communauté par un évêque (episkopos = inspecteur, surveillant), consacré par un rite similaire aux pontifes juifs,
institution de prêtres ordonnés par l’évêque qui participent à son sacerdoce et exclusion des laïcs de tout office cultuel. (JM)
Les clercs s’installent alors que Jésus avait envoyé ses apôtres « dans le monde entier » et, malgré cela, les évêques revendiquent d’être
détenteurs de la succession apostolique ! (bb)
10
Malgré les persécutions (bb)
11
Le vrai responsable de la peur qui étreint les hommes est la religion (JM) car « l’homme a préféré se soumettre aux dieux que d’assumer seul
la responsabilité de son destin » (Marcel Gauchet)

ces laïcs de participer aussi, au rythme qu’ils voudront, à la messe fréquentée par les autres fidèles, pour
entretenir leur lien avec l’Institution ecclésiale.
L’avenir n’appartient plus aux religions, qu’elles soient chrétienne ou autres, car le déclin dont souffre la nôtre
les menace pareillement ; les soubresauts actuels de l’islam ont pour explication probable la sensation qu’il
a de perdre son pouvoir sur les populations qui commencent à ne plus le supporter, comme cela s’est passé
pour le christianisme en Occident
12
Synthèse (bb)
Deux siècles durant, les chrétiens ont vécu le Royaume de l’amour sur Terre, mais l’Institution ecclésiale a
déporté leur regard vers le Ciel, en leur promettant le renouement des liens humains pour une éternité de
bonheur après la mort, en les exhortant à supporter de souffrir ici-bas, afin de ne pas expier leurs péchés
plus tard.
Le message de Jésus était centré sur la liberté de la personne humaine et l’amour mutuel, tandis que
l’Institution ecclésiale a édicté des dogmes, des obligations et des interdits.
La religion chrétienne est structurellement incapable d’accueillir les multitudes auxquelles elle est censée
s’ouvrir ; sa révélation du Dieu fait homme est devenue inintelligible dans les régions mêmes où elle s’était
longuement implantée ; son annonce du Salut "à venir"
13
rebute les « post-modernes » plus qu’elle ne les
séduit.
Nous devons revenir au message-même de Jésus pour désaliéner l’annonce du Salut et rappeler qu’il enjoint
à ses disciples de partager les espoirs temporels de tous leurs frères humains et de prendre en charge avec
eux leur avenir sur Terre. Notre mission n’est pas d’attirer le monde mais d’aller à lui. Conscients que
l’annonce de la Bonne Nouvelle par l’Institution ecclésiale n’est plus audible dans le monde contemporain
marqué par le rationalisme
14
, nous devons remanier cette annonce et adopter un comportement proche des
petites communautés des deux premiers siècles : fraternité concrète, entraide amicale, ouverture universelle
(à toutes les religions, aux sans-religion et aux agnostiques) et présenter simplement les conditions du Salut :
amour et liberté !
Il faut évidemment profiter de la crise actuelle de l’Institution ecclésiale pour investir le terrain qui se
« désertifie » rapidement…
12
La particularité des USA est d’être une théocratie du pognon (bb)
13
Alors que « le salut de ce monde a déjà été effectué par Jésus jusqu’à la fin des temps » (Joseph Moingt)
14
« L’esprit ne peut être forcé de croire ce qu’il sait être faux : si on choque les principes de la raison, notre religion sera absurde et ridicule »
(Pascal)
1
/
5
100%