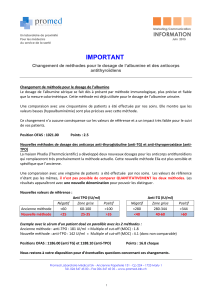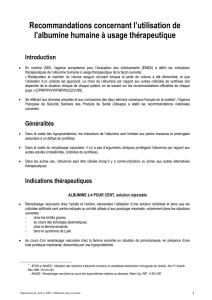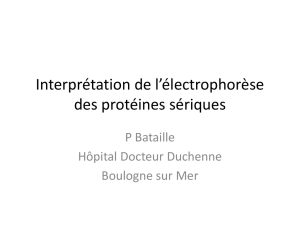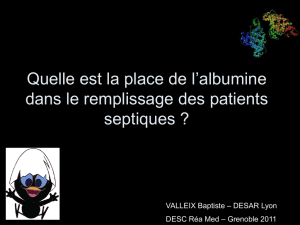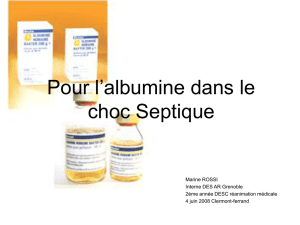Albumine et albuminémie : structure, fonctions et métabolisme
Telechargé par
semanekawther

1- Albumine et albuminémie : Notions générales
A. Les protéines représentent la plus grande partie des matières solides du plasma. En
dehors du fibrinogène, protéine fibreuse, ce sont toutes des protéines globulaires. Seule la
sérum-albumine est une holoprotéine, Elle joue un rôle essentiel dans le maintien de la
pression oncotique intravasculaire et dans le transport de nombreuses substances endogènes
et exogènes. Sa synthèse exclusivement hépatique se fait à un taux élevé. La pression
oncotique est un paramètre majeur de la régulation de sa production. toutes les autres étant
des hétéroprotéines pouvant contenir des lipides (lipoprotéines), des métaux
(métalloprotéines) et surtout des glucides, la plupart des protéines plasmatiques sont en effet
des glycoprotéines.
Leurs propriétés sont très variables : transporteurs, anticorps, enzymes, agents de pression
oncotique, marqueurs de l'inflammation, marqueurs tumoraux, agents de la coagulation,
facteurs de croissance, etc...
B.A l'intérieur du pool des protéines plasmatiques, l’albumine occupe
quantitativement et qualitativement une place prépondérante de 55 à 60% de la
protéinémie. Ses propriétés essentielles étaient déjà reconnues depuis 1837
lorsqu’ANCELL observa que l’albumine sérique humaine, était requise pour des
fonctions de transport, pour le maintien de la fluidité du système vasculaire et pour la
prévention de l'œdème. Des études ultérieures ont effectivement confirmées ces
informations (ROCHU, 1986 ; VALDIGUIE, 2000). comparaison alb.pdf
REMARQUE : en veut choisir entre A ET B
Définition :
La présence d’albumine (de albus : blanc, couleur que prennent les albumines quand
elles coagulent) dans le sang et la lymphe est connue depuis l’antiquité. Elle est la protéine la
plus abondante du plasma . Sa synthèse est sous le contrôle d’un unique gène (ALB,
chromosome 4). Sous sa forme mature, c’est une protéine de 585 acides aminés (Poids
moléculaire : 66 KDa) dont la synthèse est principalement hépatique (12-15 g/j) ) qui est
équilibre avec son élimination qui se fait au niveau musculaire, cutané, hépatique et rénal à

raison de 15g/j. En condition physiologique, la perte digestive n’excède pas 1 g/j. La durée de
vie de l’albumine va de 20 à30 jours. La particularité fonctionnelle principale de l’albumine
est qu’elle joue un vrai rôle d’ « éponge » pour petites molécules chargées ou hydrophobes.
L’albuminome (ou ensemble des molécules transportées par l’albumine) est riche, complexe
et va se trouver modifié dans les différentes situations pathologiques.
Structure :
La structure de l’albumine permet d’expliquer ses fonctions multiples et son rôle dans
l’organisme.
Cette structure est identique chez tous les individus de l’espèce humaine. Il s’agit d’une
protéine de 585 acides aminés en forme de « coeur», constituée de 3 domaines homologues
divisés en 9 boucles (sous domaines) dont la stabilité est assurée par les 17 ponts disulfures
(8, 9) (Figure 1).
Son poids moléculaire est de 66 KDa.
Figure 1 : Structure tridimensionnelle de l’albumine avec ses 3 domaines et ses ponts
disulfures.

Chez l’Homme, l’albumine est présente sous trois formes principales dont la répartition varie
en
fonction de l’équilibre redox (Figure 2):
– la mercaptalbumine (HMA), forme réduite de l’albumine possédant un groupe thiol libre en
cystéine-34, il s’agit de la forme prédominante (70 %)
– la non-mercaptalbumine-1 (HNA1), caractérisée par la présence d’une cystéine, d’une
homocystéine ou d’un glutathion liés par un lien disulfide ;
– la non-mercaptalbumine-2 (HNA2), dotée d’un radical cystéine oxydé par un acide
sulfinique ou sulfonique .
Figure 2 : Les principales formes de l’albumine.
Propriétés physico-chimiques de l’albumine :
Lorsqu'elle est dépourvue de tout ligand, l’albumine est une protéine incolore portant 198
résidus chargés, ce qui d’un côté lui confère une hydrophilie importante (ROCHU, 1986).
D’un autre côté, ces résidus ne sont pas également proportionnés en fonctions acides (98 Glu
+ Asp) et basiques (83 Lys + Arg) ce qui procure à cette protéine une charge nette négative
de -15 à pH physiologique.

La concentration plasmatique de l’albumine varie entre 35 et 50 g/l.
Son pH isoélectrique est acide, mais dans la mesure où l’albumine a la capacité de se lier à
plusieurs molécules, il est difficile de donner une valeur exacte, il varie de 4,8 à 5,28 en
fonction de la nature des molécules .
L'albumine change de manière réversible dans des conditions dans lesquelles de nombreuses
protéines sont dénaturées. L’agrégation par chauffage offre un autre exemple de l'adaptabilité
de cette molécule. Lorsqu’elle est portée à 60°C à pH 7, la plupart de l'albumine s'agrège et
précipite. La fraction qui reste soluble est stable au chauffage jusqu'à 78°C ou plus .
Métabolisme : Interet-de-lutilisation-dalbumine-2015.pdf
Synthèse de l’albumine :
Le mécanisme de synthèse est commun à toutes les protéines chez les eucaryotes. Au niveau
du noyau la séquence d'ARN est transcrite en une séquence équivalente d'ARNm. C'est cette
dernière qui est traduite dans le cytosol au niveau des ribosomes. Des ARNt y apportent les
acides aminés et les disposent dans l'ordre défini par le message, où chaque triplet de
nucléotides de l'ARNm correspond à un acide aminé précis.
Les molécules d'albumine synthétisées au niveau des ribosomes fixés au réticulum
endoplasmique sont destinées à être exportées. Initialement sous la forme de préoproprotéine
au niveau du ribosome, elles perdent leur peptide signal lors de leur passage dans les citernes
du réticulum. Elles perdent également un hexapeptide au niveau de leur extrémité N-
terminale avant d'être excrétée par l'hépatocyte.
Les molécules d'albumine synthétisées au niveau des ribosomes libres dans le cytosol
sont directement utilisées par l'hépatocyte(13).
Dégradation :
. Sa dégradation est importante, notamment par rapport aux autres protéines plasmatiques.
Elle représente par exemple chez l'Homme 4% du taux total en albumine par jour. Elle est
cependant compensée par sa haute concentration plasmatique.
Le catabolisme de l'albumine a lieu dans la plupart des organes. Il est montré que 40 à 60%
de la dégradation était d'origine musculaire et dermatologique, moins de 15% était d'origine
hépatique, environ 10% était d'origine rénale, et que 10% était d'origine intestinale(14).

Des études ont montré que dans des situations où le passage de l'albumine à travers les
réseaux capillaires était important, on observait une augmentation de son catabolisme. Les
cellules endothéliales semblent être responsables de la dégradation de l'albumine(15).
La dégradation d'une protéine se fait essentiellement par le système lysosomal: les
cathepsines (protéases actives en milieu acide) sont localisées dans les vésicules lysosomales
qui incorporent par endocytose les protéines à dégrader. Pour l'albumine c'est le système
lysosomal des cellules endothéliales qui entre en jeu. Ceci implique la présence de récepteurs
membranaires à l'albumine. Ce sont les molécules gp18 et gp30 qui ont la capacité de fixer
l'albumine altérée ou modifiée par la fixation d'un ligand (15).
La fixation d'un ligand à l'albumine entraîne sa dégradation, l'albumine se fixant à gp18 et
gp30. Cependant certains composés semblent à l'inverse protéger l'albumine de sa
dégradation. Par exemple la fixation d'acides gars à longue chaîne diminue le
catabolisme(13).
Distribution :
L'albuminémie est en fonction du taux de synthèse et de dégradation de l'albumine, mais
aussi de sa distribution entre le milieu intravasculaire et extravasculaire. Chez l'Homme le
milieu intravasculaire contient environ 40% de l'albumine totale, et le milieu extravasculaire
environ 60%.
Le milieu extravasculaire est formé de deux compartiments. Le premier est composé des
tissus à capillaires sanguins discontinus: fenestrés (villosités de l'intestin grêle, glomérules
rénaux, glandes endocrines) ou sinusoïdes (foie, rate, os). Il a le temps de distribution de
l'albumine le plus rapide. Le deuxième compartiment est composé des tissus à capillaires
continus (muscles lisses et squelettiques, peau). La distribution de l'albumine y est plus
longue(15).
Tableau 1: Distribution de l'albumine dans les différents
organes extravasculaires
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
1
/
10
100%