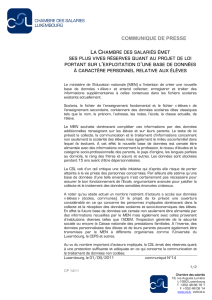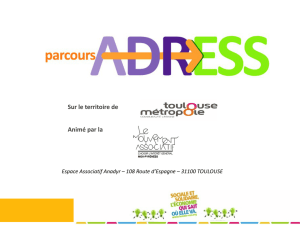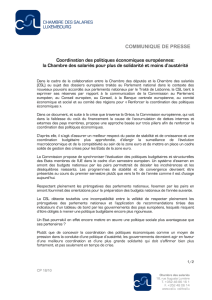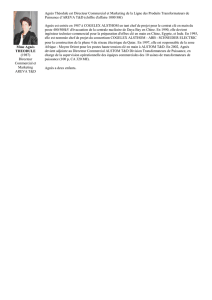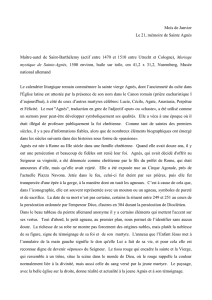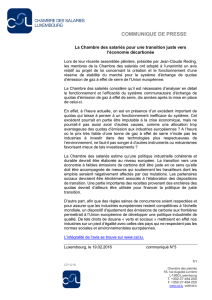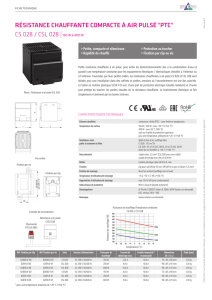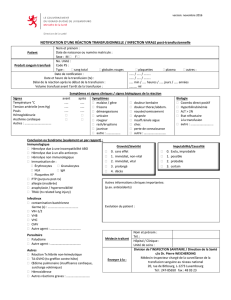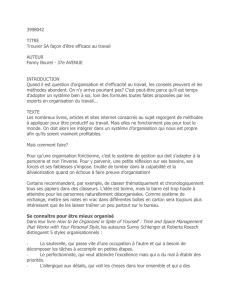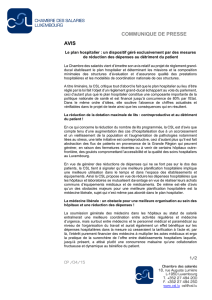Vers une cartographie intégrée des risques
organisationnels : application à la
transfusion hospitalière
Agnès Bernard
1
, Christian Delvosalle
2
, Lahcen El Hiki
3
, France
T’Sas
4
, Agnès Van Daele
5
1
Hôpital Militaire Reine Astrid, Direction, Cellule Qualité. Rue Bruyn, 1120
Bruxelles (Belgique). [email protected]
2
Service de Génie de Procédés Chimiques (Pôle Risques), Faculté Polytechnique
Université de Mons. Rue de l’Epargne, 56, 7000-Mons (Belgique)
christian.delvosalle@umons.ac.be
3
Pôle Risques, Faculté Polytechnique, Université de Mons. Rue du Joncquois, 53,
7000-Mons (Belgique). lahcen.elhiki@umons.ac.be
4
Hôpital Militaire Reine Astrid, Service Militaire de Transfusion Sanguine. Rue
Bruyn, 1120 Bruxelles (Belgique). [email protected]
5
Service de psychologie de travail, Faculté de Psychologie et des Sciences de
l’Education, Université de Mons. Place du Parc, 18B, 7000-Mons (Belgique).
Agnes.v[email protected]
RÉSUMÉ
.
Ces dernières années, la sécurité des patients est devenue une préoccupation
mondiale notamment à partir des programmes 2005 de l’OMS. Dans le domaine
transfusionnel, la sécurité du donneur et celle du patient receveur demeure au cœur
des préoccupations et ce, tout au long du circuit des Composants Sanguins Labiles
(CSL). L’approche réticulaire adoptée, comme cadre d’analyse, dans le cas de ce
projet nous a permis d’une part, de cartographier les flux physiques, informationnels
et décisionnels entretenus au niveau des interactions entre les agents du circuit
hospitalier des CSL. D’autre part, d’identifier et de modéliser les barrières de
sécurité au sein de ce réseau. Afin de constituer un système de vigilance dynamique
et hybride, ce modèle de cartographie des risques organisationnels pourrait à terme
être couplé à HERMES
©
, système de gestion des non-conformités en cours de
développement à l’Hôpital Militaire. Enfin, l’approche réticulaire présentée ici
pourrait faire l’objet d’analyse de vulnérabilité du réseau en cas d’aléas liés aux
dysfonctionnements d’un agent, d’une barrière de sécurité ou de la coordination
organisationnelle.
MOTS-CLÉS
: risques organisationnels, non-conformité, transfusion, réseau, vulnérabilité,
barrière de sécurité, HERMES©

Agnès Bernard, Christian Delvosalle, Lahcen El Hiki, France T’Sas, Agnès Van Daele
2
1. Introduction
A l’heure où l’accroissement d’accidents iatrogènes préoccupe bon nombre de
décideurs hospitaliers, force est de constater que les organisations hospitalières
deviennent le siège de nombreux facteurs de risques liés à la multiplication des
défaillances d’origines cliniques, humaines ou organisationnelles.
Face à des systèmes de production de soins de santé de plus en plus complexes,
l’omniprésence des facteurs de risques demeure une évidence. A cet égard, il
est
devenu crucial pour les gestionnaires hospitalier de disposer de méthodes
scientifiques leurs permettant d’identifier a priori ces facteurs de risques et in fine,
de promouvoir une culture préventive de management de risques.
Dans cette perspective, les années 2000 ont vu se développer dans les organisations
hospitalières une panoplie de méthodes et outils de gestion des risques. Oscillant
entre les vigilances à visée réglementaire (pharmacovigilance, hémovigilance,
matériovigilance…) et les spécificités inhérentes à la technicité de soins (sur le plan
diagnostique et thérapeutique), ces méthodes tendent actuellement à se nuancer en
intégrant le cadre complexe et turbulent dans lequel évolue l’organisation de ces
soins.
Etant donné la complexité organisationnelle des hôpitaux et son implication
manifeste dans les accidents iatrogènes, la prise en compte de la dimension
organisationnelle dans les démarches d’analyse de ces accidents est en plein essor.
D’ailleurs, les multiples publications récentes en cette matière en sont l’illustration
parfaite (Lassale et al., 2008) ; (Roussel et al.,2009). Dans ce sens, les auteurs
s’appuient sur les modèles développés en industrie dont notamment ceux de (Weick,
1993) ; (Turner et al., 1997) ; (Reason, 1997) ; (OCDE, 1999) ; (Hollnagel, 2004) ;
(Dien, 2006), (ESReDa, 2009). Bien que ces auteurs confirment l’implication des
facteurs organisationnels dans l’occurrence des défaillances, force est de constater
que d’autres facteurs liés aux interactions entre Agents et les flux échangés entre eux
sont négligés. Et comme le souligne ESREDA
1
(2009), la dimension interactionniste
présente d’importantes perspectives en matière de gestion des risques
organisationnels.
Après avoir relevé les spécificités organisationnelles hospitalières en privilégiant la
dimension réticulaire, nous allons proposer une méthodologie dédiée à la
cartographie des risques organisationnels dans les institutions de soins de santé. Il
s’agit d’une approche qui intègre les interactions (flux d’information, physique et
décisionnel) entre les agents (acteur, entités, processus…) d’un réseau régit par des
modes de coordination distribués. Notre ambition est de jeter de nouvelles bases
conceptuelles de la dynamique du risque (vulnérabilité et propagation) dans une
configuration organisationnelle réticulaire.
1
European Safety, Reliability and Data Association

3
Vers une cartographie intégrée des risques organisationnels
2. Configuration organisationnelle hospitalière
Lorsque Magritte intitule un de ses tableaux « ceci n’est pas une pipe », il suscite
la réflexion évidente que l’image n’est pas l’objet. En effet, un organigramme n’est
pas une organisation et ne représente donc pas la complexité du système-
organisation : se limiter à l’aspect structurel de l’organisation en occulte sa
dimension dynamique (Delvosalle, 2007). Et à l’instar de toute action collective
finalisée, l’hôpital se caractérise par un ensemble complexe d’activités dont la
configuration organisationnelle peut être modélisée à l’aide de trois grandes
approches complémentaires : l’approche structuro-fonctionnaliste de Mintzberg,
l’approche systémique et l’approche réticulaire.
2.1. L’approche structuro-fonctionnaliste de Mintzberg
A la lumière de l’approche de Mintzberg (1990), Blaise (2004) considère, dans
une logique structurelle, l’organisation hospitalière comme une bureaucratie
professionnelle et y relève les caractéristiques suivantes :
-Un sommet stratégique bicéphale (médical et gestionnaire) constituant
l’interface entre le Centre opérationnel (les professionnels de la santé) et les parties
prenantes externes (autorités) ;
Une ligne hiérarchique quasi inexistante ;
Une technostructure marginale ;
Une fonction de support logistique bien développée dont la mission est
de servir le centre opérationnel ;
Un centre opérationnel cloisonné et composé de professionnels de la
santé qui contrôlent leur propre travail et privilégient leur contact
singulier avec leur patient.
Dans une perspective fonctionnelle, Glouberman et Mintzberg (2001) identifient
quatre mondes au sein de l’hôpital : celui de l’art de guérir, celui de l’art de soigner,
celui du management et enfin celui des autorités hospitalières. Ces mondes se
différencient de par leurs activités, leurs manières de fonctionner, leurs mentalités
irréconciliées et déconnectés les uns des autres. Dès lors, ils induisent une forme de
clivage (horizontal et vertical) de l’organisation hospitalière et qui nécessite une
approche intégrative du management qui s’y opère (El Hiki, 2008).
2.2. Approche systémique et complexité
Glouberman et Mintzberg (2001) considèrent l’hôpital comme étant l’un des
systèmes les plus complexes de notre société contemporaine. Cette complexité relève
de la diversité des composantes organisationnelles et des multiples interactions
qu’elles entretiennent. Dans ce sens et compte-tenu de l’approche de Meinadier

Agnès Bernard, Christian Delvosalle, Lahcen El Hiki, France T’Sas, Agnès Van Daele
4
(1998), l’organisation hospitalière demeure un système sociotechnique complexe
dont la prise en charge des patients repose sur l’implication d’un ensemble de
processus complexes où s'enchevêtrent une multitude d'activités faisant intervenir
dans le temps et dans l’espace plusieurs acteurs d’horizons différents, tenus de
coopérer ensemble en s’appuyant sur des plateaux techniques de plus en plus
sophistiqués (Romoyer et al., 2004). Ces processus, en perpétuelle interaction, se
répartissent en trois familles : les processus de management, les processus
transversaux qu’on apparente aux processus de soins, les processus de support tels le
laboratoire, le circuit du médicament, la radiologie… (El Hiki, 2009).
Contrairement aux processus industriels, Minvielle (2000) souligne que l’une des
caractéristiques fondamentales des processus hospitaliers est la variabilité du mode
de prise en charge de patient. Pour une même pathologie, certaines activités peuvent
être simples pour un patient, alors qu’elles peuvent être complexes pour un autre
patient. Et à chaque aléa, la prise en charge peut être revue ou modifiée et de
nombreuses itérations peuvent être nécessaires.
A la lumière de la théorie de la complexité (Morin, 2005), l’organisation hospitalière
peut être apparentée à un système sociotechnique complexe qui se caractérise d’une
part par un réseau d’unités régis par des interactions non linéaires et d’autre part, par
un comportement émergent a priori non prédictibles. C’est précisément ce caractère
non prédictible et variable des interactions entre ses composantes (acteurs,
service…) qui engendre le besoin de maîtrise des risques au sein des organisations
hospitalières.
2.3. L’approche réticulaire
De toute évidence, le fonctionnement hospitalier ne peut être appréhendé sans
prendre en considération les configurations réticulaires dans lequel il s’intègre
puisqu’actuellement, les hôpitaux sont amenés à externaliser certaines de leurs
activités, à développer des réseaux de soins et des réseaux inter-établissements.
A priori, le réseau peut être défini comme une logique d’organisation en privilégiant
davantage l’interaction sociale entre acteurs (Josserand, 2007) ou entre agents
(Schreiber et al., 2005). Ces interactions sociales furent largement étudiées en
sociologie au travers des réseaux sociaux considérés ici comme un ensemble de
personnes ou groupe de personnes (acteurs) interagissant entre eux (Newman et al.,
2002). Ces réseaux sociaux peuvent être modélisés à l’aide de la théorie des graphes
d’Euler permettant par exemple d’identifier la distribution des degrés d’interrelations
de chaque acteur et de déterminer, par simulation, la robustesse du réseau en cas de
disparition d’un acteur-clé.
Comme nous l’avons souligné, l’hôpital est une organisation servicielle dont les
prestations de soins sont caractérisées par une forte implication humaine (médicale
ou paramédicale). Etant donnée la variabilité inhérente à la prise en charge de

5
Vers une cartographie intégrée des risques organisationnels
patient, le taux d’interaction entre acteurs (professionnels, services) est très
significatif. Ainsi, autour de ces interactions se dessinent des structures de
coordinations de type réticulaire. De ce fait, il nous semble que la prise en
considération de cette dimension réticulaire de l’organisation hospitalière présente
de réelles perspectives en matière de cartographie des risques organisationnels.
3. Le risque organisationnel : émergence de la dimension "réseau"
3.1 Dimension organisationnelle du risque
Dans le secteur industriel (aviation, transport, nucléaire), le développement des
connaissances liées aux dynamiques incidentelles/accidentelles est lié aux différentes
analyses des accidents majeurs. A ce titre, Wilpert (1998) et Dufour (2008)
soulignent que l’évolution de ces connaissances s’est articulée sur trois grandes
approches majeures :
1. l’approche technique qui associe les causes de l’incident/accident à une
défaillance technique. On y trouve des outils relevant des méthodes
quantitatives ;
2. l’approche humaine : il s’agit d’une démarche fondée sur l’hypothèse que le
facteur humain en tant que maillon incontournable du système
sociotechnique, demeure générateur de défaillances et d’erreurs. Dans cette
approche, on trouve les concepts centrés sur l’acteur (Swan, 1983 ;
Rasmussen, 1983 ; Hollnagel, 1998) ou sur ses interactions avec les
éléments du système environnant (Rasmussen, 1986 ; Amalberti, 1996) ;
3. l’approche organisationnelle : c’est une approche qui considère
l’incident/l’accident dans une perspective systémique et le positionne dans
son environnement organisationnel, institutionnel voir contextuel. On y
trouve le concept de l’accident organisationnel (Reason, 1997), la résilience
organisationnelle (Weick, 1993), la théorie des Organisation Hautement
Fiable (Rochlin et al., 1987).
Au-delà des approches portant sur l’analyse de la causalité linéaire entre le scénario
et l’accident, les modèles actuels de gestion des risques organisationnels se penchent
d’avantage sur les variables/facteurs de l’organisation susceptibles de rendre
vulnérable ou de dégrader sa sécurité. Dans cette perspective, Reason (Reason,
1997) mentionne que dans un système sociotechnique doté de multiples barrières de
sécurité, tout accident suppose la concomitance des facteurs contributifs (latents et
patents) qu’il associe à la défaillance combinée de différentes barrières. Dans la
même lignée de concept, Dien (Dien, 2006) considère que la sécurité d’une
organisation est le résultat d’une perpétuelle tension entre les facteurs
organisationnel résilient (FOR) et les facteurs organisationnels pathogènes (FOP). Il
souligne que l’accident parvient lorsque les FOP dominent les FOR.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
1
/
20
100%