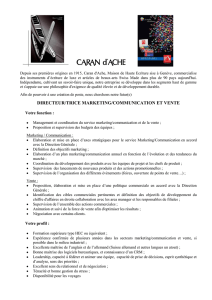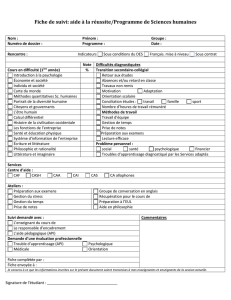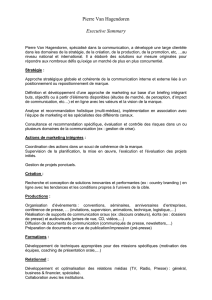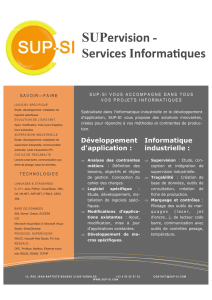REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAMEROON PAIX-TRAVAIL-PATRIE PEACE-WORK-FATHERLAND ******** ******* MINISTERE MINISTRY DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR OF HIGHER EDUCATION UNIVERSITE DE DOUALA DEVELOPPEMENT D’UNE APPLICATION MOBILE POUR LA SUPERVISION DU BALISAGE ET DES SYSTEMES ELECTRIQUES DE L’ASECNA : CAS DE L’AEROPORT INTERNATIONAL DE DOUALA KANKEU BEDOUEN DEPARTEMENT DE ROBOTIQUE INDUSTRIELLE FACULTE DE GENIE INDUSTRIEL MEMOIRE PRESENTE EN VUE DE L’OBTENTION DU DIPLOME D’INGENIEUR EN GENIE INDUSTRIEL (SPECIALITE ROBOTIQUE INDUSTRIELLE) (OPTION SYSTEMES INTELLIGENTS, VISION ET ROBOTIQUE) JANVIER 2019 UNIVERSITE DE DOUALA FACULTE DE GENIE INDUSTRIEL Ce mémoire intitulé : DEVELOPPEMENT D’UNE APPLICATION MOBILE POUR LA SUPERVISION DU BALISAGE ET DES SYSTEMES ELECTRIQUES DE L’ASECNA : CAS DE L’AEROPORT INTERNATIONAL DE DOUALA présenté par : KANKEU Bedouen en vue de l’obtention du diplôme de : Ingénieur en Génie Industriel a été dument Accepté par le jury d’examen constitué de : …………………………………………………………….. , Président M. TAWAMBA Lorince, Rapporteur et encadreur académique M. NOUMBO SOFACK Gervais, Membre et encadreur professionnel ……………………………………………………… , Membre interne DEVELOPPEMENT D’UNE APPLICATION MOBILE POUR LA SUPERVISION DU BILASAGE ET DES SYSTEMES ELECTRIQUES DE L’ASECNA : CAS DE L’AEROPORT INTERNTIONAL DE DOUALA DEDICACES A ma famille A mes amis Mémoire de fin d’étude rédigé par KANKEU Bedouen en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur en Génie Industriel III DEVELOPPEMENT D’UNE APPLICATION MOBILE POUR LA SUPERVISION DU BILASAGE ET DES SYSTEMES ELECTRIQUES DE L’ASECNA : CAS DE L’AEROPORT INTERNTIONAL DE DOUALA REMERCIEMENTS Je remercie tout d’abord Le Seigneur Jésus-Christ qui m’a donné chaque jour la force et l’inspiration nécessaires à l’exécution du présent travail. Ce dernier a été réalisé à l’unité Energie et Balisage de l’ASECNA à l’aéroport international de Douala. Son aboutissement est le fruit d’un apport conjugué de divers moyens matériels et compétences humaines. C’est donc très sincèrement que j’exprime ma profonde gratitude à toutes ces personnes ayant contribué à la réussite de ce projet. Il s’agit notamment de : Pr Robert NZENGWA, doyen de la faculté de génie industriel, pour nous avoir managés durant toute notre formation. Dr YEREMOU Aurélien, chef de département de Robotique industrielle, pour nous avoir bien managés lors de notre spécialisation. M. NOUMBO SOFACK Gervais, mon encadreur professionnel, pour sa disponibilité, ses remarques, et le partage de son expertise ; M. TAWAMBA Lorince, mon encadreur académique, pour sa disponibilité, ses directives et critiques constructives, et sa rigueur tout au long de ce travail ; M. KOMGUEM MAGNI Appolin, Le Représentant de l’ASECNA au Cameroun, pour l’opportunité qu’il m’a offerte en m’acceptant dans leurs locaux pour un stage de fin d’étude, ainsi que le suivi qui m’y a été accordé ; Le Corps enseignant de la FGI, pour chaque sacrifice qu’ils ont dû faire pour assurer la qualité de la formation offerte; Tout le personnel de l’ASECNA à l’aéroport international de Douala, pour l’environnement de travail très convivial et leur soutien multiforme ; A toute ma famille pour l’éducation qu’ils n’ont jamais cesser de m’apporter. Tous mes amis et camarades; Mémoire de fin d’étude rédigé par KANKEU Bedouen en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur en Génie Industriel IV DEVELOPPEMENT D’UNE APPLICATION MOBILE POUR LA SUPERVISION DU BILASAGE ET DES SYSTEMES ELECTRIQUES DE L’ASECNA : CAS DE L’AEROPORT INTERNTIONAL DE DOUALA RESUME Visualiser et piloter en temps réel un processus critique comme la gestion d’un aéroport permettent de réduire au minimum les temps d’arrêt en vue d’optimiser la disponibilité des installations. Lors de notre stage de fin de d’étude à l’Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et en Madagascar plus précisément à l’unité énergie et balisage, nous avons constaté une indisponibilité permanente du système de supervision complétant l’architecture SCADA de cette unité. Il nous a été demandé de développer une application mobile pour la supervision du balisage et des systèmes électriques inclus dans cette architecture. Le système à mettre sur pieds aura pour fonction la surveillance, la visualisation des systèmes électriques et du balisage au moyen des interfaces hommes machines à accès distants régies par un jeu de couleurs intuitifs et le traitement informatique de ces données. Pour ce faire nous avons recensé les équipements constitutifs du balisage et des systèmes électriques ainsi que l’ensemble des informations relatives à l’état de chaque équipements, suivi la remontée de ces informations jusqu’aux entrées sorties déportées, étudié le système de communication à l’ASECNA Douala en général et celui de l’unité ELB en particulier afin de localiser les points d’extraction des données pour supervision et enfin nous avons effectué en accord avec le cahier de charges, un choix de l’architecture du système distribué à implémenté. Pour y parvenir, nous avons opté pour une approche UML afin effectuer une analyse fonctionnelle de l’application au moyen des diagrammes de cas d’utilisation et de séquence, la conception étant basée sur le diagramme des classes. Ensuite une architecture distribuée incluant l’application a été proposée et enfin l’implémentation a été effectuée sur le logiciel LabVIEW en association à Unity Pro et les serveurs OFS, MySQL et Wezarp. Mots clés : Disponibilité, SCADA, serveur, système distribué, mobile Mémoire de fin d’étude rédigé par KANKEU Bedouen en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur en Génie Industriel V DEVELOPPEMENT D’UNE APPLICATION MOBILE POUR LA SUPERVISION DU BILASAGE ET DES SYSTEMES ELECTRIQUES DE L’ASECNA : CAS DE L’AEROPORT INTERNTIONAL DE DOUALA ABSTRACT Overseeing and piloting with a real-time a critical process like the management of an airport helps reduce significantly stops processes with a view to optimize the availability of the overall wiring. During our end-of-year internship for the “Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et en Madagascar”, specifically at Energy and Boundary Lights unit, we discovered a significant unavailability of the supervision system which is supposed to fill the gap of the SCADA architecture of that area. Our work was to develop a mobile app for the supervision of the Boundary Lights as well as electrical systems within the architecture. The would-be system will help for the monitoring, the overseeing of electrical systems as well as the Boundary Lights with Humans Interfaces Machines (HIM) with further accesses centralized by a game of colors as well as a computerized data processing. In order to achieve this, we collected the differents equipments of Boundary Lights and electrical systems as well as the overall data relating the state of each equipment, we followed the connections of these data to the deported inputs-outputs, we studied the communication system within ASECNA Douala in overall and particularly the one of the ELB unit which helps localize the points of data extraction to supervise. Lastly, in accordance with the contract documents, we chose an architecture of the distributed system to implement. To achieve our goal, we focused on an UML approach to establish a functional analysis of the mobile app through ‘’the case of use and sequence diagrams’’ as the conception is based on ‘’Class Diagram’’. Afterwards, a distributed architecture using the application was proposed and finally, the implementation was done through the software LabVIEW in association with Unity Pro as well as servers like OFS, MySQL and Wezarp. Key-words: Availability, SCADA, server, distributed system, mobile Mémoire de fin d’étude rédigé par KANKEU Bedouen en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur en Génie Industriel VI DEVELOPPEMENT D’UNE APPLICATION MOBILE POUR LA SUPERVISION DU BILASAGE ET DES SYSTEMES ELECTRIQUES DE L’ASECNA : CAS DE L’AEROPORT INTERNTIONAL DE DOUALA TABLES DE MATIERES DEDICACES ............................................................................................................................ iii REMERCIEMENTS ................................................................................................................. iv RESUME .................................................................................................................................... v ABSTRACT .............................................................................................................................. vi TABLES DE MATIERES........................................................................................................ vii LISTE DES TABLEAUX ......................................................................................................... xi LISTE DES FIGURES ............................................................................................................. xii GLOSSIAIRE ........................................................................................................................... xv SIGLES ET ABBREVIATIONS ............................................................................................ xvi LISTE DES ANNEXES ........................................................................................................ xviii INTRODUCTION GENERALE ................................................................................................ 1 CHAPITRE I : CONTEXTE ET PROBLEMATIQUE ............................................................. 2 I.1 PRESENTATION DE L’ENTREPRISE ..................................................................... 2 I.1.1 Historique et fiche d’identification de l’ASECNA .................................................. 2 I.1.2 Missions et champs d’application de l’ASECNA .................................................... 4 I.1.3 Organisation de l’ASECNA ..................................................................................... 5 I.2 LA REPRESENTATION DE L’ASECNA AU CAMEROUN .................................. 6 I.2.1 Situation géographique ............................................................................................ 6 I.2.2 Organisation ............................................................................................................. 6 I.3 PRESENTATION DE L’UNITE ENERGIE ET BALISAGE .................................... 8 I.3.1 Missions ................................................................................................................... 8 I.3.2 Fonctionnement ........................................................................................................ 8 I.3.3 Politique de maintenance ....................................................................................... 11 Mémoire de fin d’étude rédigé par KANKEU Bedouen en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur en Génie Industriel VII DEVELOPPEMENT D’UNE APPLICATION MOBILE POUR LA SUPERVISION DU BILASAGE ET DES SYSTEMES ELECTRIQUES DE L’ASECNA : CAS DE L’AEROPORT INTERNTIONAL DE DOUALA I.4 ETATS DES LIEUX ET PROBLEMATIQUE......................................................... 11 I.4.1 Etat des lieux .......................................................................................................... 11 I.4.2 Problématique ........................................................................................................ 16 I.5 CAHIER DES CHARGES ........................................................................................ 17 I.6 GENERALITES SUR LES SYSTEMES SCADA ................................................... 17 I.6.1 Définition et architecture des systèmes SCADA ................................................... 18 I.6.2 Les équipements du niveau 0 ................................................................................. 21 I.6.3 Les équipements du niveau 1 ................................................................................. 22 I.6.4 Les bus et réseaux de terrain .................................................................................. 26 I.6.5 Topologie des communications dans un système SCADA .................................... 33 I.6.6 Interopérabilité entre équipements en milieu industriel ......................................... 34 I.7 GENERALITES SUR LA SUPERVISION A DISTANCE ..................................... 36 I.7.1 La supervision ........................................................................................................ 36 I.7.2 Architecture des systèmes distribués ..................................................................... 37 I.7.3 La supervision industrielle ..................................................................................... 40 I.8 CONCEPTS THEORIQUES ..................................................................................... 42 I.8.1 Analyse UML ......................................................................................................... 42 I.8.2 Conception UML ................................................................................................... 43 CHAPITRE II : ETUDE DE L’EXISTANT ET ASPECTS METHODOLOGIQUES .......... 45 I Etude de l’existant............................................................................................................. 45 I.1 Le RLE ...................................................................................................................... 45 I.2 Les supports de transmission ..................................................................................... 46 I.2.1 La fibre optique ...................................................................................................... 46 I.2.2 La paire torsadée .................................................................................................... 47 I.3 I.3.1 Le RLI : Système de communication engageant la centrale ...................................... 48 La communication Jbus ......................................................................................... 48 Mémoire de fin d’étude rédigé par KANKEU Bedouen en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur en Génie Industriel VIII DEVELOPPEMENT D’UNE APPLICATION MOBILE POUR LA SUPERVISION DU BILASAGE ET DES SYSTEMES ELECTRIQUES DE L’ASECNA : CAS DE L’AEROPORT INTERNTIONAL DE DOUALA I.3.2 La communication MODBUS série ....................................................................... 49 I.3.3 La communication MODBUS TCP/IP .................................................................. 50 I.3.4 La communication filaire ....................................................................................... 51 I.3.5 La communication Uni-Telway ............................................................................. 51 I.3.6 Les équipements réseaux ....................................................................................... 51 I.4 I.4.1 L’appareillage électrique........................................................................................ 54 I.4.2 Les groupes électrogènes ....................................................................................... 56 I.4.3 Les onduleurs ASI.................................................................................................. 59 I.4.4 Les régulateurs de balisage .................................................................................... 59 I.4.5 Les transformateurs ................................................................................................ 62 I.5 Les automates programmables industriels ................................................................. 63 I.5.1 L’automate de Balisage .......................................................................................... 63 I.5.2 L’automate des Groupes et TGBT ......................................................................... 67 I.5.3 Les contrôleurs WAGO ......................................................................................... 68 I.5.4 L’automate de supervision ..................................................................................... 70 I.6 II Equipements supervisés : Principe de la mesure et paramètres surveillés ................ 54 Le système de supervision existant ........................................................................... 71 I.6.1 Mise en service....................................................................................................... 71 I.6.2 Communication avec les automates ....................................................................... 71 I.6.3 Utilisation ............................................................................................................... 71 I.6.4 Consignation d'événements .................................................................................... 72 I.6.5 Perte de communication ......................................................................................... 73 I.6.6 Sortie de la supervision .......................................................................................... 73 ASPECTS METHODOLOGIQUES ................................................................................ 73 II.1 Analyse UML : Le diagramme des cas d’utilisation de l’application ....................... 73 II.1.1 Acteurs et cas d’utilisation ................................................................................. 73 Mémoire de fin d’étude rédigé par KANKEU Bedouen en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur en Génie Industriel IX DEVELOPPEMENT D’UNE APPLICATION MOBILE POUR LA SUPERVISION DU BILASAGE ET DES SYSTEMES ELECTRIQUES DE L’ASECNA : CAS DE L’AEROPORT INTERNTIONAL DE DOUALA II.1.2 II.2 Diagramme des cas d’utilisation ........................................................................ 75 Conception générale .................................................................................................. 77 II.2.1 Le cycle de développement en V ....................................................................... 77 II.2.2 Diagramme de séquences de l’application ......................................................... 78 II.2.3 Diagramme des classes ....................................................................................... 85 II.3 Architecture 5-Tier du système ................................................................................. 87 II.3.1 La logique connexion aux données terrains ....................................................... 87 II.3.2 La logique métier................................................................................................ 89 II.3.3 La logique service Web ...................................................................................... 89 II.3.4 La logique Base de données ............................................................................... 92 II.3.5 La logique présentation ...................................................................................... 93 II.3.6 Outils de Mapping .............................................................................................. 93 II.4 Architecture logique associée au système distribué .................................................. 94 CHAPITRE III : RESULTATS ET DISCUSSIONS ............................................................... 97 III.1 Principes d’animation et d’utilisation des couleurs ................................................... 97 III.2 Paramétrage de la communication ............................................................................. 98 III.2.1 Communication automates-LabVIEW ............................................................... 98 III.2.2 Communication Client Wezarp-Serveur Wezarp ............................................... 98 III.3 Caractéristiques de l’application ............................................................................... 98 III.4 Vue du code source de la page d’accueil de l’application ......................................... 99 III.5 Vue de la page d’accueil .......................................................................................... 102 III.6 Quelques IHM de l’application ............................................................................... 103 III.7 Estimation du coût du projet .................................................................................... 112 CONCLUSION ...................................................................................................................... 113 REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES ............................................................................... 114 Mémoire de fin d’étude rédigé par KANKEU Bedouen en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur en Génie Industriel X DEVELOPPEMENT D’UNE APPLICATION MOBILE POUR LA SUPERVISION DU BILASAGE ET DES SYSTEMES ELECTRIQUES DE L’ASECNA : CAS DE L’AEROPORT INTERNTIONAL DE DOUALA LISTE DES TABLEAUX Tableau 1- 1: Fiche d'identification de l'ASECNA .................................................................... 3 Tableau 1- 2: Comparaison entre les réseaux de terrain (niveau physique) ............................. 32 Tableau 1- 3: Comparaison entre les réseaux de terrain (niveau liaison et application) .......... 33 Tableau 1- 4: Quelques superviseurs commerciaux ................................................................. 41 Tableau 2- 1: Liste des adresses MODBUS RS485 ................................................................. 49 Tableau 2- 2: Adresses réseaux des équipements .................................................................... 50 Tableau 2- 3: Types de multiplexage fréquentiel ..................................................................... 54 Tableau 2- 4: Caractéristiques du module TSX SCY 21601.................................................... 65 Tableau 2- 5: Fonctionnalités de l’application ......................................................................... 73 Tableau 2- 6: Les classes du système ....................................................................................... 85 Tableau 3- 1:Principe de la représentation des équipements et interprétation des couleurs .... 97 Mémoire de fin d’étude rédigé par KANKEU Bedouen en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur en Génie Industriel XI DEVELOPPEMENT D’UNE APPLICATION MOBILE POUR LA SUPERVISION DU BILASAGE ET DES SYSTEMES ELECTRIQUES DE L’ASECNA : CAS DE L’AEROPORT INTERNTIONAL DE DOUALA LISTE DES FIGURES Figure 1- 1: Organisation des structures statuaires de l'ASECNA ............................................. 6 Figure 1- 2: Organisation de la Représentation de l’ASECNA Cameroun ................................ 7 Figure 1- 3: Chaîne de distribution automatique de l’énergie électrique ................................. 10 Figure 1- 4 : Système de supervision en salle de contrôle ....................................................... 12 Figure 1- 5 : Système de communication ................................................................................. 14 Figure 1- 6: Modèle CIM ......................................................................................................... 18 Figure 1- 7: Système SCADA de seconde génération ............................................................. 20 Figure 1- 8: Courbe d'étalonnage d'un capteur ......................................................................... 21 Figure 1- 9: Principe de fonctionnement d'un capteur ............................................................. 22 Figure 1- 10: Structure interne d’un automate ......................................................................... 23 Figure 1- 11: Automate compact (Allen-Bradley) ................................................................... 23 Figure 1- 12: Automate modulaire (siemens)........................................................................... 24 Figure 1- 13: Fonctionnement cyclique d’un API .................................................................... 25 Figure 1- 14: Format d’une trame de données sur Ethernet II ................................................. 28 Figure 1- 15: Couches du protocole UNI-TelWay ................................................................... 28 Figure 1- 16: Architecture d’une communication Uni-TelWay ............................................... 29 Figure 1- 17: Communication entre un maitre et trois esclaves en Modbus série ................... 30 Figure 1- 18: Format d’une trame de données Modbus ASCII et Modbus série...................... 30 Figure 1- 19: Format de la trame de données en Modbus TCP/IP et Modbus Plus ................. 31 Figure 1- 20: Echange de données entre équipements OPC..................................................... 35 Figure 1- 21: Fonctions d’un système de supervision .............................................................. 36 Figure 1- 22: Place de la supervision en industrie.................................................................... 37 Figure 1- 23: Architecture 1-Tier ............................................................................................. 38 Figure 1- 24: Architecture 2-Tier ............................................................................................. 38 Figure 1- 25: Architecture 3-Tier ............................................................................................. 39 Figure 1- 26: Architecture d’un logiciel de supervision industrielle ........................................ 41 Figure 1- 27: Eléments d’un diagramme de cas d’utilisation a) acteur, b) cas d’utilisation, c) Héritage/Généralisation entre cas d’utilisation, extension et inclusion.................................... 42 Figure 1- 28: Eléments d’un diagramme de séquences : a) Acteur, b) Objet, c) Ligne de vie, de l’objet, d) Message synchrone ............................................................................................. 43 Mémoire de fin d’étude rédigé par KANKEU Bedouen en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur en Génie Industriel XII DEVELOPPEMENT D’UNE APPLICATION MOBILE POUR LA SUPERVISION DU BILASAGE ET DES SYSTEMES ELECTRIQUES DE L’ASECNA : CAS DE L’AEROPORT INTERNTIONAL DE DOUALA Figure 1- 29: Eléments d’un diagramme de classe: a) Acteur, b) Objet, c) Ligne de vie, de l’objet, d) Message synchrone .................................................................................................. 44 Figure 2- 1: Diagramme fonctionnel de la transmission à fibre Optique ................................. 47 Figure 2- 2: Schéma de principe du réseau de transmission engageant la centrale .................. 48 Figure 2- 3: Vue externe d’une passerelle ETG100 ................................................................. 52 Figure 2- 4: Principe multiplexage : a) Temporel, b) Fréquentiel ............................................ 53 Figure 2- 5: Acquisition des états d’un disjoncteur magnétothermique unipolaire.................. 56 Figure 2- 6: Les groupes électrogènes ...................................................................................... 57 Figure 2- 7: Cartes électroniques de contrôle d'un groupe électrogène CUMMINS................ 58 Figure 2- 8: Onduleur en mode double conversion .................................................................. 59 Figure 2- 9: Régulateur 1 Piste 20 KVA .................................................................................. 61 Figure 2- 10: Paramètres surveillés sur un régulateur .............................................................. 62 Figure 2- 11: Le TSX 57 Premium du balisage........................................................................ 63 Figure 2- 12 : Rack TSX RKY 08 sur lequel est monté un module processeur ....................... 64 Figure 2- 13: Arborescence d'un projet sur Unity Pro.............................................................. 67 Figure 2- 14: Configuration du TSX 6740 des Groupes et TGBT ........................................... 68 Figure 2- 15: Automate WAGO 750-842 de la série 750- I/O SYSTEM ................................ 69 Figure 2- 16: WAGO 750-842 du TDBT cellules élévatrices .................................................. 69 Figure 2- 17: Vue API supervision........................................................................................... 70 Figure 2- 18: Page d’accueil du logiciel de supervision PCVUE 32 en salle de contrôle ....... 72 Figure 2- 19: Principe de représentation des disjoncteurs sur PCVUE 32 ............................... 72 Figure 2- 20: Diagramme de cas d'utilisation ½ ....................................................................... 76 Figure 2- 21: Diagramme de cas d'utilisation 2/2..................................................................... 76 Figure 2- 22: Modèle en V ....................................................................................................... 77 Figure 2- 23: Diagramme séquence « s'authentifier » .............................................................. 78 Figure 2- 24: Diagramme de séquence « gérer groupes » ....................................................... 79 Figure 2- 25: Diagramme de séquence « gérer SHELTERS » ................................................ 79 Figure 2- 26: diagramme de séquence « gérer balisage » ........................................................ 80 Figure 2- 27: diagramme de séquence « visualiser onduleurs »............................................... 80 Figure 2- 28 : Diagramme de séquence « visualiser chargeurs » ............................................. 81 Mémoire de fin d’étude rédigé par KANKEU Bedouen en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur en Génie Industriel XIII DEVELOPPEMENT D’UNE APPLICATION MOBILE POUR LA SUPERVISION DU BILASAGE ET DES SYSTEMES ELECTRIQUES DE L’ASECNA : CAS DE L’AEROPORT INTERNTIONAL DE DOUALA Figure 2- 29: Diagramme de séquence « visualiser cellules élévatrices » ............................... 81 Figure 2- 30: Diagramme de séquence « gérer TGBT et TDBT » ........................................... 82 Figure 2- 31: Diagramme de séquence « visualiser système de communication » .................. 83 Figure 2- 32: Diagramme de séquence « visualiser synoptique unifilaire général » ............... 83 Figure 2- 33: Diagramme de séquence « visualiser courbes tendances » ................................ 84 Figure 2- 34: Diagramme de séquence « gérer archives » ....................................................... 84 Figure 2- 35: Architecture physique du système distribué proposée ....................................... 87 Figure 2- 36: Schéma d'un VPN d’accès .................................................................................. 91 Figure 2- 37: Schéma d'un VPN de type Intranet ..................................................................... 91 Figure 2- 38: Liaison VPN de type extranet............................................................................. 91 Figure 2- 39: Architecture LabVIEW en tant que solution de supervision industrielle ........... 95 Figure 3- 1: Page d'accueil de l'application : page d’authentification .................................... 102 Figure 3- 2:Confirmation d'authenfication par le système ..................................................... 103 Figure 3- 3: Vue du sommaire général ................................................................................... 104 Figure 3- 4: vue de la liste des évènements ............................................................................ 104 Figure 3- 5: Vue de la liste des alarmes ................................................................................. 105 Figure 3- 6:Vue du synoptique unifilaire général .................................................................. 105 Figure 3- 7: Vue du système de communication .................................................................... 106 Figure 3- 8: Vue du Groupe électrogène 1 ............................................................................. 106 Figure 3- 9: Vue du groupe électrogène 2 .............................................................................. 107 Figure 3- 10: Vue des évènements de l'ensemble des groupes électrogènes.......................... 107 Figure 3- 11:Vue des alarmes de l'ensemble des groupes électrogènes ................................. 108 Figure 3- 12: Vue des aides visuelles au balisage .................................................................. 109 Figure 3- 13:Vue des régulateurs du balisage ........................................................................ 109 Figure 3- 14: Vue Station Météo ............................................................................................ 110 Figure 3- 15: Vue TGBT non secouru.................................................................................... 110 Figure 3- 16: Vue TGBT secouru........................................................................................... 111 Figure 3- 17: Vue Onduleurs ASI 1 & 2 ................................................................................ 111 Figure 3- 18: Vue cellules élévatrices .................................................................................... 112 Mémoire de fin d’étude rédigé par KANKEU Bedouen en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur en Génie Industriel XIV DEVELOPPEMENT D’UNE APPLICATION MOBILE POUR LA SUPERVISION DU BILASAGE ET DES SYSTEMES ELECTRIQUES DE L’ASECNA : CAS DE L’AEROPORT INTERNTIONAL DE DOUALA GLOSSIAIRE TERME DEFINITION Alias Nom désignant un équipement d’automatisme ainsi que ses paramètres réseaux Balisage Système global comprenant les éléments en bout de chaîne (les feux et panneaux lumineux de signalisation aéronautique), les équipements de contrôle/commande (télécommande), les équipements en poste et sur l’aire de manœuvre Balle Traçante GLIDE Equipement radioélectrique qui indique au pilote, l’inclinaison de l’avion par rapport au sol permettant son ajustement convenablement lors des opérations de décollage ou d’atterrissage Groupe d’items Ensemble d’items régit par un même ensemble de propriété Item Nom d’une variable transitant sur un standard d’interopérabilité entre équipements LOCALIZER Equipement radioélectrique qui indique au pilote l’azimut ou le latéral (angle) pour guider l’avion au centre de la piste PAPI Instrument indiquant au pilote la pente pour atterrissage RTILS C’est un système lumineux d’identification de seuil de piste Station Météo Centre de collecte et de traitement des données climatologiques TAXIWAY Voie de circulation des aéronefs dans un aéroport VOR Equipement radioélectrique qui indique au pilote la direction de son avion par rapport à une destination donnée, définissant ainsi un trajet aérien Mémoire de fin d’étude rédigé par KANKEU Bedouen en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur en Génie Industriel XV DEVELOPPEMENT D’UNE APPLICATION MOBILE POUR LA SUPERVISION DU BILASAGE ET DES SYSTEMES ELECTRIQUES DE L’ASECNA : CAS DE L’AEROPORT INTERNTIONAL DE DOUALA SIGLES ET ABBREVIATIONS ADC : Aéroports Du Cameroun API : Automate Programmable Industriel ASECNA : Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et Madagascar CDE : Centre d’Emission Déporté CDIV : Centre Délégué d’Informations en Vol CIM : Computer Integreted Manufacturing CPU : Central Processing Unit CSMA/CD : Carried Sense Multiple Access/Collision Detection DCOM : Distributed Component Model DME : Distance Measuring Equipment ELB : Energy and Boundary Lights ERP : Enterprise Resource Planning FCU : Carte électronique de contrôle du feu à éclat IP : Internet Protocol LMC : Local Master Controller OFS : OPC Factory Server OLE : Objet Linked and Embedded OPC : OLE for Process Control PAPI : Précision Approach Path Indicator MAC : Media Access Controller MDAC : Microsoft Data Access Components MES : Manufacturing Execution System NC : Normaly Close NO : Normal Open RAM : Random Access Memory RLI : Réseau Local Industriel RTILS : Systèmes Lumineux d’identification de seuil RTU : Remote Terminal Unit SCADA : Supervisory Control And Data Acquisition SDH : Synchronous Digital Hierarchy Mémoire de fin d’étude rédigé par KANKEU Bedouen en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur en Génie Industriel XVI DEVELOPPEMENT D’UNE APPLICATION MOBILE POUR LA SUPERVISION DU BILASAGE ET DES SYSTEMES ELECTRIQUES DE L’ASECNA : CAS DE L’AEROPORT INTERNTIONAL DE DOUALA SONET : Synchronous Optical NETwork TMA : Terminal Manoeuvring area TDBT : Tableau de Distribution Basse Tension TGBT : Tableau Général Basse Tension TDM : Time Division Multiplexing TCP : Transmission control protocol TOR : Tout Ou Rien VHF : Very High Frequency VOR : VHF Omni-directional Range VPN : Virtual Private Network WAN : Wide Area Network WDM : Wavelength Division Multiplexing Mémoire de fin d’étude rédigé par KANKEU Bedouen en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur en Génie Industriel XVII DEVELOPPEMENT D’UNE APPLICATION MOBILE POUR LA SUPERVISION DU BILASAGE ET DES SYSTEMES ELECTRIQUES DE L’ASECNA : CAS DE L’AEROPORT INTERNTIONAL DE DOUALA LISTE DES ANNEXES Annexe 1 : Vue du groupe électrogène 1............................................................................... 115 Annexe 2: Vue régulateurs de balisage.................................................................................. 116 Annexe 3: Vue du TGBT secouru ......................................................................................... 117 Annexe 4: Vue onduleurs ...................................................................................................... 118 Annexe 5: Evolution des modes de raccordement ................................................................. 118 Annexe 6: Firmament des bus de terrain ............................................................................... 119 Annexe 7: Modèle OSI ......................................................................................................... 119 Annexe 8: Synthèse du modèle OSI pour les RLI ................................................................. 120 Annexe 9: Quelques fonctions Modbus usuelles ................................................................... 121 Annexe 10: Caractéristiques des GE CUMMINS KTA19-G3 .............................................. 122 Annexe 11: Câblage de la carte de control de vitesse CSC................................................... 122 Annexe 12: Caractéristiques TSX PSY 3610 ....................................................................... 123 Annexe 13: Schéma de principe : a) d’une entrée du 32D2K, b) d’une sortie du 32T2K ..... 123 Annexe 14: Caractéristiques générales 32T2K...................................................................... 125 Annexe 15: Caractéristiques réseau et techniques du 750-842 ............................................. 126 Annexe 16: Caractéristiques du CPU TSX P57 104M .......................................................... 127 Annexe 17: Access local ........................................................................................................ 128 Annexe 18 : Access distant par DCOM ................................................................................. 128 Annexe 19: Access distant par IIS ......................................................................................... 129 Annexe 20: Paramètres TGBT et TDBT surveillés ............................................................... 130 Annexe 21: Paramètres GE 1 et GE 2 surveillés ................................................................... 131 Annexe 22 : Paramètres onduleurs ASI et chargeurs surveillés ............................................ 134 Mémoire de fin d’étude rédigé par KANKEU Bedouen en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur en Génie Industriel XVIII DEVELOPPEMENT D’UNE APPLICATION MOBILE POUR LA SUPERVISION DU BILASAGE ET DES SYSTEMES ELECTRIQUES DE L’ASECNA : CAS DE L’AEROPORT INTERNTIONAL DE DOUALA INTRODUCTION GENERALE La bonne conduite des opérations en navigation aérienne fait appel à la sûreté de fonctionnement des infrastructures électriques et radioélectriques. Remplir les exigences associées à cette sûreté passe par un regard minutieux sur l’aspect énergétique; L’ASECNA dans l’accomplissement de sa mission principal qui est d’assurer la sécurité dans la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar y accorde un intérêt tout particulier. Elle est ainsi dotée dans chaque aéroport d’une unité qui assure d’une part la distribution et la production secourue de l’énergie électrique et d’autre part la disponibilité du balisage (lumineux). Contrainte à son tour au rythme zéro interruption d’énergie électrique et cent pour cent disponibilité du balisage, cette unité bien que conçue dans une architecture de redondance, doit se doter d’un outil permanent de surveillance de l’ensemble des systèmes électriques à sa charge et d’aide à la décision afin de planifier ses opérations de maintenance et de les conduire à bon terme, dans les délais. Vue l’étendue d’un aéroport, cet outil doit être accessible à distance. Fort de ce constat, il nous a été confiée la tâche du « développement d’une application mobile pour la supervision du balisage et des systèmes électriques de l’ASECNA : Cas de l’aéroport international de Douala ». Afin de répondre à la problématique soulevée par ce thème, nous décomposerons notre travail en trois chapitres. Le chapitre 1 dans lequel nous présenterons le contexte et la problématique qui en résulte et dont se dégage ce thème, le cahier de charge soumit et les généralités nécessaires à la compréhension de la suite de notre travail. Le chapitre 2 présente brièvement les équipements supervisés, les paramètres surveillés et leur acheminement à travers le RLE, il ressort également les aspects méthodologiques que nous avons adoptés pour répondre au cahier de charge. Enfin le chapitre 3 est consacrée à la synthèse des résultats simulés conjointement sur les logiciels Unity Pro-OFS-LabVIEW-MySQL et Wezarp, ainsi que l’analyse du coût du projet. Mémoire de fin d’étude rédigé par KANKEU Bedouen en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur en Génie Industriel 1 DEVELOPPEMENT D’UNE APPLICATION MOBILE POUR LA SUPERVISION DU BILASAGE ET DES SYSTEMES ELECTRIQUES DE L’ASECNA : CAS DE L’AEROPORT INTERNTIONAL DE DOUALA CHAPITRE I : CONTEXTE ET PROBLEMATIQUE Dans ce chapitre, nous présentons l’organisation structurelle de l’ASECNA et plus particulièrement celle de sa représentation au Cameroun. Ensuite nous exposons la problématique dans laquelle découle notre thème et enfin, nous faisons une revue de littérature sur les systèmes SCADA et en occurrence les systèmes de supervision industrielle. I.1 PRESENTATION DE L’ENTREPRISE I.1.1 Historique et fiche d’identification de l’ASECNA Créée le 12 décembre 1959, l’Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar en abrégée ASECNA nait suite à la décision d’un groupe d’Etats de mettre en commun leurs moyens pour la fourniture des services de la navigation aérienne à l’intérieur de leurs espaces au regard de la Convention de Chicago. Après avoir été longtemps un modèle de coopération nord/sud entre la France et dix-sept (17) pays africains, l’ASECNA est devenue progressivement un organisme de coopération interafricaine : c’est l’organe de l’unité africaine par excellence dans le domaine de l’aviation civile. Cette transformation s’est traduite dans les faits : D’abord par le transfert du siège de Paris à Dakar et, ensuite par l’africanisation du poste du directeur général. Ci-dessous quelques dates importantes de son évolution : 12 décembre 1959 : Signature de la convention de Saint-Louis, création de L’ASECNA au Sénégal ; 25 octobre 1974 : Remplacement de la convention de Saint-Louis par celle de Dakar ; 2004 : L’ASECNA supervise 10 centres de contrôle régionaux, 25 aéroports internationaux, 57 tours de contrôle et 76 aéroports nationaux et régionaux ; 10 mai 2008 : Rupture du contrat particulier liant l’ASECNA au Sénégal, permettant à ce dernier de se réapproprier la gestion de ses aéroports secondaires ; Mémoire de fin d’étude rédigé par KANKEU Bedouen en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur en Génie Industriel 2 DEVELOPPEMENT D’UNE APPLICATION MOBILE POUR LA SUPERVISION DU BILASAGE ET DES SYSTEMES ELECTRIQUES DE L’ASECNA : CAS DE L’AEROPORT INTERNTIONAL DE DOUALA 28 avril 2010 : Signature suite à la menace du Sénégal et de Madagascar de quitter l’agence, d’une nouvelle convention à Libreville visant à moderniser les textes qui régissent l’agence. Partager et administrer un bien aussi imperceptible qu’insaisissable étant une tâche assurément considérable mais possible, Il fallait mettre en œuvre les moyens très modestes des pays membres en les regroupant autour de ce projet communautaire ; ceci afin de réduire les efforts d’inventions et permettre aux innovations d’être à l’actif de tous. Cet établissement public à caractère multinational s’identifie ainsi clairement : Tableau 1- 1: Fiche d'identification de l'ASECNA Nom complet Agence pour sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar Sigle ASECNA Logo Forme juridique Société Anonyme Signature institutionnelle Les routes du ciel, notre métier Siege social Dakar, Sénégal Boite postale Année de création 12 décembre 1959 Chiffre d’affaire Effectif 5000 Fax 33 42 48 48 Site web www.asecna.aero/www.ais-asecna.org Directeur général MOUAHAMADOU Ousmane G. Représentant ASECNA Cameroun KOMGUEM MAGNI Appolin Activités Produire les services de la navigation aérienne Mémoire de fin d’étude rédigé par KANKEU Bedouen en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur en Génie Industriel 3 DEVELOPPEMENT D’UNE APPLICATION MOBILE POUR LA SUPERVISION DU BILASAGE ET DES SYSTEMES ELECTRIQUES DE L’ASECNA : CAS DE L’AEROPORT INTERNTIONAL DE DOUALA I.1.2 Missions et champs d’application de l’ASECNA I.1.2.1 Missions L’ASECNA, telle que présentée, a une mission essentielle : la sécurité de la navigation aérienne. Comme défini par certains articles de la convention de Dakar du 25 octobre 1974, L’ASECNA est chargée de: Assurer des services qui garantissent la sécurité des vols dans un espace aérien de 16.1 millions Km2 ainsi que la sécurité d'approche et d'atterrissage sur les aéroports des états membres ; Gérer ou entretenir toute exploitation d'utilité aéronautique ou météorologique à la demande des états membres et en vertu de contrat particulier; Passer des contrats avec les états non membres qui seraient désireux d'utiliser ses services. Ces différentes activités nécessitent la présence d'un personnel hautement qualifié et formé. C'est ainsi que l'agence dispose de trois (03) établissements qui bénéficient du soutien des établissements français homologues. Nous avons: L'Ecole Africaine de la Météorologie et de l'Aviation Civile (EAMAC) à Niamey qui forme des ingénieurs et des techniciens supérieurs dans les domaines de l'aviation ; L'Ecole Régionale de la Navigation Aérienne et du Management (ERNAM) à Dakar qui assure la formation continue en sécurisation, gestion des aéroports, maintenance des infrastructures du génie civil et management ; L'Ecole Régionale de Sécurité et Incendie (ERSI) à Douala pour la formation des techniciens de sécurité et de sauvetage. I.1.2.2 Champs d’application L’ASECNA de part sa mission gère 10 centres de contrôle régionaux, 57 tours de contrôle, 25 aéroports internationaux et 76 aéroports nationaux et régionaux. L’agence a la charge d’un espace aérien étendu sur 16 100 000 km2 couvert par six régions d’information en vol (Antananarivo, Brazzaville, Dakar Océanique, Dakar Terrestre, Niamey, Ndjamena). Mémoire de fin d’étude rédigé par KANKEU Bedouen en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur en Génie Industriel 4 DEVELOPPEMENT D’UNE APPLICATION MOBILE POUR LA SUPERVISION DU BILASAGE ET DES SYSTEMES ELECTRIQUES DE L’ASECNA : CAS DE L’AEROPORT INTERNTIONAL DE DOUALA En somme, elle assure les aides terminales sur les 27 aéroports principaux des 17 Etats africains et malgache membres à travers : o Le contrôle d’aérodrome ; o Le contrôle d’approche ; o Le guidage du roulement des aéronefs au sol ; o L’aide radio et visuelle à l’approche et à l’atterrissage ; o Les transmissions radios, les prévisions météorologiques ; o Le bureau de piste et d’information aéronautique ; o Les services de sécurité incendie. I.1.3 Organisation de l’ASECNA I.1.3.1 Etats membres L’ASECNA regroupe 17 Etats africains : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique, Congo, Comores, Côte d’ivoire, Gabon, Guinée Bissau, Guinée Equatoriale, Madagascar, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad, Togo. Toutefois, le fait que la TMA (Terminal Manoeuvring area) de Saint-Denis-Gillot soit située dans la région d’information de vol d’Antananarivo place la France comme le 18 ième Etat membre de l’ASECNA. I.1.3.2 Structure Pour la nécessité d’assurer une gestion commune, il importe pour les Etats membres de se doter d’une organisation bien structurée. Pour cela, il existe au sein de l’ASECNA des structures statutaires et les services extérieurs au siège. Les structures statutaires sont les points de départ de toute prise de décisions importantes. L’organigramme de la Figure 1.1 présente graphiquement l’organisation des structures statuaires de l’ASECNA. Mémoire de fin d’étude rédigé par KANKEU Bedouen en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur en Génie Industriel 5 DEVELOPPEMENT D’UNE APPLICATION MOBILE POUR LA SUPERVISION DU BILASAGE ET DES SYSTEMES ELECTRIQUES DE L’ASECNA : CAS DE L’AEROPORT INTERNTIONAL DE DOUALA Figure 1- 1: Organisation des structures statuaires de l'ASECNA Les services extérieurs compris dans la structure organisationnelle de l’ASECNA sont les délégations et les représentations. Nous développerons dans la suite la structure et le rôle d’une représentation puisqu’il s’agit du type de service extérieur au sein duquel nous avons effectué notre stage. I.2 LA REPRESENTATION DE L’ASECNA AU CAMEROUN I.2.1 Situation géographique L’ASECNA est représentée dans chaque état membre par une Représentation, dirigée par un représentant qui est nommé par le directeur général. Le représentant se tient à la disposition de ce dernier pour lui fournir toutes les informations sur sa représentation. Celle de la République du Cameroun est la représentation qui nous a accueilli durant notre stage. Elle est située à l’aéroport international de Douala. Elle remplit les missions de l’agence sur le territoire national en assurant la sécurité de la navigation aérienne dans les aéroports internationaux de Douala et Yaoundé, entre autres. La Représentation de l’ASECNA Cameroun est située non loin de l’aéroport international de Douala. I.2.2 Organisation Comme la majorité des représentations, la représentation de l’ASECNA Cameroun est organisée suivant l’organigramme ci-dessous. Mémoire de fin d’étude rédigé par KANKEU Bedouen en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur en Génie Industriel 6 DEVELOPPEMENT D’UNE APPLICATION MOBILE POUR LA SUPERVISION DU BILASAGE ET DES SYSTEMES ELECTRIQUES DE L’ASECNA : CAS DE L’AEROPORT INTERNTIONAL DE DOUALA Figure 1- 2: Organisation de la Représentation de l’ASECNA Cameroun C’est au sein du Service Infrastructures Radioélectriques (IRE) que l’on retrouve l’Unité Energie et Balisage(ELB) qui fera l’objet d’une ample description, puisqu’il s’agit de l’unité dans laquelle nous avons séjourné durant le stage. Mémoire de fin d’étude rédigé par KANKEU Bedouen en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur en Génie Industriel 7 DEVELOPPEMENT D’UNE APPLICATION MOBILE POUR LA SUPERVISION DU BILASAGE ET DES SYSTEMES ELECTRIQUES DE L’ASECNA : CAS DE L’AEROPORT INTERNTIONAL DE DOUALA I.3 PRESENTATION DE L’UNITE ENERGIE ET BALISAGE I.3.1 Missions L’unité ELB communément appelé Centrale électrique contribue à travers ses activités à assurer la sécurité des opérations de la navigation aérienne. Elles consistent à : Assurer la continuité de l’approvisionnement en énergie électrique pour les besoins de l’agence et de l’aéroport international de Douala en cas de blackout : Fonction d’appoint en énergie électrique ; Assurer la distribution de l’énergie produite ou provenant du fournisseur ENEO vers tous les locaux de l’ASECNA et vers l’aéroport international de Douala ; Assurer la maintenance électrique des équipements intervenant dans les opérations de contrôle de la navigation aérienne. I.3.2 Fonctionnement En amont d’une part, l’énergie électrique provenant du fournisseur public passe par un système de trois (03) cellules d’isolement haute tension 15kV ; dispositifs assurant les fonctions d’interruption et de protection, avant d’être envoyée vers deux (02) transformateurs triphasés abaisseurs 15kV/400V fonctionnant en redondance. D’autre part, un système de quatre (04) groupes électrogènes 250KVA repartis en deux sections à raison de 02 groupes (installés suivant une architecture de redondance assurée par un système d’inversion à verrouillage électrique et mécanique) par section, est ménagé pour produire de l’énergie électrique en cas de blackout. Un système d’inversion à verrouillage électrique assure le basculement entre le fournisseur public et les groupes. La distribution de l’énergie électrique, qu’elle provienne des transformateurs ou des groupes, vers les différentes installations techniques de l’ASECNA, se fait via un système d’inversion a verrouillage mécanique entre un des deux (02) onduleurs inverseurs A.S.I (Alimentation Sans Interruption) 300KVA chacun, munis de batteries et l’ultime secours (mode de marche consistant en l’alimentation des installations et équipements à l’aide des groupes Mémoire de fin d’étude rédigé par KANKEU Bedouen en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur en Génie Industriel 8 DEVELOPPEMENT D’UNE APPLICATION MOBILE POUR LA SUPERVISION DU BILASAGE ET DES SYSTEMES ELECTRIQUES DE L’ASECNA : CAS DE L’AEROPORT INTERNTIONAL DE DOUALA électrogènes, sans passage par les onduleurs). Ce passage à travers les onduleurs permet la recharge des batteries. En somme, lorsque l’alimentation secteur est défaillante, le système d’inversion bascule automatiquement vers l’alimentation d’appoint assurée par les groupes électrogènes, afin que l’un de ces derniers démarre. Pendant le démarrage, les onduleurs convertissent le courant continu fourni par les batteries (disposant d’une autonomie de 20 à 25 minutes) qui leur sont associées, en courant alternatif. Cela permet d’assurer l’alimentation des installations le temps que les groupes électrogènes atteignent leur régime permanent. Une fois les groupes démarrés, ils alimentent les équipements secourus uniquement. En outre, la répartition des équipements d’aide à la navigation sur une superficie d’environ 8 hectas impose un transport de l’énergie de la centrale jusqu’aux sites concernés avant la distribution. Ceci se fait au moyen de : Quatre (04) cellules élévatrices monophasés 20KVA-400V/3.2KV, 10KVA- 400V/3.2KV : Ce sont des transformateurs élévateurs assurant le départ de l’énergie électrique en direction du VOR/DME, du GLIDE/DME, du LOCALIZER et de la station météo ; Quatre (04) cellules abaisseuses 3.2kV/400V : Il s’agit des transformateurs abaisseurs assurant la conversion MT/BT au VOR/DME, GLIDE/DME, LOCALIZER et station météo ; Un (01) transformateur assurant le départ de l’énergie vers l’aérogare. La figure ci-dessous présente le synoptique unifilaire général de distribution de l’énergie électrique. Mémoire de fin d’étude rédigé par KANKEU Bedouen en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur en Génie Industriel 9 DEVELOPPEMENT D’UNE APPLICATION MOBILE POUR LA SUPERVISION DU BILASAGE ET DES SYSTEMES ELECTRIQUES DE L’ASECNA : CAS DE L’AEROPORT INTERNTIONAL DE DOUALA Figure 1- 3: Chaîne de distribution automatique de l’énergie électrique Mémoire de fin d’étude rédigé par KANKEU Bedouen en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur en Génie Industriel 10 DEVELOPPEMENT D’UNE APPLICATION MOBILE POUR LA SUPERVISION DU BILASAGE ET DES SYSTEMES ELECTRIQUES DE L’ASECNA : CAS DE L’AEROPORT INTERNTIONAL DE DOUALA L’ensemble du balisage est alimenté par un système de 14 régulateurs de courant de puissance 7,5 KVA, 10KVA, fonctionnant en redondance et pilotés en local (à la centrale) ou depuis la tour de contrôle. I.3.3 Politique de maintenance Le souci majeur du personnel de l’unité ELB est d’assurer la continuité de l’énergie électrique et la disponibilité des équipements électriques intervenant dans les opérations de contrôle de la navigation aérienne. Remplir ses missions requiert une véritable politique de maintenance. I.3.3.1 Fonctionnement de service Avant l’exécution des travaux sur un site les agents s’assurent que certaines procédures sont respectées (mesure de sécurité, préparation du matériels) et après exécution des travaux le personnel de l’unité répertorie tous les travaux dans une base de donnée. I.3.3.2 Type de maintenance pratiquée La maintenance préventive systématique est prônée : C’est une maintenance qui est exécutée suivant un calendrier mensuel. Il s’agit ici principalement des inspections des équipements et du remplacement systématique de certains éléments. I.4 ETATS DES LIEUX ET PROBLEMATIQUE I.4.1 Etat des lieux D’une part, la sollicitation des équipements par l’équipage des aéronefs et par conséquent par la tour de contrôle et d’autre part, la criticité de la tâche à leur confiée (politique zéro coupure d’énergie et 100% disponibilité des équipements) dans ce secteur qu’est l’aéronautique justifient le fait que la centrale réponde aux exigences d’une industrie 3.0. Elle est de ce fait : Intégrée au réseau local de l’entreprise ; Mémoire de fin d’étude rédigé par KANKEU Bedouen en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur en Génie Industriel 11 DEVELOPPEMENT D’UNE APPLICATION MOBILE POUR LA SUPERVISION DU BILASAGE ET DES SYSTEMES ELECTRIQUES DE L’ASECNA : CAS DE L’AEROPORT INTERNTIONAL DE DOUALA Dotée d’une chaine entièrement automatisée et pilotée par un système de 12 automates programmables Industriels (API) ; Couronnée dans son architecture SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) par un système de supervision assurant la remontée d’informations du balisage et de l’ensemble des systèmes électriques (du moins ceux connectés aux automates). Figure 1- 4 : Système de supervision en salle de contrôle La complexité des installations et le flux important de paramètres équipements à surveiller révèlent l’intérêt du système de supervision pour les opérations de maintenance. Installé en salle de contrôle, ce dernier a pour but : La supervision du procédé électrique : Elle consiste en l’affichage des mesures en temps réels, la visualisation de l’état de l’appareillage électrique (disjoncteurs, interrupteurs, contacteurs, sectionneur,…) des tableaux généraux basse tension (TGBT) secouru et non secouru et des tableaux de distribution basse tension (TDBT), la visualisation de l’état du balisage. La supervision système : Celle-ci permet le diagnostic rapide d’une défaillance d’un équipement de la chaine par un jeu de couleur intuitif ainsi d’une historisation de l’ensemble des évènements survenus. Mémoire de fin d’étude rédigé par KANKEU Bedouen en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur en Génie Industriel 12 DEVELOPPEMENT D’UNE APPLICATION MOBILE POUR LA SUPERVISION DU BILASAGE ET DES SYSTEMES ELECTRIQUES DE L’ASECNA : CAS DE L’AEROPORT INTERNTIONAL DE DOUALA Quelques équipements supervisés et paramètres surveillés : Nous présentons en annexe 1, 2, 3 et 4, quelques interfaces extraites du système de supervision. Présentation du système de supervision Logé en salle de contrôle, le poste de conduite consiste en un pupitre auquel est associé un PC industriel exécutant le logiciel de supervision industriel PCVUE d’ARC Informatique dans sa version 32. Ce dernier est complété par une imprimante servant à obtenir les copies couleurs des différents synoptiques. Ce poste de traçabilité se résume en une base de données extraite des mémoires des API. L’architecture décentralisée de l’automatisme en place se décline nettement sur le système de communication ci-dessous : Elle laisse paraitre la remontée des informations jusqu’aux mémoires API. Mémoire de fin d’étude rédigé par KANKEU Bedouen en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur en Génie Industriel 13 DEVELOPPEMENT D’UNE APPLICATION MOBILE POUR LA SUPERVISION DU BILASAGE ET DES SYSTEMES ELECTRIQUES DE L’ASECNA : CAS DE L’AEROPORT INTERNTIONAL DE DOUALA Figure 1- 5 : Système de communication En effet, sur chacun des sites du SHELTERS (nom donné au regroupement des locaux suivants : VOR/DME, GLIDE/DME, LOCALIZER, station météo) ainsi qu’au bloc technique et à la tour de contrôle, un automate WAGO 750-842 de la série 750-I/O PRO System de la firme WAGO assure les fonctions de distribution de l’énergie et de collecte de données des systèmes électriques. Du fait de l’éloignement des sites, une combinaison de support (paire torsadée et fibre optiques) et d’équipements (Multiplexeurs optiques et passerelles ETG100) assurent la transmission des données jusqu’à la centrale via le canal du réseau local d’entreprise (RLE), ici Ethernet. Mémoire de fin d’étude rédigé par KANKEU Bedouen en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur en Génie Industriel 14 DEVELOPPEMENT D’UNE APPLICATION MOBILE POUR LA SUPERVISION DU BILASAGE ET DES SYSTEMES ELECTRIQUES DE L’ASECNA : CAS DE L’AEROPORT INTERNTIONAL DE DOUALA Par ailleurs, à la centrale, la gestion des groupes, la distribution de l’énergie électrique, le pilotage du balisage, la gestion des TGBT et TDBT et la coordination des automatismes des sites mentionnés ci-haut s’effectuent par un système de six (06) automates évoluant eux-mêmes dans une architecture de réseau de terrain robuste centre sur les protocoles de réseaux de terrain Uni-TelWay et Modbus dans ses variantes Modbus RTU (Remote Terminal Unit), Modbus Over Ethernet encore appelé Modbus TCP/IP (Transmission control Protocol/ Internet Protocol) et Jbus. Ainsi, L’API des groupes et TGBT gère l’automatisme des groupes, la collecte des informations relatives à l’état des groupes et de l’appareillage électrique du TGBT (secouru et non secouru) ainsi que du TDBT (secouru et non secouru) et suivant essentiellement suivant une logique câblée 9 utilisation du câble coaxiale). L’API de supervision assure la liaison avec tous les automates (automates en local et distant) suivant une architecture maitre-esclave conformément aux protocoles UNITELWAY (liaison avec l’API des groupes et TGBT) et Modbus TCP/IP (avec tous les autres API). Il Assure de ce fait les fonctions de coordination et de remontée des informations relatives à la supervision en provenance de tous les API excepté l’API de balisage. L’API de Balisage pilote les onze (11) régulateurs de balisage (en sélection réseau normal ou secouru) et assure la remontée de l’état des régulateurs à l’automate WAGO 750-842 de la platine de VIGIE (tour de contrôle).Tel qu’on peut observer sur la figure 1-5, la trame de données échangée entre cet API et les régulateurs est conforme au protocole de JBus. L’API du synoptique unifilaire général : Esclave de l’API des groupes et TGBT assure la visualisation en salle de contrôle, de la chaine de distribution automatisée de l’énergie dans tous les locaux. L’API du TDBT PO assure la remontée des informations des cellules élévatrices de départ SHELTERS à l’API de Supervision. L’API du CDE (centre d’émission déportée) assure la remontée des informations des systèmes électriques du CDE au pupitre de la salle de contrôle. En somme, superviser un paramètre relatif à un équipement consiste en : L’identification de l’équipement émettant la donnée ; Le suivie du canal emprunté par la donnée ; Mémoire de fin d’étude rédigé par KANKEU Bedouen en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur en Génie Industriel 15 DEVELOPPEMENT D’UNE APPLICATION MOBILE POUR LA SUPERVISION DU BILASAGE ET DES SYSTEMES ELECTRIQUES DE L’ASECNA : CAS DE L’AEROPORT INTERNTIONAL DE DOUALA L’identification de l’API auquel parvient la donnée; Identification de l’adresse mémoire de la donnée ; Lecture de la donnée en mémoire depuis le logiciel de supervision ; Son archivage et son monitoring instantané. I.4.2 Problématique Le système de supervision présent fait face à deux handicaps majeurs : Supervision à accès local: Un opérateur s’informe de l’état d’un équipement si et seulement s’il est en salle de contrôle. Cette situation rend difficile les opérations de maintenance avec pour effet : Perte financière et perte en temps : Les sites étant répartis sur une superficie de huit hectas, une opération de maintenance sur un site distant se fait par assistance téléphonique avec un opérateur resté en salle de contrôle. C’est ce dernier qui fournit les retours d’état en provenance de la supervision à l’opérateur sur site distant pour correction éventuelle. Occupation abusive du canal VHF (Very High Frequency): La maintenance du balisage requiert l’accord du contrôleur aérien pour accéder à la piste d’atterrissage. Ce dernier à la demande de l’opérateur de l’unité ELB, met en marche les feux de balisage dans une configuration précise; Configuration soumise à l’appréciation de l’opérateur. Mais couramment, le contrôleur est confronté à des appels répétés de l’opérateur lui demandant la confirmation de la mise en marche d’un feu ou d’un autre : Cas évitable si la supervision était à sa portée. Ce qui a pour effet, l’occupation anarchique et abusive de la fréquence VHF qui est une ressource partagée et la dispersion du contrôleur au vue de la lourde tâche de guidage des aéronefs donc il a la charge. Indisponibilité récurrente du système de supervision : En effet, le système n’a fonctionné que quelques années après son installation malgré toutes les tentatives de remise sur pieds (Réception d’un nouveau système de supervision d’arc informatique mais arrêt après quelques jours de fonctionnement). Non maîtrise local de l’outil de supervision Mémoire de fin d’étude rédigé par KANKEU Bedouen en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur en Génie Industriel 16 DEVELOPPEMENT D’UNE APPLICATION MOBILE POUR LA SUPERVISION DU BILASAGE ET DES SYSTEMES ELECTRIQUES DE L’ASECNA : CAS DE L’AEROPORT INTERNTIONAL DE DOUALA I.5 CAHIER DES CHARGES Vu la problématique ci-dessus, un cahier de charge nous a été soumis par l’entreprise. Objectif : Mettre sur pied une application mobile pour la supervision du balisage et des systèmes électriques à la charge de l’unité ELB. Livrable : L’application pour système d’exploitation Android, IOS, Windows phone et PC Windows ; Le guide d’utilisation de l’application ; La liste du matériel et l’estimation du cout du projet. Exigences : Remplir toutes les fonctionnalités offertes par le logiciel de supervision existant à savoir : Permettre à l’utilisateur de visualiser l’état des systèmes électriques ; Permettre à l’utilisateur de visualiser l’état de l’ensemble du balisage ; Permettre à l’utilisateur de visualiser les alarmes, et l’historique des évènements ; Permettre à l’utilisateur de suivre les mesures secteur, le nombre d’heures de fonctionnement des groupes. Permettre un accès distant de l’ensemble des données. I.6 GENERALITES SUR LES SYSTEMES SCADA La complexité du processus de production a favorisé la modélisation de l’architecture des RLI afin de mieux appréhender les flux de communication dans l’entreprise. Parmi les modèles existants, il en ressort 2 plus importants : Le modèle CIM (Computer Integrated Manufacturing) ; Le modèle à 3 axes. Suivant le modèle CIM, les systèmes SCADA apparaissent comme le tous des réseaux locaux industriels (niveaux 2, 1 et 0) tandis que les réseaux informatiques et les systèmes de télécommunication apparaissent dans les niveaux 3 et 4. Mémoire de fin d’étude rédigé par KANKEU Bedouen en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur en Génie Industriel 17 DEVELOPPEMENT D’UNE APPLICATION MOBILE POUR LA SUPERVISION DU BILASAGE ET DES SYSTEMES ELECTRIQUES DE L’ASECNA : CAS DE L’AEROPORT INTERNTIONAL DE DOUALA Figure 1- 6: Modèle CIM I.6.1 Définition et architecture des systèmes SCADA I.6.1.1 Définition Un système de contrôle et d’acquisition de données (SCADA) est un système de télégestion à grande échelle permettant de traiter en temps réel un grand nombre de télémesures et de contrôler à distance des installations techniques. Un système SCADA est généralement composé des sous-systèmes suivants : Une interface homme-machine (IHM) qui présente les données à un opérateur humain et qui lui permet de superviser et commander les processus, Un système de supervision et contrôle informatique, faisant l'acquisition des données des processus et envoyant des commandes (consignes) aux processus, Mémoire de fin d’étude rédigé par KANKEU Bedouen en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur en Génie Industriel 18 DEVELOPPEMENT D’UNE APPLICATION MOBILE POUR LA SUPERVISION DU BILASAGE ET DES SYSTEMES ELECTRIQUES DE L’ASECNA : CAS DE L’AEROPORT INTERNTIONAL DE DOUALA Une unité terminale distante (RTU) reliant les capteurs convertissant les signaux en flux de données numériques et envoyant les données numériques au système de supervision, Une infrastructure de communication reliant le système de supervision et contrôle aux éléments terminaux, Divers instruments d'analyse. Ces systèmes évoluent sous plusieurs architectures. Des automates programmables industriels utilisés sur le terrain pour leur versatilité et flexibilité due à leur capacité d'être configurables. I.6.1.2 Architecture des systèmes SCADA Les avancées technologiques en matière de communication, l’augmentation de la taille de l’industrie et la complexité sans cesse croissance des automatismes industriels n’ont pas été sans incident sur la configuration des systèmes SCADA. o Les systèmes SCADA monolithiques : Pour cette génération, les calculs sont réalisés avec des ordinateurs centraux, les réseaux n'existant pas à cette époque et les systèmes SCADA sont indépendants et ne sont connectés à aucun autre système. Les protocoles de communication utilisés sont le plus souvent propriétaires. Cette première génération de systèmes SCADA est redondante car un ordinateur central de secours est connecté au niveau du bus informatique et activé en cas de panne de l'ordinateur central principal. o Les systèmes SCADA distribués : La deuxième génération a profité des développements dans le domaine de la miniaturisation et de la technologie des réseaux locaux pour repartir le traitement entre plusieurs stations reliées par un réseau local et partager l’information en temps réel. Chaque station est responsable d'une tâche particulière rendant ainsi la taille et le coût de chaque station inférieure à celle utilisée dans la première génération. La répartition des tâches de fonctionnement du système à toutes les stations connectées au réseau ne sert pas seulement à l’augmentation de la Mémoire de fin d’étude rédigé par KANKEU Bedouen en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur en Génie Industriel 19 DEVELOPPEMENT D’UNE APPLICATION MOBILE POUR LA SUPERVISION DU BILASAGE ET DES SYSTEMES ELECTRIQUES DE L’ASECNA : CAS DE L’AEROPORT INTERNTIONAL DE DOUALA puissance de traitement mais aussi permet d’améliorer la redondance et la fiabilité dans le système. Figure 1- 7: Système SCADA de seconde génération o Les systèmes SCADA en réseau : Cette génération adopte une architecture réseau, qui est étroitement liée à l’architecture distribuée sauf que l’architecture réseau offre une ouverture à un environnement autre que celui conditionné par le fournisseur. L’amélioration majeure dans la troisième génération vient de l’utilisation des protocoles WAN (Wide Area Network) comme le protocole IP (Internet Protocol) pour la communication entre la station maitresse et les équipements de communication. Cela permet à la portion de la station maitre responsable de la communication avec les appareils de terrain d’être sépare de la station maitre et cela par le biais du réseau WAN : On parle d’industrie 3.0. o Les systèmes SCADA de l’IIoT: Mémoire de fin d’étude rédigé par KANKEU Bedouen en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur en Génie Industriel 20 DEVELOPPEMENT D’UNE APPLICATION MOBILE POUR LA SUPERVISION DU BILASAGE ET DES SYSTEMES ELECTRIQUES DE L’ASECNA : CAS DE L’AEROPORT INTERNTIONAL DE DOUALA Ici, le coût des systèmes SCADA de l'infrastructure est réduit en adoptant les technologies de l'Internet des choses ou d’IIoT (Industrial Internet of Things) et d’informatique en nuage (Cloud computing) disponible dans le commerce. La maintenance et l'intégration est également très facile pour la quatrième génération par rapport aux systèmes SCADA antérieures : On parle d’industrie 4.0. Dans la suite nous examinerons les différentes composantes d’un système SCADA distribuée. I.6.2 Les équipements du niveau 0 Au niveau 0 de la pyramide CIM, nous retrouvons les capteurs, les pré-actionneurs et les actionneurs. Un capteur est un système qui permet d'obtenir une image sous forme en général électrique, d'une grandeur physique. On appelle : m le mesurande c'est à dire la grandeur physique à mesurer. s la grandeur de sortie du capteur. Une relation mathématique tirée des lois physiques entre la grandeur d’entrée et la grandeur de sortie doit exister. Cette relation entre le mesurande m et la sortie s (s=f(m)) s’appelle courbe d’étalonnage du capteur. Lorsque la courbe d’étalonnage du capteur est une droite, le capteur est dit linéaire ou sinon il est dit non linéaire. Figure 1- 8: Courbe d'étalonnage d'un capteur Mémoire de fin d’étude rédigé par KANKEU Bedouen en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur en Génie Industriel 21 DEVELOPPEMENT D’UNE APPLICATION MOBILE POUR LA SUPERVISION DU BILASAGE ET DES SYSTEMES ELECTRIQUES DE L’ASECNA : CAS DE L’AEROPORT INTERNTIONAL DE DOUALA Son schéma du principe de fonctionnement est le suivant : Figure 1- 9: Principe de fonctionnement d'un capteur Caractéristiques d’un capteur Etendue de mesure : Valeurs extrêmes pouvant être mesurée par le capteur. ; Résolution : Plus petite variation de grandeur mesurable par le capteur ; Sensibilité : Variation du signal de sortie par rapport à la variation du signal d'entrée ; Précision : Aptitude du capteur à donner une mesure proche de la valeur vraie ; Rapidité : Temps de réaction du capteur. La rapidité est liée à la bande passante ; Linéarité : représente l'écart de sensibilité sur l'étendue de mesure. I.6.3 Les équipements du niveau 1 Au niveau 1 de la pyramide CIM, on retrouve les automatismes. Les équipements qui s’y retrouvent sont donc des API, de variateurs de vitesse et bien d’autres équipements munis d’un calculateur. Nous Nous nous intéressons dans la suite aux automates programmables industriels. I.6.3.1 Présentation Un automate programmable industriel est un appareil électronique programmable, adapté à l’environnement industriel, qui réalise des fonctions d’automatisme pour assurer la commande des actionneurs et pré-actionneurs à partir des informations logique, analogique ou numérique. On distingue deux types d’automates : Mémoire de fin d’étude rédigé par KANKEU Bedouen en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur en Génie Industriel 22 DEVELOPPEMENT D’UNE APPLICATION MOBILE POUR LA SUPERVISION DU BILASAGE ET DES SYSTEMES ELECTRIQUES DE L’ASECNA : CAS DE L’AEROPORT INTERNTIONAL DE DOUALA Figure 1- 10: Structure interne d’un automate Les automates compacts : Ils intègrent le processeur, l’alimentation, les entrées et les sorties. Selon le modèle et les fabricants il pourra réaliser certaines fonctions supplémentaires. Figure 1- 11: Automate compact (Allen-Bradley) o Les automates modulaires : Dans La configuration modulaire de l’API, le processeur, l’alimentation et les interfaces entrées /sorties résident dans des unités séparées (modules) et sont fixés sur un ou plusieurs racks contenant le fond de panier (bus de connecteurs). Ainsi des modules spécifiques sont ajoutés au CPU (Central Processing Unit) pour la réalisation des tâches précises : Tâche d’acquisition d’entrées/sorties⟹ 𝑀𝑜𝑑𝑢𝑙𝑒 𝑇𝑂𝑅, E/S 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑜𝑔𝑖𝑞𝑢𝑒𝑠 Mémoire de fin d’étude rédigé par KANKEU Bedouen en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur en Génie Industriel 23 DEVELOPPEMENT D’UNE APPLICATION MOBILE POUR LA SUPERVISION DU BILASAGE ET DES SYSTEMES ELECTRIQUES DE L’ASECNA : CAS DE L’AEROPORT INTERNTIONAL DE DOUALA Tâche de communication ⟹ Module de communication LAN (Local Area Network) et bus de terrain (Modbus, Profibus, FIPIO, FIPWAY) Tâche spécifiques aux métiers ⟹ Module de comptage rapide, de pesage Tâche de commande de mouvement ⟹ Module motion (𝑑𝑒𝑚𝑎𝑟𝑟𝑒𝑢𝑟𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑓𝑠,𝑣𝑎𝑟𝑖𝑡𝑒𝑢𝑟𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑡𝑒𝑠𝑠𝑒, 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑑′ 𝑎𝑥𝑒𝑠). Figure 1- 12: Automate modulaire (siemens) I.6.3.2 Fonctionnement Tous les automates ont le même mode opératoire de fonctionnement (cyclique) : Traitement interne: L’automate effectue des opérations de contrôle et met à jour certains paramètres systèmes (détection des passages en Run/Stop, mise à jour des valeurs de l’horodateur) ; Lecture des entrées: L’automate lit des entrées de façons synchrones et les recopie dans la mémoire des entrées ; Exécution du programme: L’automate exécute le programme instruction par instruction et écrit les sorties dans la mémoire image des sorties ; Écriture des sorties: L’automate bascule les différentes sorties de façon synchrone aux positions définies dans la mémoire image des sorties Mémoire de fin d’étude rédigé par KANKEU Bedouen en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur en Génie Industriel 24 DEVELOPPEMENT D’UNE APPLICATION MOBILE POUR LA SUPERVISION DU BILASAGE ET DES SYSTEMES ELECTRIQUES DE L’ASECNA : CAS DE L’AEROPORT INTERNTIONAL DE DOUALA Figure 1- 13: Fonctionnement cyclique d’un API I.6.3.3 Programmation Les automates programmables industriels disposent de plusieurs langages de programmation normalisés au plan mondiale par la norme CEI 61131-3. o Langage a liste d’instructions « IL » : C’est un langage textuel de même nature que l’assembleur (programmation des microcontrôleurs), très peu utilise par les automaticiens. o Langage littéral structure « ST » : C’est un langage informatique de même nature que le pascal. Il utilise la structure conditionnelle « if ... then ... else…» (Si…alors…sinon…) très peu utilise par les automaticiens. o Langage a contact « LD »: Langage graphique développé pour les électriciens, ils utilisent les symboles tel que les relais, contact et les blocs fonctionnels et s’organise en réseau (labels). C’est le plus utilisé. o Les langages Blocs fonctionnels (FBD) o SFC (Sequential Function Chart) ou GRAFCET. I.6.3.4 Principe de la supervision par automate La supervision par API réside sur une scrutation de la mémoire interne de l’automate. En effet, une mémoire automate est organisée en trois partitions : Mémoire de fin d’étude rédigé par KANKEU Bedouen en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur en Génie Industriel 25 DEVELOPPEMENT D’UNE APPLICATION MOBILE POUR LA SUPERVISION DU BILASAGE ET DES SYSTEMES ELECTRIQUES DE L’ASECNA : CAS DE L’AEROPORT INTERNTIONAL DE DOUALA La mémoire interne ou mémoire morte: elles permettent de mémoriser les données de l'automate (instructions des langages de programmations et blocs de données). Les données contenues dans cette mémoire sont des données de configuration matérielle et des données utilisateur : Elle sert de mémoire de chargement à l'automate. Elle transfère en permanence les données vers la RAM. Il s’agit des mémoires ROM, EPROM, EEPROM ou flash. La mémoire RAM : De nature volatile, elle est chargée du stockage temporaire des variables impliquées dans les opérations en cours dans l’unité arithmétique et logique (UAL). La mémoire système ou utilisateur : C’est la partition manipuler en permanence par l’automaticien (mémoire des cartes PCMCIA par exemple). Elle est organisée en trois sousensembles : o La mémoire (table) image des entrées : C’est celle utilisée pour l’adressage des entrées. o La mémoire image des sorties : Il s’agit de la partition allouée à l’adressage des sorties. o La mémoire interne : c’est la mémoire dans laquelle sont logées les variables partages par le calculateur et les autres contrôleurs. Les principales variables associées sont de type Mot (MW, 16bis) ayant pour sous multiples le bit Mot (M, 1bit) et l’octet Mot (MB, 8bits) et pour multiple le double mot (MD, 32bits). Les automates programmables industriels sont connectés aux équipements de niveaux 0 et 2 aux moyens des bus de terrain. I.6.4 Les bus et réseaux de terrain Interconnectant les équipements des niveaux 0,1, 2 et 3, les bus de terrains voient le jour suite à la nécessite optimiser l’utilisation de la connectique entre équipements (l’annexe 5 présente l’évolution des modes de raccordement). Ils sont généralement caractérises par le type d’équipements auxquels ils sont connectés. Ainsi à chaque niveau de la pyramide CIM, correspond un bus ou réseau de terrain : Les Sensors Bus (Bus de capteurs et d’actionneurs) : Il s’agit d’un bus aux temps de réponse très courts. Il requiert le plus souvent des actions réflexes au plus près des actionneurs. Exemple : AS-i, Bitbus, Seriplex, Jbus… Les Devices Bus : Ce sont des Bus et réseaux pour périphéries d’automatisme (variateurs de vitesse, robots,axes). Exemple : DeviceNet, WorldFIP, SDS, Interbus, Profibus DP, Modbus RTU, Mémoire de fin d’étude rédigé par KANKEU Bedouen en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur en Génie Industriel 26 DEVELOPPEMENT D’UNE APPLICATION MOBILE POUR LA SUPERVISION DU BILASAGE ET DES SYSTEMES ELECTRIQUES DE L’ASECNA : CAS DE L’AEROPORT INTERNTIONAL DE DOUALA Les Field Bus : Ce sont des bus de communication Inter-unités de traitement (automates programmables, superviseurs, commandes numériques). Exemple: Profibus FMS, Profibus PA, FieldBus WorldFIP, Modbus +… Les Data Bus : Il s’agit des réseaux locaux industriels. Ils sont utilisés pour l’établissement de la communication entre l’automatisme et le monde informatique Exemple: MMS (Manufacturing Message Spécification), Ethernet, FDDI, MAP, token Ring)… A l’annexe 6, le firmament des bus de terrains. Nous présentons dans la suite quelques protocoles de RLE ou RLI. I.6.4.1 Ethernet Un protocole de communication est un ensemble de règles et de procédures qui permettent d’émettre et de recevoir des données sur un réseau. Tandis que le réseau étendu Internet est conçu autour de la suite protocolaire TCP/IP (transmission control Protocol/Internet Protocol) donc les plus utilisés sont le http (HyperText Transfert Protocol), le FTP (File Transfert Protocol), l’IRC (Internet Relay Chat), Ethernet est un protocole de réseau local à commutation de paquets (mode d’acheminement de messages dans un réseau de télécommunication, où les messages sont préalablement découpés en paquets munis d’une adresse). Il est basé sur le principe de membres sur le réseau, envoyant des messages sous forme de trame, à l'intérieur d'un fil ou d'un canal commun. Utilisant, comme support de transmission le câble coaxial, la paire torsadée (câble RJ45) ou la fibre optique (constituant du cœur du réseau), Il s’appuie sur la technologie CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection, ‘Écoute de porteuse avec accès multiple et détection de collision’) pour régir la façon dont les postes accèdent au média. Ici, Chaque membre est identifié par une clé globalement unique, appelée adresse MAC (Media Access Control), pour s'assurer que tous les postes sur un réseau Ethernet aient des adresses distinctes sans configuration préalable. Bien qu'il implémente la couche physique et la sous-couche MAC du modèle IEEE 802.3, le protocole Ethernet est classé dans les couches de liaison de données (niveau 2) et physique (niveau 1) du modèle OSI (annexe 7). Les formats de trames que le standard définit sont normalisés et peuvent être encapsulés dans des protocoles autres que ses propres couches physiques sur-citées Mémoire de fin d’étude rédigé par KANKEU Bedouen en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur en Génie Industriel 27 DEVELOPPEMENT D’UNE APPLICATION MOBILE POUR LA SUPERVISION DU BILASAGE ET DES SYSTEMES ELECTRIQUES DE L’ASECNA : CAS DE L’AEROPORT INTERNTIONAL DE DOUALA Figure 1- 14: Format d’une trame de données sur Ethernet II Les réseaux dataBus (RLE) sont beaucoup plus des normes. Une implémentation d’Ethernet par Modbus est présentée à la figure 1-18. I.6.4.2 Uni-Telway Uni-Telway est un standard de communication entre constituants d'automatisme (API, Terminaux de dialogue, variateurs de vitesse, Commandes numériques,…). Il s’appuie sur 3 couches du modèle ISO et offre une communication entre équipements suivants les architectures Maître/Esclave, Esclave/ Esclave ou Maitre/Maitre. Figure 1- 15: Couches du protocole UNI-TelWay La couche UNI-TE consiste en une liste de requêtes communes à l'ensemble des équipements (requêtes standards) ou spécifiques à certains produits (requêtes spécifiques aux automates programmables ou aux commandes numériques). Elle offre les services suivants : Lecture/écriture d'objets (bits, mots, ...) ; Mémoire de fin d’étude rédigé par KANKEU Bedouen en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur en Génie Industriel 28 DEVELOPPEMENT D’UNE APPLICATION MOBILE POUR LA SUPERVISION DU BILASAGE ET DES SYSTEMES ELECTRIQUES DE L’ASECNA : CAS DE L’AEROPORT INTERNTIONAL DE DOUALA Gestion des modes de marche (Init, Run, Stop) ; Diagnostic bus et équipement ; Chargement et déchargement de fichiers et programmes ; Gestion de sémaphore. L’architecture d’une communication UNITELWAY est présentée à la figure suivante. Figure 1- 16: Architecture d’une communication Uni-TelWay I.6.4.3 Protocole MODBUS Modbus est le protocole de communication industriel introduit par Modicon (filiale de Schneider électrique) en 1979. Il est généralement utilisé avec les automates programmables ou les équipements de types industriels (équipements de niveau 0, 1 et 2). Devenu une norme dans le monde de l’automatisme et de la communication industrielle, il se décline en quatre versions afin de s’adapter à d’autres environnements : JBUS ou Modbus ASCII, Modbus RTU ou Série, Modbus TCP/IP, Modbus Plus. Principe de la communication Dans le protocole MODBUS, seul le maître est actif, les esclaves sont complètement passifs. Il est donc initiateur de toute communication et effectue de ce part, des requêtes de Mémoire de fin d’étude rédigé par KANKEU Bedouen en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur en Génie Industriel 29 DEVELOPPEMENT D’UNE APPLICATION MOBILE POUR LA SUPERVISION DU BILASAGE ET DES SYSTEMES ELECTRIQUES DE L’ASECNA : CAS DE L’AEROPORT INTERNTIONAL DE DOUALA lecture et d’écriture dans chaque esclave. Il peut également envoyer un message de broadcast [6]. Le maître réitère la question lors d’un échange erroné, et décrète l’esclave interrogé absent après une non-réponse dans un temps enveloppe donné. Figure 1- 17: Communication entre un maitre et trois esclaves en Modbus série. Les échanges entre équipements se font par petits paquets appelés trames. L’architecture d’une trame de donnée Modbus diffère selon ses variantes. Toutes fois, elle repose sur 3 couches du modèle OSI (Open System Interconnection) et ce conformément u modèle réduit OSI pour RLI de l’annexe 8. Figure 1- 18: Format d’une trame de données Modbus ASCII et Modbus série Plus concrètement, la trame d’une donnée Modbus (ASCII et série) est structurée comme suite : o Les bits de Start et de end o Numéro d'esclave sur 1 octet (le numéro 00 est réservé aux messages de diffusion) : Adresse de l'esclave sur le réseau ; o Code fonction (1 octet) : Code fonction à exécuter ; Mémoire de fin d’étude rédigé par KANKEU Bedouen en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur en Génie Industriel 30 DEVELOPPEMENT D’UNE APPLICATION MOBILE POUR LA SUPERVISION DU BILASAGE ET DES SYSTEMES ELECTRIQUES DE L’ASECNA : CAS DE L’AEROPORT INTERNTIONAL DE DOUALA o Données (n octets) : La quantité de données (n) contenues dans la trame dépend de la fonction utilisée (lecture/écriture) ; o CRC16 (2 octets) : il s’agit du code de contrôle de redondance cyclique (CRC) qui permet la détection des erreurs dans la trame de données. Figure 1- 19: Format de la trame de données en Modbus TCP/IP et Modbus Plus Remarque : 1) Le protocole Modbus RTU diffère du JBUS par la taille maximale de données pouvant être transmise. 2) Seule l’adresse de l’esclave figure dans la trame de données : Le maitre n’est pas adressé. 3) En Modbus TCP /IP et Modbus Plus, la trame de données contient en plus des informations citées plus haut, les adresses MAC (Media Access Control) des équipements communicants, les adresses du client et du serveur : Le format d’une adresse serveur ou client est celui d’une adresse IP (IPv4) ou XWAY. De plus, le CRC16 Modbus est supprimé car le protocole TCP intègre un CRC32. Quelques fonctions usuelles : Le protocole Modbus possède une grande quantité de code de fonctions. En annexe 9, quelques fonctions usuelles. I.6.4.4 Autres protocoles pour réseau de terrain Les fabricants de solution d’automatisme mettent sur pieds des protocoles afin d’optimiser les communications entre ses équipements. Nous pouvons citer entre autres : PROFIBUS dans Mémoire de fin d’étude rédigé par KANKEU Bedouen en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur en Génie Industriel 31 DEVELOPPEMENT D’UNE APPLICATION MOBILE POUR LA SUPERVISION DU BILASAGE ET DES SYSTEMES ELECTRIQUES DE L’ASECNA : CAS DE L’AEROPORT INTERNTIONAL DE DOUALA ses variantes PROFIBUS DP (Decentralised Peripherics), PA, MPS et PROFINET de Siemens, FIPWAY, AS-i (Actuator/Sensor- Interface), CAN (Controller Area Network), CANOpen. I.6.4.5 Critères de comparaison et de choix des bus de terrain Le CIAME (Comité Interprofessionnel pour l’Automatisation et la Mesure) propose un ensemble de critères (46) pour la comparaison des RLI. Ils sont repartis en deux sous-groupes [12] : Les critères techniques d’ordre : Topologique (longueur maximale et topologie physique du medium), Temporelle (Débit de transmission et le temps de rection maximal admissible), le nombre maximum d’équipements, l’efficacité du protocole et le type de détection d’erreurs. Les critères stratégiques : Les couches du modèle OSI activées et la certification du RLI. Les tableaux 1-1 et 1-2 suivant présentent les performances de quelques réseaux de terrain. Tableau 1- 2: Comparaison entre les réseaux de terrain (niveau physique) Mémoire de fin d’étude rédigé par KANKEU Bedouen en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur en Génie Industriel 32 DEVELOPPEMENT D’UNE APPLICATION MOBILE POUR LA SUPERVISION DU BILASAGE ET DES SYSTEMES ELECTRIQUES DE L’ASECNA : CAS DE L’AEROPORT INTERNTIONAL DE DOUALA Tableau 1- 3: Comparaison entre les réseaux de terrain (niveau liaison et application) Le choix d’un RLI est déterminé par : La criticité de l’application (temps de réponse) ; L’étendue géographique des installations; Les caractéristiques des équipements. I.6.5 Topologie des communications dans un système SCADA Il peut coexister différentes architectures de communication dans un système SCADA. Selon le nombre d’équipements utilisant le support on parle de : Communication point à point et Communication multipoint ; Selon le nombre de périphéries susceptibles d’initier une communication et le niveau d’abstraction des couches du modèle OSI, on parle de : Communication Maitre/EsclaveMaitre/Maitre-Esclave/Esclave- Serveur/client. Selon les sens possibles de la communication, on parle de communication simplex, half duplex, full duplex. Selon la simultanéité des échanges, on parle de: communication série (synchrone ou asynchrone) ou parallèle. Mémoire de fin d’étude rédigé par KANKEU Bedouen en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur en Génie Industriel 33 DEVELOPPEMENT D’UNE APPLICATION MOBILE POUR LA SUPERVISION DU BILASAGE ET DES SYSTEMES ELECTRIQUES DE L’ASECNA : CAS DE L’AEROPORT INTERNTIONAL DE DOUALA I.6.6 Interopérabilité entre équipements en milieu industriel L’interopérabilité est la faculté de communiquer de manière intelligible avec d’autres équipements. Des standards définissent les règles d’interopérabilité entre équipements en milieu industriel : I.6.6.1 Le standard OPC De l’acronyme Object Linked and Embedded for Process Control, OPC est un standard de communication entre équipements d’automatismes, d’instrumentation, de supervision, les systèmes MES et ERP en milieu industriel. Il est développé par l’OPC fondation dans l’objectif de : Standardiser les échanges de flux entre équipements hétérogènes communicants ; Limiter la prolifération des protocoles ; Faciliter la maintenance des communications ; Pérenniser les installations ; Donner le choix des fournisseurs aux utilisateurs ; Permettre aux exploitants de se concentrer sur leur métier. Les spécifications OPC s’articulent autour de : OPC DA (Data Access) : Il s’agit de l’accès aux données en temps réel ; OPC HDA (Historical Data Access) : Elle traite de l’historisation des données ; OPC A & E (Alarms and Events) : Il s’agit de la gestion des alarmes et évènements OPC UA (Unified Architecture). L’implémentation du standard OPC est basée sur les notions de serveur et client OPC. Le serveur OPC : S’installant par-dessus l’application originale, un serveur OPC présent sur un équipement est chargée de mettre à disposition les données de productions qui s’y trouvent aux autres équipements (Client OPC) quel que soit leur nature (conformément aux standard OPC). Le client OPC : Il s’agit d’un logiciel qui met en œuvre les spécifications du standard OPC et qui peut communiquer avec tout serveur OPC. Un client OPC peut donc se connecter à un serveur OPC de n’importe quel fabricant. Mémoire de fin d’étude rédigé par KANKEU Bedouen en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur en Génie Industriel 34 DEVELOPPEMENT D’UNE APPLICATION MOBILE POUR LA SUPERVISION DU BILASAGE ET DES SYSTEMES ELECTRIQUES DE L’ASECNA : CAS DE L’AEROPORT INTERNTIONAL DE DOUALA Figure 1- 20: Echange de données entre équipements OPC I.6.6.2 Le standard DDE Le standard DDE (Dynamics Data Exchange) est une norme développée par Microsoft et régissant les règles de communications entre équipements en milieu informatique. Tout comme l’OPC, la communication n’est possible qu’entre deux équipements compatibles DDE (un client DDE et un serveur DDE). I.6.6.3 Le standard SDO Le SDO (service Data Object) est quant à lui utilisé pour l’échange des données dans un réseau CANOpen. Un système SCADA exploite les standards d’interopérabilités pour échanger avec tous les équipements et est complété dans son architecture par un système de supervision. Mémoire de fin d’étude rédigé par KANKEU Bedouen en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur en Génie Industriel 35 DEVELOPPEMENT D’UNE APPLICATION MOBILE POUR LA SUPERVISION DU BILASAGE ET DES SYSTEMES ELECTRIQUES DE L’ASECNA : CAS DE L’AEROPORT INTERNTIONAL DE DOUALA I.7 GENERALITES SUR LA SUPERVISION A DISTANCE I.7.1 La supervision La supervision est l’ensemble des opérations associées à la conduite d’une installation industrielle aux moyens d’écran de supervision placés au poste de pilotage et rafraichis à chaque instant par les informations en provenance des automatismes et des capteurs intelligents. Parmi les tâches principales de la supervision se trouve la surveillance (détection et diagnostic) et l’aide à la décision [08]. Figure 1- 21: Fonctions d’un système de supervision D’ici, il ressort que la conception d’un système de supervision requiert la maitrise des techniques associées à l’acquisition des données, la surveillance et la commande [9]. Mémoire de fin d’étude rédigé par KANKEU Bedouen en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur en Génie Industriel 36 DEVELOPPEMENT D’UNE APPLICATION MOBILE POUR LA SUPERVISION DU BILASAGE ET DES SYSTEMES ELECTRIQUES DE L’ASECNA : CAS DE L’AEROPORT INTERNTIONAL DE DOUALA Figure 1- 22: Place de la supervision en industrie Pour de nombreuses raisons (zones à accès risqué, besoin de centralisation de la supervision,..) la supervision doit être distante (éloignée du l’équipement ou hors de la salle de contrôle). Il faut de ce fait compléter l’architecture du système SCADA existant. I.7.2 Architecture des systèmes distribués I.7.2.1 Architecture 1-Tier L’architecture 1-Tier est employée par les applications autonomes pour stocker les données, appliquer la logique métier et montrer les résultats. Ces applications autonomes fonctionnant sur un seul terminal, fournissent une interface utilisateur, manipulent toute entrée, valident les données et maintiennent la base de données. Mémoire de fin d’étude rédigé par KANKEU Bedouen en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur en Génie Industriel 37 DEVELOPPEMENT D’UNE APPLICATION MOBILE POUR LA SUPERVISION DU BILASAGE ET DES SYSTEMES ELECTRIQUES DE L’ASECNA : CAS DE L’AEROPORT INTERNTIONAL DE DOUALA Figure 1- 23: Architecture 1-Tier Une application qui implémente l’architecture 1-tier a les limitations suivantes : Connectivité et interopérabilité limitées ; Passage à l’échelle limité ; Pour la mise à jour et la correction des bugs, l’application doit être recompilée et redistribuée. Base de données asynchrones : un changement fait dans une base de données n’est pas reflétée dans les autres bases de données. I.7.2.2 Architecture 2-Tiers L’architecture 2-Tiers se compose de plusieurs clients et d’un serveur. Les clients se connectent au serveur à travers un réseau en utilisant des protocoles de réseau, tel que le TCP/IP : Ils implémentent l’interface utilisateur et contiennent la logique présentation. Le serveur contient la logique métier et stocke des données. Toutefois, les processus client et serveur peuvent fonctionner sur un ordinateur simple ou sur des ordinateurs séparés dans un réseau. Figure 1- 24: Architecture 2-Tier Mémoire de fin d’étude rédigé par KANKEU Bedouen en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur en Génie Industriel 38 DEVELOPPEMENT D’UNE APPLICATION MOBILE POUR LA SUPERVISION DU BILASAGE ET DES SYSTEMES ELECTRIQUES DE L’ASECNA : CAS DE L’AEROPORT INTERNTIONAL DE DOUALA Les avantages de l’architecture à deux niveaux sont : Partage des données : car l’ensemble des données sont stockées à un seul endroit, au niveau du serveur et est accessible à tous les utilisateurs; Augmentation du passage à l’échelle par rapport à l’architecture 1-Tier. Elle peut s’adapter à environ 100 utilisateurs, permettant à plusieurs clients de se connecter au serveur. Simplicité de mise à jour : Si une modification doit être apportée au programme, il est souvent suffisant de la déployer en un seul point unique ; Au niveau du serveur. Comme inconvénients : Trafic élevé sur le réseau : De larges volumes de données sont transférées sur le réseau entre le client et le serveur. Le débit élevé augment la charge sur les ressources du réseau. Charge sur le serveur : Tous les clients dans cet architecture accèdent au serveur et ceci augment la charge du serveur.la charge accrue sur le serveur réduit son exécution. I.7.2.3 Architecture 3-tiers L’architecture 3-tier divise chaque application en trois couches logiques séparées : La couche présentation, la couche métier et la couche données. La couche présentation contient l’interface utilisateur, La couche métier effectue le contrôle du processus métier ou la logique et les règles fonctionnelles sont exécutées. La couche données se charge du stockage de données et y contrôle les données. Dans cette architecture, le composant de gestion des données s’assure que les données sont conformes dans tout l’environnement distribué. Figure 1- 25: Architecture 3-Tier Mémoire de fin d’étude rédigé par KANKEU Bedouen en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur en Génie Industriel 39 DEVELOPPEMENT D’UNE APPLICATION MOBILE POUR LA SUPERVISION DU BILASAGE ET DES SYSTEMES ELECTRIQUES DE L’ASECNA : CAS DE L’AEROPORT INTERNTIONAL DE DOUALA L’architecture 3-Tier est utile dans un environnement distribué de client/serveur. Leur conception cache à l’utilisateur, la complexité du traitement distribué et fournit une exécution, une flexibilité, un entretien, une réutilisabilité et un passage à l’échelle accrus comparé à l’architecture 2-tier. I.7.2.4 Architecture n-tiers L’architecture à plusieurs niveaux peut contenir un nombre illimité de couches. Dans un scenario a quatre-Tiers, nous pouvons avoir : Le Tiers-client ; la couche service Web ; la couche métier et la couche données. Le Tiers client contient les systèmes clients, la couche présentation contient le serveur web, la couche métier contient le serveur d’application et la couche données contient la base de données. I.7.3 La supervision industrielle Les solutions de supervision ont évolué conséquemment avec le type d’industrie (1.0, 2.0 ,3.0 et 4.0), avec la technologie employée par cette dernière et à la complexité des installations. Allant du simple voyant lumineux monté sur équipement sur terrain (industrie 1.0), elle associe de nos jours une concentration des données en un seul poste appelé salle de contrôle (industrie 3.0) et une déportation de ces données sur internet (industrie 4.0). Ainsi, à l’ère de l’IIoT (Industrial Internet of Things), la supervision en milieu industriel nécessite un outil adéquat afin de respecter les contraintes liées à l’étendue (géographique) et à la complexité du processus industriel, à l’hétérogénéité des calculateurs intégrés et au flot de données (souvent de l’ordre du millier de variables) régissant son fonctionnement. De même, la mobilité des données et l’aspect temps réel doivent être des exigences clés de conception ou de choix d’une solution de supervision. Il existe de ce fait une panoplie de solution en supervision industrielle qui bien que prônant des concepts différents, s’appuient toute la même architecture de base. Mémoire de fin d’étude rédigé par KANKEU Bedouen en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur en Génie Industriel 40 DEVELOPPEMENT D’UNE APPLICATION MOBILE POUR LA SUPERVISION DU BILASAGE ET DES SYSTEMES ELECTRIQUES DE L’ASECNA : CAS DE L’AEROPORT INTERNTIONAL DE DOUALA Figure 1- 26: Architecture d’un logiciel de supervision industrielle Tableau 1- 4: Quelques superviseurs commerciaux Mémoire de fin d’étude rédigé par KANKEU Bedouen en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur en Génie Industriel 41 DEVELOPPEMENT D’UNE APPLICATION MOBILE POUR LA SUPERVISION DU BILASAGE ET DES SYSTEMES ELECTRIQUES DE L’ASECNA : CAS DE L’AEROPORT INTERNTIONAL DE DOUALA I.8 CONCEPTS THEORIQUES I.8.1 Analyse UML I.8.1.1 Diagramme des cas d’utilisation Le diagramme des cas d’utilisation a pour but de présenter le système tel que perçu par l’utilisateur final de l’extérieur. Il ressort donc les fonctionnalités de l’application et les interactions entre ces fonctionnalités en répondant à la question «Qui peut faire quoi ?». Elaborer à partir du cahier de charge, Il laisse donc apparaitre les acteurs, les cas d’utilisation et les relations qui les lient. Les acteurs : C’est un rôle jouer par une personne, une chose ou un sous-système qui interagir de l’extérieur avec le futur système. Les cas d’utilisation : Il représente une fonctionnalité ou un service offert par le système. Les relations : o Relation d’association (unidirectionnelle ou bidirectionnelle) : elle existe uniquement entre un acteur et cas d’utilisation. Elle permet de déterminer l’acteur qui peut mettre en marche un service ou qui sera utiliser pour exécuter un service. o L’inclusion : Elle impose la dépendance obligatoire d’un cas d’utilisation par rapport à un autre. o La généralisation/héritage: elle peut se faire entre deux acteurs ou deux cas d’utilisation. o L’extension a) b) c) Figure 1- 27: Eléments d’un diagramme de cas d’utilisation a) acteur, b) cas d’utilisation, c) Héritage/Généralisation entre cas d’utilisation, extension et inclusion Mémoire de fin d’étude rédigé par KANKEU Bedouen en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur en Génie Industriel 42 DEVELOPPEMENT D’UNE APPLICATION MOBILE POUR LA SUPERVISION DU BILASAGE ET DES SYSTEMES ELECTRIQUES DE L’ASECNA : CAS DE L’AEROPORT INTERNTIONAL DE DOUALA I.8.1.2 Diagramme de séquences Le diagramme de séquences décrit étape par étape les actions à mener lorsqu’un cas d’utilisation est déclenchée. Il permet donc de représenter des échanges entre les différents objets et acteurs du système en fonction du temps, ceci en prévoyant tous les cas possibles et imaginables. Sur un diagramme de séquences, on peut voir, Les acteurs : Ce sont les acteurs du diagramme cas d’utilisation ; Les objets : Ils représentent tout élément qui va intervenir dans notre système en faisant partir de ce dernier ; La ligne de vie : Elle représente l’évolution de l’élément dans le temps et de manière chronologique. C’est un trait vertical. Les messages : Un message correspond tout simplement à l’appel d’un service a) b) c) d) Figure 1- 28: Eléments d’un diagramme de séquences : a) Acteur, b) Objet, c) Ligne de vie, de l’objet, d) Message synchrone I.8.2 Conception UML I.8.2.1 Diagramme des classes Le diagramme des classes permet de représenter la structure interne du futur logiciel. Il sert d’élément de transition entre la modélisation orientée objet et la programmation orientée objet et s’appuie sur les éléments suivants : Les classes (ordinaires et abstraites) Mémoire de fin d’étude rédigé par KANKEU Bedouen en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur en Génie Industriel 43 DEVELOPPEMENT D’UNE APPLICATION MOBILE POUR LA SUPERVISION DU BILASAGE ET DES SYSTEMES ELECTRIQUES DE L’ASECNA : CAS DE L’AEROPORT INTERNTIONAL DE DOUALA Une classe est constituée de son nom, des attributs (définit par un nom et un type) et des méthodes (constructeurs, destructeurs, sélecteurs, multiplicateurs, itérateurs et bien d’autres opérations auxquelles peuvent se prêter les instances de la classe). Ces éléments internes à une classe utilisent la notion de visibilité (public, protected, private et packatage) pour être accessible de l’extérieur ou non. Une classe est die abstraite lorsqu’elle peut être instanciée et abstraite dans le cas contraire. Une classe est abstraite lorsqu’elle possède au moins une méthode abstraite. Les interfaces et les associations L’association est la relation qui existe entre deux classes. Il peut s’agir d’une association simple, d’une agrégation, d’une composition, d’une généralisation auquel on associe une multiplicité. L’interface est une plateforme sur laquelle les classes offrent leurs méthodes à d’autres classes. a) b) c) Figure 1- 29: Eléments d’un diagramme de classe: a) Acteur, b) Objet, c) Ligne de vie, de l’objet, d) Message synchrone Conclusion Dans ce chapitre, il était question pour nous de présenter le contexte, la problématique engendrant notre thème et les généralités nécessaires à la compréhension du travail qui sera effectué. Dans le chapitre qui suit, nous ferons un suivi des données de supervision à la centrale et présenterons les aspects méthodologiques adoptés. Mémoire de fin d’étude rédigé par KANKEU Bedouen en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur en Génie Industriel 44 DEVELOPPEMENT D’UNE APPLICATION MOBILE POUR LA SUPERVISION DU BILASAGE ET DES SYSTEMES ELECTRIQUES DE L’ASECNA : CAS DE L’AEROPORT INTERNTIONAL DE DOUALA CHAPITRE II : ETUDE DE L’EXISTANT ET ASPECTS METHODOLOGIQUES I ETUDE DE L’EXISTANT I.1 Le RLE L’unité ELB baigne dans la topologie étoilée du réseau Ethernet de l’ASECNA et dont quelques caractéristiques sont : Topologie logique : Ethernet norme IEE 802.3 ; Topologie physique : Etoile ; Transmission de signaux en bande de base ; Méthode d’accès au medium : CSMA/CD ; Support passif (c’est l’alimentation des ordinateurs allumés qui fournit l’énergie au support) ; Support de transmission : paire torsadée et fibre optique (cœur du réseau) ; Connecteurs : BNC, RJ45, Baies à multiplexeurs optiques, Switch ; Débit de 10 Mbps à 10Gbps ; Trames de 64 à 1518 Octets. L’essentiel des informations échangées entre la centrale et les six (06) départements techniques consistent en : Des données TOR ; Les signaux de télécommande et de télésignalisation des AIDES NAV ; Les signaux pour terminaux IP de la chaine CONCERTO IP ; Les signaux pour terminaux de la chaine RADIO NUCLEO CD 30 à interface E1 à 2MBPS ; Les signaux de synchronisation horaire via les interfaces E/M pour panneaux d’affichage horaire ; Les signaux de synchronisation entre la chaine RADIO CONCERTO IP et les terminaux déportés du CDIV (Centre Délégué d’Information en Vol) ; Mémoire de fin d’étude rédigé par KANKEU Bedouen en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur en Génie Industriel 45 DEVELOPPEMENT D’UNE APPLICATION MOBILE POUR LA SUPERVISION DU BILASAGE ET DES SYSTEMES ELECTRIQUES DE L’ASECNA : CAS DE L’AEROPORT INTERNTIONAL DE DOUALA Les signaux de synchronisation entre la centrale horaire et le système de traitement des données RADAR « TOPSKY » ; Les signaux en direction des interfaces pour l‘enregistrement des conversations audio basse fréquences des postes de chaine RADIO CONCERTO IP (hauts parleurs, microphones et casques) déportées au CDIV et l’acquisition des données des équipements Météo en bout de piste. I.2 Les supports de transmission I.2.1 La fibre optique La transmission des données sur-citées se fait essentiellement par fibre optique. La contrainte de continuité (redondance des canaux de transmission) impose au réseau à fibre optique une architecture à boucle en anneau (Figure 2-1) au détriment du point à point ; Les échanges quant à eux étant basés sur le protocole SONET/SDH (Synchronous Optical Networks/ Synchronous Digital Hierarchy) au détriment du PDH (Plesiochronous Digital Hierarchy). Mémoire de fin d’étude rédigé par KANKEU Bedouen en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur en Génie Industriel 46 DEVELOPPEMENT D’UNE APPLICATION MOBILE POUR LA SUPERVISION DU BILASAGE ET DES SYSTEMES ELECTRIQUES DE L’ASECNA : CAS DE L’AEROPORT INTERNTIONAL DE DOUALA 12 brins 12 brins 12 brins 12 brins 12 brins 12 brins Météo Figure 2- 1: Diagramme fonctionnel de la transmission à fibre Optique I.2.2 La paire torsadée La paire torsadée existe sur variantes à savoir : L’UTP (.Unshielded Twisted Pair) : Paire torsadée non blindée, Utilisée en environnement ordinaire; La FTP (Foiled Twisted Pair): Câble blindé avec une mince feuille d’aluminium ou feuillard, utilisé en environnement. La SFTP (Shielded Foiled Twisded Pair) : Câble représentant les propriétés STP et FTP ; La SSFTP (Shielded Shielded Twisted Pair): Câble doublement blindé. La version FTP est utilisée dans ses variantes 2fils et 4fils (Câble RS 485) pour la connexion des équipements en Jbus et Modbus série. Sa variante a 8 fils (Câble RJ45) étant employée pour la communication en Modbus over Ethernet. Mémoire de fin d’étude rédigé par KANKEU Bedouen en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur en Génie Industriel 47 DEVELOPPEMENT D’UNE APPLICATION MOBILE POUR LA SUPERVISION DU BILASAGE ET DES SYSTEMES ELECTRIQUES DE L’ASECNA : CAS DE L’AEROPORT INTERNTIONAL DE DOUALA I.3 Le RLI : Système de communication engageant la centrale Figure 2- 2: Schéma de principe du réseau de transmission engageant la centrale I.3.1 La communication Jbus L’automate de balisage et les quatorze (14) régulateurs d’intensité du balisage échangent des données au moyen du protocole Jbus suivant la technique « Maitre /Esclave » où l’API de balisage est le maitre et les régulateurs les esclaves adressés (Tableau 2.1). Utilisant comme support La paire torsadée blindée (câble RS485 2fils), l’essentiel des données de télécommande du balisage en provenance de la tour et la remontée de l’état général de tous les régulateurs s’effectue sur ce canal redondant (Figure 2-2): les modes normal et secours. Mémoire de fin d’étude rédigé par KANKEU Bedouen en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur en Génie Industriel 48 DEVELOPPEMENT D’UNE APPLICATION MOBILE POUR LA SUPERVISION DU BILASAGE ET DES SYSTEMES ELECTRIQUES DE L’ASECNA : CAS DE L’AEROPORT INTERNTIONAL DE DOUALA I.3.2 La communication MODBUS série C’est ce protocole qui permet une communication half-duplex redondante entre l’API de balisage et les coffrets maitres du RTLIS 12, RTILS 30 et Balle traçante (Figure 2-2).les échanges interfacés par les passerelles ETG100, s’effectuent suivant une architecture clientserveur. Ce protocole régit également les communications entre les coffrets maitres et esclaves des feux à éclat du RTILS 12 (deux esclaves), RTILS 30 (deux esclaves) et balle traçante (29 esclaves). L’adressage est celui du tableau 2.1. Le support de transmission utilisée est la paire torsadée blindée. Tableau 2- 1: Liste des adresses MODBUS RS485 Désignation Adresse Régulateur Piste 1 1 Régulateur Piste 2 2 Régulateur Seuil & Extrémité 1 3 Régulateur Seuil & Extrémité 2 4 Régulateur Taxiway 1 5 Régulateur Taxiway 2 6 Régulateur PAPI 12 7 Régulateur PAPI 30 8 Régulateur Approche BI 9 Régulateur Approche HI 1 10 Régulateur Approche HI 2 11 Coffret Maitre RTILS 12 1 Coffret Maitre RTILS 30 2 Coffret Maitre Balle Traçante 3 Esclaves RTILS 12 (02) 1-2 Esclaves RTILS 30 (02) 1-2 Esclaves Balle Traçante (29) 1 à 29 Mémoire de fin d’étude rédigé par KANKEU Bedouen en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur en Génie Industriel 49 DEVELOPPEMENT D’UNE APPLICATION MOBILE POUR LA SUPERVISION DU BILASAGE ET DES SYSTEMES ELECTRIQUES DE L’ASECNA : CAS DE L’AEROPORT INTERNTIONAL DE DOUALA I.3.3 La communication MODBUS TCP/IP MODBUS TCP/IP est une implémentation de Modbus pour la communication sur Ethernet, Il utilise comme support la paire torsadée a 9 fils (câble RJ45) et régit dans une architecture client-serveur, les échanges entre : o L’API de supervision et le poste de supervision local (logiciel PCVUE 32); o L’API de balisage et le poste de supervision local ; o L’API de supervision et l’API de balisage ; o L’API de supervision et le contrôleur du synoptique murale ; o L’API de supervision et le coupleur VOR ; o L’API de supervision et le coupleur Glide; o L’API de supervision et le coupleur station météo; o L’API de supervision et le coupleur Glide; o L’API de supervision et le coupleur Localizer; o L’API de supervision et le coupleur Bloc technique; o L’API de Balisage et le coupleur VIGIE; o Les convertisseurs Modbus série -Modbus TCP/IP et Modbus TCP/IP-Modbus série Le tableau suivant donne l’adressage réseau des équipements engagés dans cette architecture. Tableau 2- 2: Adresses réseaux des équipements Désignation Adresse API Supervision 160.50.1.1 Wago du Synoptique Mural 160.50.1.2 Wago du Glide 160.50.1.3 Wago du VOR/DME 160.50.1.4 Wago de la station Météo 160.50.1.6 Wago Bloc Technique info TOR 160.50.1.7 Wago Salle Electrique info TOR 160.50.1.8 API Balisage 160.50.2.1 Mémoire de fin d’étude rédigé par KANKEU Bedouen en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur en Génie Industriel 50 DEVELOPPEMENT D’UNE APPLICATION MOBILE POUR LA SUPERVISION DU BILASAGE ET DES SYSTEMES ELECTRIQUES DE L’ASECNA : CAS DE L’AEROPORT INTERNTIONAL DE DOUALA Wago Platine VIGIE 160.50.1.10 ETG100 (RTILS 12 et Balle Traçante) voie normale 160.50.1.20 ETG100 (RTILS 12 et Balle Traçante) voie secoure 160.50.1.21 ETG100 (RTILS 30) voie normale 160.50.1.22 ETG100 (RTILS 30) voie secoure 160.50.1.23 ETG100 (Centrale) voie normale 160.50.1.30 ETG100 (Centrale) voie secoure 160.50.1.31 I.3.4 La communication filaire Présent dans tous les locaux, la communication filaire s’appuie sur du câble coaxiale et sert de support de collecte de données d’équipements terrain (état des appareillages électriques et d’alimentation dans les locaux, commande et retour commande sur platine VIGIE, signalisation sur synoptique mural unifilaire général et synoptique mural unifilaire CDE). La logique câblée qui couvre l’automatisme des quatre (04) groupes électrogènes utilise évidemment le câble coaxial. I.3.5 La communication Uni-Telway Uni-Telway est implémenté à la centrale dans son architecture Maitre-Maitre. il utilise comme support le câble RS 232 et régit les échanges half-duplex entre l’API des groupes et TGBT et l’API de supervision. I.3.6 Les équipements réseaux Les signaux de supervision en provenance des différents locaux passent par un ensemble d’équipements réseaux. I.3.6.1 Les convertisseurs Ethernet/RS485 : Passerelles ETG100 et TU8005 Les passerelles ETG100 sont des équipements électroniques utilisés pour connecter les RTILS 12&30 et la balle traçante (en Modbus) au réseau Ethernet (Figure 2-2). Au nombre de six (06) sur les trois (03), ils établissent une connexion permanente entre le l’API de balisage, la balle traçante et les RTILS 12&30. On retrouve : Mémoire de fin d’étude rédigé par KANKEU Bedouen en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur en Génie Industriel 51 DEVELOPPEMENT D’UNE APPLICATION MOBILE POUR LA SUPERVISION DU BILASAGE ET DES SYSTEMES ELECTRIQUES DE L’ASECNA : CAS DE L’AEROPORT INTERNTIONAL DE DOUALA Deux (02) au poste PO (ETG100 normal et secouru) : Ils fonctionnent simultanément et convertissent la trame de données de télécommande en Modbus série, des feux de balle traçante et RTILS 12&30 en provenance de l’API balisage en trame Modbus TCP/IP. Deux (02) au GLIDE/DME (ETG100 normal et secours) : Ils assurent la conversion bidirectionnelle des trames de données TCP/IP (signaux de télécommandes en provenance de l’API Balisage) en Modbus série en direction de deux cartes LMC (Local Master Controller) pilotant les deux (02) cartes FCU (Flight Control Unit) du RTILS 30 et les vingt-neuf (29) cartes FCU de la balle traçante. Deux (02) au Localizer (ETG100 normal et secours) : Ils assurent la conversion bidirectionnelle des trames de données TCP/IP (signaux de télécommandes en provenance de l’API Balisage) en Modbus série en direction de la carte LMC pilotant les deux (02) cartes FCU du RTILS 12. Figure 2- 3: Vue externe d’une passerelle ETG100 I.3.6.2 Les multiplexeurs optiques Un multiplexeur optique est un circuit électronique utilisé en communication dans le but non seulement de faire passer simultanément plusieurs données sur un même support, mais de réaliser également une interface entre les signaux réseaux (signaux Ethernet) et signaux lumineux (signaux empruntant pour support la fibre optique). Mémoire de fin d’étude rédigé par KANKEU Bedouen en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur en Génie Industriel 52 DEVELOPPEMENT D’UNE APPLICATION MOBILE POUR LA SUPERVISION DU BILASAGE ET DES SYSTEMES ELECTRIQUES DE L’ASECNA : CAS DE L’AEROPORT INTERNTIONAL DE DOUALA Cette opération peut s’agir : Un multiplexage temporel (TDM, Time Division Multiplexing) : Cette technique consiste à affecter à tour de rôle et à un signal unique la totalité de la bande passante pendant un court instant. Le Multiplexeur optique se comporte comme un commutateur et alloue à tour de rôle, à chaque signal, un temps t de diffusion sur le media (Figure 2-4a). Un multiplexage en longueur d’onde (WDM, Wavelength Division Multiplexing) : il s’agit d’une technique au cours de laquelle on alloue une fraction de la bande passante de la fibre à chaque signal. Il est ainsi envoyer sur une seule fibre N porteuses optiques à différentes longueurs d’onde transmettant chacune à un débit 𝐷𝑏. Toutefois, la mise en œuvre de cette technique nécessite le conditionnement préalable de chaque signal à l’aide des transceivers ou transpondeurs : on parle de modulation en amplitude et/ou en phase (Figure 2-4b). Les types de multiplexage en longueur d’onde ainsi que leurs caractéristiques sont présentés au tableau 2-3. Un multiplexage par code a) b) Figure 2- 4: Principe multiplexage : a) Temporel, b) Fréquentiel Mémoire de fin d’étude rédigé par KANKEU Bedouen en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur en Génie Industriel 53 DEVELOPPEMENT D’UNE APPLICATION MOBILE POUR LA SUPERVISION DU BILASAGE ET DES SYSTEMES ELECTRIQUES DE L’ASECNA : CAS DE L’AEROPORT INTERNTIONAL DE DOUALA Tableau 2- 3: Types de multiplexage fréquentiel I.4 Equipements supervisés : Principe de la mesure et paramètres surveillés I.4.1 L’appareillage électrique L’appareillage électrique est l’ensemble du matériel permettant la mise sous ou hors tension des portions d’un réseau électrique. Conformément à la norme NFC 15-100, l’appareillage électrique a pour fonction principal la protection des personnes et des biens. Elle consiste donc à des appareils permettant : Séparer et Condamner : Les sectionneurs, sectionneurs portes fusible, les interrupteurssectionneurs. Protéger contre les surintensités (court-circuit) : Disjoncteurs magnétiques, disjoncteurs magnétothermiques, les fusibles, relais magnétiques. Protéger contre les surcharges : Disjoncteurs magnétothermiques, relais thermiques Protéger contre les défauts d’isolement : Disjoncteurs différentiels, interrupteurs différentiels. Etablir et interrompre l’énergie : contacteurs Dans la suite, nous nous intéresserons à ceux présent à la centrale et donc les états remontent à l’automate. Mémoire de fin d’étude rédigé par KANKEU Bedouen en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur en Génie Industriel 54 DEVELOPPEMENT D’UNE APPLICATION MOBILE POUR LA SUPERVISION DU BILASAGE ET DES SYSTEMES ELECTRIQUES DE L’ASECNA : CAS DE L’AEROPORT INTERNTIONAL DE DOUALA I.4.4.1 Les appareils Les contacteurs: Ce sont des appareils d’électrotechnique destinés à établir ou interrompre le passage du courant, à partir d'une commande électrique ou pneumatique. Les sectionneurs : Appareils électromécanique permettant de séparer, de façon mécanique, un circuit électrique de son alimentation, tout en assurant physiquement une distance de sectionnement satisfaisante électriquement. Assister de fusible, ils assurent également la fonction de protection contre les court circuits. A la différence du disjoncteur ou de l'interrupteur, n'a pas de pouvoir de coupure, ni de fermeture Interrupteurs: Organes physiques ou virtuels, permettant d'interrompre ou d'autoriser le passage d'un flux. Disjoncteurs différentiels : Dispositifs électromécaniques, voire électroniques, de protection dont la fonction est d'interrompre le courant électrique en cas d'incident sur un circuit électrique. Il est capable d'interrompre un courant de surcharge ou un courant de courtcircuit dans une installation. Disjoncteurs de mesure : ils permettent de remonter la présence ou l’absence de signal. I.4.4.2 Symbolisation des appareils des TGBT et TDBT de la centrale et principe de la mesure : L’appareillage électrique du TGBT et TDBT est constitué d’équipements qui possèdent en général deux états : L’état fermé (NC, Normally Close): c’est l’état de fonctionnement normal. L’état ouvert (NO, Normally Open): il correspond à un état où l’appareil est disjoncté ou en défaut. La mesure consiste à associer à chaque appareil, un contact auxiliaire adéquat possédant deux entrées (NO, NC). Ce dernier permet d'envoyer un signal indiquant la position des contacts en fonction de l'état de l’appareillage électrique auquel il est accouplé. I.4.4.3 Application du principe de la mesure à un disjoncteur magnétothermique unipolaire Le contact auxiliaire a trois bornes (11, 12, 14) est le contact de mesure (Figure 2-5). Mémoire de fin d’étude rédigé par KANKEU Bedouen en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur en Génie Industriel 55 DEVELOPPEMENT D’UNE APPLICATION MOBILE POUR LA SUPERVISION DU BILASAGE ET DES SYSTEMES ELECTRIQUES DE L’ASECNA : CAS DE L’AEROPORT INTERNTIONAL DE DOUALA La borne 11 est la borne commune : c’est alimentation qui généralement est du 12V ou 24V. L’entrée 12 est le contact NO : Dans la configuration d’usine, son niveau est haut (12V ou 24V) : Le disjoncteur est ouvert. L’entrée 14 est le contact NC : la fermeture du disjoncteur entraine le basculement du contact mobile du commun (11) de 12 vers 14. L’entrée 14 passe à l’état haut (12 ou 24) : le disjoncteur est fermé. Figure 2- 5: Acquisition des états d’un disjoncteur magnétothermique unipolaire. Il un extrait des équipements et paramètres surveilles des TGBT et TDBT est représenté en annexe 20. I.4.2 Les groupes électrogènes I.4.2.1 Caractéristiques des groupes électrogènes La centrale dispose d’un parc de six (06) groupes électrogènes et dont quatre (04) sont connectés à l’automatisme. Il s’agit de quatre groupes électrogènes diesel de marque CUMMINS Renault d’une puissance de 250KVA chacun donc les caractéristiques sont représentées en annexe 10. Mémoire de fin d’étude rédigé par KANKEU Bedouen en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur en Génie Industriel 56 DEVELOPPEMENT D’UNE APPLICATION MOBILE POUR LA SUPERVISION DU BILASAGE ET DES SYSTEMES ELECTRIQUES DE L’ASECNA : CAS DE L’AEROPORT INTERNTIONAL DE DOUALA Figure 2- 6: Les groupes électrogènes I.4.2.2 Mesure des paramètres Chaque groupe électrogène est entièrement intégré à l’automatisme par une logique câblée, ceci au moyen de quatre (04) cartes électroniques à sorties TOR. Il s’agit des cartes électriques de contrôle de vitesse (à sorties analogiques), de fuel, de l’alternateur et du système de démarrage. Mémoire de fin d’étude rédigé par KANKEU Bedouen en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur en Génie Industriel 57 DEVELOPPEMENT D’UNE APPLICATION MOBILE POUR LA SUPERVISION DU BILASAGE ET DES SYSTEMES ELECTRIQUES DE L’ASECNA : CAS DE L’AEROPORT INTERNTIONAL DE DOUALA a) b) c) Figure 2- 7: Cartes électroniques de contrôle d'un groupe électrogène CUMMINS Ainsi, vingt-neuf (29) paramètres surveillés relatifs au système de démarrage (04), au moteur (05), à l’alternateur (04) et au système de contrôle-commande (16) remontent à l’automate des groupes et TGBT pour chaque groupe. En exemple, la température huile moteur et celle de l’eau de refroidissement sont donnés par des thermocouples à sortie analogique (K19 KTA 3015238) donc l’étendue de mesure est [40; 130]0C. Leur sorties sont reliées à la carte électronique CSC (speed Control for Cummins PT Fuel System) de contrôle de vitesse (Figure 2-7). Cette dernière en délivre un signal TOR selon que la valeur de lv température soit supérieure ou inférieure à 90℃. Il est inséré en annexe 11, la datasheet de cette carte et en annexe 22 un tableau répertoriant quelques paramètres surveillés pour chaque groupe. Mémoire de fin d’étude rédigé par KANKEU Bedouen en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur en Génie Industriel 58 DEVELOPPEMENT D’UNE APPLICATION MOBILE POUR LA SUPERVISION DU BILASAGE ET DES SYSTEMES ELECTRIQUES DE L’ASECNA : CAS DE L’AEROPORT INTERNTIONAL DE DOUALA I.4.3 Les onduleurs ASI Encore appelés ASSC (Alimentation Statique sans Interruption), les onduleurs ASI 250KVA d’ADB sont des convertisseurs bidirectionnels de l’énergie électrique qui ont comme fonction de base, de fournir une alimentation fixe à la charge quel que soit les intempéries du réseau électrique amont. Ils sont donc constitués d’un convertisseur AC/DC (redresseur), d’un parc de batteries (qui assure l’alimentation des installations électriques pendant le régime transitoire des groupes en cas de blackout) et d’un convertisseur DC/AC (onduleur). Ils peuvent donc fonctionner en mode double conversion et donc l’état peut le mode normal ou le mode autonomie. Figure 2- 8: Onduleur en mode double conversion Au nombre de deux à la centrale, un circuit de BAYPASS (Figure 2-8) permet de palier à leur indisponibilité. De ce fait, 12 paramètres remontent à l’automate de groupes et TGBT suivant le protocole JBUS via une liaison RS232. Il est inséré en annexe 13, un tableau présentant entre autre, un extrait des paramètres onduleurs surveillés. I.4.4 Les régulateurs de balisage Les régulateurs de balisage MCR3 d’ADB sont des régulateurs à thyristors contrôlés par microprocesseur. Ils exécutent la fonction basique de régulateur à courant constant (RCC) et sont spécialement conçus pour l’alimentation à différents niveaux de brillance des circuits série de balisage lumineux des aéroports. Mémoire de fin d’étude rédigé par KANKEU Bedouen en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur en Génie Industriel 59 DEVELOPPEMENT D’UNE APPLICATION MOBILE POUR LA SUPERVISION DU BILASAGE ET DES SYSTEMES ELECTRIQUES DE L’ASECNA : CAS DE L’AEROPORT INTERNTIONAL DE DOUALA I.4.4.4 Caractéristiques Autre leur fonction de base, ils sont dotés des fonctionnalités suivantes : Contrôle et régulation du régulateur entièrement numériques ; Interface homme-machine intégrée pilotée par menus permettant une configuration totale sur site sans équipement supplémentaire ; Fonctionnalités de diagnostic de maintenance à distance évolutives ; Option d’intégration de la fonction maître AGLAS (commande et contrôle individuel des feux) ou de sélecteur de circuits ; Excellente dynamique de régulation ; Circuit limiteur de tension en cas de variation de charge importante (surintensité) dans la boucle de balisage (disponible en 2006) ; Télécommande et télésignalisation disponibles en fil-à-fil et en simple ou en double J-Bus ; Mémoire de type flash permettant la mise à jour à distance du régulateur ou son paramétrage ; Entièrement autonome, tant pour la configuration que pour l’utilisation. On recense 11 régulateurs connectés à l’automate de balisage à savoir : Les régulateurs de piste 1 & 2, les régulateurs de seuils et extrémités 1 & 2 , les régulateurs d’approche HI 1 & 2, le régulateur d’approche BI, les régulateurs de PAPI 12 & 30, le régulateur parking A & B, le régulateur parking C. Le balisage est complété par les feux de RTILS 12 & 30 et la balle traçante. Mémoire de fin d’étude rédigé par KANKEU Bedouen en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur en Génie Industriel 60 DEVELOPPEMENT D’UNE APPLICATION MOBILE POUR LA SUPERVISION DU BILASAGE ET DES SYSTEMES ELECTRIQUES DE L’ASECNA : CAS DE L’AEROPORT INTERNTIONAL DE DOUALA Figure 2- 9: Régulateur 1 Piste 20 KVA I.4.4.5 Paramètres surveillés Chaque régulateur échange 21 paramètres avec l’API de balisage sur la liaison Jbus commune. La figure ci-dessous laisse paraitres les paramètres surveillés pour un régulateur. Toutefois, un extrait détaillé de ces derniers est reporté en annexe 22. Mémoire de fin d’étude rédigé par KANKEU Bedouen en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur en Génie Industriel 61 DEVELOPPEMENT D’UNE APPLICATION MOBILE POUR LA SUPERVISION DU BILASAGE ET DES SYSTEMES ELECTRIQUES DE L’ASECNA : CAS DE L’AEROPORT INTERNTIONAL DE DOUALA Figure 2- 10: Paramètres surveillés sur un régulateur I.4.5 Les transformateurs Il s’agit d’un parc de 11 transformateurs repartis comme suite : Deux (02) transformateurs abaisseurs 15KV/400V; Il s’agit des transformateurs le grand 400KVA ; Quatre (04) cellules élévatrices 400V/3,2kV ; Quatre (04) cellules élévatrices 3,2kV/400V ; Un (01) transformateur élévateur 400v/5,5kV ; Les paramètres surveillés pour chaque transformateur sont récapitulés en annexe 23. Mémoire de fin d’étude rédigé par KANKEU Bedouen en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur en Génie Industriel 62 DEVELOPPEMENT D’UNE APPLICATION MOBILE POUR LA SUPERVISION DU BILASAGE ET DES SYSTEMES ELECTRIQUES DE L’ASECNA : CAS DE L’AEROPORT INTERNTIONAL DE DOUALA I.5 Les automates programmables industriels I.5.1 L’automate de Balisage I.5.1.1 Présentation Le TSX Premium P57 104 de Schneider électrique gère l’automatisme reliant la tour de contrôle (contrôleur WAGO 750-842 VIGIE) aux régulateurs du balisage et assure en parallèle la mise à disposition des données pour les tâches du niveau 2 dans la pyramide CIM. Il s’agit d’un API modulaire dont l’essentiel des modules est dédié est la communication. Figure 2- 11: Le TSX 57 Premium du balisage Ce calculateur est constitué de 10 modules ou cartes montés sur un rack et donc les caractéristiques sont les suivantes : Mémoire de fin d’étude rédigé par KANKEU Bedouen en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur en Génie Industriel 63 DEVELOPPEMENT D’UNE APPLICATION MOBILE POUR LA SUPERVISION DU BILASAGE ET DES SYSTEMES ELECTRIQUES DE L’ASECNA : CAS DE L’AEROPORT INTERNTIONAL DE DOUALA RACK TSX RKY 08 : Il offre deux fonctions principales : Fonction mécanique : ce racks permet la fixation de l’ensemble des modules (module d’alimentation, processeur, modules E/S TOR/analogiques, modules métiers) de cette station. Fonction électrique : l’alimentation nécessaire à chaque module du rack, les bus de communication, les signaux de service et les données pour l’ensemble de la station [11]. Figure 2- 12 : Rack TSX RKY 08 sur lequel est monté un module processeur Carte TSX PSY 3610 : C’est un module d’alimentation double format non isolé à courant continu. Il sert à l’alimentation du processeur et des modules associés. Les caractéristiques du module sont reportées en annexe 12 [2]. Carte TSX ETY 5103 : Le module de communication TSX ETY 5103 permet la communication dans une architecture Ethernet. Ils comportent une voie de communication dont les caractéristiques principales sont les suivantes [4] : Connexion à un réseau TCP/IP. Communication en mode Half et Full Duplex par reconnaissance automatique. Vitesse de transmission de 10 ou 100 Mbits/s par reconnaissance automatique. Raccordement au réseau par câble cuivre via un connecteur RJ45. Ce module réalise donc les fonctions suivantes : Service de messagerie X-WAY, UNI-TE et MODBUS sur TCP/IP ; Service I/O Scanner pouvant scruter jusqu’à 64 équipements distants. Mémoire de fin d’étude rédigé par KANKEU Bedouen en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur en Génie Industriel 64 DEVELOPPEMENT D’UNE APPLICATION MOBILE POUR LA SUPERVISION DU BILASAGE ET DES SYSTEMES ELECTRIQUES DE L’ASECNA : CAS DE L’AEROPORT INTERNTIONAL DE DOUALA Service SNMP ; Web serveur ; Global Data Ici, la carte ETY 5103 établît la communication entre l’automate du balisage, l’automate de supervision et l’automate Wago de la tour de contrôle. Carte TSX SCY 21601 : Ils occupent les emplacements 2 à 6 dans le rack de la station TSX Premium. chacun apporte : Une voie de communication RS485 isolée multi-protocole (Jbus, Modbus série, Unitelway). Le tableau ci-dessous présente les caractéristiques de la voie intégrée pour les 03 protocoles [1]. Un emplacement pour une carte mémoire de communication au standard PCMCIA supportant l’un des protocoles : UNI-TELWAY, Jbus, Mode caractères, FIPWAY. Les deux premières sont dédiées à l’échange des données en voie normal et secours avec les régulateurs de balisage tandis que les deux (02) servent à la communication en voie normal et secours avec les RTILS 12 & 30 et la balle traçante. Tableau 2- 4: Caractéristiques du module TSX SCY 21601 Mémoire de fin d’étude rédigé par KANKEU Bedouen en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur en Génie Industriel 65 DEVELOPPEMENT D’UNE APPLICATION MOBILE POUR LA SUPERVISION DU BILASAGE ET DES SYSTEMES ELECTRIQUES DE L’ASECNA : CAS DE L’AEROPORT INTERNTIONAL DE DOUALA Carte PCMCIA : Les cartes PCMCIA (Personal Computer Memory for Industrial Application) sont des extensions mémoires dédiées au stockage permanent des données transitant sur le module associé (SCY 21601). On distingue quatre variantes de cartes selon le protocole de transmission de données employé par le module hôte. Le TSX SCP 111 : cette carte mémoire utilise le protocole Unitel-Way sur liaison RS 232-D ; Le TSX SCP 112 : Utilisant le protocole Jbus sur liaison RS48; Le TSX SCP 114 : Communicant en mode caractère via une boucle de courant; La carte TSX FPP 20 : Réseau de cellule FIPWAY Chaque carte PCMCIA se connecte à la mémoire centrale (celle du processeur P57 104) par un bus de données conformément au protocole X-Bus de Schneider Electrique. Carte TSX DEY 32D2K : C’est un module qui comporte 32 voies d’entrées 24 VCC [3]. A l’annexe 13-a, le schéma de principe des entrées. Carte TSX DSY 32T2K : Il s’agit d’un module de sorties TOR à connecteur à 32 voies statiques pour courant continu. Le raccordement des sorties aux pré-actionneurs et les caractéristiques sont présentés en annexe 13-b et annexe 14. Carte TSX P57 104 : c’est le module processeur qui s’occupe de l’automatisme du balisage à travers les informations collectées sur les 8 modules de rack TSX RKY 10 au moyen du protocole X-BUS de Schneider. Les caractéristiques du processeur TSX P57104M sont présentées en annexe xxx. En sommes, les informations en annexe 22 sont extraites de la mémoire de l’API de balisage (table des mnémoniques), soit un total de 314 données relatives à la supervision. I.5.1.2 Fonctionnement du programme La structure complète du projet laisse voir la configuration de l’API et la structure du programme [12]. La partie Sections correspond u programme principal qui est exécuté en boucle par l’API, la partie Sections SR correspond à des sous fonctions appelées depuis le programme principal (Figure 2-13). Mémoire de fin d’étude rédigé par KANKEU Bedouen en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur en Génie Industriel 66 DEVELOPPEMENT D’UNE APPLICATION MOBILE POUR LA SUPERVISION DU BILASAGE ET DES SYSTEMES ELECTRIQUES DE L’ASECNA : CAS DE L’AEROPORT INTERNTIONAL DE DOUALA Figure 2- 13: Arborescence d'un projet sur Unity Pro En effet, après une phase d’initialisation, l’automate acquiert toutes les informations émises depuis la platine de la vigie. Dans un deuxième temps, il envoie ces informations aux différents équipements (régulateurs, entrées sorties TOR, …) et récupère les retours de commande. Enfin, il met à jour les retours d’états et défauts (si présents) sur la platine de contrôle commande de la VIGIE. I.5.2 I.5.2.1 L’automate des Groupes et TGBT Présentation L’automate des groupes et TGBT est un TSX 6740 de la famille micro de Schneider électrique. Cette station est un automate modulaire consistant un en ensemble de 08 racks TSX RKY 10 (10 modules chacun) (Figure 2-12) dont : Mémoire de fin d’étude rédigé par KANKEU Bedouen en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur en Génie Industriel 67 DEVELOPPEMENT D’UNE APPLICATION MOBILE POUR LA SUPERVISION DU BILASAGE ET DES SYSTEMES ELECTRIQUES DE L’ASECNA : CAS DE L’AEROPORT INTERNTIONAL DE DOUALA Quatre (04) modules d’alimentation ; Un (01) module processeur : le TSX 6740 Quatre (04) modules d’extension ; Un (01) module coupleur réseau UNITELWAY ; (14) modules d’entrées - sorties TOR. Figure 2- 14: Configuration du TSX 6740 des Groupes et TGBT I.5.2.2 Fonctionnement du programme Les données véhiculant à travers ce module et bien d’autres sont mises en mémoire système du TSX 6740 en vue d’une remontée périodique à l’API de supervision via le protocole UNITELWAY. Une scrutation de la mémoire interne permet d’associer des adresses aux paramètres surveillés pour chaque système électrique (330 données). Les informations contenues aux annexes 20, 21, 22 et 23 sont extraites de la mémoire de l’API des Groupes et TGBT. I.5.3 Les contrôleurs WAGO Un sérialiseur WAGO est un équipement électronique programmable ou configurable et modulaire effectuant les fonctions d’entrée/sortie déportée (coupleur) ou d’automate Mémoire de fin d’étude rédigé par KANKEU Bedouen en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur en Génie Industriel 68 DEVELOPPEMENT D’UNE APPLICATION MOBILE POUR LA SUPERVISION DU BILASAGE ET DES SYSTEMES ELECTRIQUES DE L’ASECNA : CAS DE L’AEROPORT INTERNTIONAL DE DOUALA programmable industriel (contrôleur). A la centrale, on retrouve neuf (09) modules WAGO donc deux (02) contrôleurs et sept (07) coupleurs. Sur un module WAGO, le premier module est un module de communication réseau et le dernier est le module 750-600 de terminaison de ligne. Figure 2- 15: Automate WAGO 750-842 de la série 750- I/O SYSTEM Figure 2- 16: WAGO 750-842 du TDBT cellules élévatrices Mémoire de fin d’étude rédigé par KANKEU Bedouen en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur en Génie Industriel 69 DEVELOPPEMENT D’UNE APPLICATION MOBILE POUR LA SUPERVISION DU BILASAGE ET DES SYSTEMES ELECTRIQUES DE L’ASECNA : CAS DE L’AEROPORT INTERNTIONAL DE DOUALA Ces caractéristiques réseau et technique sont présentées en annexe 15. Leur programmation et configuration se font aux moyens de la suite logicielle Wago (WAGO BootPServer, WAGO Ethernet Settings, WAGO-I/O-Pro et WAGO-I/O-Check). Les langages de programmation sont ceux prescrits par la norme CEI 61131-3. I.5.4 L’automate de supervision La supervision est gérée par un automate Premium de Schneider électrique. Il est constitué de trois (03) modules montés dans un rack RKY 08 dont: Un module TSX P1610 : C’est la carte d’alimentation ; Un module TSX P57104 : C’est la carte processeur ; Un module ETY 5103 : C’est le module de communication Ethernet. Il a deux principales fonctions : Coordonner la tâche d’automatisme entre la centrale (API groupes et TGBT, Wago synoptique murale, Wago TDBT cellules élévatrices, Wago CED) et les sites distants (Wago bloc technique et les Wago du SHELTERS). Assurer la remontée des informations des systèmes électriques aux taches de niveau 2 de la pyramide CIM. Figure 2- 17: Vue API supervision Mémoire de fin d’étude rédigé par KANKEU Bedouen en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur en Génie Industriel 70 DEVELOPPEMENT D’UNE APPLICATION MOBILE POUR LA SUPERVISION DU BILASAGE ET DES SYSTEMES ELECTRIQUES DE L’ASECNA : CAS DE L’AEROPORT INTERNTIONAL DE DOUALA I.6 Le système de supervision existant I.6.1 Mise en service La mise en service de poste PCVUE 32 est automatique à la mise sous tension. PCVUE se positionne sur la vue d'accueil en étant configuré avec un accès " Niveau 0". Seule la navigation dans les vues est possible. La communication avec l'automate est établie. Toutefois, le poste de conduite est protégé par 2 mots de passe pour 3 niveaux d'accès (consultation, conduite et administrateur). Niveau Consultation : Ce niveau est celui par défaut (au lancement du système), il permet de lire toutes les informations données par les synoptiques sans pouvoir en modifier aucune. Niveau USER : Ce niveau permet à un opérateur de visualiser l’ensemble de l’installation. Niveau SUPERUSER : Ce niveau est celui du développeur, il donne accès à toutes les fonctions du système de conduite PCVUE32 : o Modification ou création de synoptiques ; o Modification de la base de données ; o Quitter l’application I.6.2 Communication avec les automates Le protocole utilisé pour la supervision est un protocole réseau de type SCHNEIDER XBUS-IP-MASTER. I.6.3 Utilisation Le bandeau supérieur et inferieur : ces bandeaux sont communs à toutes les vues. Le bandeau inferieur permet de naviguer dans l’application. Mémoire de fin d’étude rédigé par KANKEU Bedouen en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur en Génie Industriel 71 DEVELOPPEMENT D’UNE APPLICATION MOBILE POUR LA SUPERVISION DU BILASAGE ET DES SYSTEMES ELECTRIQUES DE L’ASECNA : CAS DE L’AEROPORT INTERNTIONAL DE DOUALA a) b) Figure 2- 18: Page d’accueil du logiciel de supervision PCVUE 32 en salle de contrôle Principe de représentation des équipements électriques : Figure 2- 19: Principe de représentation des disjoncteurs sur PCVUE 32 Les IHM des annexes 1, 2, 3 et 4 sont extraits du logiciel de supervision PCVUE V8.2 d’ARC Informatique. I.6.4 Consignation d'événements Afin de tracer toutes les commandes ainsi que les changements d'état et les alarmes, l'ensemble des points est consigné par PCVUE : Une unité d'archivage EVEN a été créée dans Mémoire de fin d’étude rédigé par KANKEU Bedouen en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur en Génie Industriel 72 DEVELOPPEMENT D’UNE APPLICATION MOBILE POUR LA SUPERVISION DU BILASAGE ET DES SYSTEMES ELECTRIQUES DE L’ASECNA : CAS DE L’AEROPORT INTERNTIONAL DE DOUALA ce but et consiste en un ensemble de deux (02) fichiers de 25000 Ko pour une capacité maximum de 50 Mo. I.6.5 Perte de communication En cas de perte de communication avec l'automate, les données d'affichage ne sont plus rafraîchies et les événements ne sont plus consignés. Les éléments animés à la supervision passent en rose. A la reprise de la communication, les animations sont à nouveau rafraîchies et la consignation d'événements reprend. I.6.6 Sortie de la supervision Une procédure est nécessaire pour quitter le programme de supervision sans causer des pertes de données. Pour ce fait, il faut ouvrir une session avec le droit de quitter l’application. II ASPECTS METHODOLOGIQUES II.1 Analyse UML : Le diagramme des cas d’utilisation de l’application II.1.1 Acteurs et cas d’utilisation Les acteurs : Personnel et administrateur événements Les cas d’utilisation. Tableau 2- 5: Fonctionnalités de l’application Créer compte Gérer TGBT S’authentifier Visualiser état TGBT secouru Gérer groupes Visualiser état TGBT non secouru Consulter alarmes groupes Gérer TDBT Consulter évènements groupes Visualiser état TDBT bloc technique secouru et non secouru Gérer SHELTERS Visualiser état TDBT secouru cellules élévatrices Visualiser état VOR_DME Visualiser état TDBT poste PO Visualiser état LOCALIZER Consulter alarmes TGBT et TDBT Mémoire de fin d’étude rédigé par KANKEU Bedouen en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur en Génie Industriel 73 DEVELOPPEMENT D’UNE APPLICATION MOBILE POUR LA SUPERVISION DU BILASAGE ET DES SYSTEMES ELECTRIQUES DE L’ASECNA : CAS DE L’AEROPORT INTERNTIONAL DE DOUALA Visualiser état GLIDE_DME Consulter évènements TGBT et TDBT Visualiser état station météo Gerer autres équipements Consulter alarmes SHELTERS Visualiser onduleurs Consulter évènements SHELTERS Visualiser chargeurs Gérer balisage Observer courbes tendances Visualiser régulateurs Consulter évènements autres équipements Visualiser aides visuelles balisage Consulter alarmes autres équipements Consulter évènements SHELTERS Gérer archives Consulter alarmes SHELTERS Consulter historique général évènements Visualiser système de communication Consulter historique général alarmes Visualiser synoptique mural Laisser consigne Mémoire de fin d’étude rédigé par KANKEU Bedouen en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur en Génie Industriel 74 DEVELOPPEMENT D’UNE APPLICATION MOBILE POUR LA SUPERVISION DU BILASAGE ET DES SYSTEMES ELECTRIQUES DE L’ASECNA : CAS DE L’AEROPORT INTERNTIONAL DE DOUALA II.1.2 Diagramme des cas d’utilisation Mémoire de fin d’étude rédigé par KANKEU Bedouen en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur en Génie Industriel 75 DEVELOPPEMENT D’UNE APPLICATION MOBILE POUR LA SUPERVISION DU BILASAGE ET DES SYSTEMES ELECTRIQUES DE L’ASECNA : CAS DE L’AEROPORT INTERNTIONAL DE DOUALA Figure 2- 20: Diagramme de cas d'utilisation ½ Figure 2- 21: Diagramme de cas d'utilisation 2/2 Mémoire de fin d’étude rédigé par KANKEU Bedouen en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur en Génie Industriel 76 DEVELOPPEMENT D’UNE APPLICATION MOBILE POUR LA SUPERVISION DU BILASAGE ET DES SYSTEMES ELECTRIQUES DE L’ASECNA : CAS DE L’AEROPORT INTERNTIONAL DE DOUALA II.2 Conception générale II.2.1 Le cycle de développement en V De nos jours, la méthodologie adoptée dans l’analyse et la conception des systèmes représente un choix stratégique pour le bureau d’études afin de mener à terme les projets tout en respectant les délais annoncés au client et avec la qualité demandée. Vu l’évolution des besoins des utilisateurs finaux, les applications d’entreprise deviennent de plus en plus complexes et difficiles à con concevoir et à développer. Pour la conception, le développement et la réalisation de notre application, nous avons opté pour l’application du processus de développement V qui demeure actuellement le cycle de vie le plus connu et certainement le plus convenable aux projets complexes. Le schéma ci-dessous représente les différentes phases du modèle en V : Figure 2- 22: Modèle en V Mémoire de fin d’étude rédigé par KANKEU Bedouen en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur en Génie Industriel 77 DEVELOPPEMENT D’UNE APPLICATION MOBILE POUR LA SUPERVISION DU BILASAGE ET DES SYSTEMES ELECTRIQUES DE L’ASECNA : CAS DE L’AEROPORT INTERNTIONAL DE DOUALA II.2.2 Diagramme de séquences de l’application Les diagrammes de séquence servent à illustrer les cas d’utilisation décrits dans la section précédente. Ils permettent de représenter la succession chronologique des opérations réalisées par un acteur et qui font passer d’un objet à un autre pour représenter un scénario. Figure 2- 23: Diagramme séquence « s'authentifier » Mémoire de fin d’étude rédigé par KANKEU Bedouen en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur en Génie Industriel 78 DEVELOPPEMENT D’UNE APPLICATION MOBILE POUR LA SUPERVISION DU BILASAGE ET DES SYSTEMES ELECTRIQUES DE L’ASECNA : CAS DE L’AEROPORT INTERNTIONAL DE DOUALA Figure 2- 24: Diagramme de séquence « gérer groupes » Figure 2- 25: Diagramme de séquence « gérer SHELTERS » Mémoire de fin d’étude rédigé par KANKEU Bedouen en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur en Génie Industriel 79 DEVELOPPEMENT D’UNE APPLICATION MOBILE POUR LA SUPERVISION DU BILASAGE ET DES SYSTEMES ELECTRIQUES DE L’ASECNA : CAS DE L’AEROPORT INTERNTIONAL DE DOUALA Figure 2- 26: diagramme de séquence « gérer balisage » Figure 2- 27: diagramme de séquence « visualiser onduleurs » Mémoire de fin d’étude rédigé par KANKEU Bedouen en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur en Génie Industriel 80 DEVELOPPEMENT D’UNE APPLICATION MOBILE POUR LA SUPERVISION DU BILASAGE ET DES SYSTEMES ELECTRIQUES DE L’ASECNA : CAS DE L’AEROPORT INTERNTIONAL DE DOUALA Figure 2- 28 : Diagramme de séquence « visualiser chargeurs » Figure 2- 29: Diagramme de séquence « visualiser cellules élévatrices » Mémoire de fin d’étude rédigé par KANKEU Bedouen en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur en Génie Industriel 81 DEVELOPPEMENT D’UNE APPLICATION MOBILE POUR LA SUPERVISION DU BILASAGE ET DES SYSTEMES ELECTRIQUES DE L’ASECNA : CAS DE L’AEROPORT INTERNTIONAL DE DOUALA Figure 2- 30: Diagramme de séquence « gérer TGBT et TDBT » Mémoire de fin d’étude rédigé par KANKEU Bedouen en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur en Génie Industriel 82 DEVELOPPEMENT D’UNE APPLICATION MOBILE POUR LA SUPERVISION DU BILASAGE ET DES SYSTEMES ELECTRIQUES DE L’ASECNA : CAS DE L’AEROPORT INTERNTIONAL DE DOUALA Figure 2- 31: Diagramme de séquence « visualiser système de communication » Figure 2- 32: Diagramme de séquence « visualiser synoptique unifilaire général » Mémoire de fin d’étude rédigé par KANKEU Bedouen en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur en Génie Industriel 83 DEVELOPPEMENT D’UNE APPLICATION MOBILE POUR LA SUPERVISION DU BILASAGE ET DES SYSTEMES ELECTRIQUES DE L’ASECNA : CAS DE L’AEROPORT INTERNTIONAL DE DOUALA Figure 2- 33: Diagramme de séquence « visualiser courbes tendances » Figure 2- 34: Diagramme de séquence « gérer archives » Mémoire de fin d’étude rédigé par KANKEU Bedouen en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur en Génie Industriel 84 DEVELOPPEMENT D’UNE APPLICATION MOBILE POUR LA SUPERVISION DU BILASAGE ET DES SYSTEMES ELECTRIQUES DE L’ASECNA : CAS DE L’AEROPORT INTERNTIONAL DE DOUALA II.2.3 Diagramme des classes II.2.2.1 Les classes Tableau 2- 6: Les classes du système Utilisateurs Administrateur Onduleurs TGBT Secouru Chargeurs TGBT non secouru Régulateurs TDBT Aides Visuelles Balisage Tendance Balisage Cellules élévatrices Synoptique mural SHELTERS Personnel Groupes Système de communication Connexion II.2.2.2 Le diagramme des classes Mémoire de fin d’étude rédigé par KANKEU Bedouen en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur en Génie Industriel 85 DEVELOPPEMENT D’UNE APPLICATION MOBILE POUR LA SUPERVISION DU BILASAGE ET DES SYSTEMES ELECTRIQUES DE L’ASECNA : CAS DE L’AEROPORT INTERNTIONAL DE DOUALA Mémoire de fin d’étude rédigé par KANKEU Bedouen en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur en Génie Industriel 86 DEVELOPPEMENT D’UNE APPLICATION MOBILE POUR LA SUPERVISION DU BILASAGE ET DES SYSTEMES ELECTRIQUES DE L’ASECNA : CAS DE L’AEROPORT INTERNTIONAL DE DOUALA II.3 Architecture 5-Tier du système Nous proposons a la figure ci-dessous, l’architecture du système distribué completant celle de la figure xx et offrant ainsi les services de la supervision industrielle multiplateforme et sans restrictions geographique. PPTP PPTP DNS/UDL Client Serveur d’application Serveur Web Serveur de Base de données Ethernet TCP/IP-NI /P2P Serveur OPC Modbus TCP/IP UNITELWAY API Groupes et TGBT API Supervision API Balisage Figure 2- 35: Architecture physique du système distribué proposée II.3.1 La logique connexion aux données terrains Il s’agit du Tier chargé de l’extraction des données des mémoires automates. La conformité des automates de balisage et de supervision au standard OPC nous offre la possibilité de l’emploi d’un serveur OPC. Plusieurs serveurs OPC coexistent sur le marché : Kepware, Mémoire de fin d’étude rédigé par KANKEU Bedouen en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur en Génie Industriel 87 DEVELOPPEMENT D’UNE APPLICATION MOBILE POUR LA SUPERVISION DU BILASAGE ET DES SYSTEMES ELECTRIQUES DE L’ASECNA : CAS DE L’AEROPORT INTERNTIONAL DE DOUALA Kassl, Matrikon, Integration Objects, Geniop, OFS (OPC Factory Server), NI OPC Server, PC Access,… La possibilité d’exporter la table des symboles de l’automate et la forte compatibilité (spécialisation) aux automates de la firme Schneider Electric ont orienté notre choix sur le serveur OFS. I.3.1.1 Présentation d’OFS OFS (OPC Factory Server) est un serveur de données multi-automates capable de communiquer avec les automates des familles M580, Unity Momentum, TSX/PCX Premium, Quantum, M340, TSX Compact, TSX Micro, TSX Momentum, TSX Series 7 et TSX S1000. Il permet ainsi de fournir des données aux clients OPC. OFS est compatible avec les versions 1.0 A et 2.0 de la norme OPC DA et fonctionne avec les logiciels clients OPC de deux manières : Logiciel de surveillance: le serveur OFS joue le rôle de driver assurant la communication avec tous les équipements pris en charge par Schneider Electric SA ; Logiciel de surveillance personnalisé, mis au point avec l'interface OLE Automation ou l'interface de personnalisation OLE Custom. I.3.1.2 Spécificités du serveur OFS Le serveur OFS assure l'interface entre les automates programmables Schneider Electric et une ou plusieurs applications clientes. Ces applications permettent de consulter et/ou de modifier les valeurs des données des équipements cibles. Ses caractéristiques principales sont : Multi-équipements, Multi-protocoles de communication (Modbus Serie, Modbus TCP avec adressage IP ou X-Way, Modbus Plus, Uni-Telway, Fipway, Ethway, ISAway, PCIway USB, USB Fip) ; Multi-clients, Accès aux équipements et aux variables par repère (adresse) ou par symbole ; Accès au serveur en mode local ou distant ; Utilisation d'un mécanisme de notification permettant d'émettre vers le client les valeurs sur changement d'état uniquement (pour les échanges avec l'automate, le serveur propose deux modes : le mode classique (polling) qui est le mode par défaut, ou le mode Push Data où l'envoi des données est à l'initiative de l'automate : ce mode est recommandé lorsque les changements d'état sont peu fréquents) ; Mémoire de fin d’étude rédigé par KANKEU Bedouen en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur en Génie Industriel 88 DEVELOPPEMENT D’UNE APPLICATION MOBILE POUR LA SUPERVISION DU BILASAGE ET DES SYSTEMES ELECTRIQUES DE L’ASECNA : CAS DE L’AEROPORT INTERNTIONAL DE DOUALA Détermination automatique de la taille des requêtes réseaux en fonction des équipements ; Exposition de ses services par les interfaces OLE Automation et OLE Custom ; Compatibilité avec les versions 1.0 A et 2.0 de la norme OPC DA (Data Access). Plusieurs modes d’accès au serveur sont possibles : Accès local : L'application cliente et le serveur OFS sont sur le même poste ; Access distant Par DCOM (Distributed Components Object Model): L'application cliente et le serveur OFS sont sur des postes distincts, reliés par le réseau TCP/IP de l’entreprise par l’intermédiaire de DCOM ; Accès distant par Internet information service (IIS) : Ici, le serveur du site et le serveur OFS sont sur le même poste. Le serveur du site et l'application cliente sont sur des postes distincts, communiquant par Internet. En annexe 17, 18 et 19 sont représentés les différents modes d’accès au serveur. Dans notre application, nous utilisons l’accès distant par DCOM. II.3.2 La logique métier C’est le Tier chargé de l’exécution du programme logique de supervision. On retrouve une panoplie de serveur d’application dédié à la supervision. Mais le choix de l’un est bien des fois conditionné par le logiciel de supervision (environnement de développement intégré sur lequel est conçu la solution de supervision). Etant donné que nous avons développé l’application sous le logiciel LabVIEW, nous utiliserons le serveur WEZARP en tant que serveur d’application. Présentation du serveur WEZARP Ce serveur d’application qui donne au système distribué, une portée de l’ordre égalant celui du réseau fils auquel l’. Il s’avère donc nécessaire de rendre disponible l’application mobile au travers du réseau Internet. II.3.3 La logique service Web Ce Tier s’articule autour d’un serveur Web. Ce dernier permet d’accroitre la mobilité de l’application mobile en levant les restrictions dues à la localisation géographique de Mémoire de fin d’étude rédigé par KANKEU Bedouen en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur en Génie Industriel 89 DEVELOPPEMENT D’UNE APPLICATION MOBILE POUR LA SUPERVISION DU BILASAGE ET DES SYSTEMES ELECTRIQUES DE L’ASECNA : CAS DE L’AEROPORT INTERNTIONAL DE DOUALA l’utilisateur. Le serveur web offre donc à l’utilisateur finale, un ensemble de services dits «services Web », en occurrence le REST ou le SOAP, basé sur le protocole HTTP (Hypertext Transfert Protocol) pour effectuer des requêtes distantes au niveau du serveur d’application. La question de sécurisation des données transitant sur le réseau publique internet (vulnérabilités aux pirates, virus, vers, cheval de trois,…) a contraint les entreprises a utilisée tour à tour, les liaisons Transpac, les lignes louées et aujourd’hui les réseaux privés virtuels (VPN, Virtual private Network). Définition de réseau privé virtuel ou VPN Les VPN sont une technique permettant un ou plusieurs postes distant de communiquer de manière sure (communications sécurisées et chiffrées), tout en empruntant les infrastructures publiques (internet).Ce type de liaison est apparu suite à un besoin croissant des entreprises de relier les différents sites, et ce de façon simple et économique (Figure 2-33). Principe de fonctionnement : Un réseau VPN repose sur un protocole appelé « protocole de tunneling ». Ce protocole permet de faire circuler les informations de l’entreprise de façon cryptée d’un bout l’autre du tunnel. Ainsi, les utilisateurs ont l’impression de se connecter directement sur le réseau de l’entreprise. Le principe de tunneling consiste à construire un chemin virtuel après avoir identifié l’émetteur et le destinataire. Par suite la source chiffre les données et les achemine en empruntant ce chemin virtuel. Les types de VPN Selon les besoins, on distingue trois types de VPN : Le VPN d’accès : il est utilisé pour permettre à des utilisateurs itinérants d’accéder au réseau de leur entreprise. L’utilisateur se sert d’une connexion internet afin d’établir une liaison sécurisée. Mémoire de fin d’étude rédigé par KANKEU Bedouen en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur en Génie Industriel 90 DEVELOPPEMENT D’UNE APPLICATION MOBILE POUR LA SUPERVISION DU BILASAGE ET DES SYSTEMES ELECTRIQUES DE L’ASECNA : CAS DE L’AEROPORT INTERNTIONAL DE DOUALA Figure 2- 36: Schéma d'un VPN d’accès L’intranet VPN : il est utilisé pour relier deux ou plusieurs intranets d’une même entreprise entre eux. Ce type de réseau est particulièrement utile au sein d’une entreprise possédant plusieurs sites distants. Figure 2- 37: Schéma d'un VPN de type Intranet L’extranet VPN : il est utilisé lorsqu’une entreprise veut communiquer avec ses partenaires et ses clients. Elle ouvre alors son réseau local à ces derniers. Figure 2- 38: Liaison VPN de type extranet Les protocoles de tunneling Les protocoles utilisés sont de deux types suivant le niveau de la couche OSI auquel ils travaillent : Mémoire de fin d’étude rédigé par KANKEU Bedouen en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur en Génie Industriel 91 DEVELOPPEMENT D’UNE APPLICATION MOBILE POUR LA SUPERVISION DU BILASAGE ET DES SYSTEMES ELECTRIQUES DE L’ASECNA : CAS DE L’AEROPORT INTERNTIONAL DE DOUALA Les protocoles de niveau 2: PPP (Point to Point Protocol), PPTP (Point to Point Tuneling Protocol), L2F (layer Two Forwarder), L2TP (Layer Two Tuneling protocol). Les protocoles de niveau 3 : IPSec et MPLS. Le protocole PPTP C’est un protocole de niveau 2 définit par la norme RFC 2661 qui permet l’encryptage des données ainsi que leur compression. Le principe du PPTP est de créer des paquets sous le protocole PPP et de les encapsuler dans des datagrammes IP. Le tunnel PPTP se caractérise par une initialisation du client, une connexion de contrôle entre le client e le serveur ainsi que par une clôture du tunnel par le serveur. Lors de l’établissement de la connexion, le client effectue d’abord une connexion avec son fournisseur d’accès internet. Cette première connexion établit une connexion de type PPP et permet de faire circuler les données sur Internet. Par suite, une deuxième connexion est établie ; elle permet d’encapsuler les paquets PPP dans des datagrammes IP : c’est la formation du tunnel VPN. OpenVPN une serveur VPN offre les services web de tunneling entre périphériques distants en garantissant la sécurité des données. Notre choix s’est portée sur OpenVPN (pour son large utilisation) avec une implémentation du tunnel suivant le protocole PPTP. II.3.4 La logique Base de données Le Tier base de données a les tâches de stockage et d’archivage des données. Ces données sont en permanence requises par le serveur d’application au moyen des requêtes SQL afin de répondre aux requêtes web des clients. Oracle, MS Access, MySQL, Microsoft SQL, MongoDB, sont des exemples de SGBD (Systèmes de gestion de base de données) proposées sur le marché. A partir du diagramme des classes de l’application un modèle Entité –Relation (E-R) a été implémenté sur la base de données relationnelles MySQL au détriment des systèmes de stockage sur fichiers et des bases de données orientées objets. Mémoire de fin d’étude rédigé par KANKEU Bedouen en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur en Génie Industriel 92 DEVELOPPEMENT D’UNE APPLICATION MOBILE POUR LA SUPERVISION DU BILASAGE ET DES SYSTEMES ELECTRIQUES DE L’ASECNA : CAS DE L’AEROPORT INTERNTIONAL DE DOUALA II.3.5 La logique présentation Ce Tier constitue le rendu au niveau du client. Toutes les interfaces de monitoring et de prises de décisions sont ainsi offertes pour cette dernière. Le client est développé en parallèle avec le serveur d’application et le choix du serveur WEZARP nous offre une logique présentation WEZARP qui se présente sur forme de clients smartphones, tablette, PC pour les moteurs d’exploitation Android, iOS, Windows phone et Windows 7, 8.1 et 10. La connexion entre les différents Tiers fait appel à un certain nombre d’outils. II.3.6 Outils de Mapping Ces outils permettent d’établir une connexion permanente entre les différents tiers du système. Liaison API – OFS Hébergé sur un terminal dans le RLE, la communication entre le serveur OFS et les automates programmables se fait au moyen d’une connexion Modbus Over Ethernet. Liaison OFS- LabVIEW Si le serveur OFS et LabVIEW sont logé sur un même poste, la connexion se fait via le protocole NI-PSP développé par National Instrument. Par ailleurs, L’usage des composants DCOM permet une connexion au moyen d’Ethernet TCP/IP. Liaison LabVIEW – MySQL La Liaison à la base de données est effectuée au moyen des connecteurs ODBC intégrés aux composants MDAC (Microsoft Data Access Components). Un connecteur ODBC est un composant de type ADO (Access Database Object) qui est lui une composante DCOM développé par Microsoft en réponse aux spécificités du standard OLE dans l’optique de Mémoire de fin d’étude rédigé par KANKEU Bedouen en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur en Génie Industriel 93 DEVELOPPEMENT D’UNE APPLICATION MOBILE POUR LA SUPERVISION DU BILASAGE ET DES SYSTEMES ELECTRIQUES DE L’ASECNA : CAS DE L’AEROPORT INTERNTIONAL DE DOUALA permettre l’interopérabilité entre les bases de données tierces et les logiciels s’exécutant sur un système d’exploitation Windows. Les composants DCOM évoluent de nos jours sous le Framework .NET (dot NET). ADO offre deux possibilités d’accès aux bases de données: Accès par liaison UDL (User Dynamic Link) ; Accès par liaison DNS (Data source Name). Nous utiliserons comme connecteur d’accès à la base de données MYSQL « MySQL Connector ODBC » sous liaison UDL pour accéder à la base de données MySQL. Liaison serveur Wezarp – serveur OpenVPN– client Wezarp : le protocole PPTP de tunneling assure cette communication. II.4 Architecture logique associée au système distribué II.4.1 Le logiciel LabVIEW De l’acronyme Laboratory Virtual Instrumentation for Engineering Workbench, LabVIEW est un environnement de développement intégré (IDE) basé sur le langage flot de données de National Instrument : Le langage graphique G. Il est communément utilisé dans les domaines d’acquisition des données, du contrôle d’instrument, de la robotique et de l’automatisation industrielle. La notion de flot de données combiné aux concepts de programmations parallèle et événementielle fait de ce logiciel, un support robuste pour le développement Temps-Réel (TR). De plus, l’ajout du module Datalogging and Supervisory Control (DSC) apporte à LabVIEW la fonctionnalité de client OPC une riche bibliothèque de symbole graphique lui permettant ainsi de se connecter à plus de 200 contrôleurs industriels. La fonctionnalité de mobilité ajoutée à LabVIEW par le module WEZARP lui permet d’offrir un rendu mobile à l’intérieur d’un RLE ; Un serveur VPN permettant, à son tour de transgresser cette restriction. Mémoire de fin d’étude rédigé par KANKEU Bedouen en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur en Génie Industriel 94 DEVELOPPEMENT D’UNE APPLICATION MOBILE POUR LA SUPERVISION DU BILASAGE ET DES SYSTEMES ELECTRIQUES DE L’ASECNA : CAS DE L’AEROPORT INTERNTIONAL DE DOUALA II.4.2 Architecture logique Il est présenté à la figure ci-dessous, une architecture de LabVIEW en tant que solution de supervision industrielle. DATABASE SERVER (CITADEL) PLCs PROVIDER SERVER DSC (OPC,DDE,EPICS) LABVIEW (DATAFLOW: LOOP AND EVENT PROGRAMMING) REMOTE TERMINAL CONTROL SERVER (WEZARP) NETWORK ACCESS (WEBSERVICES) Figure 2- 39: Architecture LabVIEW en tant que solution de supervision industrielle Mémoire de fin d’étude rédigé par KANKEU Bedouen en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur en Génie Industriel 95 DEVELOPPEMENT D’UNE APPLICATION MOBILE POUR LA SUPERVISION DU BILASAGE ET DES SYSTEMES ELECTRIQUES DE L’ASECNA : CAS DE L’AEROPORT INTERNTIONAL DE DOUALA Conclusion Dans ce chapitre, il était question pour nous de montrer la démarche adoptée pour résoudre le problème posé. Dans le chapitre qui suit, nous présenterons les résultats obtenus dans une simulation, puis nous ferons une analyse financière du système à implémenter. Mémoire de fin d’étude rédigé par KANKEU Bedouen en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur en Génie Industriel 96 DEVELOPPEMENT D’UNE APPLICATION MOBILE POUR LA SUPERVISION DU BILASAGE ET DES SYSTEMES ELECTRIQUES DE L’ASECNA : CAS DE L’AEROPORT INTERNTIONAL DE DOUALA CHAPITRE III : RESULTATS ET DISCUSSIONS Dans le chapitre précédent, nous avons présenté la démarche adoptée pour résoudre le problème posé. Il sera question dans ce chapitre de Présenter les résultats obtenus et commentaires, ensuite faire une évaluation du coût du projet III.1 Principes d’animation et d’utilisation des couleurs Le fond des synoptiques est en vert. Le repère des équipements est en noir. Selon le standard d’utilisation des couleurs relatives à la supervision des procédés énergétiques, la représentation des états et des alarmes est celle du tableau suivant : Tableau 3- 1:Principe de la représentation des équipements et interprétation des couleurs Etats Symbole couleur Interprétation Etat à 0 ------ Gris, noir Disjoncteur ouvert, Absence tension Etat à 1 ------- Noir Disjoncteur fermé Blanc, jaune Appareil fermé -------- Vert Présence tension -------- Rouge Défaut isolement, Appareil ouvert Alarme à 1 -------- Rouge Disjoncteur disjoncté -------- Défaut général -------- Défaut isolement Mémoire de fin d’étude rédigé par KANKEU Bedouen en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur en Génie Industriel 97 DEVELOPPEMENT D’UNE APPLICATION MOBILE POUR LA SUPERVISION DU BILASAGE ET DES SYSTEMES ELECTRIQUES DE L’ASECNA : CAS DE L’AEROPORT INTERNTIONAL DE DOUALA III.2 Paramétrage de la communication III.2.1 Communication automates-LabVIEW L’outil de configuration d’OFS permet de configurer les paramètres de communication entre les automates et LabVIEW. Cette configuration consiste à définir entre autre : L’alias de l’équipement ; Le deadbean ;’ Le nombre de tentative de connexion et le timeout de l’équipement ; Au niveau du client OFS (LabVIEW), elle consiste à définir les groupes d’items et le mode d’accès aux variables automates (lecture seule, écriture seule, lecture et écriture). III.2.2 Communication Client Wezarp-Serveur Wezarp La connexion du client au serveur Wezarp requiert l’adresse IP du serveur et le port d’écoute avec le client en question. III.3 Caractéristiques de l’application Redimensionnement des vues (Vectorisation) ; affichage distant ; Validation de la conduite par authentification ; Hiérarchisation des alarmes ; Horodatage des évènements ; Historique des variables ; Archivage sur structure standard : SQL ; Rafraichissement de la base de données sur exception (Rafraichissement sur changement d’état de la variable) ; Archivage sélectif et long terme; Occurrence multiple ; Acquittement par des postes multiples ; Multiplaforme. Mémoire de fin d’étude rédigé par KANKEU Bedouen en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur en Génie Industriel 98 DEVELOPPEMENT D’UNE APPLICATION MOBILE POUR LA SUPERVISION DU BILASAGE ET DES SYSTEMES ELECTRIQUES DE L’ASECNA : CAS DE L’AEROPORT INTERNTIONAL DE DOUALA III.4 Vue du code source de la page d’accueil de l’application L’arborescence du projet est celle de la figure ci-dessous : Mémoire de fin d’étude rédigé par KANKEU Bedouen en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur en Génie Industriel 99 DEVELOPPEMENT D’UNE APPLICATION MOBILE POUR LA SUPERVISION DU BILASAGE ET DES SYSTEMES ELECTRIQUES DE L’ASECNA : CAS DE L’AEROPORT INTERNTIONAL DE DOUALA Figure 3-1 : Arborescence du projet Mémoire de fin d’étude rédigé par KANKEU Bedouen en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur en Génie Industriel 100 DEVELOPPEMENT D’UNE APPLICATION MOBILE POUR LA SUPERVISION DU BILASAGE ET DES SYSTEMES ELECTRIQUES DE L’ASECNA : CAS DE L’AEROPORT INTERNTIONAL DE DOUALA Mémoire de fin d’étude rédigé par KANKEU Bedouen en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur en Génie Industriel 101 DEVELOPPEMENT D’UNE APPLICATION MOBILE POUR LA SUPERVISION DU BILASAGE ET DES SYSTEMES ELECTRIQUES DE L’ASECNA : CAS DE L’AEROPORT INTERNTIONAL DE DOUALA III.5 Vue de la page d’accueil Figure 3- 1: Page d'accueil de l'application : page d’authentificati Mémoire de fin d’étude rédigé par KANKEU Bedouen en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur en Génie Industriel 102 DEVELOPPEMENT D’UNE APPLICATION MOBILE POUR LA SUPERVISION DU BILASAGE ET DES SYSTEMES ELECTRIQUES DE L’ASECNA : CAS DE L’AEROPORT INTERNTIONAL DE DOUALA III.6 Quelques IHM de l’application Figure 3- 2:Confirmation d'authenfication par le système Mémoire de fin d’étude rédigé par KANKEU Bedouen en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur en Génie Industriel 103 DEVELOPPEMENT D’UNE APPLICATION MOBILE POUR LA SUPERVISION DU BILASAGE ET DES SYSTEMES ELECTRIQUES DE L’ASECNA : CAS DE L’AEROPORT INTERNTIONAL DE DOUALA Figure 3- 3: Vue du sommaire général Figure 3- 4: vue de la liste des évènements Mémoire de fin d’étude rédigé par KANKEU Bedouen en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur en Génie Industriel 104 DEVELOPPEMENT D’UNE APPLICATION MOBILE POUR LA SUPERVISION DU BILASAGE ET DES SYSTEMES ELECTRIQUES DE L’ASECNA : CAS DE L’AEROPORT INTERNTIONAL DE DOUALA Figure 3- 5: Vue de la liste des alarmes Figure 3- 6:Vue du synoptique unifilaire général Mémoire de fin d’étude rédigé par KANKEU Bedouen en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur en Génie Industriel 105 DEVELOPPEMENT D’UNE APPLICATION MOBILE POUR LA SUPERVISION DU BILASAGE ET DES SYSTEMES ELECTRIQUES DE L’ASECNA : CAS DE L’AEROPORT INTERNTIONAL DE DOUALA Figure 3- 7: Vue du système de communication Figure 3- 8: Vue du Groupe électrogène 1 Mémoire de fin d’étude rédigé par KANKEU Bedouen en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur en Génie Industriel 106 DEVELOPPEMENT D’UNE APPLICATION MOBILE POUR LA SUPERVISION DU BILASAGE ET DES SYSTEMES ELECTRIQUES DE L’ASECNA : CAS DE L’AEROPORT INTERNTIONAL DE DOUALA Figure 3- 9: Vue du groupe électrogène 2 Figure 3- 10: Vue des évènements de l'ensemble des groupes électrogènes Mémoire de fin d’étude rédigé par KANKEU Bedouen en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur en Génie Industriel 107 DEVELOPPEMENT D’UNE APPLICATION MOBILE POUR LA SUPERVISION DU BILASAGE ET DES SYSTEMES ELECTRIQUES DE L’ASECNA : CAS DE L’AEROPORT INTERNTIONAL DE DOUALA Figure 3- 11:Vue des alarmes de l'ensemble des groupes électrogènes Mémoire de fin d’étude rédigé par KANKEU Bedouen en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur en Génie Industriel 108 DEVELOPPEMENT D’UNE APPLICATION MOBILE POUR LA SUPERVISION DU BILASAGE ET DES SYSTEMES ELECTRIQUES DE L’ASECNA : CAS DE L’AEROPORT INTERNTIONAL DE DOUALA Figure 3- 12: Vue des aides visuelles au balisage Figure 3- 13:Vue des régulateurs du balisage Mémoire de fin d’étude rédigé par KANKEU Bedouen en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur en Génie Industriel 109 DEVELOPPEMENT D’UNE APPLICATION MOBILE POUR LA SUPERVISION DU BILASAGE ET DES SYSTEMES ELECTRIQUES DE L’ASECNA : CAS DE L’AEROPORT INTERNTIONAL DE DOUALA Figure 3- 14: Vue Station Météo Figure 3- 15: Vue TGBT non secouru Mémoire de fin d’étude rédigé par KANKEU Bedouen en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur en Génie Industriel 110 DEVELOPPEMENT D’UNE APPLICATION MOBILE POUR LA SUPERVISION DU BILASAGE ET DES SYSTEMES ELECTRIQUES DE L’ASECNA : CAS DE L’AEROPORT INTERNTIONAL DE DOUALA Figure 3- 16: Vue TGBT secouru Figure 3- 17: Vue Onduleurs ASI 1 & 2 Mémoire de fin d’étude rédigé par KANKEU Bedouen en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur en Génie Industriel 111 DEVELOPPEMENT D’UNE APPLICATION MOBILE POUR LA SUPERVISION DU BILASAGE ET DES SYSTEMES ELECTRIQUES DE L’ASECNA : CAS DE L’AEROPORT INTERNTIONAL DE DOUALA Figure 3- 18: Vue cellules élévatrices III.7 Estimation du coût du projet Le tableau qui suit présente un récapitulatif de l’ensemble des équipements nécessaire à l’implémentation de l’application mobile. Equipements Caractéristiques Quantités Prix (F CFA) Serveur WEZARP Scalable 01 1.937.000 Serveur OpenVPN Sécurité, débit élevé 01 1.300.000/2ans PC de supervision 4G RAM, processeur 2GHz*2 01 250.000 Smartphone/Tablette/ Android, iOS, Windows phone, Windows PC SE Windows Main d’œuvre - 01/utilisateur 75.000 - 1.500.000 Il ressort de cette étude que le cout de l’implémentation de l’application s’élève à 5.062.000 FCFA. Mémoire de fin d’étude rédigé par KANKEU Bedouen en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur en Génie Industriel 112 DEVELOPPEMENT D’UNE APPLICATION MOBILE POUR LA SUPERVISION DU BILASAGE ET DES SYSTEMES ELECTRIQUES DE L’ASECNA : CAS DE L’AEROPORT INTERNTIONAL DE DOUALA CONCLUSION Ce travail a été réalisé à la Représentation de l’ASECNA au Cameroun plus précisément à l’unité Energie et Balisage de l’aéroport internationale de Douala et portait sur le « Développement d’une application mobile pour la supervision du balisage et des systèmes électriques de l’ASECNA : Cas de l’aéroport international de Douala ». L’application est d’une aide précieuse pour l’optimisation de la sécurité en navigation aérienne à l’aéroport international de Douala en ce sens qu’elle fournit les informations temps réels et distants sur l’ensemble du balisage et des systèmes électriques. Pour ce faire, il nous a été important d’élaborer un patron de conception adéquat pour l’application, de disposer des informations à surveiller pour l’ensemble des équipements à supervisés et surtout de choisir les outils adéquat pour devant gérer les 596 données relatives à cette supervision en respectant la contrainte sécuritaire liée à ces données. Pour y parvenir, nous avons après avoir fait une analyse UML du système à mettre sur pieds, localiser les points et rechercher la méthode d’extractions des données équipements, effectuer un choix adéquat de l’ architecture du système distribue a installé et enfin nous avons élaborer une conception UML de l’application au moyen des diagrammes de séquence et de classe. La réalisation suivant le cycle de développement en V s’est effectuée sur les logiciels LabVIEW, UnityPro, OFS, MYSQL, OpenVPN et Wezarp. Nous avons enfin effectué une analyse financière, qui nous permis d’estimer le cout de réalisation de l’application à hauteur de 5.062.000FCFA. En guise de perspective, associer les fonctionnalités de ‘forum d’échange’ entre opérateurs et ‘d’envoi de mail’ en cas d’alarme de niveau 1 permettrait de rendre l’application plus flexible et à l’unité Energie et Balisage, de réaffirmer son principe de « 100% disponibilité du balisage et zéro blackout » Mémoire de fin d’étude rédigé par KANKEU Bedouen en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur en Génie Industriel 113 DEVELOPPEMENT D’UNE APPLICATION MOBILE POUR LA SUPERVISION DU BILASAGE ET DES SYSTEMES ELECTRIQUES DE L’ASECNA : CAS DE L’AEROPORT INTERNTIONAL DE DOUALA REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 1- Automates Premium TSX 57/PCX 57 Communication Interfaces bus et réseaux Manuel de mise en œuvre Tome 4 2- Automates Premium TSX 57/PCX 57 Processeurs Manuel de mise en œuvre Tome 1 3- Automates Premium TSX 57 / PCX 57 Interfaces TOR et Sécurité Manuel de mise en œuvre Tome 2 4- Automates Premium TSX 57/PCX 57 Communication Interfaces bus et réseaux Manuel de mise en œuvre Tome 4. 5- Automate Balisage de Douala 9- Introduction à la supervision, Pierre Bonnet, Université Lille 1, Novembre 2010 10- Introduction aux Réseaux locaux Industriels, P. Hoppenot, 1999 Mémoire de fin d’étude rédigé par KANKEU Bedouen en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur en Génie Industriel 114 DEVELOPPEMENT D’UNE APPLICATION MOBILE POUR LA SUPERVISION DU BILASAGE ET DES SYSTEMES ELECTRIQUES DE L’ASECNA : CAS DE L’AEROPORT INTERNTIONAL DE DOUALA Annexe 1 : Vue du groupe électrogène 1 Mémoire de fin d’étude rédigé par KANKEU Bedouen en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur en Génie Industriel 115 DEVELOPPEMENT D’UNE APPLICATION MOBILE POUR LA SUPERVISION DU BILASAGE ET DES SYSTEMES ELECTRIQUES DE L’ASECNA : CAS DE L’AEROPORT INTERNTIONAL DE DOUALA Annexe 2: Vue régulateurs de balisage Mémoire de fin d’étude rédigé par KANKEU Bedouen en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur en Génie Industriel 116 DEVELOPPEMENT D’UNE APPLICATION MOBILE POUR LA SUPERVISION DU BILASAGE ET DES SYSTEMES ELECTRIQUES DE L’ASECNA : CAS DE L’AEROPORT INTERNTIONAL DE DOUALA Annexe 3: Vue du TGBT secouru Mémoire de fin d’étude rédigé par KANKEU Bedouen en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur en Génie Industriel 117 DEVELOPPEMENT D’UNE APPLICATION MOBILE POUR LA SUPERVISION DU BILASAGE ET DES SYSTEMES ELECTRIQUES DE L’ASECNA : CAS DE L’AEROPORT INTERNTIONAL DE DOUALA Annexe 4: Vue onduleurs Annexe 5: Evolution des modes de raccordement Mémoire de fin d’étude rédigé par KANKEU Bedouen en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur en Génie Industriel 118 DEVELOPPEMENT D’UNE APPLICATION MOBILE POUR LA SUPERVISION DU BILASAGE ET DES SYSTEMES ELECTRIQUES DE L’ASECNA : CAS DE L’AEROPORT INTERNTIONAL DE DOUALA Annexe 6: Firmament des bus de terrain Annexe 7: Modèle OSI Mémoire de fin d’étude rédigé par KANKEU Bedouen en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur en Génie Industriel 119 DEVELOPPEMENT D’UNE APPLICATION MOBILE POUR LA SUPERVISION DU BILASAGE ET DES SYSTEMES ELECTRIQUES DE L’ASECNA : CAS DE L’AEROPORT INTERNTIONAL DE DOUALA Annexe 8: Synthèse du modèle OSI pour les RLI Mémoire de fin d’étude rédigé par KANKEU Bedouen en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur en Génie Industriel 120 DEVELOPPEMENT D’UNE APPLICATION MOBILE POUR LA SUPERVISION DU BILASAGE ET DES SYSTEMES ELECTRIQUES DE L’ASECNA : CAS DE L’AEROPORT INTERNTIONAL DE DOUALA Annexe 9: Quelques fonctions Modbus usuelles Mémoire de fin d’étude rédigé par KANKEU Bedouen en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur en Génie Industriel 121 DEVELOPPEMENT D’UNE APPLICATION MOBILE POUR LA SUPERVISION DU BILASAGE ET DES SYSTEMES ELECTRIQUES DE L’ASECNA : CAS DE L’AEROPORT INTERNTIONAL DE DOUALA Annexe 10: Caractéristiques des GE CUMMINS KTA19-G3 Annexe 11: Câblage de la carte de control de vitesse CSC Mémoire de fin d’étude rédigé par KANKEU Bedouen en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur en Génie Industriel 122 DEVELOPPEMENT D’UNE APPLICATION MOBILE POUR LA SUPERVISION DU BILASAGE ET DES SYSTEMES ELECTRIQUES DE L’ASECNA : CAS DE L’AEROPORT INTERNTIONAL DE DOUALA Annexe 12: Caractéristiques TSX PSY 3610 Annexe 13: Schéma de principe : a) d’une entrée du 32D2K, b) d’une sortie du 32T2K a) Mémoire de fin d’étude rédigé par KANKEU Bedouen en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur en Génie Industriel b) 123 DEVELOPPEMENT D’UNE APPLICATION MOBILE POUR LA SUPERVISION DU BILASAGE ET DES SYSTEMES ELECTRIQUES DE L’ASECNA : CAS DE L’AEROPORT INTERNTIONAL DE DOUALA c) Mémoire de fin d’étude rédigé par KANKEU Bedouen en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur en Génie Industriel 124 DEVELOPPEMENT D’UNE APPLICATION MOBILE POUR LA SUPERVISION DU BILASAGE ET DES SYSTEMES ELECTRIQUES DE L’ASECNA : CAS DE L’AEROPORT INTERNTIONAL DE DOUALA Annexe 14: Caractéristiques générales 32T2K Mémoire de fin d’étude rédigé par KANKEU Bedouen en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur en Génie Industriel 125 DEVELOPPEMENT D’UNE APPLICATION MOBILE POUR LA SUPERVISION DU BILASAGE ET DES SYSTEMES ELECTRIQUES DE L’ASECNA : CAS DE L’AEROPORT INTERNTIONAL DE DOUALA Annexe 15: Caractéristiques réseau et techniques du 750-842 Mémoire de fin d’étude rédigé par KANKEU Bedouen en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur en Génie Industriel 126 DEVELOPPEMENT D’UNE APPLICATION MOBILE POUR LA SUPERVISION DU BILASAGE ET DES SYSTEMES ELECTRIQUES DE L’ASECNA : CAS DE L’AEROPORT INTERNTIONAL DE DOUALA Annexe 16: Caractéristiques du CPU TSX P57 104M Mémoire de fin d’étude rédigé par KANKEU Bedouen en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur en Génie Industriel 127 DEVELOPPEMENT D’UNE APPLICATION MOBILE POUR LA SUPERVISION DU BILASAGE ET DES SYSTEMES ELECTRIQUES DE L’ASECNA : CAS DE L’AEROPORT INTERNTIONAL DE DOUALA Annexe 17: Access local Annexe 18 : Access distant par DCOM Mémoire de fin d’étude rédigé par KANKEU Bedouen en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur en Génie Industriel 128 DEVELOPPEMENT D’UNE APPLICATION MOBILE POUR LA SUPERVISION DU BILASAGE ET DES SYSTEMES ELECTRIQUES DE L’ASECNA : CAS DE L’AEROPORT INTERNTIONAL DE DOUALA Annexe 19: Access distant par IIS Mémoire de fin d’étude rédigé par KANKEU Bedouen en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur en Génie Industriel 129 DEVELOPPEMENT D’UNE APPLICATION MOBILE POUR LA SUPERVISION DU BILASAGE ET DES SYSTEMES ELECTRIQUES DE L’ASECNA : CAS DE L’AEROPORT INTERNTIONAL DE DOUALA Annexe 20: Paramètres TGBT et TDBT surveillés API_Cent_MW417_12_I44_C_W3016_C API_Cent_MW417_13_I44_D_W3016_D API_Cent_MW417_14_I44_E_W3016_E API_Cent_MW417_15_I44_F_W3016_F API_Cent_MW418_0_I45_0_W3017_0 API_Cent_MW418_1_I45_1_W3017_1 API_Cent_MW418_2_I45_2_W3017_2 API_Cent_MW418_3_I45_3_W3017_3 API_Cent_MW418_4_I45_4_W3017_4 API_Cent_MW418_5_I45_5_W3017_5 API_Cent_MW418_6_I45_6_W3017_6 API_Cent_MW418_7_I45_7_W3017_7 API_Cent_MW418_8_I45_8_W3017_8 API_Cent_MW418_9_I45_9_W3017_9 API_Cent_MW418_10_I45_A_W3017_A API_Cent_MW418_11_I45_B_W3017_B API_Cent_MW418_12_I45_C_W3017_C API_Cent_MW418_13_I45_D_W3017_D API_Cent_MW418_14_I45_E_W3017_E API_Cent_MW418_15_I45_F_W3017_F API_Cent_MW419_0_I46_0_W3018_0 API_Cent_MW419_1_I46_1_W3018_1 API_Cent_MW419_2_I46_2_W3018_2 API_Cent_MW419_3_I46_3_W3018_3 API_Cent_MW419_4_I46_4_W3018_4 API_Cent_MW419_5_I46_5_W3018_5 API_Cent_MW419_6_I46_6_W3018_6 API_Cent_MW419_7_I46_7_W3018_7 API_Cent_MW419_8_I46_8_W3018_8 %MW417.12 %MW417.13 %MW417.14 %MW417.15 %MW418.0 %MW418.1 %MW418.2 %MW418.3 %MW418.4 %MW418.5 %MW418.6 %MW418.7 %MW418.8 %MW418.9 %MW418.10 %MW418.11 %MW418.12 %MW418.13 %MW418.14 %MW418.15 %MW419.0 %MW419.1 %MW419.2 %MW419.3 %MW419.4 %MW419.5 %MW419.6 %MW419.7 %MW419.8 BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL P0 TGBT SECTEUR 1 DÉFAUT ISOLEMENT P0 TGBT TRANSFORMATEUR TR01 TEMPERATURE 1ER SEUIL ALARME P0 TGBT TRANSFORMATEUR TR01 TEMPERATURE 2EME SEUIL DÉFAUT P0 TGBT SECTEUR 1 DISJONCTEUR GENERAL Q1 INV1 FERME P0 TGBT SECTEUR 1 DISJONCTEUR GENERAL Q1 INV1 DÉFAUT P0 TGBT PRESENCE TENSION SECTEUR P0 TGBT SECTEUR 2 DÉFAUT ISOLEMENT P0 TGBT TRANSFORMATEUR TR02 TEMPERATURE 1ER SEUIL ALARME P0 TGBT TRANSFORMATEUR TR02 TEMPERATURE 2EME SEUIL DÉFAUT P0 TGBT SECTEUR 1 DISJONCTEUR GENERAL Q2 INV1 FERME P0 TGBT SECTEUR 1 DISJONCTEUR GENERAL Q2 INV1 DÉFAUT P0 TGBT SECTEUR CONTRÔLE RESEAU RDT1 DÉFAUT TENSION P0 TGBT SECTEUR CONTRÔLE RESEAU RDF1 DÉFAUT FREQUENCE P0 TGBT SECTEUR SURVEILLANCE RESEAU R1 DÉFAUT PHASE P0 TGBT PRESENCE TENSION SECTEUR 1 P0 TGBT PRESENCE TENSION SECTEUR 2 P0 TGBT SECTEUR 1 DISJONCTEUR CONTRÔLE Q8 FERME P0 TGBT SECTEUR 2 DISJONCTEUR CONTRÔLE Q9 FERME P0 TGBT SECTEUR DISJONCTEUR MESURE QM1 FERME P0 TGBT SECTEUR DISJONCTEUR BATTERIE DE CONDENSATEURS Q10 FERME P0 TGBT SECTEUR DISJONCTEUR BATTERIE DE CONDENSATEURS Q10 DÉFAUT P0 TGBT SECTEUR DISJONCTEUR ECLAIRAGE AIRE DE STATIONNEMENT Q11 FERME P0 TGBT SECTEUR DISJONCTEUR ECLAIRAGE AIRE DE STATIONNEMENT Q11 DÉFAUT P0 TGBT SECTEUR CONTACTEUR INTERRUPTEUR ECLAIRAGE AIRE DE STATIONNEM. KM1 FER P0 TGBT SECTEUR DISJONCTEUR MAGASIN GENERAL Q12 FERME P0 TGBT SECTEUR DISJONCTEUR MAGASIN GENERAL Q12 DÉFAUT P0 TGBT SECTEUR DISJONCTEUR BLOC TECHNIQUE Q13 FERME P0 TGBT SECTEUR DISJONCTEUR BLOC TECHNIQUE Q13 DÉFAUT P0 TGBT SECTEUR DISJONCTEUR SSIS Q14 FERME Mémoire de fin d’étude rédigé par KANKEU Bedouen en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur en Génie Industriel 130 DEVELOPPEMENT D’UNE APPLICATION MOBILE POUR LA SUPERVISION DU BILASAGE ET DES SYSTEMES ELECTRIQUES DE L’ASECNA : CAS DE L’AEROPORT INTERNTIONAL DE DOUALA API_Cent_MW419_9_I46_9_W3018_9 %MW419.9 BOOL P0 TGBT SECTEUR DISJONCTEUR SSIS Q14 DÉFAUT Annexe 21: Paramètres GE 1 et GE 2 surveillés API_Cent_MW430_8_I61_8_W3029_8 API_Cent_MW430_9_I61_9_W3029_9 API_Cent_MW430_10_I61_A_W3029_A API_Cent_MW430_11_I61_B_W3029_B API_Cent_MW430_12_I61_C_W3029_C API_Cent_MW430_13_I61_D_W3029_D API_Cent_MW430_14_I61_E_W3029_E API_Cent_MW430_15_I61_F_W3029_F API_Cent_MW431_0_I62_0_W3030_0 API_Cent_MW431_1_I62_1_W3030_1 API_Cent_MW431_2_I62_2_W3030_2 API_Cent_MW431_3_I62_3_W3030_3 API_Cent_MW431_4_I62_4_W3030_4 API_Cent_MW431_5_I62_5_W3030_5 API_Cent_MW431_6_I62_6_W3030_6 API_Cent_MW431_7_I62_7_W3030_7 API_Cent_MW431_8_I62_8_W3030_8 API_Cent_MW431_9_I62_9_W3030_9 API_Cent_MW431_10_I62_A_W3030_A API_Cent_MW431_11_I62_B_W3030_B API_Cent_MW431_12_I62_C_W3030_C API_Cent_MW431_13_I62_D_W3030_D API_Cent_MW431_14_I62_E_W3030_E API_Cent_MW431_15_I62_F_W3030_F API_Cent_MW432_0_I63_0_W3031_0 API_Cent_MW432_1_I63_1_W3031_1 %MW430.8 %MW430.9 %MW430.10 %MW430.11 %MW430.12 %MW430.13 %MW430.14 %MW430.15 %MW431.0 %MW431.1 %MW431.2 %MW431.3 %MW431.4 %MW431.5 %MW431.6 %MW431.7 %MW431.8 %MW431.9 %MW431.10 %MW431.11 %MW431.12 %MW431.13 %MW431.14 %MW431.15 %MW432.0 %MW432.1 BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL P0 GROUPE 1 NON DEMARRAGE P0 GROUPE 1 GROUPE INDISPONIBLE P0 GROUPE 1 NIVEAU BAS RADIATEUR P0 GROUPE 1 TEMPERATURE EAU P0 GROUPE 1 PRESSION HUILE P0 GROUPE 1 TEMPERATURE HUILE P0 GROUPE 1 SURVITESSE P0 GROUPE 1 DÉFAUT TENSION BATTERIE P0 GROUPE 1 DÉFAUT AUXILIAIRE P0 GROUPE 1 GROUPE EN FONCTIONNEMENT P0 GROUPE 1 TEMPERATURE ALTERNATEUR P0 GROUPE 1 TENSION ALTERNATEUR P0 GROUPE 1 FREQUENCE ALTERNATEUR P0 GROUPE 1 PHASE ALTERNATEUR P0 GROUPE 1 PRECHAUFFAGE MOTEUR P0 GROUPE 1 ARRET D'URGENCE P0 GROUPE 1 SURINTENSITE P0 GROUPE 1 FUITE BAC RETENTION 500L P0 GROUPE 1 NIVEAU TRES BAS 500L P0 GROUPE 1 DÉFAUT AIR COMPRIME RESERVE P0 GROUPE 1 GROUPE PRÊT P0 GROUPE 2 NON DEMARRAGE P0 GROUPE 2 GROUPE INDISPONIBLE P0 GROUPE 2 NIVEAU BAS RADIATEUR P0 GROUPE 2 TEMPERATURE EAU Mémoire de fin d’étude rédigé par KANKEU Bedouen en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur en Génie Industriel 131 DEVELOPPEMENT D’UNE APPLICATION MOBILE POUR LA SUPERVISION DU BILASAGE ET DES SYSTEMES ELECTRIQUES DE L’ASECNA : CAS DE L’AEROPORT INTERNTIONAL DE DOUALA API_Cent_MW432_2_I63_2_W3031_2 API_Cent_MW432_3_I63_3_W3031_3 API_Cent_MW432_4_I63_4_W3031_4 API_Cent_MW432_5_I63_5_W3031_5 API_Cent_MW432_6_I63_6_W3031_6 API_Cent_MW432_7_I63_7_W3031_7 API_Cent_MW434_14_I65_E_W3033_E API_Cent_MW434_15_I65_F_W3033_F API_Cent_MW435_0_I66_0_W3034_0 API_Cent_MW435_1_I66_1_W3034_1 API_Cent_MW435_2_I66_2_W3034_2 API_Cent_MW435_3_I66_3_W3034_3 API_Cent_MW435_4_I66_4_W3034_4 API_Cent_MW435_5_I66_5_W3034_5 API_Cent_MW435_6_I66_6_W3034_6 API_Cent_MW435_7_I66_7_W3034_7 API_Cent_MW435_8_I66_8_W3034_8 API_Cent_MW435_9_I66_9_W3034_9 API_Cent_MW435_10_I66_A_W3034_A API_Cent_MW435_11_I66_B_W3034_B API_Cent_MW435_12_I66_C_W3034_C API_Cent_MW435_13_I66_D_W3034_D API_Cent_MW435_14_I66_E_W3034_E API_Cent_MW435_15_I66_F_W3034_F API_Cent_MW436_0_I67_0_W3035_0 API_Cent_MW436_1_I67_1_W3035_1 API_Cent_MW436_2_I67_2_W3035_2 API_Cent_MW436_3_I67_3_W3035_3 API_Cent_MW436_4_I67_4_W3035_4 API_Cent_MW436_5_I67_5_W3035_5 API_Cent_MW436_6_I67_6_W3035_6 %MW432.2 %MW432.3 %MW432.4 %MW432.5 %MW432.6 %MW432.7 %MW434.14 %MW434.15 %MW435.0 %MW435.1 %MW435.2 %MW435.3 %MW435.4 %MW435.5 %MW435.6 %MW435.7 %MW435.8 %MW435.9 %MW435.10 %MW435.11 %MW435.12 %MW435.13 %MW435.14 %MW435.15 %MW436.0 %MW436.1 %MW436.2 %MW436.3 %MW436.4 %MW436.5 %MW436.6 BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL P0 GROUPE 2 PRESSION HUILE P0 GROUPE 2 TEMPERATURE HUILE P0 GROUPE 2 SURVITESSE P0 GROUPE 2 DÉFAUT TENSION BATTERIE P0 GROUPE 2 DÉFAUT AUXILIAIRE P0 GROUPE 2 GROUPE EN FONCTIONNEMENT P0 COFFRET 48VDC DISJONCTEURS Q1C A Q5C DÉFAUT P0 PU COMMUTATEUR CHOIX DE MARCHE GROUPE 1 POSITION ARRET P0 PU COMMUTATEUR CHOIX DE MARCHE GROUPE 1 POSITION AUTO P0 PU COMMUTATEUR CHOIX DE MARCHE GROUPE 1 POSITION ESSAI P0 PU COMMUTATEUR CHOIX DE MARCHE GROUPE 1 POSITION MANU P0 PU DISJONCTEUR ALIMENTATION 48VDC PUPITRE QMG1 FERME P0 PU COMMUTATEUR CHOIX DE PRIORITE GROUPE G1 OU G2 POSITION G1 P0 PU COMMUTATEUR CHOIX DE PRIORITE GROUPE G1 OU G2 POSITION G2 P0 PU DEMANDE DEBIT G1 P0 PU ARRET DEBIT G1 P0 PU COMMUTATEUR CHOIX DE MARCHE GROUPE 2 POSITION ARRET P0 PU COMMUTATEUR CHOIX DE MARCHE GROUPE 2 POSITION AUTO P0 PU COMMUTATEUR CHOIX DE MARCHE GROUPE 2 POSITION ESSAI P0 PU COMMUTATEUR CHOIX DE MARCHE GROUPE 2 POSITION MANU P0 PU DEMANDE DEBIT G2 P0 PU ARRET DEBIT G2 P0 PU COMMUTATEUR CHOIX DE MARCHE GROUPE 3 POSITION ARRET P0 PU COMMUTATEUR CHOIX DE MARCHE GROUPE 3 POSITION AUTO P0 PU COMMUTATEUR CHOIX DE MARCHE GROUPE 3 POSITION ESSAI P0 PU COMMUTATEUR CHOIX DE MARCHE GROUPE 3 POSITION MANU P0 PU COMMUTATEUR CHOIX DE PRIORITE GROUPE G3 OU G4 POSITION G3 P0 PU COMMUTATEUR CHOIX DE PRIORITE GROUPE G3 OU G4 POSITION G4 P0 PU DEMANDE DEBIT G3 P0 PU ARRET DEBIT G3 P0 PU COMMUTATEUR CHOIX DE MARCHE GROUPE 4 POSITION ARRET Mémoire de fin d’étude rédigé par KANKEU Bedouen en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur en Génie Industriel 132 DEVELOPPEMENT D’UNE APPLICATION MOBILE POUR LA SUPERVISION DU BILASAGE ET DES SYSTEMES ELECTRIQUES DE L’ASECNA : CAS DE L’AEROPORT INTERNTIONAL DE DOUALA API_Cent_MW436_7_I67_7_W3035_7 API_Cent_MW436_8_I67_8_W3035_8 API_Cent_MW436_9_I67_9_W3035_9 API_Cent_MW436_10_I67_A_W3035_A API_Cent_MW436_11_I67_B_W3035_B Pcv_API_Cent_TOR_mot22 PCV_API_Cent_W3030_0 PCV_API_Cent_W3030_1 PCV_API_Cent_W3030_2 PCV_API_Cent_W3030_3 PCV_API_Cent_W3030_4 PCV_API_Cent_W3030_5 PCV_API_Cent_W3030_6 PCV_API_Cent_W3030_7 PCV_API_Cent_W3030_8 PCV_API_Cent_W3030_9 PCV_API_Cent_W3030_A PCV_API_Cent_W3030_B PCV_API_Cent_W3030_C PCV_API_Cent_W3030_D PCV_API_Cent_W3030_E PCV_API_Cent_W3030_F Pcv_API_Cent_TOR_mot23 PCV_API_Cent_W3031_0 PCV_API_Cent_W3031_1 PCV_API_Cent_W3031_2 PCV_API_Cent_W3031_3 PCV_API_Cent_W3031_4 PCV_API_Cent_W3031_5 %MW436.7 %MW436.8 %MW436.9 %MW436.10 %MW436.11 %M2836 %M2836 %M2837 %M2838 %M2839 %M2840 %M2841 %M2842 %M2843 %M2844 %M2845 %M2846 %M2847 %M2848 %M2849 %M2850 %M2851 %M2852 %M2852 %M2853 %M2854 %M2855 %M2856 %M2857 BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL ARRAY[0..15] OF EBOOL EBOOL EBOOL EBOOL EBOOL EBOOL EBOOL EBOOL EBOOL EBOOL EBOOL EBOOL EBOOL EBOOL EBOOL EBOOL EBOOL ARRAY[0..15] OF EBOOL EBOOL EBOOL EBOOL EBOOL EBOOL EBOOL P0 PU COMMUTATEUR CHOIX DE MARCHE GROUPE 4 POSITION AUTO P0 PU COMMUTATEUR CHOIX DE MARCHE GROUPE 4 POSITION ESSAI P0 PU COMMUTATEUR CHOIX DE MARCHE GROUPE 4 POSITION MANU P0 PU DEMANDE DEBIT G4 P0 PU ARRET DEBIT G4 Table image PCV API centrale %MW 3030 P0 GROUPE 1 DÉFAUT AUXILIAIRE P0 GROUPE 1 GROUPE EN FONCTIONNEMENT P0 GROUPE 1 TEMPERATURE ALTERNATEUR P0 GROUPE 1 TENSION ALTERNATEUR P0 GROUPE 1 FREQUENCE ALTERNATEUR P0 GROUPE 1 PHASE ALTERNATEUR P0 GROUPE 1 PRECHAUFFAGE MOTEUR P0 GROUPE 1 ARRET D'URGENCE P0 GROUPE 1 SURINTENSITE P0 GROUPE 1 FUITE BAC RETENTION 500L P0 GROUPE 1 NIVEAU TRES BAS 500L P0 GROUPE 1 DÉFAUT AIR COMPRIME RESERVE P0 GROUPE 1 GROUPE PRÊT P0 GROUPE 2 NON DEMARRAGE P0 GROUPE 2 GROUPE INDISPONIBLE Table image PCV API centrale %MW 3031 P0 GROUPE 2 NIVEAU BAS RADIATEUR P0 GROUPE 2 TEMPERATURE EAU P0 GROUPE 2 PRESSION HUILE P0 GROUPE 2 TEMPERATURE HUILE P0 GROUPE 2 SURVITESSE P0 GROUPE 2 DÉFAUT TENSION BATTERIE Mémoire de fin d’étude rédigé par KANKEU Bedouen en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur en Génie Industriel 133 DEVELOPPEMENT D’UNE APPLICATION MOBILE POUR LA SUPERVISION DU BILASAGE ET DES SYSTEMES ELECTRIQUES DE L’ASECNA : CAS DE L’AEROPORT INTERNTIONAL DE DOUALA PCV_API_Cent_W3031_6 PCV_API_Cent_W3031_7 PCV_API_Cent_W3031_8 PCV_API_Cent_W3031_9 PCV_API_Cent_W3031_A PCV_API_Cent_W3031_B PCV_API_Cent_W3031_C PCV_API_Cent_W3031_D PCV_API_Cent_W3031_E PCV_API_Cent_W3031_F Pcv_API_Cent_TOR_mot24 PCV_API_Cent_W3032_0 PCV_API_Cent_W3032_1 PCV_API_Cent_W3032_2 PCV_API_Cent_W3032_3 PCV_API_Cent_W3032_4 PCV_API_Cent_W3032_5 PCV_API_Cent_W3032_6 PCV_API_Cent_W3032_7 PCV_API_Cent_W3032_8 PCV_API_Cent_W3032_9 PCV_API_Cent_W3032_A PCV_API_Cent_W3032_B %M2858 %M2859 %M2860 %M2861 %M2862 %M2863 %M2864 %M2865 %M2866 %M2867 %M2868 %M2868 %M2869 %M2870 %M2871 %M2872 %M2873 %M2874 %M2875 %M2876 %M2877 %M2878 %M2879 EBOOL EBOOL EBOOL EBOOL EBOOL EBOOL EBOOL EBOOL EBOOL EBOOL ARRAY[0..15] OF EBOOL EBOOL EBOOL EBOOL EBOOL EBOOL EBOOL EBOOL EBOOL EBOOL EBOOL EBOOL EBOOL P0 GROUPE 2 DÉFAUT AUXILIAIRE P0 GROUPE 2 GROUPE EN FONCTIONNEMENT P0 GROUPE 2 TEMPERATURE ALTERNATEUR P0 GROUPE 2 TENSION ALTERNATEUR P0 GROUPE 2 FREQUENCE ALTERNATEUR P0 GROUPE 2 PHASE ALTERNATEUR P0 GROUPE 2 PRECHAUFFAGE MOTEUR P0 GROUPE 2 ARRET D'URGENCE P0 GROUPE 2 SURINTENSITE P0 GROUPE 2 FUITE BAC RETENTION 500L Table image PCV API centrale %MW 3032 P0 OND1 PREALARME FIN D'AUTONOMIE BATTERIE P0 OND1 FONCTIONNEMENT SUR BATTERIE P0 OND1 FONCTIONNEMENT SUR ONDULEUR P0 OND1 ALARME GLOBALE P0 PU COMMUTATEUR LOCAL/DISTANCE GROUPE 1 POSIT, DISTANCE P0 OND2 PREALARME FIN D'AUTONOMIE BATTERIE P0 OND2 FONCTIONNEMENT SUR BATTERIE P0 OND2 FONCTIONNEMENT SUR ONDULEUR P0 OND2 ALARME GLOBALE P0 PU COMMUTATEUR LOCAL/DISTANCE GROUPE 2 POSIT, DISTANCE P0 NORMAL/SECOUR ONDULEUR FONCTIONNEMENT SUR ONDULEUR P0 NORMAL/SECOUR ONDULEUR ALARME GLOBALE Annexe 22 : Paramètres onduleurs ASI et chargeurs surveillés Pcv_API_Cent_TOR_mot25 PCV_API_Cent_W3033_0 PCV_API_Cent_W3033_1 %M2884 %M2884 %M2885 ARRAY[0..15] OF EBOOL EBOOL EBOOL Table image PCV API centrale %MW 3033 P0 BATTERIE ONDULEUR 2 DÉFAUT ISOLEMENT P0 COFFRET DISJONCTEUR BATTERIES ONDULEUR 2 QF2 FERME Mémoire de fin d’étude rédigé par KANKEU Bedouen en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur en Génie Industriel 134 DEVELOPPEMENT D’UNE APPLICATION MOBILE POUR LA SUPERVISION DU BILASAGE ET DES SYSTEMES ELECTRIQUES DE L’ASECNA : CAS DE L’AEROPORT INTERNTIONAL DE DOUALA PCV_API_Cent_W3033_2 PCV_API_Cent_W3033_3 PCV_API_Cent_W3033_4 PCV_API_Cent_W3033_5 PCV_API_Cent_W3033_6 PCV_API_Cent_W3033_7 PCV_API_Cent_W3033_8 PCV_API_Cent_W3033_9 PCV_API_Cent_W3033_A PCV_API_Cent_W3033_B PCV_API_Cent_W3033_C PCV_API_Cent_W3033_D PCV_API_Cent_W3033_E %M2886 %M2887 %M2888 %M2889 %M2890 %M2891 %M2892 %M2893 %M2894 %M2895 %M2896 %M2897 %M2898 EBOOL EBOOL EBOOL EBOOL EBOOL EBOOL EBOOL EBOOL EBOOL EBOOL EBOOL EBOOL EBOOL P0 COFFRET DISJONCTEUR BATTERIES ONDULEUR 2 QF2 DÉFAUT P0 CHARGEUR 48VDC N°1 DÉFAUT REDRESSEUR ET MAXI DC P0 CHARGEUR 48VDC N°1 DÉFAUT TERRE P0 CHARGEUR 48VDC N°1 PREALARME MINI DC UTILISATION P0 CHARGEUR 48VDC N°1 DISJONCTEUR UTILISATION Q2 FERME P0 CHARGEUR 48VDC N°2 DÉFAUT REDRESSEUR ET MAXI DC P0 CHARGEUR 48VDC N°2 DÉFAUT TERRE P0 CHARGEUR 48VDC N°2 PREALARME MINI DC UTILISATION P0 CHARGEUR 48VDC N°2 DISJONCTEUR UTILISATION Q2 FERME P0 COFFRET 48VDC INTERRUPTEUR GENERAL I1C FERME P0 COFFRET 48VDC INTERRUPTEUR GENERAL I2C FERME P0 COFFRET 48VDC DISJONCTEURS Q1C A Q5C FERME P0 COFFRET 48VDC DISJONCTEURS Q1C A Q5C DÉFAUT Mémoire de fin d’étude rédigé par KANKEU Bedouen en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur en Génie Industriel 135 DEVELOPPEMENT D’UNE APPLICATION MOBILE POUR LA SUPERVISION DU BILASAGE ET DES SYSTEMES ELECTRIQUES DE L’ASECNA : CAS DE L’AEROPORT INTERNTIONAL DE DOUALA Mémoire de fin d’étude rédigé par KANKEU Bedouen en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur en Génie Industriel 136