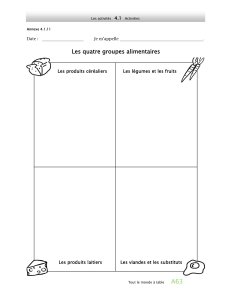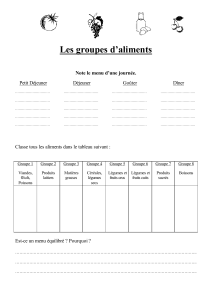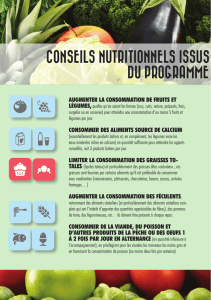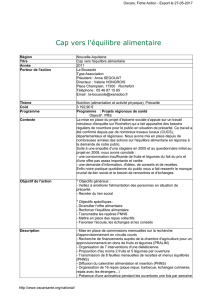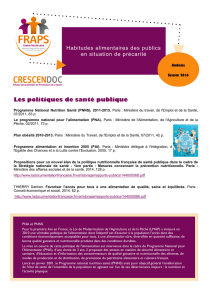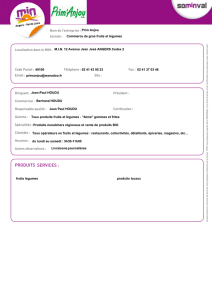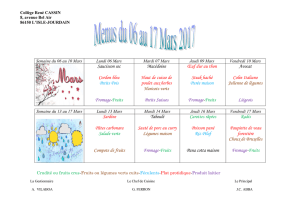Cah. Nutr. Diét., 40, 2, 2005 97
comportement alimentaire
comportement alimentaire
ÉVOLUTION DE LA CONSOMMATION
ALIMENTAIRE DANS L’ÉTUDE
SU.VI.MAX (1995-2002)
Chantal SAVANOVITCH1, Valérie DESCHAMPS1, Nathalie ARNAULT2, Katia CASTETBON1,
Sandrine BERTRAIS1, 2, Louise MENNEN1, 2, Pilar GALAN1, 2, Serge HERCBERG1, 2
Depuis le début des années 1970, de très nombreux travaux issus de la
recherche fondamentale, clinique et épidémiologique ont permis d’identifier
divers facteurs nutritionnels (alimentaires, marqueurs de l’état nutritionnel
et activité physique), qui en excès ou en insuffisance, sont susceptibles
d’intervenir en tant que facteur de risque, ou au contraire de protection, vis-
à-vis du développement de certaines maladies chroniques [1].
C’est sur la base de ces connaissances scientifiques et des enjeux humains,
sociaux et économiques associés à ces maladies (cancers, maladies cardiovas-
culaires, obésité, ostéoporose, diabète,..), qu’ont été fixés, en 2001, les objec-
tifs du Programme National Nutrition Santé (PNNS) [2]. Ces objectifs de
santé publique ont été traduits sous forme de recommandations d’apports
quantitatifs de groupes d’aliments, à destination du grand public et diffusées
par l’intermédiaire de guides de référence [3].
Surveiller les facteurs risque ou de protection liés à la
nutrition est un élément essentiel pour définir, évaluer
l’impact, et, éventuellement, ajuster les actions de santé
publique selon les évolutions observées. Concernant l’ali-
mentation, la plupart des informations longitudinales dis-
ponibles proviennent des données statistiques relatives
aux disponibilités alimentaires et aux achats des ménages
(FAO, Insee, données Sécodip…). Malgré l’intérêt de ces
informations indirectes sur les tendances évolutives de la
consommation alimentaire moyenne de la population, ces
données ne représentent pas les consommations réelles,
et masquent les disparités en fonction de l’âge, du sexe,
des catégories socioprofessionnelles,… Peu de données
recueillies par des enquêtes transversales répétées ou lon-
gitudinales (cohortes), permettent en France de décrire
l’évolution de la consommation alimentaire mesurée au
niveau des individus.
La cohorte constituée pour l’étude SU.VI.MAX, suivie
régulièrement sur le plan alimentaire depuis 1995, offre
l’opportunité d’analyser l’évolution des consommations,
en termes d’aliments et de nutriments, sur une large popu-
lation adultes [4]. L’objectif de cet article est de présenter
l’évolution entre 1995 et 2002, de la consommation ali-
mentaire des participants à cette étude SU.VI.MAX, par
catégories d’aliments telles qu’elles ont été définies pour
les repères de consommation du PNNS [3].
Matériel et méthodes
Population
L’étude SU.VI.MAX (Supplémentation en vitamines et
minéraux anti-oxydants) est un essai d’intervention rando-
misé en double aveugle et contre placebo, dont l’objectif
principal visait à évaluer l’impact pendant 8 ans d’un
1. Unité de Surveillance et d’Épidémiologie Nutritionnelle (USEN), Institut national
de Veille Sanitaire (InVS), Institut Scientifique et Technique de l’Alimentation
(ISTNA), Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM), Paris, France.
2. UMR INSERM U.557/INRA U.1125/CNAM, Unité de Recherche en Épidé-
miologie Nutritionnelle (UREN), Institut Scientifique et Technique de l’Alimentation
(ISTNA), Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM), Paris, France.
Correspondance : Ch. Savanovitch, à l’adresse ci-dessus.
E-mail : [email protected]

98 Cah. Nutr. Diét., 40, 2, 2005
comportement alimentaire
apport quotidien d’antioxydants (β− carotène, vitamines C
et E, sélénium et zinc) à des doses nutritionnelles, sur
l’incidence des cardiopathies ischémiques et des cancers,
et sur la mortalité [4-6]. Cette étude a également permis
de disposer d’une banque de données sur la nutrition et la
santé. Au total, 12 741 sujets (7 713 femmes âgées de
35 à 60 ans, et 5 028 hommes âgés de 45 à 60 ans) ont
été inclus et suivis depuis 1994-1995, après que près de
80 000 personnes se soient portées volontaires suite à
une campagne médiatique nationale.
Recueil des données alimentaires
Les données alimentaires ont été recueillies par déclaration
thématique de l’alimentation sur 24 heures tous les 2 mois,
soit 6 enregistrements par sujet et par an. Les jours choisis
pour les enregistrements ont été aléatoirement répartis sur
la semaine (week-ends compris), afin d’améliorer la repré-
sentativité de la mesure des apports alimentaires. À l’occa-
sion de ces enregistrements alimentaires, des précisions
étaient demandées sur les aliments consommés, les lieux de
prise alimentaire (domicile, restaurant, cantine…), les quan-
tités consommées, les modes de préparation, l’origine des
aliments (surgelés, conserves…) et les marques. Ces infor-
mations étaient utilisées pour évaluer avec précision les
apports nutritionnels des sujets.
Les jours tirés au sort, les sujets saisissaient l’ensemble de
leurs prises alimentaires selon le moment de la journée, y
compris les collations. Les données quantitatives ont été
estimées par les sujets grâce au manuel photographique
des portions alimentaires de l’étude, validé par une étude
spécifique [6]. Il comprend plus de 250 aliments (soit
1 000 aliments génériques), représentés en trois tailles
principales pour la plupart des quantités. Avec la possibi-
lité de choisir les positions extrêmes ou entre les portions,
sept possibilités de tailles différentes étaient proposées.
Analyses statistiques
Les analyses sur les données alimentaires portent ici sur
les sujets ayant répondu à au moins 6 enregistrements ali-
mentaires par période de 2 ans (si les sujets avaient
répondu à plus de 6 rappels en 2 ans, les rappels supplé-
mentaires ont été pris en compte dans les analyses). Les
périodes analysées sont : 1995-1996 (n = 6 396), 1997-
1998 (n = 4 605), 1999-2000 (n = 3 187), 2001-2002
(n = 2 035). Les analyses ont été réalisées séparément
chez les hommes et les femmes. Les apports alimentaires
ont par ailleurs été décrits au cours du temps à classes
d’âge équivalentes, pour tenir compte du vieillissement de
la cohorte.
Les données alimentaires sont décrites sous forme
d’apports quantitatifs en grammes (moyennes et écarts-
types) et de fréquences de consommation par catégorie
d’aliments, telles qu’elles peuvent être définies d’après les
repères de consommation du PNNS (tableau I). La pro-
portion de sujets atteignant les repères de consommation
du PNNS est quant à elle présentée en pourcentage. Les
indicateurs utilisés pour chaque catégorie d’aliments selon
les objectifs et repères de consommation du PNNS sont
détaillés dans le tableau II. Des tests de tendances ont été
réalisés pour comparer, aux différentes périodes d’étude,
les apports moyens des groupes d’aliments à tranche
d’âge équivalente et par sexe. L’évolution dans le temps
des pourcentages de sujets atteignant les seuils de
consommation attribués à chaque catégorie d’aliments a
été testée par un Chi-2 de tendance. Le logiciel SAS (ver-
sion 6.2) a été utilisé pour l’analyse des données.
Résultats
Fruits et légumes
En moyenne, la consommation de fruits en g/jour a aug-
menté au cours des années d’enquête chez les hommes
comme chez les femmes (tableau III). Une augmentation,
régulière au cours des périodes d’enquête, de la consom-
mation de fruits a été observée dans chaque tranche d’âge
au cours des différentes périodes d’enquête mais n’était
pas significative. Par exemple, les hommes de 50-59 ans
en 1995–1996 consommaient en moyenne 235,7 g/jour
de fruits, et ceux du même âge en 2001–2002 en
consommaient 243,4 g/jour (p = 0,23).
Globalement, la consommation moyenne de légumes a
légèrement augmenté en 2001-2002 par rapport à 1995-
Tableau I.
Exemples d’aliments inclus dans les groupes d’aliments, selon les repères de consommation du PNNS.
Groupe d’aliments Aliments
Fruits et légumes Fruits frais, au sirop, en compote, pur jus de fruit et jus de fruit sans sucre ajouté
Légumes crus ou cuits, soupes de légumes et jus de légumes
Pains, céréales, pommes de terre et légumes secs Pains, biscottes
Riz, pâtes, semoule, céréales du petit déjeuner sans sucre ajouté
Pommes de terre et légumes secs
Lait et produits laitiers Lait et boissons chaudes à base de lait, yaourts, petits suisses, fromages blancs,
fromages frais, fromages affinés
Viandes et volailles, produits de la pêche et œufs Viandes rouges, volailles, gibier, abats, jambon cuit
Poissons frais, en conserve, surgelés et crustacés
Œufs entiers, omelettes
Matières grasses ajoutées Beurre, crème fraîche, saindoux, graisse d’oie, lard, huiles, coprah, margarine,
pâte d’arachide, pâte à tartiner
Sucre et produits sucrés Miel, confiture, chocolat, gâteaux, biscuits, pâtisseries, crêpes, entremets,
crèmes desserts, glaces
Sirops, sodas, jus de fruits sucrés et nectars,
Bonbons, céréales du petit déjeuner sucrées ou chocolatées, pâte d’amande
Boissons alcoolisées Vins, bière, cidre et spiritueux
Les plats composés contenant différentes catégories d’aliments n’ont pas été pris en compte.

Cah. Nutr. Diét., 40, 2, 2005 99
comportement alimentaire
Tableau II.
Indicateurs utilisés pour chaque catégorie d’aliments selon les objectifs de santé publique et les repères de consommation du PNNS.
Catégorie d’aliments Indicateurs utilisés
Fruits et légumes < 3,5/jour* (moins d’1,5 portion de fruits et moins de 2 portions de légumes
quotidiennement)
≥ 5/jour**
Pains, céréales, pommes de terre et légumes secs ≥ 3/jour***
Lait et produits laitiers 3/jour**
Viandes et volailles, produits de la pêche et œufs (VPO) VPO : 1 à 2/jour**
Produits de la pêche : ≥ 2/semaine**
Matières grasses ajoutées Apports moyens en g/jour*** (Limiter la consommation**)
Sucre et produits sucrés Apports moyens en g/jour*** (Limiter la consommation**)
Boissons alcoolisées Hommes : ≤ 3 verres/jour**
Femmes : ≤ 2 verres/jour**
Tous : ≤ 20 g/jour* abstinents exclus ou non
* Référence utilisée pour la définition de l’objectif de santé publique.
** Repère de consommation du PNNS.
*** Indicateur utilisé pour des raisons méthodologiques.
Tableau III.
Consommation de groupes d’aliments (g/jour) selon le sexe et la période.
Groupe d’aliments Année Hommes Femmes
Moy ± Ec typ Moy ± Ec typ
Fruits 1995-1996
1997-1998
1999-2000
2001-2002
232,5 ± 151,6
234,6 ± 149,2
245,6 ± 155,5
249,2 ± 160,4
216,6 ± 125,3
215,3 ± 121,7
222,5 ± 125,0
230,3 ± 127,7
Légumes 1995-1996
1997-1998
1999-2000
2001-2002
241,5 ± 129,0
238,8 ± 125,0
243,1 ± 132,8
251,1 ± 123,5
230,6 ± 114,6
225,6 ± 112,9
226,4 ± 112,0
242,4 ± 117,1
Pains, céréales,
pommes de terre et légumes secs 1995-1996
1997-1998
1999-2000
2001-2002
295,8 ± 123,3
295,6 ± 118,1
289,4 ± 109,2
295,1 ± 118,3
197,4 ± 84,9
195,8 ± 83,5
191,3 ± 81,3
190,4 ± 78,0
Lait et produits laitiers 1995-1996
1997-1998
1999-2000
2001-2002
260,4 ± 164,2
257,0 ± 163,7
259,7 ± 166,9
261,4 ± 169,2
258,2 ± 163,5
253,0 ± 155,8
254,0 ± 157,9
250,8 ± 157,3
Viandes et volailles,
produits de la pêche et oeufs 1995-1996
1997-1998
1999-2000
2001-2002
172,5 ± 65,1
163,7 ± 63,2
155,7 ± 59,9
151,5 ± 59,5
127,6 ± 49,3
117,8 ± 48,9
114,4 ± 48,1
110,1 ± 48,2
Matières grasses ajoutées 1995-1996
1997-1998
1999-2000
2001-2002
25,6 ± 13,2
24,5 ± 13,1
22,8 ± 12,7
15,2 ± 11,7
21,6 ± 10,7
20,3 ± 10,4
18,6 ± 10,0
12,8 ± 9,0
Sucre et produits sucrés 1995-1996
1997-1998
1999-2000
2001-2002
134,6 ± 92,6
133,8 ± 97,8
129,4 ± 86,6
129,9 ± 92,7
113,9 ± 77,9
113,6 ± 82,8
110,1 ± 77,7
106,0 ± 69,4
Boissons alcoolisées
(g d’alcool) 1995-1996
1997-1998
1999-2000
2001-2002
29,3 ± 24,2
31,2 ± 24,1
31,4 ± 23,6
30,5 ± 24,3
11,0 ± 13,2
12,0 ± 13,7
12,2 ± 13,6
11,3 ± 12,6
Effectifs :
Hommes 1995-1996 : 2 731 ; 1997-1998 : 2005 ; 1999-2000 : 1458 ; 2001-2002 : 962.
Femmes 1995-1996 : 3 665 ; 1997-1998 : 2 600 ; 1999-2000 : 1 729 ; 2001-2002 : 1 073.

100 Cah. Nutr. Diét., 40, 2, 2005
comportement alimentaire
1996 (tableau III). Néanmoins, les analyses à classes d’âge
équivalentes montrent une tendance à la diminution, non
significative, dans chaque tranche d’âge. Seuls les hommes
de 50-59 ans voyaient leur consommation diminuer signi-
ficativement (de 250,7 g/jour (± 35,8) à 234,4 g/jour
(± 117,5) ; p = 0,03). L’augmentation globale moyenne
semblait donc liée au vieillissement de la cohorte, puisque
les sujets des classes d’âge les plus élevées en étaient les
plus forts consommateurs : par exemple, en 2001-2002,
les hommes de 50-59 ans consommaient en moyenne
234,4 g/jour de légumes contre 268,2 g/jour chez ceux
de 60-68 ans à la même période.
Le pourcentage de petits consommateurs de fruits et
légumes, selon l’objectif de santé publique du PNNS, a
globalement diminué de 31,5 % en 1995-1996 à 21,0 %
en 2001-2002 chez les hommes, et de 25,9 % à 18,2 %
chez les femmes au cours de la même période. Si le
repère de consommation du PNNS est pris en considéra-
tion, le pourcentage des sujets consommant au moins 5
fruits et légumes par jour a augmenté sur la même période
(hommes : 14,6 % à 22,5 % ; femmes : 17,0 % à
27,5 %). Ces améliorations ont été observées également
lorsque les analyses ont été réalisées à tranches d’âge
équivalentes (fig. 2a), exprimées pour l’objectif de santé
publique (< 3,5 par jour, Figure 1a) ou le repère de
consommation (≥ 5 par jour, (fig. 2b).
Pains, céréales, pommes de terre et légumes secs
Les apports alimentaires moyens en pain, céréales, pommes
de terre et légumes secs ont été peu modifiés au cours des
quatre périodes d’enquêtes, chez les hommes comme les
femmes (tableau III). À tranche d’âge équivalente et selon
le sexe, aucune modification significative des apports en
cette catégorie d’aliments n’a été observée.
La proportion de personnes consommant du pain, des
céréales, des pommes de terre ou des légumes secs au
moins 3 fois par jour, était de l’ordre de 30 % au cours
des quatre périodes d’enquête. Cette proportion n’a pas
évolué chez les femmes et a diminuée chez les hommes
(de 33,8 % à 30,6 %) sur la période considérée. À
tranche d’âge équivalente, chez les hommes comme chez
les femmes, cette proportion augmentait chez les moins
de 50 ans, alors qu’elle diminuait chez les personnes âgées
de 50 ans et plus. Par exemple, chez les femmes, elle est
passée de 28,5 % en 1995-1996 à 30,9 % (p < 0,001)
chez les 40-49 ans, et de 32,7 % à 28,5 % chez les 60-
68 ans (p < 0,01).
Lait et produits laitiers
La consommation de lait et produits laitiers est restée rela-
tivement stable en moyenne au cours des 8 années de
l’étude SU.VI.MAX. (tableau III). Ce constat est confirmé
par les analyses sur tranches d’âge équivalentes.
De 3 % à 5 % des sujets ont consommé 3 produits lai-
tiers par jour sur la période considérée : 70 % à 75 % en
consommaient moins et 20 % à 25 % en consommaient
plus. Les individus pris en compte pour ce repère devaient
avoir consommé 3 produits laitiers (ni plus, ni moins) par
jour sur l’ensemble des enregistrements de 24 h remplis
par période de 2 ans. Aucune tendance commune signifi-
cative n’a été observée à tranche d’âge équivalente.
Viandes et volailles, produits de la pêche et œufs
La consommation moyenne de viandes, produits de la
pêche et œufs a diminuée dans les deux sexes (tableau III).
Cette diminution des apports moyens est observée pour
chaque tranche d’âge (p ≤ 0,001).
Près de 80 % des hommes de l’étude SU.VI.MAX attei-
gnaient le repère de consommation du groupe viandes,
poissons, œufs, sans variation majeure au cours du temps
(77,6 % à 79,5 % selon les années). Chez les femmes,
cette proportion est passée de 78,4 % en 1995-1996 à
74,2 % en 2001-2002, ce qui est dû surtout à une dimi-
nution de cette proportion chez les femmes les plus
jeunes : chez les femmes de 40-49 ans, elle est passée de
77,9 % à 66,4 % (p < 0,001), et de 80,7 % à 74,5 %
chez celles de 50-59 ans (p < 0,01)). De 9 % à 13 % des
hommes consommaient de la viande, du poisson ou des
œufs moins de 1 fois par jour, alors que ces chiffres
étaient de 18 % à 22 % chez les femmes. Ceux qui en
consommaient plus de 2 fois par jour étaient de 8 % à
13 % chez les hommes et de 4 % à 6 % chez les femmes.
Par ailleurs, près de la moitié des sujets ont consommé au
moins deux fois par semaine du poisson quels que soient
l’âge, le sexe et la période considérée.
Matières grasses ajoutées
Les données de l’étude SU.VI.MAX ont montré une forte
diminution des consommations de matières grasses ajoutées
sur la période étudiée (tableau III). Cette diminution a été
observée pour chaque tranche d’âge (p ≤ 0,001, (fig. 2).
5
0
10
15
20
25
30
35 P = 0,04
P = 0,05
P = 0,02
50-59 ans 60-68 ans 50-59 ans 60-68 ans
Hommes Femmes
< 3,5/jour
%
5/jour
0
5
10
15
20
25
30
35
50-59 ans 60-68 ans 50-59 ans 60-68 ans
Hommes Femmes
%
1995-1996
1997-1998
1998-1999
2001-2002
P ≤ 0,001
Figure 1.
Fréquences de sujets consommant moins de 3,5 portions par jour (a) ou au moins 5 fruits et légumes par jour (b)
selon le sexe et l’âge dans l’étude Suvimax entre 1995-1996 et 2001-2002.

Cah. Nutr. Diét., 40, 2, 2005 101
comportement alimentaire
Produits sucrés
Les consommations moyennes de produits sucrés ont légè-
rement diminué (tableau III). Les analyses à tranches d’âge
équivalentes ne montrent pas de tendance commune pou-
vant expliquer cette légère diminution des apports en
moyenne.
Boissons alcoolisées
La consommation d’alcool a peu évolué (tableau III). Quel
que soit le sexe, aucune modification significative n’a été
observée à tranche d’âge équivalente.
Le pourcentage d’hommes consommant moins de 3 verres
de boissons alcoolisées par jour est passé de 59,8 % en
1995-1996 à 56,9 % en 2001-2002. Chez les femmes,
autour de 80 % consommaient moins de 2 verres par
jour, sans que cette proportion n’ait été modifiée au cours
du temps. Quel que soit le sexe, aucune modification signi-
ficative n’a été observée à tranches d’âge équivalentes.
Discussion
Chez les adultes participant à l’étude SU.VI.MAX, âgés
de 35 à 60 ans pour les femmes et de 45 à 60 ans pour
les hommes au début du suivi (1994-1995), l’analyse de
leurs apports alimentaires moyens a montré entre 1995
et 2002 : a) une tendance à l’augmentation de la consom-
mation de fruits, ; b) une stabilité de la consommation de
féculents, produits sucrés, des produits laitiers et des bois-
sons alcoolisées, et c) une diminution de la consomma-
tion de légumes, des viandes, poissons et œufs et de celle
des matières grasses ajoutées.
Lorsque les apports alimentaires ont été analysés selon les
repères de consommation du PNNS diffusés au grand
public, cette population semblait se rapprocher des repères
de consommation pour les fruits et légumes, et s’en éloi-
gner pour les boissons alcoolisées, les autres groupes d’ali-
ments qui sont l’objet de recommandations chiffrées ne
semblant pas connaître d’évolution notable. Permettant
de tenir compte du vieillissement de la cohorte, et de
l’évolution des comportements alimentaires habituelle-
ment observée chez les adultes les plus âgés, les analyses
réalisées à classes d’âge équivalentes ont montré de façon
intéressante qu’une même tendance de la consommation
moyenne était retrouvée dans toutes les classes d’âge
pour les fruits (qui augmentaient dans les différentes
classes d’âge), les matières grasses, et les viandes, pois-
sons et œufs (qui diminuaient).
Ces résultats semblent a priori différents de ce qui est
observé dans d’autres études réalisées en France, notam-
ment celles transversales répétées, telles que le Baromètre
santé nutrition conduit par l’Institut National de Préven-
tion et d’Éducation pour la Santé (INPES) en 1996 [7] et
2002 [8] ou l’enquête Individuelle Nationale des Consom-
mations Alimentaires (INCA), enquête transversale conduite
en 1998-1999 par le CREDOC et l’Agence Française de
Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA) [9]. La variété
des populations étudiées, en raison notamment de classes
d’âge plus larges dans les Baromètres de l’INPES et
l’enquête INCA, et la diversité des méthodes de recueil et
d’analyse des données alimentaires (dont la définition des
groupes d’aliments) contribuent à comprendre en grande
partie ces différences. Il est important de noter qu’en
général, la hiérarchie des groupes d’aliments est retrouvée
au travers des études, avec certains groupes d’aliments
pour lesquels la majorité de la population satisfait le
repère (par exemple le groupe des viandes, poissons,
œufs), tandis que d’autres sont atteints par une faible pro-
portion des sujets inclus (par exemple les fruits et légumes
ou les produits laitiers).
D’une façon globale, les sujets de l’étude SU.VI.MAX
montrent une évolution de leurs consommations alimen-
taires vers les recommandations actuelles, alors que ce
n’est pas le cas entre les Baromètres santé nutrition de
1996 et de 2002 [7, 8]. Par exemple, dans le Baromètre
santé nutrition 2002, seulement 10 % des personnes
âgées de 12 à 75 ans consommaient au moins 5 fruits et
légumes par jour (sans que les jus de fruits soient pris en
compte), proportion comparable à celle relevée en 1996.
Cette différence peut être liée à l’utilisation d’une
méthode d’enquête différente : un relevé unique des fré-
quences de consommation la veille de l’entretien en
février et mars de l’année d’enquête pour le Baromètre,
contre 6 enregistrements de 24 heures sur une période de
deux ans dans l’étude SU.VI.MAX. Dans cette dernière,
la tendance favorable peut également être expliquée par
la classe d’âge plutôt élevée des sujets, quoique les analyses
réalisées à classes d’âges équivalentes aient montré que
cette amélioration ne soit pas seulement liée à l’âge pour
les fruits. Bien que la majorité des sujets de l’étude
SU.VI.MAX respecte le repère de consommation, l’aug-
mentation de la consommation d’alcool reste quant à elle
préoccupante chez les hommes les plus jeunes.
Il n’existe que peu d’études de cohorte en France permet-
tant de faire des analyses équivalentes sur de larges popu-
lations d’adultes, avec un recueil de données alimentaires
suffisamment détaillé pour adapter la méthode d’analyse
aux recommandations qui ont été diffusées dans le cadre
du PNNS ultérieurement à la mise en place de l’étude.
Cependant, la participation volontaire à un essai d’inter-
vention tel que l’étude SU.VI.MAX induit des limitations
dans la portée de ces résultats. La question de l’âge des
sujets inclus, déjà évoquée précédemment, conduit à
considérer que ces résultats sont probablement à l’image de
la population adulte française d’âge mûr, ces sujets ayant
été considérés comme représentatifs de la population sur
les principales caractéristiques sociodémographiques [10],
avec la réserve supplémentaire qu’il s’agit d’une cohorte
de volontaires intéressés par l’alimentation. Disposer de
données chez des adultes d’âge moins élevé reste primor-
diale, d’autant qu’il est observé dans les études transversales
Figure 2.
Apports moyens quotidiens en matières grasses ajoutées (g/jour) selon le
sexe et l’âge dans l’étude Suvimax entre 1995-1996 et 2001-2002.
 6
6
1
/
6
100%