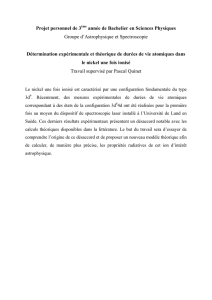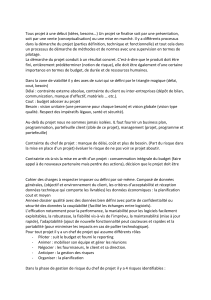Toute reproduction sans autorisation du Centre français d’exploitation du droit de copie est strictement interdite.
© Techniques de l’Ingénieur, traité L’entreprise industrielle T 4 305 − 1
T 4 305 12 - 1987
Maintenabilité. Maintenance
par Pierre CHAPOUILLE
Ingénieur de l’Institut Électrotechnique de Grenoble
Ancien Chef de la Division Fiabilité et Qualification des Procédés de Bull SA
Ancien Chargé d’Enseignement de la Fiabilité au Conservatoire National
des Arts et Métiers
et article est spécialement consacré à la maintenabilité et à la maintenance.
Cependant, la maintenabilité est si intimement liée à la fiabilité et à la
disponibilité que l’on devra parler sommairement de ces deux caractéristiques.
En effet, si la maintenabilité permet de réduire la durée des pannes et leur
coût, la fiabilité permet de réduire la fréquence de ces pannes. Toutes deux, grâce
au choix d’une politique de maintenance appropriée, ont pour but d’augmenter
la disponibilité des systèmes ou des équipements et de diminuer les coûts
d’entretien et les stocks de pièces de rechange.
1. Concepts de base..................................................................................... T 4 305 - 2
1.1 Notion de maintenabilité ............................................................................ — 2
1.2 Définition...................................................................................................... — 2
1.3 Décomposition des durées de maintenance active.................................. — 2
1.4 Différence entre maintenabilité et maintenance....................................... — 2
1.5 Notions sur la maintenance........................................................................ — 2
1.6 Fiabilité ......................................................................................................... — 3
1.7 Disponibilité ................................................................................................. — 3
2. Éléments théoriques ............................................................................... — 3
2.1 Généralités sur les durées de maintenance .............................................. — 3
2.2 Fréquence des actions de maintenance .................................................... — 5
3. Prévisions de maintenabilité ................................................................ — 8
3.1 Solution théorique....................................................................................... — 8
3.2 Méthode de simulation ............................................................................... — 8
3.3 Cas particuliers ............................................................................................ — 9
3.4 Durée totale d’immobilisation d’un système ............................................ — 9
4. Vérification expérimentale.................................................................... — 10
4.1 Vérification qualitative ................................................................................ — 10
4.2 Vérification quantitative.............................................................................. — 10
5. Tests de démonstration statistique .................................................... — 11
5.1 Méthode 1 de la norme MIL-STD 471 ........................................................ — 11
5.2 Méthode 2 de la norme MIL-STD 471 ........................................................ — 12
5.3 Test non paramétrique de la norme MIL-STD 473.................................... — 12
Références bibliographiques ......................................................................... — 13
C

MAINTENABILITÉ. MAINTENANCE ________________________________________________________________________________________________________
Toute reproduction sans autorisation du Centre français d’exploitation du droit de copie est strictement interdite.
T 4 305 − 2© Techniques de l’Ingénieur, traité L’entreprise industrielle
1. Concepts de base
1.1 Notion de maintenabilité
La maintenabilité est une caractéristique précisant la facilité et la
rapidité avec lesquelles un système peut être remis en un état de
fonctionnement total avec une fiabilité correspondant à son âge.
La rapidité de remise en état d’un système peut être mesurée par
la durée active du dépannage. Par active, on entend qu’on ne
comptera pas les temps morts non imputables à la conception du
système, tels que les délais de réponse des dépanneurs, les durées
d’attente des pièces de rechange ou les temps passés à la rédaction
des pièces administratives, car ces temps dépendent de l’organisa-
tion et de l’efficacité du service de maintenance et non de la
conception du système.
Pour rendre le dépannage plus facile et plus rapide, on devra
prévoir, dès la conception, les moyens pour faciliter :
— le diagnostic des pannes existantes et de celles risquant de
survenir rapidement (défaillances par dégradation) ;
— l’accès aux pièces à remplacer, leur démontage et leur
remplacement ;
— le contrôle de la validité de l’action de maintenance.
1.2 Définition
La durée de maintenance active, qui concerne la maintenabilité
comme la durée de maintenance totale incluant les temps morts,
est très variable en fonction de la panne, de l’aptitude du dépanneur
et des moyens d’aide dont il dispose. Ce sont des variables aléatoires
caractérisées par une densité de probabilité et une fonction de
répartition appelée fonction maintenabilité. Il en résulte que la
maintenabilité peut être mesurée par une probabilité, d’où une
définition possible :
« La maintenabilité est une caractéristique d’un système mesurée
par la probabilité d’être remis, par une action de maintenance, dans
des conditions opérationnelles définies, dans une durée fixée, les
ressources et les conditions d’environnement étant préalablement
spécifiées ».
Les conditions opérationnelles comprennent l’aptitude à remplir
les fonctions spécifiées avec un niveau de fiabilité et de sécurité
conforme au cahier des charges. Les ressources et les conditions
d’environnement doivent être conformes au plan de maintenance
du système.
1.3 Décomposition des durées
de maintenance active
Une action de maintenance comporte plusieurs tâches
successives. On peut considérer les tâches suivantes comme
typiques :
— vérifier la réalité de la panne ;
— identifier la pièce défaillante ;
— démonter le système pour accéder à la pièce ;
— retirer la pièce ;
— la remplacer par une pièce en bon état ;
— remonter le système ;
— contrôler le bon résultat de la réparation.
1.4 Différence entre maintenabilité
et maintenance
La maintenabilité est une caractéristique du système et est définie
en terme de probabilité. En revanche, la maintenance est une action
réalisée par les techniciens de maintenance sur le système pour le
remettre en état.
1.5 Notions sur la maintenance
1.5.1 Types d’actions de maintenance
On distingue généralement trois types d’actions :
— l’entretien de routine, tel que le graissage ou les réglages
simples souvent confiés à l’utilisateur ;
— la maintenance corrective ou non programmée, qui a pour
but de réparer une panne déclarée ;
— la maintenance préventive ou programmée, qui a pour but de
prévenir des pannes prévisibles par des remplacements de pièces
non encore défaillantes ou des révisions périodiques.
1.5.2 Politiques de maintenance préventive
La maintenance préventive permet de remplacer des pièces qui
se dégradent par suite d’usure, de fatigue, etc., avant qu’elles ne
provoquent une défaillance. Ces pièces présentent un taux de
défaillance croissant avec l’âge. La détermination de la durée entre
remplacements nécessite la connaissance de la distribution des
durées de vie. Elle fait appel à la théorie du renouvellement.
On a le choix entre plusieurs politiques de maintenance préven-
tive. Les plus fréquentes sont les suivantes.
■Dans la maintenance préventive systématique, on fixe les règles
strictes pour déterminer les dates de maintenance.
Suivant l’importance d’un équipement dans un système, celle-ci
peut s’effectuer :
— pour un âge fixé de l’équipement ; il faut alors disposer d’un
moyen pour connaître l’âge de l’équipement durant la vie du
système ;
— pour un âge fixé du système ; c’est le cas des révisions des
automobiles préconisées par les constructeurs ;
— à des dates fixes.
Les deux premières sont plus efficaces, mais difficiles à gérer. La
troisième se gère bien, mais elle est plus coûteuse en temps et en
pièces de rechange.
■La maintenance préventive conditionnelle consiste à vérifier
périodiquement l’état des pièces qui se dégradent et à n’intervenir
que si l’état de dégradation est suffisamment avancé pour
compromettre la fiabilité du système. Elle nécessite des moyens de
mesure ou de test permettant d’apprécier l’état de dégradation.
L’évolution des capteurs de mesure (par exemple, les capteurs de
vibrations) et des dispositifs d’analyse automatique (par exemple,
l’analyse des huiles de graissage) associés aux télémesures et aux
ordinateurs rendent cette politique plus accessible. Elle est très
efficace, mais la gestion des ressources de maintenance est plus
difficile et nécessite souvent le recours à l’ordinateur.
Dans la pratique, on est amené, pour réduire les coûts de
maintenance et assurer la disponibilité des systèmes, à combiner
ces différentes politiques dans le plan de maintenance, par exemple
à prévoir une partie des actions de maintenance à dates fixes et à
en profiter pour effectuer les vérifications sur les pièces soumises
à la maintenance conditionnelle.

________________________________________________________________________________________________________ MAINTENABILITÉ. MAINTENANCE
Toute reproduction sans autorisation du Centre français d’exploitation du droit de copie est strictement interdite.
© Techniques de l’Ingénieur, traité L’entreprise industrielle T 4 305 − 3
1.5.3 Échelons de maintenance
Lorsque la maintenance s’applique à un parc important de
systèmes complexes ou techniquement difficiles à réparer sur place,
on prévoit des échelons de maintenance. En général, trois échelons
sont prévus :
— le premier correspond à des opérations simples, ne nécessitant
pas d’outillage spécial ni de compétences étendues, et habituelle-
ment effectuées par l’utilisateur ;
— le deuxième concerne des opérations effectuées sur le site par
des techniciens spécialisés, disposant de moyens de test mobiles
et d’un outillage adéquat, mais relativement réduit ;
— le troisième est réservé aux réparations difficiles, aux révisions
générales ou aux reconstructions ; elles s’effectuent soit en usine,
soit dans des centres de maintenance très équipés.
La définition des opérations à effectuer aux différents échelons
est liée aux choix réalisés concernant les niveaux d’échange des
éléments réparables (composant, sous-ensemble, équipement).
1.5.4 Problème des rebuts
Lors de l’étude de la maintenabilité et de l’établissement du plan
de maintenance, on doit faire le choix entre réparer ou rebuter un
élément défaillant. Si la maintenance se fait au niveau du composant,
le choix du rebut est fréquent. En revanche, si la maintenance se
fait à un degré d’intégration plus élevé, le choix doit être dicté par
des considérations économiques, en fonction des coûts de
réparation, du prix de revient de l’élément neuf, des stocks de main-
tenance, des délais et de la disponibilité à assurer au système.
1.6 Fiabilité
La fiabilité est une caractéristique d’un système mesurée par la
probabilité qu’il accomplisse les fonctions requises dans des
conditions données pendant une durée spécifiée.
Elle est donc concernée par un fonctionnement sans défaillance
du système pendant une durée donnée et est caractérisée par la
fonction de répartition R (t) des durées jusqu’à défaillance (fonction
fiabilité).
La durée moyenne jusqu’à défaillance θ (moyenne des temps de
bon fonctionnement : MTBF) est une caractéristique fondamentale :
Le taux instantané de défaillance z (t) caractérisant la probabilité
de défaillance à l’âge t est donné par :
Dans de nombreux cas, le taux de défaillance est constant avec
l’âge. On le représente par λ. Dans ce cas, la MTBF est :
θ = 1/ λ
et la fiabilité : R (t) = exp (– λt)
1.7 Disponibilité
La disponibilité A est une mesure de la fraction du temps pendant
laquelle un système est disponible, c’est-à-dire en fonction ou apte
à fonctionner. C’est une probabilité fonction du temps.
Dans le cas le plus simple du régime permanent, en désignant par τ
la moyenne des durées de maintenance et par θ la MTBF, on a :
A = θ/(θ + τ)
Pour augmenter la disponibilité, il faut donc augmenter la durée
de bon fonctionnement et réduire la durée de maintenance.
2. Éléments théoriques
Ces éléments ne comprendront pas les éléments de probabilité
et de distribution statistiques communes à la fiabilité et à la main-
tenabilité qu’on trouvera dans l’article spécialisé du présent traité,
mais un exposé général sur les durées de réparation (§ 2.1) et sur
la fréquence des actions de maintenance et la théorie du renouvel-
lement (§ 2.2).
2.1 Généralités sur les durées
de maintenance
On utilise souvent le terme de temps de réparation, alors qu’en
réalité, on s’intéresse à un intervalle de temps, donc à une durée.
De même, le terme de réparation ne concerne que la maintenance
corrective, alors qu’il faut également considérer la maintenance
préventive dans les études de maintenabilité. Enfin, rappelons qu’on
ne s’intéresse qu’à la durée de la maintenance active (§ 1.1).
2.1.1 Caractéristiques statistiques
La durée de maintenance est une variable aléatoire constituée par
la somme des durées des opérations élémentaires décrites au
paragraphe 1.3. Elle est caractérisée par une distribution de proba-
bilité g (t) dont la fonction de répartition :
est la fonction maintenabilité. Cette fonction représente la probabi-
lité de terminer la maintenance dans une durée au plus égale à t.
À partir de cette fonction maintenabilité, on peut calculer des
durées caractéristiques de la maintenance.
2.1.1.1 Durée moyenne de maintenance
C’est l’espérance mathématique de la durée :
aussi égale à :
Elle est représentée par le sigle MTTR (en anglais : Mean Time To
Repair, en français : moyenne des temps techniques de réparation).
2.1.1.2 Durée maximale de réparation
Elle est généralement définie comme une durée telle que 95 % des
durées de maintenance lui seront inférieures ou égales. À noter que,
quelquefois, cette limite est ramenée à 90 %. Cette valeur Tmax est
donnée par M (Tmax) = 0,95 (ou 0,90).
θ0
∞
Rt()dt=
zt() 1
Rt()
---------------
dRt()
dt
-------------------
⋅–=
Mt() 0
t
gu()du=
τ0
∞
tgt()dt⋅=
τ0
∞
1Mt()–[]dt=

MAINTENABILITÉ. MAINTENANCE ________________________________________________________________________________________________________
Toute reproduction sans autorisation du Centre français d’exploitation du droit de copie est strictement interdite.
T 4 305 − 4© Techniques de l’Ingénieur, traité L’entreprise industrielle
2.1.1.3 Taux de maintenance
Cette notion est semblable à la notion de taux de défaillance en
fiabilité. Le taux de maintenance est donné par :
C’est généralement une fonction croissante du temps, ce qui
signifie que plus une action de maintenance progresse dans le
temps, plus il est probable qu’elle se termine rapidement.
Cependant, on suppose souvent le taux constant pour faciliter les
calculs.
2.1.2 Distribution des durées de maintenance
Dans de nombreux cas, il est difficile de choisir sans ambiguïté
la distribution représentant le mieux les données expérimentales.
Une analyse du processus et des causes de génération des
événements permet de mieux guider le choix de la distribution la
plus appropriée. Si cette analyse ne peut être faite, et en l’absence
de très nombreuses données expérimentales, on choisit souvent une
distribution qui facilite la résolution mathématique des problèmes.
2.1.2.1 Distribution exponentielle
C’est la plus facile à utiliser. Le taux de maintenance est constant,
généralement représenté par la lettre µ.
Distribution de probabilité :
g (t) = µ exp (– µt)
Fonction maintenabilité :
M (t) = 1 – exp (– µt)
Durée moyenne de maintenance :
τ = 1/µ
Durée maximale de réparation pour une probabilité α :
Tmax = – τ ln (1 – α)
soit, pour α = 0,95 : Tmax = 3 τ
et, pour α = 0,90 : Tmax = 2,3 τ
Estimation de τ à partir de n durées mesurées ti :
2.1.2.2 Distribution normale
Si les durées de maintenance sont concentrées symétriquement
autour d’une valeur centrale, on peut utiliser la loi normale, dans
la mesure où le coefficient de variation σ/µ est plus petit que 1/3.
Le taux de maintenance est toujours croissant.
Distribution de probabilité :
avec σécart-type.
En posant u = (t – µ)/σ on obtient la variable réduite de
distribution :
qui est tabulée (article Statistiques [A 166] dans le traité Sciences
fondamentales).
Fonction maintenabilité :M (t) = Φ (u)
fonction de répartition de la loi normale.
Durée moyenne de maintenance :
τ = µ
Estimation de la durée moyenne :
Estimation de l’écart-type :
Durée maximale de maintenance :
— pour une maintenabilité de 0,95 :
Tmax = µ + 1,65 σ
— et pour une valeur de 0,90 :
Tmax = µ + 1,28 σ
2.1.2.3 Distribution log-normale
La distribution log-normale représente assez bien les durées de
maintenance, avec un taux de maintenance croissant au départ, puis
passant par un maximum. Elle est caractérisée par le fait que le loga-
rithme des durées suit une loi normale. Malgré ses avantages de
représentativité, elle est d’une utilisation difficile, en particulier pour
les systèmes redondants.
Si l’on désigne par ϕ (u) la distribution normale réduite et par Φ (u)
la fonction de répartition correspondante, et que l’on fait la trans-
formation u = (ln t – m)/s, où m et s sont les deux paramètres de
la loi log-normale, on a :
Distribution des durées de maintenance :
g (t) = ϕ (u)/ts
Fonction maintenabilité :M (t) = Φ (u)
µt() gt()
1Mt()–
--------------------------=
τti/n
i1=
n
∑
=
^
gt() 1
σ2π
------------------exp tµ–
σ
-------------
=
ϕu() 1
2π
--------------exp u2
2
---------
–σgt()==
Remarque
En posant on
a approximativement (d’après [7]) :
Φ (u) = 1 – [ϕ (u) · (a1x + a2x2 + a3x3)]
avec p= 0,332 67 ,
a1= 0,436 183 6 ,
a2= – 0,120 167 6 ,
a3= 0,937 298 0.
De même, la fonction inverse donnant u en fonction de Φ est
approximativement (d’après [7]) :
avec x,
p= (1 – Φ) < 0,5 ,
a0= 2,307 53 ,
a1= 0,270 61 ,
b1= 0,992 29 ,
b2= 0,044 81.
µm1
n
----- ti
i1=
n
∑
==
^
σs1
n1–
-------------- tim–()
2
∑
≈=
^
ϕu() 1/ 2π()exp u2/2–()et x1/ 1 pu+()==
ux
a0a1x+
1b1xb
2x2
++
------------------------------------------
–=
= 2 ln p

________________________________________________________________________________________________________ MAINTENABILITÉ. MAINTENANCE
Toute reproduction sans autorisation du Centre français d’exploitation du droit de copie est strictement interdite.
© Techniques de l’Ingénieur, traité L’entreprise industrielle T 4 305 − 5
Taux de maintenance :
avec z (u) taux de maintenance de la loi normale réduite.
Durée moyenne de maintenance :
Durée maximale de maintenance :
Tmax = exp (m + 1,65s) pour 95 %
Tmax = exp (m + 1,28s) pour 90 %
Estimation de m :
Estimation de s :
Dans le cas de la loi log-normale, on utilise fréquemment la durée
médiane de maintenance Tmed = exp (m) correspondant à une
probabilité (maintenabilité) de 0,5. Les spécifications sont souvent
exprimées par une durée médiane et une durée maximale à ne pas
dépasser. On doit alors avoir :
m < ln Tmed
et si la durée maximale est donnée :
pour une maintenabilité de 0,95
pour une maintenabilité de 0,90
2.1.2.4 Distribution Gamma entière ou d’Erlang
Lorsque la durée de maintenance peut être considérée comme la
somme de k durées élémentaires distribuées exponentiellement
avec une même moyenne 1/ λ, elle peut être représentée par une
distribution Gamma entière d’ordre k.
Distribution des durées de maintenance :
Fonction maintenabilité :
Taux de maintenance :
Durée moyenne de maintenance :
τ = k/λ
Durée maximale de maintenance : Tmax .
Le tableau ci-après donne les valeurs de λTmax en fonction de k
pour des maintenabilités de 90 % et 95 %. (0)
Pour des valeurs de k > 6 on a approximativement :
— pour 90 % : Tmax = k + (1,28 /k) à mieux de 2 % ;
— pour 95 % : Tmax = k + (1,65 /k) à mieux de 5 %.
M (t) est donné par la probabilité cumulée de la loi de Poisson
de paramètre m = λt pour c = k – 1 événements.
2.2 Fréquence des actions
de maintenance
2.2.1 Notion de taux de renouvellement
Si un composant est remplacé lors d’une défaillance, on peut
déterminer le nombre moyen de pièces remplacées pendant une
durée t.
Soit H (t) ce nombre moyen de remplacement, le taux de
renouvellement est alors : h (t) = dH (t)/dt et peut être calculé par
l’équation du renouvellement (§ 2.2.3).
Il ne faut pas confondre le taux de renouvellement avec le taux
de défaillance. Ce n’est que dans le cas où le taux de défaillance
est constant, et qu’alors une maintenance préventive est inutile, que
les deux sont égaux à λ = 1/θ, θ étant la MTBF.
Le taux de renouvellement est donc en général une fonction du
temps. Cependant, dans le cas d’une maintenance uniquement
corrective, il tend vers une valeur limite λc = lim h (t) = 1/θ.
2.2.2 Renouvellement préventif à âge fixé
Si un composant a un taux de défaillance croissant, il peut être
remplacé préventivement lorsque son âge atteint une valeur T.
La moyenne des temps entre défaillances observées devient :
plus élevée que la MTBF du composant. Le taux de renouvellement
correctif limite est : λc = 1/θ0
et il apparaît un taux de renouvellement préventif limite :
Un exemple est donné figure 1.
µt() ϕu()
ts 1Φu()–[]
-------------------------------------
zu()
ts
--------------==
τexp ms2
2
--------+
=
mln ti/n
i1=
n
∑
=
^
sln tim–()
2
n1–
-------------------------------
i1=
n
∑
≈
^
sln Tmax /Tmed
()
1,65
--------------------------------------------=
sln Tmax /Tmed
()
1,28
--------------------------------------------=
gt() λ
k1–()!
--------------------- λt()
k1–exp λt–()=
Mt() 1exp
λ
t
–
() λ
t
()
i
i
!
----------------
i
0
=
k
1
–
∑
–=
µt() λt()
k1–
k1–()!λt()
i
i!
---------------
i0=
k1–
∑
--------------------------------------------------=
Valeurs de
Maintenabilité
k
90 % 95 %
2 3,89 4,74
3 5,32 6,30
4 6,68 7,75
5 7,99 9,15
6 9,27 10,51
Remarque :
la distribution d’Erlang est duale de la loi de
Poisson.
Tma
x
θ00
T
Rt()dt/1 RT()–[]=
λp
RT()
0
T
RT()dt
--------------------------------
RT()
1RT()–
--------------------------λc
⋅==
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
1
/
13
100%