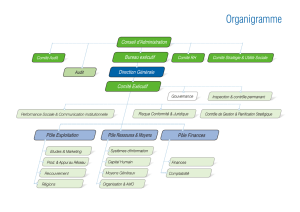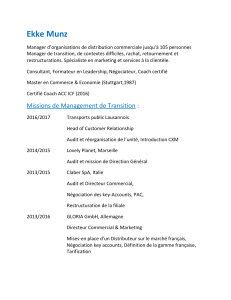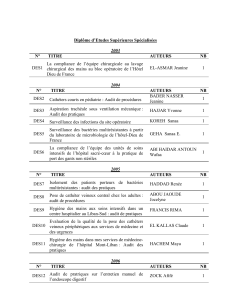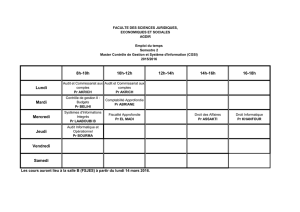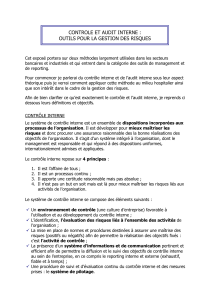L’apport du contrôle interne et d’audit interne à la bonne gouvernance des entreprises :
Une étude quantitative sur les entreprises marocaines
Taoufik EL IDRISSI
Inter nati onal Revi ew of E cono mics, Man a ge ment an d Law Resea rch
1
L’apport du contrôle interne et d’audit interne à la bonne gouvernance des
entreprises : une étude quantitative sur les entreprises marocaines
Par : Taoufik EL IDRISSI
Docteur en Sciences de Gestion,
Université Abdelmalek Essaadi
Résumé : La gouvernance d’entreprise, est apparue comme le sujet qui a soulevé le plus de
débats en matière de management au cours de ces dix dernières années, dans le
monde des affaires, politique et académique. Sans aucun doute, une bonne
gouvernance d’entreprise, est un levier indispensable au développement de la
nation.
De nombreux efforts sont à noter, visant à encourager et à inciter les nationaux à
développer la culture de la gouvernance. Très clairement, cette communication
s'inscrit dans cette vision de contribuer à l'amélioration de l'efficacité du système de
contrôle et de développement de la culture de la gouvernance tout en mettant en
avant un cadre théorique expliquant la contribution du contrôle interne et d’audit à
la bonne gouvernance d’entreprise.
Les résultats ont permis de tirer deux grandes conclusions. Premièrement, l’impact
toujours aussi conséquent du contrôle interne et d’audit sur la gouvernance
d’entreprise.
Deuxièmement, cette recherche a pu avoir porté un éclairage assez important sur un
autre type de mécanismes assez pesant sur le comportement des dirigeants
notamment en matière d’organisation et de clarification des responsabilités.
Mots clés : Audit, contrôle interne, gouvernance d’entreprise, asymétrie d’information, théorie
de l’agence.
Abstract: Corporate governance has emerged as the subject that created the most debate in
management over the last decade in the business, political and academic world.
Undoubtedly, good corporate governance is an essential lever to the development of
the nation.
Many efforts are noteworthy, to encourage and stimulate the national economic
agents to develop the culture of governance. Clearly, this communication is part of
this vision to contribute to improving the effectiveness of the control system and
development of the culture of governance while highlighting a theoretical
framework explaining the contribution of internal control and audit to good
corporate governance.
The results yielded two main conclusions. First, the impact still as a result of
internal control and audit of corporate governance. Second, this research may have
brought a sizable lighting on another type of mechanisms quite heavy on the
behavior of such leaders in organizing and clarifying responsibilities.
Keywords: Audit, internal control, corporate governance, information asymmetry, agency
theory.

L’apport du contrôle interne et d’audit interne à la bonne gouvernance des entreprises :
Une étude quantitative sur les entreprises marocaines
Taoufik EL IDRISSI
Inter nati onal Revi ew of E cono mics, Man a ge me nt and Law Resea rch
2

L’apport du contrôle interne et d’audit interne à la bonne gouvernance des entreprises :
Une étude quantitative sur les entreprises marocaines
Taoufik EL IDRISSI
Inter nati onal Revi ew of E cono mics, Man a ge me nt and Law Resea rch
3
INTRODUCTION
Le constat de grande défaillance qu’ont ressenti les investisseurs et l’opinion publique
depuis la catastrophe financière, a été fortement accentué par les autres faillites qui lui ont
succédé aussi bien aux Etats-Unis qu’en Europe, faisant ainsi naître une énorme crise de
confiance qui a fragilisé l’économie mondiale.
Devant le constat de comportements manifestement déviants de la part de certains
dirigeants ayant conduit à la spoliation de nombreux actionnaires, l’explication des
phénomènes de gouvernance en termes de conflits d’intérêts, telle que proposée par la théorie
positive de l’agence (TPA) semblerait s’être imposée comme l’approche dominante.
De surcroit, ce sujet est actuellement au centre des débats. Les enjeux sont importants, car
il s’agit de générer la confiance et de permettre aux investisseurs d’obtenir les moyens
d’exercer un véritable contrôle sur la gestion de leurs actifs.
L’étude de la gouvernance de l’entreprise au Maroc peut contribuer à une meilleure
compréhension des interactions entre l’évolution des modes de gestion des entreprises
marocaines et les profondes transformations de leur environnement économique, juridique et
institutionnel.
Au-delà de ces aspects, il faut analyser les modalités d’exercice et de contrôle du pouvoir
des dirigeants, les normes liées à la prise de décision et le conflit au sein de ces entreprises. La
problématique porte donc sur l’existence et de la pertinence d’un éventuel mode de
gouvernement des entreprises marocaines et la nature de ce modèle. Nous nous posons donc la
question de savoir, en quoi, le contrôle interne ainsi que l’audit, peuvent contribuer, à la
bonne gouvernance des entreprises marocaines ? Autrement dit, dans quelle mesure le
contrôle interne et l’audit, peuvent contribuer, à réduire : l’asymétrie d’information, le
déséquilibre des pouvoirs et l’opportunisme des dirigeants ?
I- CONTROLE INTERNE, AUDIT ET GOUVERNANCE D’ENTREPRISE(GE) :
DEVELOPPEMENTS THEORIQUES
Avant d’aborder le cadre théorique, des concepts clés pour cette recherche tels la «
gouvernance d’entreprise» soit le « contrôle interne » ou encore l’« audit» se doit d’être pris en
compte comme des compléments incontournables à la transparence que nous viserons
approcher.
1. Contrôle interne, audit et gouvernance de l’entreprise : approches conceptuelles
1.1. La Gouvernance de l’Entreprise
La Gouvernance de l’Entreprise (GE) est une notion qui a pris de l’ampleur ces dernières
décennies que ce soit au niveau des recherches académiques ou au niveau des
recommandations des instances internationales (ONU, OCDE, Commission européenn e, etc.).
Il s’agit d’un concept qui s’est répandu sur le plan international, aussi bien dans les pays
développés que dans les pays en voie de développement.
Avec la mondialisation des échanges et la globalisation des économies, accélérées depuis
les vingt dernières années, les réflexions théoriques sur la gouvernance d'entreprise se sont
progressivement structurées.
Dans ce cadre, la littérature financière à ce sujet est abondante et divers auteurs ont proposé
plusieurs définitions, nous en retenons la définition de G.Charreaux selon laquelle, « le
gouvernement des entreprises recouvre l’ense*mble des mécanismes qui ont pour effet de délimiter
les pouvoirs et d’influencer les décisions des dirigeants, autrement dit, qui ‘gouvernent’ leur
conduite et définissent leur espace discrétionnaire »1.
1 Charreaux, G., (1997b), «Le Gouvernement des Entreprises - Corporate Governance -
Théorie et Faits» (Economica, Paris).

L’apport du contrôle interne et d’audit interne à la bonne gouvernance des entreprises :
Une étude quantitative sur les entreprises marocaines
Taoufik EL IDRISSI
Inter nati onal Revi ew of E cono mics, Man a ge me nt and Law Resea rch
4
Donc, la multiplicité des niveaux d’analyse et des catégories conceptuelles rend difficile,
voire impossible, la construction d’une définition théorique unique de la gouvernance
d’entreprise.
Malgré cela, nous avons essayé de synthétiser la plupart des définitions données et nous
avons proposé la définition selon laquelle la gouvernance d’entreprise « est un ensemble des
règles et pratiques qui s’intéresse à la façon dont les entreprises sont contrôlées, dirigées et de
s’assurer de la capacité des organes de gestion :
à respecter les lois et les règlements en vigueur ;
à poursuivre les objectifs conformes aux intérêts des actionnaires et des autres parties
prenantes ;
à mettre en œuvre les systèmes de contrôle efficaces pour :
prévenir les abus de pouvoir et les risques éventuels,
réduire l’opportunisme;
gérer les conflits d’intérêts potentiels »2
1.2. Le contrôle interne
Quant au contrôle interne, l'Insitute of Internal Audit (IIA) et l’American Institute of
Certified Public Accountants (AICPA), ont le défini comme « un processus mis en oeuvre par
la direction générale, la hiérarchie, et le personnel d’une entreprise, destiné à fournir une
assurance raisonnable quant à la réalisation des objectifs suivants :
réalisation et optimisation des opérations ;
fiabilité des informations financières ;
conformité aux lois et réglementations en vigueur. »3
L’audit constitue notre troisième concept-clé à travers cette recherche. Il s’agit donc d’un
élément crucial afin de pouvoir traiter notre problématique. Pour ce faire, le point suivant aura
pour objet de cerner ce concept
1.3. L’audit
L’audit est un métier qui s’est développé suite à une longue évolution, durant laquelle il a
pu acquérir une grande maturité. Il est appréhendé désormais comme synonyme d’objectivité,
d’efficacité et outil d’aide à la décision et ce grâce aux recommandations dont il est la source.
Selon que l’instance chargée de l’audit est interne, on parlera «d’audit interne » où
qu’elle est de nature externe, on parlera «d’audit externe». Les objectifs et les champs
d’application des deux fonctions étant totalement complémentaires, et étroitement imbriquées.
Audit interne : L’audit interne peut être défini comme l’ensemble des dispositions
incluses dans les organisations et dans les procédures, dispositions dont l’objet est assurer la
qualité de l’information, la protection du patrimoine, le respect des lois comme des plans et
politiques de la Direction Générale, ainsi que l’efficacité du fonctionnement de l’entreprise.
Audit externe : Il s’agit d’un examen visant « l’assurance de la régularité, la sincérité et
l’image fidèle. L’émission d’une opinion sur la qualité de l’information financière et comptable
faisant l’objet d’un rapport de fin de mission ». La portée de l’audit externe ne se résume point
dans la certification des comptes, donc aux travaux de « commissariat aux comptes », mais
inclut aussi des « missions de revue limitée » (visant une meilleure présentation des documents
comptables et états financiers de l’entreprise par un cabinet d’expertise).
2- Synthèse des principales théories de la gouvernance d’entreprise
Il n'existe pas de théorie pionnière de la gouvernance, cette dernière est la résultante de
plusieurs constructions théoriques. Les principales évolutions théoriques de la gouvernance
appartiennent au même paradigme mais proposent des explications différentes de l'efficience
des organisations et de leur existence, sous cet angle on peut distinguer deux courants : Le
premier courant est d'origine contractuelle et le second est d'origine cognitive.
2 Définition élaborée par l’auteur
3 BOUQUIN H. & J.C. BECOUR (1996), « Audit Opérationnel : Efficacité, Efficience ou Sécurité», 2ème
Edition, Collection Gestion, Série : Politique générale, Finance et Marketing, Economica, p 22-21

L’apport du contrôle interne et d’audit interne à la bonne gouvernance des entreprises :
Une étude quantitative sur les entreprises marocaines
Taoufik EL IDRISSI
Inter nati onal Revi ew of E cono mics, Man a ge me nt and Law Resea rch
5
2.1. Les théories contractuelles de la gouvernance
a- L'approche actionnariale
La notion centrale de l'approche contractuelle est celle de la firme perçue comme un
nœud de contrats, un centre contractant chargé de gérer de façon centralisée, l'ensemble des
contrats nécessaires à la production. Trois théories constituent l'essence de ce courant
contractuel :
La théorie des droits de propriété « TDP », (Alchian & Demsetz 1972) : A.A. Alchian et H.
Demestz 4(1972), décomposent les droits de propriété en trois grandes parties:
L'usus : le droit d'utiliser le bien.
Le fructus : droit d'en percevoir les fruits.
L'abusus : droit du décider du sort du bien et d'en faire ce qui bon nous semble.
En résumé, la théorie des droits de propriété nous indique que la séparation entre fructs,
usus et abusus, qui symbolise l'entreprise managériale tend à atténuer l'efficacité des droits de
propriété. Les parties en présence, bénéficiant chacune d'une partie des droits de propriété sur la
firme vont, dés lors, poursuivre des intérêts pouvant être divergents.
La théorie de l'agence « TA », (Jensen & Meckling, 1976) : M.C. Jensen et W.H. Meckling,
fondateurs de la théorie de l'agence, s'inspirent à l'origine de la démarche d’Alchian et
Demsetz, pour définir la firme comme nœud de contrats. Pour eux, « il existe une relation
d'agence lorsqu'une personne a recours aux services d'une autre personne en vue
d'accomplir en son nom une tache quelconque »5.
Dans le cas présent, la relation d'agence concernera le principal (l'actionnaire) et son
agent (le gestionnaire), ce dernier s'étant engagé à servir les intérêts du premier. De ces
relations émane la notion de coûts d'agence, coûts qui résultent du caractère potentiellement
opportuniste des acteurs et de l'asymétrie d'informations entre les cocontractants.
La théorie des coûts de transactions « TCT », (Williamson, 1985) : cette théorie considère
que la firme existe pour pallier les failles du marché, liées aux problèmes posés par la
spécificité des actifs et l'opportunisme potentiel des acteurs.
Pour O.E. Williamson, on internalise pour éviter d'être spolié et perdre le minimum de
valeur par rapport à ce qui serait réalisable par rapport à l'optimum. C’est pourquoi, les
directions des sociétés, incitées par les auditeurs légaux, ont décidé d’internaliser des activités
d’audit légal grâce à la création des services d’audit interne, pour économiser les honoraires
élevés versées aux auditeurs externes.
Or, on peut tout à fait admettre que l’audit et le contrôle interne peuvent être présentés
comme deux mécanismes de surveillance fournissant une évaluation du management de la
direction aux actionnaires. En contribuant à réduire l’asymétrie informationnelle qui existe
entre les managers et les autres stakeholders7, l’audit concours également à la résolution des
problèmes liés à la véracité des comptes en assumant une fonction d’assurance.
b- La théorie de l'enracinement
A la fin des années 80, la thèse de l'enracinement fut développée par A. Shleifer, R.W.
Vishny et R. Morck. Elle remet en cause les fondements des théories contractuelles en général
et de la théorie de l'agence en particulier. Cette théorie semble offrir un cadre d'étude approprié
à l'analyse des stratégies opportunistes des dirigeants et leurs conséquences sur les systèmes de
contrôle et sur la performance de l'entreprise.
Dans les théories fondatrices de la gouvernance des entreprises, le rôle du dirigeant
apparaît très discret voire absent. Une fois évoquées, les divergences d'intérêts entre le
dirigeant et les actionnaires, et la possibilité d'opportunisme, l'attention est principalement
portée sur l'identification des mécanismes externes ou internes permettant de discipliner le
dirigeant.
4 Gérard CHARREAUX « Mode de contrôle des dirigeants et performance des firmes », Décembre 1992, page 7
5 Céline CHATELIN, Stéphane TRÉBUCQ « du processus d’élaboration d'un cadre conceptuel en gouvernance
d'entreprise », article n°102-12, page 11
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
1
/
16
100%