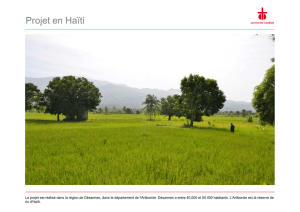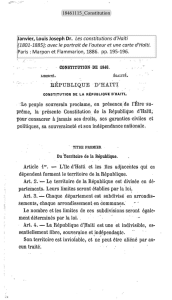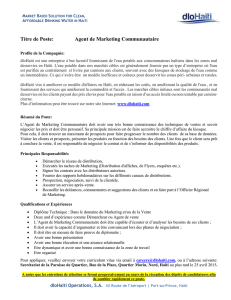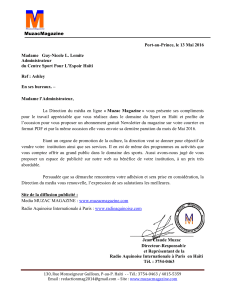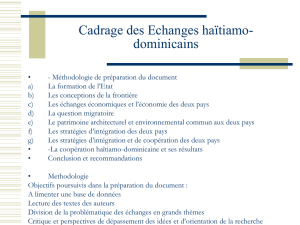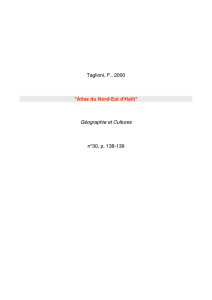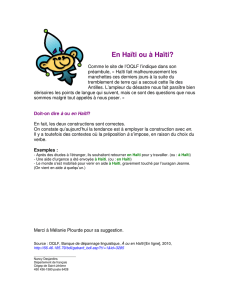Projet binational de réhabilitation du bassin versant
du fleuve Artibonite, dans la zone frontalière
entre Haïti et la République dominicaine
- Projet n
o
4456/A-031937 -
RAPPORT
DE
L’ÉTUDE DIAGNOSTIQUE
-HAÏTI-
Décembre 2006
République d’Haïti
Ministère de l’Environnement

OXFAM QUÉBEC CRC SOGEMA
2330, rue Notre-Dame Ouest, bureau 200 1111, rue Saint-Charles
Montréal (Québec) H3J 2Y2 Longueuil (Québec) J4K 5G4
T O U S D R O I T S R É S E R V É S
©Oxfam Québec-CRC Sogema, 2006-2007
Ce document ne peut être reproduit en tout ou en partie par quelque procédé
électronique ou mécanique que ce soit, sans la permission écrite
d’Oxfam Québec et de CRC Sogema.
Sauf dans le cas où le genre est explicitement mentionné, le masculin est utilisé comme représentant les
deux sexes et se veut sans discrimination à l’égard des femmes et des hommes.

Projet binational de réhabilitation du bassin versant du fleuve Artibonite,
dans la zone frontalière entre Haïti et la République dominicaine - Projet n
o
4456/A-031937
Oxfam Québec-CRC Sogema – Rapport de l’étude diagnostique - Haïti / i
Table des matières
page
Table des matières...................................................................................................................... i
Table des tableaux.....................................................................................................................vi
Table des figures........................................................................................................................xi
Remerciements........................................................................................................................ xiii
Réalisation de l’étude par l’équipe du Projet.............................................................................xiv
Sigles utilisés ............................................................................................................................xv
Chapitre 1 - Introduction ......................................................................................................... 1
1.1
Contexte.....................................................................................................................................1
1.2
Objectifs et approche du diagnostic...........................................................................................2
1.2.1
Objectif général.............................................................................................................2
1.2.2
Objectifs spécifiques.....................................................................................................2
1.2.3
Approche.......................................................................................................................2
Chapitre 2 - Aspects biophysiques.......................................................................................... 3
2.1
Territoire de l’étude diagnostique...............................................................................................3
2.1.1
Localisation, superficie et nature du bassin versant de l’Artibonite..............................3
2.1.2
Bassins versants...........................................................................................................5
2.1.2.1
Division en sous bassins utilisée par l’OÉA...................................................5
2.1.2.2
Division du territoire en unités hydrographiques ...........................................9
2.1.2.3
Hiérarchisation des rivières alimentant le lac Péligre et à potentiel
hydroélectrique ..............................................................................................9
2.1.2.4
Zones potentielles d’intervention : les minibassins .....................................11
2.2
Divisions administratives..........................................................................................................14
2.3
Géologie, géomorphologie et topographie...............................................................................18
2.3.1
Origines et formations géologiques ............................................................................18
2.3.2
Géomorphologie .........................................................................................................20
2.3.3
Relief...........................................................................................................................21
2.3.4
Pente...........................................................................................................................25
2.4
Érosion et sédimentation .........................................................................................................27
2.4.1
Situation ......................................................................................................................27
2.4.2
Origine et aires productrices de sédiments ................................................................27
2.4.2.1
Rapports de LGL .........................................................................................28
2.4.2.2
Rapport de l’OÉA.........................................................................................32
2.4.2.3
Concordance entre les études.....................................................................33
2.4.3
Quantification de la sédimentation du lac Péligre et de l’érosion du bassin...............33
2.4.4
Risque d’érosion par la pluie et le ruissellement de surface ......................................35
2.4.4.1
Facteurs d’érosion .......................................................................................35
2.4.4.2
Risque d’érosion (UTSIG)............................................................................36
2.4.4.3
Risque réel d’érosion (IGN France, UTSIG)................................................37
2.4.4.4
Indices d’agressivité de la pluie (érosion potentielle) ..................................38
2.4.4.5
Indices d’érosion potentielle sur une parcelle nue ......................................40
2.4.5
Risque de glissement de terrain : précipitation et pente.............................................41
2.4.5.1
Intensité de la précipitation..........................................................................42
2.4.5.2
Classes de pente .........................................................................................43
2.4.5.3
Précipitation et classes de pente combinées ..............................................43

Projet binational de réhabilitation du bassin versant du fleuve Artibonite,
dans la zone frontalière entre Haïti et la République dominicaine - Projet n
o
4456/A-031937
Oxfam Québec-CRC Sogema – Rapport de l’étude diagnostique - Haïti / ii
2.5
Hydrométéorologie...................................................................................................................45
2.5.1
Données pluviométriques et isohyètes annuelles ......................................................45
2.5.2
Évapotranspiration potentielle calculée ......................................................................48
2.5.3
Variations climatiques mensuelles..............................................................................50
2.5.4
Indices de disponibilité en eau pour la végétation......................................................54
2.5.4.1
Indice de disponibilité en eau (IDE) de Hargreaves et Samani...................54
2.5.4.2
Relation d’humidité du sol (RHS) ................................................................54
2.5.4.3
Nombre de mois consécutifs avec disponibilité en eau (NM)......................54
2.5.5
Climats ........................................................................................................................61
2.5.5.1
Système de classification en Haïti et en République dominicaine ..............61
2.5.5.2
Système de classification international........................................................64
2.5.5.3
Système de classification pour le HBFA......................................................64
2.6
Hydrologie................................................................................................................................64
2.6.1
Écoulement en rivière : intérêt et disponibilité des données ......................................64
2.6.2
Bilan hydrologique annuel...........................................................................................65
2.6.2.1
Étude du PNUD-SCET (Haïti 1980) ............................................................65
2.6.2.2
Cette étude ..................................................................................................65
2.6.2.3
Variabilité des écoulements annuels...........................................................69
2.6.3
Disponibilité minimale en eau .....................................................................................69
2.6.3.1
Base annuelle ..............................................................................................69
2.6.3.2
Base mensuelle ...........................................................................................72
2.6.4
Débits journaliers de crue au barrage du Péligre .......................................................77
2.6.5
Distribution de l’écoulement dans les minibassins .....................................................77
2.6.6
Qualité de l’eau ...........................................................................................................79
2.6.6.1
Charges sédimentaires................................................................................79
2.6.6.2
Caractéristiques physicochimiques des eaux de surface............................79
2.6.7
Hydrogéologie - eaux souterraines.............................................................................79
2.7
Effets de la dégradation et de la réhabilitation du couvert végétal sur l’écoulement, l’érosion et
la qualité de l’eau .....................................................................................................................80
2.7.1
Mise en situation .........................................................................................................80
2.7.2
Rappel des fonctions hydrologiques d’un bassin boisé..............................................81
2.7.3
Récolte forestière, conversion agricole et reboisement en milieu non dégradé.........83
2.7.3.1
Écoulement..................................................................................................83
2.7.3.2
Érosion.........................................................................................................87
2.7.3.3
Qualité de l’eau............................................................................................89
2.7.3.4
Dimension des bassins................................................................................89
2.7.4
Conversion de la forêt en milieu agricole, suivi de la dégradation du sol...................90
2.7.4.1
Écoulement..................................................................................................90
2.7.4.2
Érosion et transport de sédiments...............................................................90
2.7.5
Effets de l’amélioration du couvert végétal sur les sols dégradés -
réhabilitation................................................................................................................91
2.7.5.1
Rôle de l’agroforesterie................................................................................92
2.7.6
Inondation ...................................................................................................................93
2.7.7
Qualité de l’eau et érosion – intégrer ou séparer ? ....................................................94
Chapitre 3 - Aspects socioéconomiques et accessibilité aux services................................... 95
3.1
Caractéristiques générales ......................................................................................................95
3.1.1
Densité........................................................................................................................96
3.1.2
Répartition de la population par sexe et par groupe d’âge.........................................98
3.1.3
Composition des ménages, taille et responsabilités.................................................100
3.1.4
Éducation et analphabétisme ...................................................................................102
3.1.5
Santé et nutrition.......................................................................................................104
3.1.6
Pauvreté (Hommes/Femmes)...................................................................................106

Projet binational de réhabilitation du bassin versant du fleuve Artibonite,
dans la zone frontalière entre Haïti et la République dominicaine - Projet n
o
4456/A-031937
Oxfam Québec-CRC Sogema – Rapport de l’étude diagnostique - Haïti / iii
3.2
Unités de production et division du travail .............................................................................107
3.2.1
Activités liées à la production ...................................................................................107
3.2.2
Activités liées à la reproduction ................................................................................113
3.3
Migrations au Haut Plateau Central.......................................................................................115
3.3.1
Évolution des tendances...........................................................................................116
3.3.2
Pôles de migration ....................................................................................................117
3.3.3
Conséquences ..........................................................................................................117
3.4
Infrastructures et accessibilité aux services de base ............................................................117
3.4.1
Transport (routes et pistes d’atterrissage) ................................................................118
3.4.2
Communication .........................................................................................................120
3.4.3
Eau potable...............................................................................................................120
3.4.4
Éducation ..................................................................................................................122
3.4.5
Soins de santé de base ............................................................................................123
3.4.6
Assainissement.........................................................................................................125
3.5
Conclusion partielle................................................................................................................126
Chapitre 4 - Classification du territoire, systèmes de production et vulnérabilité ................. 127
4.1
Considérations générales ......................................................................................................127
4.2
Écologie et mise en valeur des aires naturelles ....................................................................127
4.2.1
Intérêt et approche....................................................................................................127
4.2.2
Zones biologiques naturelles et formations végétales..............................................127
4.2.2.1
Forêt humide de la zone subtropicale (Fh-S) ............................................131
4.2.2.2
Forêt très humide de la zone subtropicale (Fth-S) ....................................131
4.2.2.3
Forêt humide de montagne de basse altitude (Fh-Mb) .............................131
4.2.2.4
Forêt très humide de montagne de basse altitude (Fth-Mb) .....................132
4.2.2.5
Forêt sèche de la zone subtropicale (Fs-S)...............................................132
4.2.3
Aires protégées et potentiel écotouristique...............................................................132
4.2.4
Aires à protéger et potentiel écotouristique ..............................................................135
4.3
Capacité potentielle des sols .................................................................................................136
4.4
Occupation des sols et gestion des ressources naturelles....................................................140
4.4.1
Occupation actuelle des sols ....................................................................................140
4.4.2
Gestion des ressources naturelles dans le contexte de l’occupation des sols.........140
4.5
Zonage agroécologique et systèmes de production..............................................................143
4.5.1
Définition, critères et zones agroécologiques du HBFA ...........................................143
4.5.2
Montagnes et plateaux humides...............................................................................146
4.5.3
Plateaux et montagnes semi-humides......................................................................146
4.5.4
Plateaux secs............................................................................................................146
4.5.5
Montagnes sèches....................................................................................................146
4.5.6
Situations particulières..............................................................................................147
4.6
Mise en valeur par les systèmes de cultures.........................................................................149
4.6.1
Organisation des systèmes en lien avec les zones agroécologiques ......................149
4.6.2
Descriptions des systèmes de cultures ....................................................................149
4.6.2.1
Les systèmes caféiers ...............................................................................149
4.6.2.2
Les systèmes à base d’arachide ...............................................................152
4.6.2.3
Les systèmes maraîchers..........................................................................153
4.6.2.3.1
Les sous-systèmes maraîchers des zones irriguées ...............153
4.6.2.3.2.
Sous-systèmes maraîchers des zones humides d’altitude......154
4.6.2.4
Les systèmes à base de canne à sucre ....................................................154
4.6.2.5
Les systèmes à base de riz .......................................................................155
4.6.2.6
Les systèmes à base de tabac ..................................................................156
4.6.2.7
Les systèmes vivriers ................................................................................156
4.6.3
Constats sur les systèmes de cultures .....................................................................157
4.6.3.1
Technicité de l’agriculture..........................................................................157
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
 129
129
 130
130
 131
131
 132
132
 133
133
 134
134
 135
135
 136
136
 137
137
 138
138
 139
139
 140
140
 141
141
 142
142
 143
143
 144
144
 145
145
 146
146
 147
147
 148
148
 149
149
 150
150
 151
151
 152
152
 153
153
 154
154
 155
155
 156
156
 157
157
 158
158
 159
159
 160
160
 161
161
 162
162
 163
163
 164
164
 165
165
 166
166
 167
167
 168
168
 169
169
 170
170
 171
171
 172
172
 173
173
 174
174
 175
175
 176
176
 177
177
 178
178
 179
179
 180
180
 181
181
 182
182
 183
183
 184
184
 185
185
 186
186
 187
187
 188
188
 189
189
 190
190
 191
191
 192
192
 193
193
 194
194
 195
195
 196
196
 197
197
 198
198
 199
199
 200
200
 201
201
 202
202
 203
203
 204
204
 205
205
 206
206
 207
207
 208
208
 209
209
 210
210
 211
211
 212
212
 213
213
 214
214
 215
215
 216
216
 217
217
 218
218
 219
219
 220
220
 221
221
 222
222
 223
223
 224
224
 225
225
 226
226
 227
227
 228
228
 229
229
 230
230
 231
231
 232
232
 233
233
 234
234
 235
235
 236
236
 237
237
 238
238
 239
239
 240
240
 241
241
 242
242
 243
243
 244
244
 245
245
1
/
245
100%