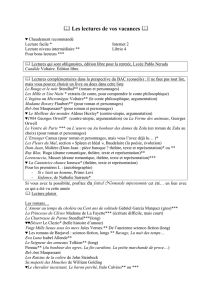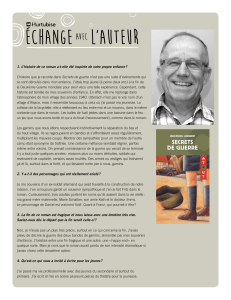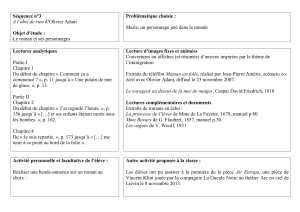1
LES GENS DU BALTO :
ROMAN URBAIN ET PARTICULARISME(S) LINGUISTIQUE(S)
Zouhour MESSILI – BEN AZIZA
Université Tunis El Manar
Institut supérieur des sciences humaines de Tunis
UREB (Unité de recherche en études brachylogiques)
Depuis les années 1980, des auteurs issus de l’immigration
essentiellement maghrébine publient des romans mettant en
scène leur vécu d’enfants d’immigrés dans les banlieues
françaises. La dénomination « littérature beure » est alors
créée. Dans leur vie quotidienne, ces jeunes sont souvent
confrontés à l’exclusion et au problème d’identité ; et la
première génération des écrivains beurs développent
amplement dans leur roman des thématiques comme leur
appartenance culturelle et identitaire. Les premiers romans sont
le plus souvent autobiographiques mais certains auteurs de la
littérature de Banlieue se libère de l’énonciation personnelle et
ambitionne de s’imposer sur la scène littéraire.
Fayza Guène est une française issue de l’immigration et met
en scène des formes langagières à partir de sa perception du
monde, mais elle refuse de s’inscrire dans la lignée de la
littérature marginale dans laquelle on tente de parquer ces
jeunes romanciers des quartiers en les ghettoïsant par
l’appellation « littérature beure ». Dans son roman, Les gens du
Balto, l’auteure ne se met pas en scène contrairement à son
roman autobiographique
1
mais présente des personnages d’une
ville banlieusarde lointaine.
Nous voudrions d’abord résumer en une phrase le roman : le
patron du café Balto est retrouvé mort et la police interroge les
voisins. Ce roman, contrairement aux apparences n’est
absolument pas un roman policier mais un roman de réalisme
social. Les personnes interrogées sont les habitués du bar et
leurs témoignages, par l’authenticité de leur langage (populaire
et crue, ponctué pour les plus jeunes de verlan et d’anglais) ne
s’intéressent pas au crime mais révèlent leur existence, leur
quotidien dans une « non-ville provinciale ». Par la maitrise
littéraire de l’illusion réaliste, par un dire authentique, l’auteure
parvient à rendre ces hommes et ces femmes profondément
humains, malgré la violence quotidienne de leur vécu. Les
1
Kiffe kiffe demain, publié en 2004. De nombreux critiques préfèrent
employer le terme « autofiction » ou « nouvelle autobiographie ».

2
personnages, par delà leur différence et chacun avec son
langage fortement marqué, se rejoignent dans le besoin
d’exprimer leur ressenti, leur manière d’être, leur mal-être,
leurs espoirs. Tous se décrivent et la somme de ces récits
présente un véritable portrait d’une ville nichée au bout du
RER, Joigny les Deux Bouts.
Dans ce roman urbain, l’auteure en prenant le parti d’écrire
comme on parle, parvient à présenter, avec beaucoup de
finesse teintée d’humour, une authentique chronique sociale.
Chaque chapitre donne la parole à un personnage et nous
verrons dans ce roman polyphonique (à plusieurs voix)
comment par un langage direct, familier, grossier, vulgaire,
usant du verlan et du style sms,…, le littéraire converse avec le
sociologique ; comment de l’illusion d’un roman policier
l’auteur mène en réalité une véritable enquête sociologique.
Mais avant toute chose, nous voudrions expliquer quel sens
nous donnons aux deux expressions utilisées dans le titre de cet
article : « roman urbain » et « particularisme(s) linguistique(s).
Roman urbain
Nous nous appuyons sur une citation de Christina Horvath
tirée de son livre Le roman urbain contemporain en France :
Par roman urbain j’entends ici les récits dont l’intrigue
se déroule à l’époque contemporaine (celle de l’auteur
et du lecteur à la parution du texte) et qui livrent une
description très précise de la vie quotidienne ordinaire
[Horvath, 2007 : 13]
Le roman urbain est souvent assimilé à ce que l’on appelle
la littérature périphérique. L’approche sociale en littérature est
fortement liée aux critères sociaux, et la littérature
périphérique est le plus souvent associée aux auteurs issus
d’une minorité. On pourrait citer la littérature ouvrière, la
littérature paysanne et –nous y reviendrons– la littérature
« beure ». C’est en fait la langue employée, l’usage d’une
langue minoritaire, qui fait de certains auteurs des auteurs
périphériques et inscrit leur roman, leur œuvre, dans la
littérature périphérique.
Notre roman valorise la littérature orale dans la mesure où
chacun des personnages prend la parole et s’exprime ainsi dans
« son » parler français. Pourquoi ce possessif « son parler
français » ? En effet, les particularités linguistiques de chacun
des personnages trahissent l’appartenance sociale. Le fait
d’écrire dans un langage parlé fortement marqué par ces
particularismes linguistiques constitue, nous semble-t-il, un fait
probant de situation périphérique sur le champ littéraire. Et là

3
nous en venons à la deuxième expression du titre :
particularisme(s) linguistique(s).
Selon Édith Bédard et Jacques Maurais :
Le langage est un moyen ou un lieu d'expression de soi
qui peut être investi de valeurs stratégiques dans
l'interaction des rôles et des statuts sociaux. Puisque
certaines caractéristiques de la langue peuvent
fonctionner comme indicateurs du statut social – surtout
relatif à autrui – la situation d'interaction appelle la mise
en jeu de ces marqueurs linguistiques [Bédard &
Maurais, 1983]
L’oralité de ce roman est une de ces particularités.
Puisqu’une des fonctions sociales du langage est, entre
autres, de marquer et de présenter l'identité de l'individu et
son statut, la langue peut jouer le rôle d’indicateur de
l’identité sociale. Le comportement linguistique donne un
ton, une coloration au personnage. Dans ce roman, le lexique,
le registre et le discours présentent des différences d'un
personnage à un autre. En littérature, les identités sont des
réalités d’ordre discursif et nous relevons une hétérogénéité
de comportements linguistiques. Chaque personnage prend la
parole et nous avons donc une multiplicité de « je » qui
raconte leur quotidien dans un oral spontané, très souvent
familier. Nous allons tenter de dégager les traits
sociolinguistiques saillants dans ce roman, et ce en trois
temps :
- Une analyse toponymique (du titre, des surnoms et des
lieux) ;
- Une analyse de l’hétérogénéité des comportements
linguistiques ;
- Une analyse des schèmes cognitifs stéréotypés, des
représentations sociales.
Nous partons donc du postulat que sociolinguistique et
littérature dialoguent ; mais pour mener à bien ce dialogue,
les concepts de la théorie sociolinguistique et les singularités
de la littérature ne doivent pas être mis en opposition, leurs
différences ne doivent pas disqualifier l’une ou l’autre.
Revenons tout d’abord brièvement sur le récit :
Le patron du café Balto est retrouvé mort dans son
établissement et la police (que l’on n’entend jamais) mène
son enquête. Un lieutenant sans nom interroge les habitués du
café.
L’auteure met en scène 08 personnages et consacre à
chacun de ses personnages 03 chapitres, chacun de ces 03

4
chapitres ont toujours le même titre. Nous y reviendrons.
Tous ont donc le même droit à la parole. Mais avant de nous
intéresser au dire de chacun des personnages, nous
commencerons par le péritexte du roman, en l’occurrence le
titre du roman lui-même, les titres des chapitres, et ce à
travers une étude toponymique et anthroponymique :
I. Analyse toponymique et anthroponymique :
Le titre : Les gens du Balto
Notre premier contact avec les signes linguistiques dans Les
gens du Balto, et plus généralement dans tout texte, se déroule
lors de la lecture du titre, qui est, entre autres, l’un des
constituants du péritexte. Le lecteur, via l’intitulé, se forge une
première idée de ce que pourrait éventuellement être le
contenu du livre et la lecture vient, par la suite, confirmer,
modifier ou compléter cette idée. Notre titre nous place
d’emblée dans un univers particulier par l’emploi de l’indéfini
« les gens » et d’un nom propre Balto.
Balto : En France », de nombreux bars-tabacs portaient ce
nom qui vient d’une marque de cigarettes blondes « Balto »
que la Société d’exploitation industrielle des tabacs et des
allumettes (la SEITA) commercialisait. La SEITA dans les
années 1950-1970 apportait une aide financière aux cafetiers
en difficulté et en contrepartie imposait aux créanciers de
changer le nom de leur établissement et d’utiliser le nom d’une
des marques des cigarettes qu’elle vendait, évidemment pour
faire de la publicité. Les cafés portant ce nom en France ont été
nombreux et le plus souvent situés dans des quartiers
populaires. Le Balto marque déjà un hors-temps puisque la
marque elle-même n’existe plus et un lieu, quartier populaire
mais qui, dans ce roman, s’apparente à une sorte de « hors-
lieu », nous y reviendrons.
Les gens : l’emploi de ce substantif collectif interpelle. Ce
nom signifie « personnes en nombre indéterminé considéré
collectivement ». Ce terme renverrait donc par cette
indétermination linguistique et sémantique à une
indétermination sociale ; le titre qui met en exergue le nom du
café permet tout de même de renvoyer ainsi « les gens » à une
certaine classe de personnes, en l’occurrence les habitués du
café. Le milieu défavorisé, populaire, transparait déjà dans le
titre et, nous allons le voir, ainsi que dans les surnoms des
personnages.
Les noms et surnoms des personnages:
Joël, dit Jojo, dit Patinoire : Joël est le patron assassiné.
Le premier surnom hypocoristique est censé être affectueux,
mais en français il existe la formule familière « affreux jojo »

5
qui signifie « une personne, le plus souvent un enfant, qui ne
sait pas se tenir » ou encore l’adjectif « jojo » toujours
employé à la forme négative « c’est pas jojo = c’est pas joli ».
Ce champ associatif connote négativement le personnage ;
connotation amplifiée par le second surnom « Patinoire » qui
s’apparenterait plus à un sobriquet, un surnom familier et
surtout moqueur.
« On me surnomme comme ça, disons à cause de ma
calvitie avancée » (p. 8)
L’un comme l’autre des surnoms s’utilise surtout dans le
milieu populaire où on aime les surnoms hypocoristiques et les
sobriquets.
Yéva, dit Mme Yéva, la daronne ou la vieille :
Yéva est un prénom arménien : Ève en français. Yéva est
une quinquagénaire, au verbe haut et à la tenue vestimentaire
courte, qui aime encore séduire, mais sans plus.
Mme Yéva : ce premier surnom pourrait sembler ne pas être
particulièrement marqué sauf si l’on pense au fait qu’en
français le titre « Madame » n’est jamais suivi du prénom
mais du nom de famille, et que dans la culture française ce
titre suivi d’un prénom évoque inévitablement Mme Claude,
une personne qui a réellement existé et qui est considérée en
France comme la reine de la prostitution. Elle a d’ailleurs
inspiré de nombreux cinéastes. Serait-ce déjà un clin d’œil
fait au personnage qui d’ailleurs est décrit par son propre fils
ainsi :
Je sais ce qu’ils disent tous quand ils la voient passer.
Elle ressemble un peu aux femmes qui tapinent derrière
la gare. (p. 13)
Daronne est un mot d’argot populaire signifiant la
patronne, mot ancien remis au goût du jour par les jeunes de
banlieue qui lui donne le sens de « mère ».
3ème surnom : La vieille est un surnom donné
principalement au sénior. En général, en France c’est un
surnom pas très gentil et ici pas très flatteur surtout quand on
découvre le personnage qui continue à porter des mini-jupes
et à vouloir séduire les hommes. On peut également imaginer
que cette appellation serait la traduction de l’arabe et dans ce
cas, elle ne serait plus péjorative parce que c’est ainsi que
l’on peut désigner sa mère en arabe.
Taniel, dit Tani, Quetur ou bon à rien
Taniel est un prénom arménien, Daniel en français.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
1
/
11
100%