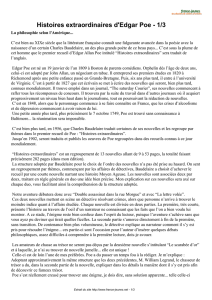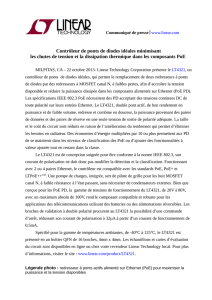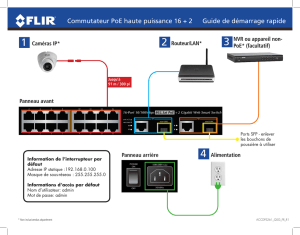« Tableaux parisiens » de Baudelaire : Modernité et vie urbaine
Telechargé par
valerie.chester

1
Tableaux parisiens : la « modernité » de Baudelaire
Source : NRP « Tableaux parisiens » et ressources pédagogiques ed. Belin
Lors de leur parution, en 1857, les Fleurs du mal font scandale. Baudelaire, accusé
d’immoralité, perd son procès et doit censurer plusieurs poèmes jugés immoraux. En 1871, il
propose une nouvelle édition de son recueil, enrichi de nombreux poèmes et bien sûr expurgé
des poèmes interdits. La 2ème section du recueil, « Tableaux parisiens », est ainsi passée de
huit à dix-huit poèmes.
Par ce titre « Tableaux parisiens », Baudelaire inscrit cette section des Fleurs du mal
dans la lignée du Tableau de Paris, que Louis Sébastien Mercier avait illustrée à partir de 1781.
Il s’agissait d’un inventaire descriptif et critique de la société d’Ancien régime saisie dans tous
ses aspects et dans toutes ses divisions. Repris par Baudelaire, le terme recouvre à part égale
une composante descriptive et une dimension satirique. Car le tableau ordonne le réel pour
le rendre pleinement visible et surtout totalement lisible : il s’offre comme une
représentation concertée des aspects de la vie. Il inventorie de la sorte — sous la forme de
quelques genres appropriés, tels le paysage, le portrait, l’esquisse, la figure, le type ou
encore l’allégorie — les manifestations et les incarnations les plus significatives d’une
époque et d’un milieu. Mais ce répertoire de la ville moderne promis par Baudelaire n’élude
pas la dimension critique et satirique : il importe moins de brosser la fresque des réalités
sociales et humaines (à la manière d’un Balzac par exemple) que de présenter des «images»,
des symboles offrant prise à l’interprétation morale et métaphysique. Dans la ville moderne,
que le réalisme balzacien avait déjà élue comme lieu privilégié d’enquête sociale et historique,
Baudelaire ne va pas puiser le pittoresque qui console ou qui aveugle, mais l’expérience d’une
réalité jusque-là négligée ou ignorée par la poésie, celle des foules anonymes, des populations
marginales et déclassées qui hantent la cité immense et lui donnent son âme propre, à la fois
lumineuse et douloureuse. Le poète voudrait ainsi ausculter les mouvements et les souffrances
de cette âme profonde et son errance est d’abord exploration poétique. Dans les «Tableaux
parisiens», il est encore et toujours question de la condition humaine et de sa misère foncière.
Baudelaire s’est lui-même voulu le « peintre de la vie moderne », en écrivant avec
beaucoup d’ironie à la fin du Salon de 1845 : « celui-là sera le peintre, le vrai peintre, qui saura
arracher à la vie actuelle son côté épique, et nous faire voir et comprendre, avec de la couleur
ou du dessin, combien nous sommes grands et poétiques dans nos cravates et nos bottes
vernies ». Les « Tableaux parisiens » révèlent plus que toute autre section des Fleurs du mal
cette ironie qui consiste à enregistrer la médiocrité ou la déception du réel. Il s’agit, dans une
langue poétique qui joue de la tension entre tradition et innovations, de dire la déception et le
dégoût que la réalité moderne engendre tout en célébrant sa beauté fugitive ou bizarre, et de
dégager sous l’apparence transitoire l’enseignement moral et métaphysique qu’elle recèle.
L’époque de Baudelaire, entre modernité et conservatisme
L’époque à laquelle écrit Baudelaire est la fin de la IIe République et les débuts du
Second Empire. C’est une période d’intense modernisation de la France, d’un affairisme

2
effréné et d’un développement économique rapide : c’est le moment de la révolution
industrielle où naît une véritable élite économique en France, tandis que la classe ouvrière
grossit et contribue à l’accroissement des villes. C’est une ère de grands travaux de
modernisation, de développement des voies de communication (routes, canaux) et du système
bancaire. Pour autant, le pouvoir napoléonien mis en place déçoit bon nombre des
représentants de la génération romantique. Après les évolutions de la IIe République, qui
entérine le suffrage universel masculin, la liberté d’association et le droit du travail, le régime
de Napoléon III est un pouvoir autoritaire, qui voit s’imposer le « parti de l’ordre », exerçant
une censure efficace sur les journaux et les publications et restreignant l’exercice
parlementaire. Victor Hugo, opposant virulent, doit s’exiler à Guernesey. Le régime bénéficie
cependant du soutien de la bourgeoisie, hormis celui des milieux républicains, notamment à
cause du souvenir encore récent des deux épisodes révolutionnaires de 1848 qui ont démontré
l’existence de forces sociales réclamant plus d’égalité et de liberté. Les « Tableaux parisiens »
en portent la trace, lorsque le poète affirme son détachement par rapport au monde qui
l’entoure : « L’Émeute, tempêtant vainement à ma vitre, / Ne fera pas lever mon front de mon
pupitre » (« Paysage »).
Quelle place la poésie peut-elle avoir, dans cette France révolutionnée à la fois
politiquement (elle a connu quatre révolutions en moins d’un siècle), économiquement et
socialement ? Elle reste souvent à l’écart des grands débats qui secouent la vie politique, et se
réfugie dans les sphères de la pure littérature. Destinée jusqu’à la fin du XVIIIe siècle à l’élite
des salons et des bourgeois éclairés, la littérature s’adresse en effet désormais aux quarante
millions d’habitants que comporte la France, une évolution qui la transforme profondément.
Elle entre dans l’ère industrielle, imprimée en masse (pour ses principaux succès), aidée par la
publicité, vendue en feuilletons de presse bon marché, en éditions populaires. En se
démocratisant, elle s’adapte au goût du plus grand nombre, mais cherche aussi à l’orienter.
Elle explore enfin des voies nouvelles, tire sa substance du réel et de la vie sociale, d’où
ressortent quelques genres phares, en particulier le roman populaire, et ses personnages du
Paris pittoresque qui tiennent en haleine des millions de lecteurs, ou le mélodrame qui fait se
presser la foule sur les boulevards.
La société nouvelle a vu l’emprise de la religion considérablement diminuer. Au
tournant du XIXe siècle, le sens du monde se trouve soudain en crise, l’histoire semblant
chaotique aux contemporains, privés d’une destinée collective. C’est ce vide que l’écrivain
s’attribue la mission de remplir. Mage, prophète, il encourage l’épopée humaine (chez Hugo,
par exemple), ou cède au désespoir... Il y a dans la poésie de Baudelaire un certain refus de
voir le « sacre de l’écrivain », c’est-à-dire la promotion de l’artiste en « mage » chargé d’offrir
à la collectivité le sens du monde et de l’existence. Le premier romantisme de la génération de
1830 cède le pas à un romantisme désenchanté, qui renonce à l’amélioration du monde par
l’idéal et qui laisse à ce renoncement une douloureuse expression. Baudelaire est le poète de
cette époque du désenchantement.
Le Paris de 1850
« Paris change ! » : ce constat est le premier des « Tableaux parisiens » qui, dans une
certaine mesure, sont une ode à la disparition des vieilles capitales. C’est que « Le vieux Paris
n’est plus (la forme d’une ville / Change plus vite, hélas ! que le cœur d’un mortel) » (« Le
cygne »). Le Paris de 1850 est en pleine transformation. La capitale s’étend, de nouveaux
quartiers apparaissent, gagnant la périphérie, annexant les villes alentour : Baudelaire

3
l’évoque comme un « colosse puissant » (« Les sept vieillards »). La capitale de la France
mélange donc quartiers nouveaux et « vieux faubourgs » (« Le soleil »). Elle comporte encore
des zones agricoles. Aussi Baudelaire peut-il voir le soleil tomber « sur les toits et les blés ». Il
observe également, « voisine de la ville, / Notre blanche maison, petite mais tranquille » (« Je
n’ai pas oublié, voisine de la ville... »). Les travaux d’Haussmann transforment le paysage
parisien. Afin de remédier aux risques d’épidémie (et d’insurrection), de longues et larges
avenues sont percées dans Paris, les systèmes d’assainissement sont perfectionnés. La
population s’urbanise, poussée par les emplois nouveaux qui apparaissent dans les villes :
usines et fabriques, permettant à Baudelaire d’évoquer « l’atelier qui chante et qui bavarde »
(« Paysage »), ou les cheminées que le poète nomme « tuyaux », qui déversent dans le ciel « les
fleuves de charbon » (« Paysage »), ou qui créent « un brouillard sale et jaune » (« Les sept
vieillards »). Paris est souvent évoqué comme ville de travail et de labeur pour ses habitants
comme dans « Le crépuscule du matin » : « Et le sombre Paris, en se frottant les yeux, /
Empoignait ses outils, vieillard laborieux. »
Dès lors, l’enjeu des « Tableaux parisiens » apparaît clairement. Les changements de la
ville viennent construire la posture encore romantique d’un poète constatant la différence
entre son cœur, la sensibilité fidèle et nostalgique de ses souvenirs, et la ville en mouvement
dont la modernité fait son entrée en poésie. C’est avec un mélange d’euphorie et de mélancolie
que le poète Baudelaire se fixe comme terrain de prédilection la ville, « trébuchant sur les mots
comme sur les pavés ». Tenté par le regret, il est également conscient du rôle que peut jouer la
poésie dans l’embellissement du réel puisque, semblable au soleil, il « ennoblit le sort des
choses les plus viles » (« Le soleil »).
Parmi les grands chantiers de l’époque, notons lors de la transformation du Carrousel
l’édification du Palais des Tuileries achevé en 1860. Dans « Le cygne », le poète fait allusion à
un « palais neuf » ayant remplacé près du Louvre un « camp de baraques », et ce n’est pas un
hasard si ce poème, évocation des bouleversements urbains et de la fin du vieux Paris, est
dédicacé à l’auteur de Notre-Dame de Paris, Victor Hugo. Sur les grandes avenues dessinées
par Haussmann, le trafic augmente, c’est, écrit Baudelaire, « un sombre ouragan dans l’air
silencieux » (« Le cygne »). Le poète évoque également le « fracas roulant des omnibus » (« Les
petites vieilles »), ces ancêtres des transports en commun, mais encore évidemment tirés par
des chevaux. La disparition en 1837 du célèbre café-glacier Frascati, rue Montmartre (cité aussi
à de nombreuses reprises par Balzac), et la destruction des jardins de Tivoli – autre endroit où
la bonne société du début du siècle venait s’amuser et se montrer – sont évoquées lorsque
Baudelaire décrit ses « petites vieilles » énamourées tout comme lui de leurs souvenirs d’un
Paris qui n’existe plus. Autres temps, autres mœurs : ces lieux de sociabilité mondaine sont
remplacés, dans le Paris haussmannien, par les grands magasins (dont beaucoup perdurent
aujourd’hui), palais de la consommation de l’élite, ou par tous les commerces des menus
plaisirs du peuple, lorsque Baudelaire « entend ça et là les cuisines siffler, / Les théâtres glapir,
les orchestres ronfler ; / Les tables d’hôte, dont le jeu fait les délices, / S’emplissent de catins et
d’escrocs » (« Le crépuscule du soir »).
Le poète et la ville
Pourtant, les « Tableaux parisiens » ne fourmillent pas de personnages et de rencontres
comme l’évocation d’une ville aurait pu le laisser attendre. Baudelaire cantonne son évocation
à des types abstraits que travaille surtout une tentation allégorique ou fantastique récurrente :
les sept vieillards semblent des allégories de la vieillesse, tout comme les petites vieilles
permettent de dire le temps qui passe et la réversibilité de la morale puisqu’elles sont, sans

4
qu’il soit possible de le savoir avec certitude, saintes ou courtisanes de jadis. La gravure
admirée sur les quais de la Seine, dans « Le squelette laboureur », est le symbole d’un travail
harassant, une allégorie de la condition humaine, enfin un memento mori, tandis que la
mendiante rousse intéresse surtout par sa pauvreté qui cache une secrète beauté inaccessible
aux yeux de la majorité.
La ville, ainsi, sert surtout de reflet au poète. Elle est le spectacle à travers lequel il se
dépeint lui-même. Cette attitude fait de Baudelaire un poète encore très influencé par le
romantisme, dont il constitue l’un des crépuscules. En même temps, la primauté du sujet, les
tentatives variées de définition du « moi » à travers ce qui apparaît comme une biographie
indirecte ou fragmentaire (dans Les Fleurs du mal, mais aussi Mon cœur mis à nu, publié en
1887 à titre posthume), l’inscrivent dans une ressemblance très forte avec l’autre grand poète
de son époque, Gérard de Nerval.
On a souvent été tenté de rapprocher Baudelaire des courants variés qui fleurissent à
son époque : il est proche du jeune mouvement parnassien, comme Théophile Gautier,
puisqu’il envisage l’art pour l’art et prise la forme, en déconnectant la poésie des enjeux
sociaux de son temps, il est romantique comme Hugo dans l’expression du « moi » poétique,
et préfigure à certains égards le symbolisme (qui est pourtant nettement postérieur). En fait,
Baudelaire a cherché toute sa vie les modèles auxquels s’associer, modèles qu’il a lui-même
élaborés dans diverses postures d’adhésion et de refus. Adhésion à l’idéalisme, à la volonté de
concevoir le réel comme valable en tant que symbole d’une réalité supérieure, et refus de ce
qu’il appelle « art positif », c’est-à-dire l’art corrélé à la nature et les qualités qu’on est tenté de
lui prêter, l’harmonie et la vertu. En somme, Baudelaire constitue une voix éminemment
singulière, une célébration de la poésie qui associe aux dissociations de la figuration du « moi
» les transformations du monde moderne.
Les métamorphoses de Paris
Écrits à l’époque des grands travaux haussmanniens, les « Tableaux parisiens », comme
Le Spleen de Paris, témoignent de la métamorphose du paysage parisien. « Le cygne » propose
ainsi une lamentation élégiaque sur la disparition du vieux Paris sous les gravats des chantiers
de modernisation de la ville. Le poète traverse le « nouveau Carrousel » qui a remplacé la
ménagerie des Tuileries, dont le cygne est le dernier représentant. Cependant, le regard du
poète est ambivalent : il est capable de voir la beauté de ces chantiers. Ce qui l’intéresse n’est
pas tant le résultat de cette transformation que le moment de la métamorphose lui-même. « La
modernité, c’est le transitoire », écrit-il dans Le Peintre de la vie moderne. D’où certainement
l’attention portée à des détails aussi prosaïques que les « échafaudages » et les « blocs » de
pierre servant à l’édification de « palais neufs ». Le Paris haussmannien voit aussi se
développer l’éclairage au gaz, qui donne à la vie nocturne un aspect nouveau quasi étrange. «
L’amour du mensonge » en fait mention : les « feux du gaz » donnent une apparence «
bizarrement fraîche » à la femme dont le poète fait le portrait.
Ce Paris neuf et moderne n’a pas complètement remplacé le vieux Paris : de nombreux
quartiers ont gardé leurs faubourgs, dont il est question par exemple dans la première strophe
du « Soleil ». « Les petites vieilles », auxquelles Baudelaire consacre un poème, sont les témoins
de ce Paris d’autrefois ; elles ont connu des lieux disparus, comme la maison de jeu Frascati ou
le parc de loisirs Tivoli, symboles de l’encanaillement de la bourgeoisie parisienne, fermés
respectivement en 1837 et 1842. Les rides de ces « Èves octogénaires » évoquent au poète la
métaphore des « plis sinueux des vieilles capitales », désignant le dédale des ruelles que le
baron Haussmann veut remplacer par de grandes artères. Ce Paris ancien clôt la section des «

5
Tableaux parisiens », avec le distique : « Et le sombre Paris, en se frottant les yeux, / Empoignait
ses outils, vieillard laborieux. » Le poète assure ainsi par son écriture la survivance d’un monde
voué à disparaître.
Un monde interlope
Ces ruelles sombres offrent un refuge aux personnages et activités qui sont le reflet
perverti de la bourgeoisie triomphante. « Le jeu » décrit par exemple une salle réunissant des
joueurs semblables à des âmes du purgatoire refusant la mort et le néant. Le vice du jeu est
associé à celui de la chair : cette salle est le repaire des « courtisanes vieilles », des « vieilles
putains ». Le Spleen de Paris offre un pendant à ce poème : « Le joueur généreux », dont le
titre désigne Satan que le poète croise dans la rue et suit dans un tripot. Le poète accède donc
à un monde inversé, une ville maléfique qui s’oppose à la ville triomphante d’Haussmann. Le
crépuscule est le moment où le paysage urbain change d’aspect et laisse place à une population
différente de celle des travailleurs. « Le crépuscule du soir » présente ainsi une tonalité quasi
fantastique:
Cependant des démons malsains dans l’atmosphère
S’éveillent lourdement, comme des gens d’affaire, [...]
La Prostitution s’allume dans les rues ;
Comme une fourmilière elle ouvre ses issues ;
Partout elle se fraye un occulte chemin,
Ainsi que l’ennemi qui tente un coup de main.
Le Paris nocturne, « cité de fange », est explicitement comparé à un Enfer sur terre. La
ville est personnifiée grâce à une hypallage qui pare les lieux des traits vicieux de leurs
occupants :
On entend çà et là les cuisines siffler,
Les théâtres glapir, les orchestres ronfler ;
Les tables d’hôte, dont le jeu fait les délices,
S’emplissent de catins et d’escrocs, leurs complices.
« Le crépuscule du matin », qui achève les « Tableaux parisiens », décrit un monde tout
aussi dysphorique, où se dissipent les illusions de la nuit :
Les femmes de plaisir, la paupière livide,
Bouche ouverte, dormaient de leur sommeil stupide ;
Les pauvresses, traînant leurs seins maigres et froides,
Soufflaient sur leurs tisons et soufflaient sur leurs doigts.
L’art du paysage est donc indissociable de celui du portrait chez Baudelaire, les
habitants comme les bâtiments parisiens offrant au lecteur le visage d’une ville corrompue,
pourrie, terreau des fleurs poétiques que sont les « Tableaux parisiens ».
Ce monde interlope donne aux poèmes une dimension proche du fantastique. Dans
« Le soleil », « Les persiennes, abri des secrètes luxures », introduisent le thème du mystère.
Les différents personnages rencontrés semblent être des apparitions fantomatiques. Dans «
Les sept vieillards », Paris est par exemple décrit comme une « cité pleine de rêves, / Où le
spectre en plein jour raccroche le passant ». Le décor est propice au développement d’une
atmosphère inquiétante et mystérieuse : « Les maisons, dont la brume allongeait la hauteur, /
Simulaient les deux quais d’une rivière accrue, / [...] Un brouillard sale et jaune inondait tout
l’espace. » Le vieillard qui apparaît tel un fantôme est comme une émanation du lieu : « un
vieillard dont les guenilles jaunes / Imitaient la couleur de ce ciel pluvieux, / [...] M’apparut. »
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
1
/
9
100%