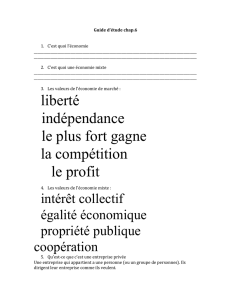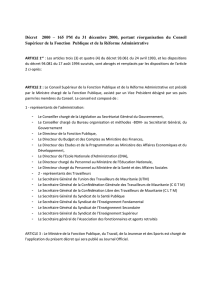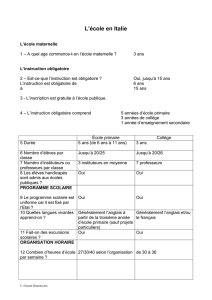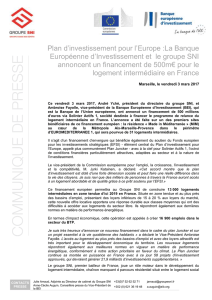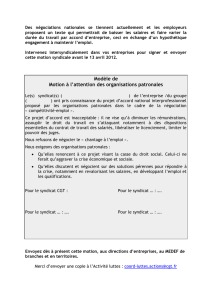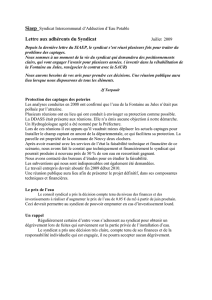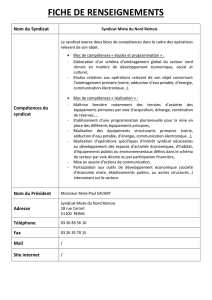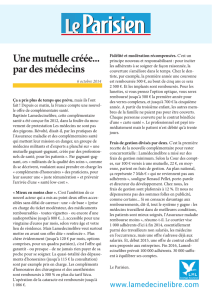Histoire syndicale des enseignants en France : SNI au SE-UNSA
Telechargé par
Alain Chiron

Revisiter une histoire syndicale des instituteurs puis professeurs des écoles
à l’occasion du trentenaire anniversaire de la création du Syndicat des enseignants
Pour avoir fait le choix attrayant de thématiques, l’ouvrage Du SNI au SE-UNSA: 100 ans
d’engagements pour l’École publique ne tient pas pour autant un discours problématique fort sur
l’histoire du syndicalisme enseignant de cette mouvance. Si l’on arrive bien à expliquer pourquoi les
instituteurs sont très majoritairement membres d’amicales et non de syndicats, on aurait pu un peu
mieux expliquer pourquoi ne naît pas un syndicat unique des enseignants en 1920 et exposer de
façon plus complète les raisons qui amenèrent la transformation du SNI-PEGC en SE-FEN puis en SE-
UNSA. La sortie de ce livre est donc, pour nous, l’occasion de reconstituer un grand pan de l’histoire
du syndicalisme enseignant. Notons le prix modique de ce titre, à savoir dix euros.
Avant 1924 les fonctionnaires ne peuvent constituer un syndicat mais les instituteurs le font plus ou
moins quand même soit en donnant cette fonction aux amicales soit en créant un syndicat affilié à la
CGT. La Fédération nationale des syndicats d’instituteurs, devenue la Fédération des membres de
l’enseignement laïque en 1919, entend bien choisir un à un les membres des amicales qui
deviendraient nouveaux adhérents de ce syndicat membre de la CGT en 1906. Ceci pour deux
raisons, l’une est que cette arrivée massive de nouveaux syndiqués ne manquerait pas de se traduire
par un changement de dirigeants et d’orientation de la Fédération des membres de l’enseignement
laïc et la seconde est liée à un fait précis s’étant déroulé durant la Première Guerre mondiale. En
effet Hélène Brion (ayant passé son enfance en Ardennes et institutrice à Pantin), devenue secrétaire
générale par intérim de ce syndicat (le titulaire ayant été mobilisé), fut inculpée pour propagande
défaitiste à la fin du conflit. Or non seulement les dirigeants des amicales n’apportèrent aucun
soutien à Hélène Brion pour ses opinions pacifistes mais en plus certains d’entre eux s’indignèrent
des actions bien limitées à partir de 1917, pour arrêter le conflit, de ceux qui avaient pour organe
syndical L’École émancipée.
Comme l’expliquent bien Nicolas Anoto et Benoît Kermoal, le paysage syndical se fixa avec la
création de la CGTU ; du côté de cette dernière, avec notamment des militants communistes on a la
Fédération des membres de l’enseignement laïque s’exprimant par le biais de L’École émancipée et
dans la CGT, et par ailleurs, avec plus particulièrement des militants réformistes, on trouve le
Syndicat national des instituteurs qui avait pour revue L’École libératrice à partir de 1929. Ajoutons
personnellement qu’une petite fraction des militants amicalistes refusa l’adhésion au SNI et se
regroupèrent dans la Fédération nationale des groupements professionnels d’instituteurs et
institutrices de France présidée par Sennelier natif de Rouillé dans la Vienne et directeur d’école à
Paris.

En 1935 disparaît la Fédération des membres de l’enseignement laïque, très affaiblie du fait de
passages réguliers de ses membres vers le SNI (dont le couple Cornec dont le fils fonda la fédération
des parents d’élèves FCPE). Ceci s’explique par le retour des militants de la CGTU au sein de la CGT.
Le fonctionnement du SNI se fait toutefois alors sur le modèle de la Fédération des membres de
l’enseignement laïque, à savoir le système des tendances. Celles-ci sont au nombre de trois ; leur
ordre d’importance numérique est dans l’ordre le camp où se trouvent essentiellement des
réformistes (mais aussi des syndicalistes révolutionnaires proches de Monatte comme Henri
Aigueperse ultérieurement secrétaire général du SNI de 1946 à 1953), les militants plutôt d’extrême-
gauche regroupés dans l’École émancipée et les adhérents se reconnaissant dans les idées du PCF.
Dans l’Entre-deux-guerres, le SNI peut syndiquer la presque totalité des enseignants ; en effet en plus
des instituteurs, il compte dans ses rangs les professeurs des écoles primaires supérieures qui
préparent au brevet élémentaire (passé à seize ans) et même parfois au brevet supérieur (présenté à
dix-huit ans). Les lycées, scolarisant de la grande section en terminale, sont généralement en
province un par département ; les maîtres des classes antérieures à la sixième sont syndiqués au SNI
et les professeurs des autres classes sont peu nombreux. Notons que les professeurs d’École normale
ont la possibilité d’être membres du SNI ; ils sont certes peu nombreux à adhérer mais on compte là
par exemple Léon Émery enseignant à Lyon qui donna de nombreux papiers à L’École libératrice.
Le courant pacifiste est très puissant chez les instituteurs aussi certains se firent ensuite les chantres
de la Collaboration, en adhérant généralement au RNP de Déat (rare défenseur officiel de l’école
laïque en ces temps où le SNI est interdit) ou en devenant responsable très actif au Secours national
(Auriaux issu de l’Indre-et-Loire est évoqué ici, mentionnons par nous-même Robert Jospin
professeur de cours complémentaire à Meudon et Louis Renard directeur du cours complémentaire
d’Audincourt dans le Doubs). Si les auteurs citent, pour le courant majoritaire, les noms d’André
Delmas (secrétaire général du SNI de 1932 à 1940) et Gisèle Bernadou (enseignante à Houilles en
Seine-et-Oise), ils ne mentionnent pas de syndiqués du courant de L’École émancipée. Parmi les
figures soutiens de la Révolution nationale ou du RNP, mentionnons personnellement Maurice
Wullens le militant libertaire personnalité phare de la pédagogie Freinet, Léon Émery déjà
mentionné, et le également Lyonnais André Lavenir conseiller au ministère de l’Instruction lorsqu’il
fut dirigé par Abel Bonnard Ministre de l'Éducation nationale à Vichy. Cette collaboration, largement
dénoncée par les communistes à la Libération, explique en partie la nette perte d’influence de
L’École émancipée au sein du SNI des années 1950.
Le gouvernement de Vichy transformant les écoles primaires supérieures en collège, le SNI perd une
partie de ses syndiqués potentiels à la Libération. Les professeurs de cours complémentaires
enseignent deux voire trois matières (comme mathématiques et sciences naturelles) dans des écoles
primaires et préparent au brevet, ils deviennent en 1969 des PEGC (perdant ainsi l’accès possible à la
retraite pour leur 55 ans). Le SNI, force principale d’une FEN qui a choisi l’autonomie face à la scission
de FO de la CGT, est concurrencé essentiellement par le SGEN puis aux marges par le Syndicat
national des collèges (créé en lien avec la revendication de la création du corps à venir des PEGC) et
par l’USNEF (qui deviendra le SNE) fondé en 1962 par des militants venant d’organisations qui ont
désapprouvé en particulier les positions du SNI vis-à-vis de l’arrivée au pouvoir de de Gaulle mais
aussi de l’indépendance de l’Algérie.
En 1976 le SNI se propose de devenir le SNI-PEGC et défend un projet d’école fondamentale où
l’enseignement ne serait pas aussi saucissonné que dans les lycées (d’où la formation polyvalente des

enseignants avec une dominante scientifique ou littéraire), un enseignement plus concret et plus
adapté aux intérêts des enfants avec une aide individualisée si besoin. Dans cette fin des années
soixante-dix, le SNES très présent dans les collèges tentent en vain ponctuellement de syndiquer des
PEGC. Dans un mouvement contraire, dans la même décennie, la FEN obtient que nombre de
maîtres auxiliaires du secondaire (souvent adhérents du SNES) soient titularisés comme PEGC. Le
collège devient un champ de conflit de syndicalisation entre deux syndicats de la FEN, l’un dirigé par
la tendance réformiste et l’autre comptant de nombreux militants communistes aux manettes. La
question est en voie de clarification par la décision du ministre Monory de ne plus recruter de PEGC,
et définitivement réglé par son successeur Lionel Jospin qui, après avoir accepté la création d’un
corps d’enseignant de collège, revient sur cette idée à la demande du SNES. Avec la loi d’orientation
de l’enseignement en 1989, le collège devient définitivement une propédeutique au lycée avec des
enseignants monovalents.
L’échec au début du premier septennat de la création d’un grand service public d’enseignement
intégrant l’enseignement catholique, est très mal vécu par nombre d’instituteurs. En 1969, est
apparu, par division du courant de L’École émancipée, le Front unique ouvrier qui est notamment
animé par des militants trotskystes lambertistes de l’OCI-AJS (mouvement dont Lionel Jospin a été
membre dans les années soixante). Armé d’un discours ouvriériste, d’une réticence aux nouveautés
dans la besace du Ministre Alain Savary (en poste de 1981 à 1984) ainsi qu’ à nombre de
changements des successeurs de ce dernier, et d’un discours intransigeant sur la défense de la
laïcité, ce courant va déboucher sur la création d’un syndicat FO dans l’enseignement. Ceci rompt
ainsi le pacte syndical de 1947, qui voulait laisser à la FEN le soin de trouver des adhérents sans
concurrence de la CGT et de FO. Selon nous, la fin de la perspective d'unifier l'enseignement primaire
et secondaire et le souhait d’André Bergeron secrétaire général de FO de redonner à son syndicat
une place incontournable dans une Fonction publique où il avait perdu de représentativité
expliquent l’apparition de Force ouvrière dans l’enseignement. C’est évidemment sur les terres de la
FEN qu’il va faire son miel, son discours étant totalement incompatible avec celui tenu par le SGEN
alors second syndicat en importance chez les enseignants.
Les réformistes d’UID doivent faire face au début des années 1990 à des divisions internes
conduisant à la demande de démission du Nantais Yannick Simbron secrétaire général de la FEN, au
passage dans l’opposition du SNET-AA regroupant des enseignants de lycée professionnel (dû au
départ à un impair de Yannick Simbron), et aux actions propres (en opposition au projet de la FEN)
des syndicats nationaux dirigés par des militants UA ainsi que par la trentaine de sections
départementales du SNI-PEGC tenues par les adhérents de ce même courant ou par L’École
émancipée. Les objectifs de la FEN sont très proches des projets du SNI-PEGC (dans de multiples
domaines) mais très largement en contradiction avec ceux du SNES, SNEP et SNCS.
L’idée de réunir tous les enseignants de la maternelle au lycée dans un même syndicat n’est pas
approuvée par tous les dirigeants des syndicats en opposition avec UID. Ceci alors que l’École
émancipée réclamait une organisation du type "fédération d’industrie" regroupant l’ensemble des
personnels de l’Éducation nationale, une organisation du syndicalisme telle qu’elle fut maintenue au
sein de la FSU ne pouvait être perçue comme totalement opposée à cette perspective.
La communication en interne et dans les médias est habilement maîtrisée par les adversaires de la
majorité. Cette dernière agit avec une certaine maladresse alors que sur le fond elle est dans son

droit de vouloir que la FEN cesse d’être un cartel de syndicats aux mots d’ordre contradictoires et
revendications corporatives pour tendre vers une dynamique revendicative fédérale. Notons que dès
1981 le SNES refuse de faire connaître son fichier d’adhérents à la FEN afin de couper toute
information directe de ses adhérents par la direction de la fédération syndicale à laquelle le SNES
appartient.
Le SE-FEN naît fin 1992 en entraînant derrière lui nombre de militants du SNI-PEGC mais certains
instituteurs, au lieu de saluer l’avancée qui fera d’eux des professeurs des écoles, se sentent frustrés
face aux conditions de passage dans ce nouveau corps. Les critiques de ces dernières par les
minoritaires du SNI-PEGC peuvent expliquer en partie que le SNUIPP soit devenu en 1996 plus
représentatif que le SE. À sa naissance, ce dernier compte très peu d’anciens adhérents de la FEN
dans l’enseignement secondaire. En effet des militants, pourtant opposés à leur direction UA du
SNES, comme Louis Astre sont attachés à leur syndicat et préfèrent ne pas rejoindre le SE-UNSA. La
FSU maintient l’organisation en tendances et garde une partie des instituteurs affiliés à la FEN ainsi
que la plupart de syndiqués au SNES, SNEP et SNETAA. Les dirigeants de ce dernier syndicat quittent
pourtant la FSU en 2002 et rejoignent FO en 2010. Petit à petit, devenu SE-UNSA, le syndicat des
enseignants accroît ses adhérents en collège, lycée et lycée professionnel et maintient une position
conséquente en primaire. Il espère beaucoup, en son trentième anniversaire, des résultats des
élections professionnelles de fin 2022.
Du SNI au SE-UNSA: 100 ans d’engagements pour l’École publique. Nicolas Anoto et Benoît Kermoal.
SUDEL, 2022. 304 pages.
ALAIN CHIRON
1
/
4
100%