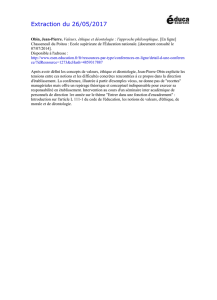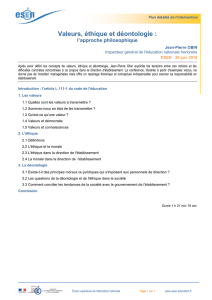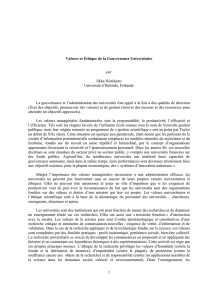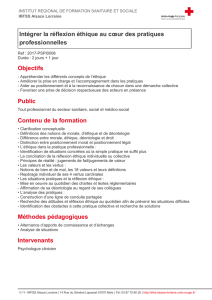Éthique, Déontologie et Communication : Cours Universitaire
Telechargé par
franckemmanuelkouablan794

1
Enseignant-chercheur, Université Félix Houphouët-Boigny, Cocody Abidjan
Éthique, déontologie et communication
SOMMAIRE
Introduction 3
I – Approche définitionnelle du champ éthique 5
1 - Éthique
2 - Morale
3 - Déontologie
4 - Droit
II – L’éthique de la communication 7
1 – Définition et origine 7
2 – Le statut ambigu de l’éthique de la communication 9
3 – Contraindre, réguler et responsabiliser : aspects de la déontologie 10
III - Problèmes d’éthique et de déontologie dans certains médias 15
1 – Cas des TIC 15
2 – La communication publicitaire 22
3 – Droits et devoirs du journaliste professionnel ivoirien 25
* * *
Bibliographie
MAIGRET Eric (sous le direction) Communication et médias, Les notices de la documentation française
Code de déontologie du journalisme professionnel en Côte d'Ivoire, OLPED.
L’OLPED, pionnier de l’autorégulation des médias en Afrique, Programme médias pour la démocratie en Afrique, avec l’appui
de la Commission de l’union européenne
KOUA Saffo Mathieu, Environnement juridique des médias en Côte d'Ivoire, Cours, Université Félix Houphouët-Boigny, 2014
VIRET Emile, Ethique de l’information : enjeux et problèmes, Master2 pro AIGEME, Université Paris 3, Cours D9CTO
* * *

2
Enseignant-chercheur, Université Félix Houphouët-Boigny, Cocody Abidjan
Morale, éthique, déontologie et droit sont toutes des règles de conduite quelque fois mal définis
ou même confondus. Notre objectif ici, consiste, d’une part, à démêler ces concepts en précisant
leurs acceptions intrinsèques ; et d’autre part, à les explorer dans leurs conjugaisons multiples
soit entre eux soit avec d’autres concepts connexes dans le processus communicationnel.
L’objectif de ce cours est d’abord, de permettre à l’étudiant de comprendre que les textes de
droit ne peuvent suffire à eux seuls à réguler les activités professionnelles ou plus généralement
la société des Hommes.
En effet, le droit comporte des lacunes qui ont besoin d’être compensées par d’autres règles de
conduites, telles l’éthique et la déontologie.
Ainsi, le droit ne peut
- ni tout prévoir : ceci est particulièrement vrai pour Internet
- ni légiférer dans tous les domaines (la morale par exemple).
De surcroit, le droit ne peut éviter de donner matière à interprétation, et par là, rester ouverte
à toutes formes de détournements. Par exemple, Le Droit des médias, pas plus que le Droit en
général, n’est neutre : un certain de nombre de questions relèvent de choix politiques.
1
En définitive, le Droit s’avère n’être qu’un élément parmi tant d’autres règles (la déontologie,
les chartes professionnelles, l’éthique, etc.), de situations de fait (les rapports de forces, la
violence, etc.) et d’influences culturelles, politiques et économiques (la culture, les pressions en
tout genre). Ne parler que de droit peut aussi donner l’impression qu’il y a des règles fixes,
valables partout et pour tous.
Ensuite, à l’issue de ce cours, l’étudiant doit être à mesure de maitriser les principes d’éthique
et de déontologie ainsi que les concepts connexes que sont la morale et le droit entre autres,
dans leurs aspects théoriques ainsi que dans leur traduction sur le terrain : comment le
problème d’éthique et de déontologie se posent dans les médias en général (médias
traditionnels et TIC), mais aussi la diversité des solutions présentées dans différentes situations
et dans certains pays.
_____________
1
Par exemple le choix entre ces deux formes de régulation que sont : d’une part, un ordre des journalistes où interviennent des
personnes extérieures à la profession (Conseil National de la Communication Audiovisuelle, par exemple) , d’autre part, un
organe composé quasi exclusivement de journalistes (Observatoire de la Liberté de la Presse, de l’Éthique et de la Déontologie).
Ce n’est pas une alternative purement technique basée sur la solution la plus efficace. Le choix dépend aussi des rapports de
forces entre les journalistes, qui souhaitent rester indépendants, et d’autres pouvoirs tentés d’intervenir pour contrôler la presse.
Autres exemples de rapports de forces : l’existence de sociétés de rédacteurs dans les rédactions ou la reconnaissance d’une «
clause de conscience » qui sont des conquêtes de la profession.

3
Enseignant-chercheur, Université Félix Houphouët-Boigny, Cocody Abidjan
Introduction
L’importance des médias dans les sociétés modernes est telle que, dans beaucoup de
domaines, ils s’imposent aux citoyens et aux consommateurs dans leurs processus de
décision. Ainsi pour ses achats, le consommateur a besoin d’information pour une
meilleure décision ; tout autant en politique, les citoyens se doivent de disposer d’un
certain nombre d’informations sur les candidats pour faire les choix les plus
intelligents. Sur les marchés économiques et financiers, les consommateurs et les
investisseurs demandent des informations avant de choisir des produits ou des titres.
La disponibilité de l’information se révèle être ainsi un déterminant crucial dans
l’efficience des marchés économiques et politiques. Dans la plupart des pays, les
consommateurs et les citoyens se procurent les informations dont ils ont besoin à
travers les médias.
Ils se posent dès lors quelques questions fondamentales : est-il souhaitable que les
médias soient publics ou privés ? Devraient-ils jouir d’un monopole ou se faire
concurrence ? Quelle morale professionnelle devrait guider leur action quotidienne ?
Quel encadrement juridique doivent-ils jouir pour mieux jouer leur rôle de pilier de la
démocratie ? Etc.
À la lueur de ces questionnements, il s’avère qu’un encadrement s’impose. Mais à
l’évidence le droit seul ne peut suffire à cela.
Ainsi, dans leur travail quotidien, les journalistes sont tenus aux respects d’autres
règles, d’autres principes : la déontologie et l’éthique. Le journaliste est en effet
quotidiennement confronté à des choix qu’il est impossible de trancher par des textes
de lois (faut-il donner telle information qui concerne la vie privée d’autrui ? Faut-il
traiter ou taire certains sujets ? Peut-on publier telle ou telle photo ? …). En principe,
le journaliste doit vivre dans cette incertitude. Son métier relève de ce que l’on
appellerait « l’éthique de la responsabilité » : agir continuellement dans l’ambigüité et
dans le doute, où la conscience et l’éthique constituent les derniers points de repère.
Communiquer est l’une des plus belles activités qui soit : c’est aider ses contemporains
à connaître et à comprendre le monde qui les entoure, exercer sa liberté d’expression
et aider tout un chacun à formuler en toute liberté leurs jugements. Activité d’autant
plus belle qu’elle est indissociable d’une certaine forme de responsabilité pour celui
qui l’exerce : on ne communique pas n’importe comment, les formes qu’il faut
respecter sont partie intégrante de l’activité de communication. C’est ainsi que
l’activité du journaliste est traditionnellement dotée de règles de conduite (éthique,
déontologie, droit…) qui permettent, dans leur rigueur, la fiabilité dans la restitution
de l’information.

4
Enseignant-chercheur, Université Félix Houphouët-Boigny, Cocody Abidjan
Ainsi, les principales règles déontologiques que les journalistes s’imposent ou
devraient s’imposer, partent d’abord de cette exigence : ‘’ne pas dénaturer
l’information, ne rien affirmer qui n’ait été recoupé, vérifié, ne pas confondre les faits
et leur interprétation, ne pas soumettre leur liberté d’expression à quelque pression
que ce soit, politique, économique ou religieuse, ne pas manipuler la réalité’’.
Même si les nouveaux médias posent, en des termes apparemment différents, les
mêmes problèmes, l’information qui circule de plus en plus vite réclame les mêmes
garanties, alors même qu’elles ne disposent plus des règles qui encadraient les anciens
supports. Comment faire pour éviter les embardées, même involontaires ?
Les notions d’éthique et de déontologie cohabitent avec ces autres que sont la morale
et le droit. Elles participent toutes des règles de conduite en société mais ne recouvrent
pas la même réalité. En pratique, pour certaines, elles tissent des relations entre elles
pour mieux encadrer le domaine de la communication.
Le plan de ce cours est constitué de trois parties articulées comme suit : d’abord une
introduction aux notions d’éthique et de déontologie élargie à celles connexes que
sont la morale et le droit en tant que règles de conduite.
Ensuite, dans une seconde phase, nous abordons l’éthique de la communication.
Pour terminer, nous évoquerons les problèmes d’éthique et de déontologie dans
certains médias.
* * *

5
Enseignant-chercheur, Université Félix Houphouët-Boigny, Cocody Abidjan
I – CHAMP DEFINITIONNEL
11 - L’ETHIQUE
✓ Étymologie : du grec ethikos, moral, de ethos, mœurs. Le mot « éthique »
signifie science de la morale et des mœurs, art de diriger sa conduite. C'est une
discipline philosophique qui réfléchit sur les finalités, sur les valeurs de
l'existence, sur les conditions d'une vie heureuse, sur la notion de "bien" ou sur
des questions de mœurs ou de morale.
✓ L'éthique peut également être définie comme une réflexion sur les
comportements à adopter pour rendre le monde humainement habitable. En
cela, l'éthique est une recherche d'idéal de société et de conduite de l'existence.
✓ Dans une troisième approche, l'éthique correspondrait à une appréciation ou
application des concepts de bien et du mal dans des conditions ou situations
données. Autrement dit, l'éthique ne serait que l'application de certains
principes moraux en un temps et dans des circonstances données.
L’éthique invite le professionnel à réfléchir sur les valeurs qui motivent son action et à
choisir, sur cette base, la conduite la plus appropriée.
Ainsi l’éthique fait appel à des valeurs, à la conscience que peut avoir chacun de ce qui
est noble ou infâme, bien ou mal, à faire ou ne pas faire. Relevant de la conscience, elle
échappe (en principe) à toute sanction. Chacun se sentira fautif ou pas selon ses
convictions morales, philosophiques ou religieuses, par exemple. Cette référence à des
valeurs pose deux problèmes : l’universalité et l’unicité.
12 - MORALE
Elle est l'ensemble des valeurs supérieures qui conduisent chacun à différencier le bien
du mal et qui fondent les conduites humaines (tout au moins pour les individus
conscients de leurs devoirs et responsables de leurs actes).
La morale est immanente au comportement humain (= fait partie de la nature
humaine), contrairement à la déontologie, fruit d'une réflexion professionnelle.
La morale trouve son fondement dans la culture (coutumes et traditions), et dans les
textes considérés comme sacrés (Bible, Coran, etc.). À la différence du droit, les règles
de morale ne sont pas toutes codifiées ; elles servent de gisement dans l’élaboration
de la règle de droit.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
1
/
34
100%