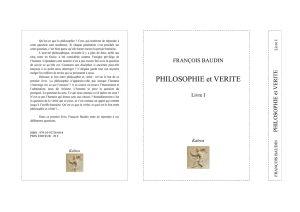Extrait PDF

Jean Leroux
Une histoire comparée de la
philosophie des sciences
Aux sources du Cercle de Vienne
Volume I
Jean Leroux
Une histoire comparée de la philosophie des sciences
Volume I • Aux sources du Cercle de Vienne
Une histoire comparée
de la philosophie des sciences
Volume I
Aux sources du Cercle de Vienne
Ce traité d’épistémologie comparée offre une étude des développements les
plus marquants qui ont précédé et qui ont suivi l’émergence du Cercle de
Vienne.
Le premier volume présente la tradition des « savants-philosophes ». Vers la
seconde moitié du x x e siècle s’amorce une profonde réexion épistémologi
que chez des scientiques de pointe tels Hermann von Helmholtz, Heinrich
Hertz, Ernst Mach, Ludwig Boltzmann et, du côté des Français, Pierre Duhem
et Henri Poincaré. L’avènement de la « nouvelle logique » et, surtout, l’essor
des investigations axiomatiques formelles promulguées par David Hilbert
menèrent le Cercle de Vienne à prendre fait et cause pour l’autonomie de la
méthode logique par rapport aux approches antérieures qui avaient partie liée
avec la méthode historique ou encore le psychologisme.
Le second volume scrute le volet sémantique de la conception empiriste logi-
que venue à maturité aux mains de Rudolf Carnap et de Carl Hempel dans les
années 1948-1958. Suit alors une étude comparative critique des conceptions
les plus connues qui se sont développées en réaction à l’empirisme logique
ou en retrait de ce dernier : celles, dès les années 1930, de Karl Popper et de
Gaston Bachelard ; puis, au début des années 1960, celles de Thomas Kuhn,
d’Imre Lakatos et de Paul Feyerabend. La principale critique que l’auteur
adresse à l’empirisme logique ne provient cependant pas de ces sources ; elle
porte plutôt sur l’incapacité, chez les tenants de l’approche logique, à élaborer
le constructivisme mathématique que leur projet nécessitait.
Ce travail sur la philosophie des sciences comparée n’a pas d’équivalent dans
le monde francophone et ailleurs.
Jean Leroux est professeur de logique et de philosophie des sciences à l’Université
d’Ottawa. Il a notamment publié La sémantique des théories physiques (Les Presses de
l’Université d’Ottawa, 1988) et Introduction à la logique (Diderot éditeur, 1998). Ses
récents travaux de recherche portent sur l’histoire de la philosophie des sciences.
Illustration de la couverture :
Kazimir Malévitch, Suprématisme dynamique no 57, 1916
Museum Ludwig, Cologne
Jean Leroux
Une histoire
comparée de
la philosophie
des sciences
Aux sources
du Cercle de Vienne
Volume I
PUL
PUL
www.pulaval.com
ISBN 978-2-7637-8788-6

COLLECTION
Cette collection accueillera des ouvrages consacrés à la logique et
à la philosophie des sciences entendues dans leur sens formel. La
logique de la science, un titre emprunté au philosophe américain
C.S. Peirce, rend compte de la logique interne du savoir qui peut se
décliner en plusieurs versions et il est légitime de parler de logiques au
pluriel comme on parle de sciences au pluriel. L’éventail des recherches
pourra s’ouvrir pour inviter des analyses portant sur l’intersection et
l’héritage commun des traditions philosophiques et scientifiques.
Enfin, les travaux d’épistémologie générale ou historique dans les
sciences sociales et humaines ne sauraient être exclus dans cet esprit
d’ouverture qui doit caractériser l’idée d’une logique interne du
discours scientifique. Si le principe de tolérance invoqué par le logicien
et philosophe des sciences R. Carnap doit présider à une telle entre-
prise, c’est pour mieux assurer le rôle de la philosophie comme vigile
du savoir.
Le symbole utilisé pour représenter la collection signifie la
quantification « effinie » ou illimitée de la logique arithmétique et il
est tiré de l’idéogramme pour « wang », roi en langue chinoise.
Yvon Gauthier

Volume I
AUX SOURCES DU CERCLE
DE VIENNE
UNE HISTOIRE COMPARÉE
DE LA PHILOSOPHIE
DES SCIENCES


Volume I
AUX SOURCES DU CERCLE
DE VIENNE
UNE HISTOIRE COMPARÉE
DE LA
PHILOSOPHIE
DES SCIENCES
Jean LEROUX
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
1
/
35
100%