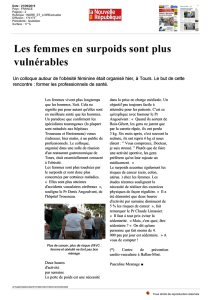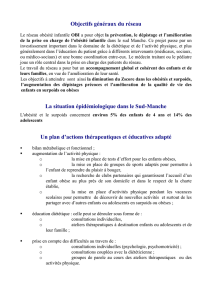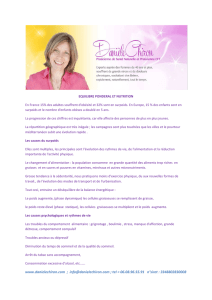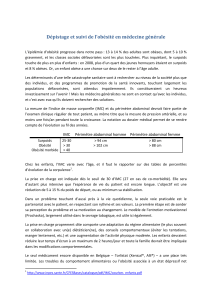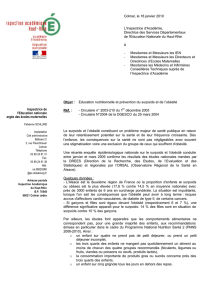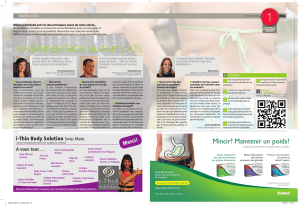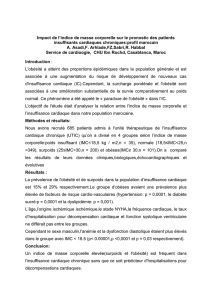Coût de l'obésité en France : Analyse économique et impact
Telechargé par
bruno.detournay

Le
coût
de
l'obésité
en
France
Bruno
Detournay
Cemka,
43,
boulevard
du
Maréchal-Joffre,
92340
Bourg-la-Reine,
France
Mots
clés
Surpoids
Obésité
France
Coûts
et
analyse
des
coûts
Résumé
Contexte
>
Le
surpoids
et
l'obésité
constituent
des
pathologies
aux
conséquences
graves
sur
un
plan
de
la
santé
publique,
mais
également
au
plan
économique.
Elles
concernent
aujourd'hui
la
quasi-totalité
de
la
planète.
Objectif
>
Établir
le
fardeau
économique
de
l'obésité
et
du
surpoids
en
France.
Méthode
>
Une
revue
de
la
littérature
a
identifié
deux
études
majeures
dans
ce
domaine.
Résultats
>
Les
deux
études
décrites,
bien
qu'ayant
un
périmètre
et
une
approche
méthodologique
qui
diffèrent,
situent
le
coût
social
de
la
surcharge
pondérale
à
un
niveau
comparable
à
celui
de
l'alcool
ou
du
tabac
en
France.
L'impact
estimé
par
l'OCDE
représente
5
%
de
l'ensemble
des
dépenses
de
santé,
8,4
%
dans
l'étude
du
Trésor
Public
français.
Plus
globalement,
c'est
environ
3
%
du
PIB
qui
serait
perdu
chaque
année
en
France
du
fait
de
ces
maladies.
Conclusion
>
L'impact
économique
négatif
du
surpoids
et
de
l'obésité
en
France
est
considérable,
même
s'il
se
situe
à
un
niveau
inférieur
à
d'autres
pays
de
l'OCDE.
Dans
le
même
temps,
toute
politique
active
dans
ce
domaine
suppose
un
changement
de
modèle
économique
pour
les
acteurs
qui
en
bénéficient
aujourd'hui.
Keywords
Overweight
Obesity
France
Costs
and
cost
analysis
Summary
The
cost
of
obesity
in
France
Background
>
Overweight
and
obesity
are
pathologies
with
serious
public
health
and
economic
consequences.
They
now
affect
all
countries
in
the
world.
Objective
>
To
establish
the
economic
burden
of
obesity
and
overweight
in
France.
Methodology
>
A
review
of
the
literature
identified
two
major
studies
in
this
field.
Results
>
The
two
studies
presented,
although
different
in
scope
and
methodological
approaches,
place
the
social
cost
of
overweight
at
a
level
comparable
to
that
of
alcohol
or
tobacco
in
France.
The
impact
as
estimated
by
the
OECD
represents
5%
of
total
health
expenditure,
8.4%
in
the
French
Treasury
study.
More
generally,
approximately
3%
of
GDP
would
be
lost
each
year
in
France
because
of
these
pathologies.
Conclusion
>
The
negative
economic
impact
of
overweight
and
obesity
in
France
is
considerable
even
if
it
is
at
a
lower
level
than
in
other
OECD
countries.
At
the
same
time,
any
active
policy
in
this
area
implies
a
change
of
economic
model
for
the
actors
who
currently
benefit
from
it.
Disponible
sur
internet
le
:
27
mars
2021
tome
15
>
n84
>
juin
2021
10.1016/j.mmm.2021.03.002
©
2021
Elsevier
Masson
SAS.
Tous
droits
réservés.
413 Le point sur
Med
Mal
Metab
2021;
15:
413–417
en
ligne
sur
/
on
line
on
www.em-consulte.com/revue/mmm
www.sciencedirect.com
EPID
EMIOLOGIE,
CO
^
UTS
ET
ORGANISATION
DES
SOINS

Contexte
Les
conséquences
du
surpoids
et
de
l'obésité
sur
la
santé
des
populations
sont
relativement
bien
établies
en
termes
de
mor-
bidité
et
de
mortalité.
L'obésité
est
l'un
des
principaux
facteurs
de
risque
contribuant
à
la
charge
des
maladies
non
transmissi-
bles
(MNT),
augmentant
le
risque
de
développer
des
maladies
endocriniennes,
des
maladies
cardiovasculaires,
les
troubles
musculosquelettiques,
différents
types
de
cancer,
ou
encore
la
dépression.
En
outre,
on
estime
qu'au
moins
2,8
millions
de
personnes
meurent
chaque
année
dans
le
monde
du
fait
de
leur
surcharge
pondérale
[1].
La
prévalence
élevée
de
la
maladie,
et
plus
encore
son
évolution
dans
le
temps,
sont
particulièrement
préoccupantes.
En
2016,
plus
d'un
adulte
sur
trois
(35,1
%)
dans
les
pays
de
l'Organisa-
tion
de
coopération
et
de
développement
économiques
(OCDE)
était
considéré
en
surpoids
(indice
de
masse
corporelle
[IMC]
25
kg/m
2
)
et
plus
d'un
adulte
sur
cinq
(23,2
%)
obèse
(IMC
30
kg/m
2
)
[2].
Chez
les
enfants
âgés
de
5
à
19
ans,
en
2016,
le
taux
moyen
de
surpoids
et
d'obésité
était
de
18,7
%
et
9,9
%,
respectivement
dans
les
pays
de
l'OCDE
[2].
Entre
1996
et
2016,
la
prévalence
du
surpoids
a
augmenté
de
18,6
%
dans
les
pays
de
l'OCDE
et
de
17,5
%
dans
l'Union
européenne
des
Vingt-Huit
(UE28).
Au
cours
de
cette
même
période,
la
prévalence
de
l'obésité
a
augmenté
de
50,4
%
dans
les
pays
de
l'OCDE
et
de
46,7
%
dans
l'UE28
[2].
En
France,
les
dernières
données
disponibles
sont
plus
rassu-
rantes.
La
corpulence
moyenne
de
la
population
adulte
n'a
pas
connu
d'évolution
statistiquement
significative
ces
dix
dernières
années,
l'IMC
moyen
mesuré
dans
l'étude
de
santé
sur
l'envi-
ronnement,
la
biosurveillance,
l'activité
physique
et
la
nutrition
(Esteban)-2015
étant
comparable
à
celui
mesuré
dans
l'étude
nationale
nutrition
santé
(ENNS)-2006
[3].
La
prévalence
du
surpoids
(tous
sexes
confondus
et
obésité
incluse)
est
restée
stable.
Elle
était
de
49,3
%
[IC95
%]
:
46,4–52,1]
en
2006
versus
49,0
%
[IC
95
%
:
46,4–51,6]
en
2015.
Il
en
est
de
même
de
la
prévalence
de
l'obésité,
qui
n'a
pas
connu
d'évolution
signifi-
cative
entre
les
deux
études
(16,9
%
[IC95
%
:
14,9–19,0]
en
2006
versus
17,2
%
[IC95
%
:
15,2–19,3]
10
ans
plus
tard).
Pour
autant,
près
de
la
moitié
des
adultes
de
18
à
74
ans
(49,0
%
[IC95
%
:
46,4–51,6])
étaient
en
surpoids
ou
obèses
en
2015
(53,9
%
[IC95
%
:
50,0–57,8]
des
hommes
et
44,2
%
[IC95
%
:
40,7–47,8]
des
femmes,
tous
âges
confondus).
La
proportion
d'adultes
obèses
était
identique
chez
les
hommes
(16,8
%
[IC95
%
:
14,2–20,0])
et
chez
les
femmes
(17,4
%
[IC95
%
:
14,8–20,4]).
Plus
récemment,
la
prévalence
du
surpoids
a
été
estimée
à
41,0
%
chez
les
hommes
et
de
25,3
%
chez
les
femmes,
et
celle
de
l'obésité
à
15,8
%
pour
les
hommes
et
de
15,6
%
pour
les
femmes
entre
30
et
69
ans
(et
relevant
du
régime
général
de
l'assurance
maladie)
[4].
Un
modèle
de
projection
de
l'Institut
national
de
la
statistique
et
des
études
économiques
(INSEE)
estime
qu'en
2030,
parmi
les
plus
de
15
ans,
23
%
des
Français
seront
obèses
et
36
%
en
surpoids
[5].
Chez
les
enfants,
la
prévalence
du
surpoids
(obésité
incluse)
n'a
pas
évolué
significativement
depuis
10
ans,
tant
chez
les
gar-
çons
que
chez
les
filles.
Elle
est
restée
stable,
passant
de
17,6
%
[IC95
%
:
15,0–20,5]
en
2006
à
16,9
%
[IC95
%
:
14,0–20,3]
en
2015.
La
prévalence
de
l'obésité
était
respectivement
de
3,3
%
[IC95
%
:
2,2–4,8]
en
2006
et
de
3,9
%
[IC95
%
:
2,5–6,0]
en
2015
[3].
En
France,
le
Plan
national
de
santé
publique
prioritÉ
Prévention
situe
l'évolution
du
taux
de
surpoids
chez
les
5–6
ans
entre
2006
et
2013
de
12,4
%
(dont
3,2
%
d'obésité)
à
11,9
%
(dont
3,5
%
d'obésité),
et
chez
les
10–11
ans
de
18,9
%
(dont
4
%
d'obésité)
à
18,1
%
(dont
3,6
%
d'obésité)
[6].
Une
récente
étude
menée
par
la
Direction
de
la
recherche,
des
études,
de
l'évaluation
et
des
statistiques
(DREES)
relève
que
la
part
des
adolescents
obèses
est
passée
de
3,8
%
en
2009
à
5
%
en
2017,
et
celle
des
adolescents
en
surpoids
est
restée
stable
à
13,2
%
sur
la
période
[7].
Surpoids
et
obésité
constituent
des
pathologies
aux
conséquen-
ces
graves
sur
un
plan
de
santé
publique,
résultant
d'un
dés-
équilibre
chronique
entre
les
apports
et
les
dépenses
énergétiques.
Si
les
prédispositions
génétiques
favorisent
clai-
rement
leur
apparition,
de
nombreux
facteurs
contribuent
à
cette
dernière.
Les
habitudes
alimentaires
et
la
sédentarité
jouent
un
rôle
majeur.
L'augmentation
de
la
taille
des
portions,
la
plus
grande
densité
énergétique
des
aliments,
l'alimentation
industrielle
en
excès
et
la
facilité
d'accès
à
cette
dernière,
l'évolution
des
prix
alimentaires,
ou
encore
un
faible
niveau
socio-économique,
sont
des
éléments
qui
favorisent,
dans
les
pays
développés,
les
consommations
caloriques
excessives.
L'obésité
peut
résulter
de
causes
métaboliques
ou
de
troubles
du
comportement
alimentaire.
D'autres
facteurs,
comme
le
Les
points
essentiels
Le
surpoids
et
l'obésité
constituent
des
pathologies
aux
conséquences
graves
sur
le
plan
de
la
santé
publique.
Pour
autant,
la
France
semble
être
dans
une
situation
plus
favorable
que
la
plupart
des
pays
de
l'OCDE.
Prévention
et
traitement
de
la
surcharge
pondérale
s'inscrivent
dans
le
cadre
d'une
politique
active
qui
déborde
largement
le
champ
du
sanitaire
et
a
de
fortes
implications
sur
l'économie
générale.
Les
études
de
référence
dans
ce
domaine
estiment
qu'obésité
et
surpoids
sont
à
l'origine,
en
France
chaque
année,
d'au
moins
5
%
des
dépenses
de
santé,
ainsi
que
d'une
perte
d'un
peu
moins
de
3
%
du
Produit
Intérieur
Brut
(PIB).
Toutefois,
ces
maladies
constituent
un
marché
considérable
pour
certains
acteurs
économiques
qui
devront
donc
changer
de
modèle
en
contrepartie
du
bénéfice
médical,
social
et
économique,
attendu
d'une
politique
de
santé
publique
active
dans
ce
domaine.
B.
Detournay
tome
15
>
n84
>
juin
2021
414 Le point sur

stress,
certains
médicaments,
des
virus,
la
composition
du
microbiote
intestinal,
voire
des
expositions
et
des
événements
précoces
au
cours
de
la
vie,
voire
avant
la
naissance,
ont
été
identifiés
comme
des
facteurs
de
risque.
Enfin,
l'environne-
ment,
au-delà
de
l'alimentation
et
de
l'activité
physique,
semble
jouer
un
rôle.
Une
part
importante
de
ces
facteurs
peuvent
être
prévenus
au
niveau
individuel
comme
collectif.
Une
prévention
qui
doit
s'inscrire
dans
le
cadre
d'une
politique
active
qui
déborde
lar-
gement
le
champ
du
sanitaire
et
a
de
fortes
implications
sur
l'économie
générale
[8].
La
justification
collective
d'une
telle
politique
suppose
une
évaluation
des
coûts
induits
par
la
maladie
elle-même,
ses
complications,
et
ses
conséquences
sociales
ou
économiques.
L'objectif
de
cet
article
est
d'établir
un
état
des
lieux
du
fardeau
économique
de
l'obésité
et
du
surpoids
en
France.
Le
coût
de
l'obésité
et
du
surpoids
De
nombreuses
études
existent
dans
la
littérature
sur
le
thème
du
coût
de
l'obésité.
Elles
se
caractérisent
par
la
diversité
des
sujets
abordés
et
des
populations
considérées,
comme
des
approches
proposées
(études
de
coût
de
la
maladie,
études
coût-efficacité,
coût-utilité,
coût-bénéfice).
Au
sein
de
cette
littérature,
le
travail
conduit
par
l'OCDE
en
2019
visant
à
construire
un
argumentaire
économique
en
faveur
des
politiques
de
prévention
du
surpoids
et
de
l'obésité
se
distingue
par
son
ampleur,
son
caractère
systématique,
et
son
adaptation
à
la
situation
des
pays
développés
[2].
En
France,
l'étude
la
plus
aboutie
est
sans
doute
celle
conduite
en
2016
par
la
Direction
générale
du
Trésor
[4].
L'étude
du
Trésor
en
France
L'étude
du
Trésor
s'appuie
principalement
sur
une
analyse
comparative
observationnelle
des
dépenses
de
santé
des
per-
sonnes
en
fonction
de
leur
IMC
conduite
à
partir
de
l'Enquête
santé
et
protection
sociale
(ESPS)
[9].
La
comparaison
ajustée
sur
l'âge,
le
sexe,
la
consommation
d'alcool
et
de
tabac,
le
niveau
de
revenu
et
la
couverture
sociale
des
dépenses
de
santé,
entre
les
personnes
en
surpoids
ou
obèses
par
rapport
aux
personnes
de
poids
normal,
permet
de
calculer
le
surcoût
en
termes
de
dépenses
de
santé
liées
à
l'obésité.
Il
était
en
2012
de
330
s
par
an
pour
les
personnes
en
surpoids,
et
de
785
s
pour
les
personnes
obèses.
Ce
surcoût
correspond
à
la
dépense
totale
de
santé,
incluant
la
part
payée
par
les
individus,
leur
complé-
mentaire
santé
et
l'assurance
maladie.
Les
auteurs
de
ce
travail
ajoutent
à
ce
montant
différentes
composantes
à
savoir
:
une
estimation
des
dépenses
de
prévention
;
les
recettes
des
taxes
nutritionnelles
;
le
montant
des
retraites
non
versées
à
la
suite
des
décès
prématurés
liés
au
surpoids
et
à
l'obésité
;
les
coûts
indirects
correspondant
aux
pertes
de
productivité
du
fait
de
l'absentéisme
plus
important
des
personnes
obèses,
mais
aussi
de
l'exclusion
d'une
partie
de
la
population
obèse
du
marché
du
travail
chez
les
femmes
;
l'effet
sur
les
dépenses
publiques
est
majoré
d'un
coefficient
reflétant
le
coût
d'opportunité
pour
l'économie
des
prélève-
ments
obligatoires.
Les
auteurs
estiment
ainsi
à
20,4
milliards
d'euros
(Mds),
en
2012,
le
coût
du
surpoids
(7,7
Mds)
et
de
l'obésité
(12,8
Mds),
pour
l'ensemble
de
la
population
en
surpoids
ou
obèse.
Ces
résultats
peuvent
être
discutés.
D'une
part,
ils
prennent
en
compte
une
prévalence
de
l'obésité
sous-estimée
par
rapport
aux
dernières
données
disponibles
(9,8
millions
de
personnes
obèses),
d'autre
part,
ils
intègrent
à
tort
les
montants
d'indem-
nités
journalières
et
de
pensions
d'invalidité
(soit
2,2
Mds
pour
le
surpoids,
et
autant
pour
l'obésité)
qui
étant
des
flux
entre
agents
économiques
n'ont
pas
à
être
intégrés
dans
un
calcul
visant
à
estimer
un
coût
sociétal.
L'estimation
des
retraites
économisées
est
basée
sur
les
années
de
vie
perdues
par
les
personnes
obèses,
et
non
sur
les
années
de
vie
perdues
par
les
personnes
obèses
du
fait
de
leur
obésité.
Enfin,
les
auteurs,
n'intègrent
pas
dans
leur
analyse
d'autres
conséquences
éco-
nomiques,
telles
que
les
pertes
de
productivité
liées
à
la
mor-
talité
prématurée
consécutive
au
surpoids
ou
à
l'obésité.
Pour
autant,
le
chiffrage
effectué
permet
de
situer
le
coût
social
de
la
surcharge
pondérale
à
un
niveau
comparable
à
celui
de
l'alcool
ou
du
tabac
en
France,
et
d'affirmer
que
la
lutte
contre
le
surpoids
et
l'obésité
pourrait
se
traduire
par
des
économies
collectives
considérables.
L'étude
de
l'OCDE
C'est
également
la
conclusion
du
travail
conduit
par
l'OCDE.
Cette
étude
repose
sur
différents
modèles
épidémiologiques
et
éco-
nomiques
combinés
qui
permettent
d'estimer
le
fardeau
de
l'obésité
et
du
surpoids
pour
52
pays.
Un
premier
modèle
(OECD
Strategic
Public
Health
Planning
for
NCDs
[SPHeP-NCDs])
est
fondé
sur
les
caractéristiques
démographiques
des
pays
retenus
et
sur
des
équations
de
risque
de
survenue
de
différentes
pathologies
issues
de
l'étude
Global
Burden
of
Disease
(GBD)
conduite
par
un
Institut
indépendant
américain
(Institute
for
Health
Metrics
and
Evaluation)
[10].
Sur
la
base
de
ces
données,
chaque
individu
inclus
dans
le
modèle
de
microsimulation
a
un
certain
risque
annuel
de
développer
une
maladie,
ce
qui
permet
de
disposer
pour
chaque
année
d'une
représentation
transver-
sale
des
populations
selon
leur
état
de
santé,
mais
aussi
de
déterminer
l'espérance
de
vie
ou
d'autres
indicateurs,
tels
que
les
années
de
vie
corrigées
de
l'incapacité
(DALY)
[11].
Dans
un
pays
comme
la
France,
39,2
décès
prématurés
seraient
observés
en
moyenne
chaque
année
du
fait
d'une
surcharge
pondérale,
sur
la
période
2020-50
(60,8
décès
prématurés
pour
l'ensemble
des
pays
de
l'OCDE
et
72,7
décès
prématurés
pour
l'UE).
Ces
décès
correspondent
à
2585
années
de
vie
perdues
(respecti-
vement,
3291
et
3935
pour
l'OCDE
et
l'UE).
L'impact
sur
les
DALYs
est
encore
plus
important,
avec
3246
DALYs
perdus
pour
100
Le
coût
de
l'obésité
en
France
EPID
EMIOLOGIE,
CO
^
UTS
ET
ORGANISATION
DES
SOINS
tome
15
>
n84
>
juin
2021
415 Le point sur

000
habitants
chaque
année
en
France
(respectivement,
3908
et
4495
pour
l'OCDE
et
l'UE).
Au
niveau
de
l'OCDE,
ce
nombre
de
DALYs
perdu
représente
près
de
12
%
du
nombre
total
de
DALYS
perdues
pour
cause
de
maladie
dans
le
monde
chaque
année,
soit
un
impact
similaire
au
fardeau
cumulé
des
accidents
vasculaires
cérébraux
et
des
cardiopathies
ischémi-
ques
[12].
Tous
les
coûts
estimés
sont
établis
en
dollars
américains
(USD)
à
parité
de
pouvoir
d'achat,
afin
de
pouvoir
comparer
les
résul-
tats
entre
pays,
et
estimés
en
moyenne
annuelle
sur
la
période
2020–2050.
Les
coûts
des
soins
de
santé
pour
les
différentes
maladies
prises
en
compte
dans
le
modèle
sont
estimés
sur
la
base
d'un
coût
annuel
par
cas
extrapolé
à
partir
des
données
nationales
sur
les
dépenses
de
santé.
Un
facteur
supplémentaire
destiné
à
prendre
en
compte
la
multimorbidité
est
également
calculé
et
appliqué.
Les
pays
de
l'OCDE
dépensent,
en
moyenne,
209
USD
par
habitant
et
par
an
pour
traiter
les
problèmes
de
santé
liés
à
l'obésité
et
au
surpoids.
Ce
montant
s'élève
à
148
USD
pour
la
France,
contre
645
USD
aux
États-Unis
ou
411
USD
en
Alle-
magne.
Les
pays
de
l'OCDE
dépenseront
chaque
année
environ
425
MdUSD
pour
traiter
la
surcharge
pondérale
et
les
maladies
liées
(9,78
MdUSD
pour
la
France
seulement).
Ces
montants
correspondent
à
8,4
%
des
dépenses
de
santé
de
l'ensemble
des
pays
de
l'OCDE,
8
%
au
niveau
européen
et
5
%
pour
la
France.
À
cette
dépense,
les
auteurs
ajoutent
les
conséquences
écono-
miques
des
décès
prématurés
qui
sont
évaluées
en
utilisant
une
estimation
de
la
valeur
de
la
vie
statistique
établie
sur
la
base
d'une
étude
précédente
de
l'OCDE
[13]
fondée
sur
une
très
large
méta-analyse
des
études
de
«
préférences
collectives
annon-
cées
»
à
travers
le
monde.
Cette
étude
retient
une
valeur
de
3
Ms
en
2005
dont,
selon
le
Produit
intérieur
brut
(PIB)
par
tête,
avec
une
élasticité-revenu
fixée
à
0,8
ce
qui
est
conforme
aux
préconisations
françaises
en
la
matière
[14].
Selon
cette
appro-
che,
le
coût
social
du
surpoids
est
estimé
à
2554
USD
par
habitant
et
par
an
dans
les
pays
de
l'OCDE,
2189
USD
dans
les
pays
du
Groupe
des
vingt
(G20),
et
2763
USD
dans
les
pays
de
l'UE28.
Pour
la
France,
ce
coût
social
est
un
peu
plus
faible,
soit
1680
USD
par
habitant
et
par
an.
Le
modèle
général
de
coûts
de
l'OCDE
inclut
également
un
module
destiné
à
évaluer
les
liens
entre
l'état
de
la
maladie
et
le
risque
d'absentéisme,
de
présentéisme
(lorsque,
même
s'ils
sont
physiquement
présents
au
travail,
les
employés
ne
sont
pas
pleinement
productifs),
de
retraite
anticipée
et
d'emploi.
Les
risques
relatifs
liés
au
surpoids
et
à
l'obésité
ont
été
estimés
à
travers
l'exploitation
des
données
d'une
vaste
enquête
européenne,
l'enquête
«
Survey
of
Health,
Ageing
and
Retirement
in
Europe
»
(SHARE)
[15].
Les
changements
de
productivité
et
de
participation
au
marché
du
travail
ont
été
évalués
sur
la
base
d'une
approche
de
type
capital
humain,
en
utilisant
les
salaires
moyens
nationaux
pour
calculer
les
pertes
de
production
sur
le
marché
résultant
de
ces
effets
indirects.
En
moyenne,
les
pays
de
l'OCDE
perdront
863
USD
par
habitant
et
par
an
(785
USD
en
France)
sur
le
marché
du
travail
en
raison
de
la
surcharge
pondérale.
Le
présentéisme
a
le
plus
grand
impact
économique
sur
le
marché
du
travail,
et
représente
près
de
la
moitié
de
la
production
perdue.
La
prise
en
compte
simultanée
des
dépenses
de
santé
directe-
ment
attribuables
et
des
coûts
indirects
résultant
de
la
réduction
de
l'espérance
de
vie,
comme
des
effets
sur
le
marché
du
travail
dans
un
modèle
macro-économique
général,
permet
enfin
de
calculer
les
conséquences
de
l'obésité
et
du
surpoids
sur
l'éco-
nomie
générale
à
travers
l'effet
sur
le
Produit
Intérieur
Brut
(PIB),
mais
aussi
sur
le
niveau
de
taxation
général
des
pays.
En
moyenne,
dans
les
pays
de
l'OCDE
ou
dans
les
pays
euro-
péens,
le
PIB
sera
inférieur
de
3,3
%
chaque
année
en
raison
de
l'impact
de
la
surcharge
pondérale
(2,7
%
pour
la
France).
Il
est
important
de
noter
que
ces
résultats
ne
tiennent
pas
compte
du
fait
qu'une
augmentation
de
l'espérance
de
vie
due
à
l'absence
de
surpoids
peut
signifier
que
les
gens
travail-
leront
plus
longtemps
et
prendront
leur
retraite
plus
tard.
L'effet
est
alors
encore
plus
important
mais,
bien
entendu,
de
nom-
breux
autres
facteurs
interviennent
dans
les
décisions
en
matière
d'âge
de
la
retraite.
L'effet
sur
la
taxation
est
quant
à
lui
estimé
en
considérant
le
taux
de
taxation
nécessaire
pour
maintenir
fixe
le
ratio
entre
le
PIB
et
le
niveau
de
dette
général
des
pays.
En
moyenne,
dans
l'OCDE,
chaque
personne
sera
soumise
à
359
USD
par
an
de
taxes
supplémentaires
en
raison
du
surpoids
et
de
l'obésité
(400
USD
pour
la
France).
Discussion
Du
fait
de
son
ambition,
le
travail
de
l'OCDE
est,
de
loin,
le
plus
abouti
en
matière
d'estimation
des
conséquences
économiques
du
surpoids
et
de
l'obésité.
Pour
la
France,
la
perte
de
PIB
annuelle
moyenne
estimée
atteindrait
2,7
%,
ce
qui
est
considérable.
Cette
estimation
reste
conservatrice,
car
elle
ne
prend
pas
en
compte
de
multiples
autres
effets
de
la
surcharge
pondérale,
par
exemple
:
les
conséquences
directes
de
cette
dernière
sur
le
parcours
éducatif
des
enfants
obèses,
ou
encore
les
effets
sur
les
carrières
professionnelles.
Une
publication
récente
va
jusqu'à
estimer
l'impact
écologique
de
l'obésité
à
travers
le
surcroît
de
gaz
à
effets
de
serre
induits
par
une
demande
métabolique
plus
importante,
un
processus
de
production
alimentaire
augmenté,
ou
des
conséquences
d'un
poids
corporel
plus
élevé
sur
transport
automobile
et
aérien.
Les
auteurs
estiment
ainsi
que
l'obésité
serait
responsable
d'un
surcroît
de
20
%
d'émission
à
effets
de
serre,
et
représenterait
1,6
%
du
total
des
émissions
mondiales
de
gaz
à
effets
de
serre
[16].
Les
coûts
les
plus
évidents
à
considérer
quand
l'on
évoque
le
fardeau
économique
du
surpoids
et
de
l'obésité
sont
les
dépen-
ses
de
santé
induites.
Ces
dernières
résultent
des
traitements
directs
de
ces
maladies,
mais
surtout
de
la
prise
en
charge
de
B.
Detournay
tome
15
>
n84
>
juin
2021
416 Le point sur

leurs
complications
multiples.
Différentes
approches
sont
possi-
bles
pour
estimer
ces
dépenses.
L'impact
estimé
par
l'OCDE
représente
5
%
de
l'ensemble
des
dépenses
de
santé,
et
8,4
%
dans
l'étude
du
Trésor.
L'écart
entre
les
deux
estimations
est
naturellement
une
question
de
sources
et
de
méthodes.
Quoi
qu'il
en
soit,
les
deux
études
s'accordent
pour
estimer
que
l'impact
de
la
surcharge
pondérale
situe
cette
dernière
parmi
les
priorités
de
santé
au
regard
de
ses
conséquences
financières
directes
sur
notre
système
de
santé.
On
ne
peut
oublier
ici
que
le
surpoids
et
obésité
constituent
un
marché
considérable
à
travers
les
consommations
alimentaires
qui
contribuent
à
les
générer
ou,
inversement,
qui
sont
destinés
à
les
corriger,
mais
aussi
parce
que
les
populations
concernées
constituent
un
segment
de
consommateurs
à
besoins
particu-
liers
de
biens
et
services
dans
de
nombreux
domaines
(trans-
port,
textile,
etc.).
On
peut
penser
que
les
politiques
visant
à
améliorer
les
régimes
alimentaires
et
à
réduire
l'obésité
peuvent
imposer
des
investissements
aux
agriculteurs
et
aux
industriels
de
l'alimentation
et
des
boissons,
qu'il
s'agisse
de
recherche
sur
les
reformulations,
sur
les
conditionnements,
mais
peuvent
également
modifier
les
niveaux
de
rentabilité
actuels
observés
du
fait
de
coûts
de
production
augmentés,
de
modèles
commerciaux
plus
contraints,
voire
de
réduction
des
ventes.
Il
y
a
certainement
là
un
prix
à
payer
pour
certains
acteurs
de
l'économie
actuelle
en
contrepartie
du
bénéfice
collectif
médi-
cal,
social
et
économique,
résultant
d'une
démarche
de
santé
publique
active
contre
les
multiples
effets
néfastes
de
la
sur-
charge
pondérale.
Déclaration
de
liens
d'intérêts
:
l'auteur
déclare
ne
pas
avoir
de
liens
d'intérêts.
Références
[1]
Abdelaal
M,
le
Roux
CW,
Docherty
NG.
Morbidity
and
mortality
associated
with
obe-
sity.
Ann
Transl
Med
2017;5:161.
[2]
Organisation
de
coopération
et
de
dévelop-
pement
économiques
(OECD).
The
Heavy
Bur-
den
of
Obesity:
The
Economics
of
Prevention.
OECD
Health
Policy
Studies.
Paris:
OCDE
Pub-
lishing;
2019.
doi:
10.1787/67450d67-en.
[3]
Verot
C,
Torres
M,
Salanave
B,
Deschamps
V.
Corpulence
des
enfants
et
des
adultes
en
France
métropolitaine
en
2015.
Résultats
de
l'étude
Esteban
et
évolution
depuis
2006.
Bull
Epidemiol
Hebd
(BEH)
2017;13:234–41,
http://invs.santepubliquefrance.fr/beh/
2017/13/2017_13_1.html.
[4]
Matta
J,
Zins
M,
Feral-Pierssens
AL,
et
al.
Prévalence
du
surpoids,
de
l'obésité
et
des
facteurs
de
risque
cardio-métaboliques
dans
la
cohorte
Constances.
Bull
Epidemiol
Hebd
(BEH)
2016;35–36:640–6,
http://invs.
santepubliquefrance.fr/beh/2016/35-36/
2016_35-36_5.html.
[5]
Caby
D.
Obésité
:
quelles
conséquences
pour
l'économie
et
comment
les
limiter
?
Trésor-
Éco.
Paris:
Ministère
de
l'Économie
et
des
Finances,
Direction
générale
du
Trésor;
2016
[Lettre
n8
179:1-12]
https://www.
tresor.economie.gouv.fr/Articles/
90846524-d27e-4d18-a4fe-e871c146beba/
files/
1f8ca101-0cdb-4ccb-95ec-0a01434e1f34.
[6]
Ministère
des
Solidarités
et
de
la
Santé.
Prior-
ité
Prévention
2018–2019.
Plan
National
de
Santé
Publique.
Rester
en
bonne
santé
toute
sa
vie;
2018,
https://solidarites-sante.gouv.
fr/IMG/pdf/
plan_national_de_sante_publique__psnp.
pdf.
[7]
Guignon
N.
In:
Études
et
Résultats.
(Direction
de
la
recherche
des
études
e
l'évaluation
et
des
statistiques
-
DREES)
En
2017
des
adoles-
cents
plutôt
en
meilleure
santé
physique
mais
plus
souvent
en
surcharge
pondérale
Études
&
Résultats
2019,
1122.
Paris:
Drees;
2019p.
1–6.
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/
sites/default//files/er1122.pdf
[Mis
à
jour
le
21/12/2020].
[8]
Dériot
G.
Office
parlementaire
d'évaluation
des
politiques
de
santé.
La
prévention
et
la
prise
en
charge
de
l'obésité.
Rapport
de
l'OPEPS
n
o
8
(2005-2006)
de
M.
Gérard
DÉRIOT,
fait
au
nom
de
l'Office
parlemen-
taire
d'évaluation
des
politiques
de
santé,
déposé
le
5
octobre
2005.
Paris:
Sénat.
https://www.senat.fr/rap/r05-008/
r05-008.html.
[9]
Célant
N,
Guillaume
S,
Rochereau
T.
IRDES.
Enquête
sur
la
santé
et
la
protection
sociale
2012.
IRDES
Juin
2014;
rapport
n
o
556.
Paris:
Institut
de
recherche
et
documentation
en
économie
de
la
santé
(Irdes);
2014,
https://www.irdes.fr/recherche/2014/
rapport-556-enquete-sur-la-sante-et-la-
protection-sociale-2012.html.
[10]
GBD
2015
Risk
Factors
Collaborators.
Global,
regional,
and
national
comparative
risk
assessment
of
79
behavioural,
environmental
and
occupational,
and
metabolic
risks
or
clus-
ters
of
risks,
1990-2015:
a
systematic
analysis
for
the
Global
Burden
of
Disease
Study
2015.
Lancet
2016;388:1659–724.
doi:
10.1016/
S0140-6736(16)31679-8.
[11]
GBD
2019
Risk
Factors
Collaborators.
Global
burden
of
87
risk
factors
in
204
countries
and
territories,
1990-2019:
a
systematic
analysis
for
the
Global
Burden
of
Disease
Study
2019.
Lancet
2020;396:1223–49.
doi:
10.1016/
S0140-6736(20)30752-2.
[12]
2017
DALYs
GBD,
Collaborators
HALE.
Global,
regional,
and
national
disability-adjusted
life-
years
(DALYs)
for
359
diseases
and
injuries
and
healthy
life
expectancy
(HALE)
for
195
countries
and
territories,
1990–2017:
a
systematic
analysis
for
the
Global
Burden
of
Disease
Study
2017.
Lancet
2018;392:1859–
922
[Erratum
in:
Lancet
2019;
393:e44].
[13]
Lindhjem
H,
Navrud
S,
Braathen
NA,
Biaus-
que
V.
Valuing
mortality
risk
reductions
from
environmental,
transport,
and
health
policies:
a
global
meta-analysis
of
stated
preference
studies.
Risk
Anal
2011;31:1381–407.
[14]
Commissariat
général
à
la
stratégie
et
à
la
pro-
spective.
L'évaluation
socioéconomique
des
investissements
publics.
Rapport
de
la
mission
présidée
par
Émile
Quinet.
Paris:
CGSP;
2013
[Tome
1.
Rapport
Final.
Rapports
et
Documents]
https://www.strategie.gouv.fr/publications/
levaluation-socioeconomique-investissements-
publics-tome1.
[15]
Feigl
AB,
Goryakin
Y,
Devaux
M,
et
al.
The
short-term
effect
of
BMI,
alcohol
use,
and
related
chronic
conditions
on
labour
market
outcomes:
A
time-lag
panel
analysis
utilizing
European
SHARE
dataset.
PLoS
One
2019;14:
e0211940.
[16]
Magkos
F,
Tetens
I,
Bügel
SG,
et
al.
The
environmental
foodprint
of
obesity.
Obesity
(Silver
Spring)
2020;28:73–9.
Le
coût
de
l'obésité
en
France
EPID
EMIOLOGIE,
CO
^
UTS
ET
ORGANISATION
DES
SOINS
tome
15
>
n84
>
juin
2021
417 Le point sur
1
/
5
100%