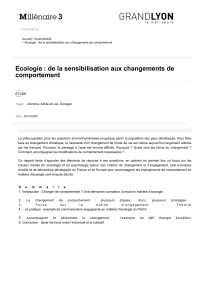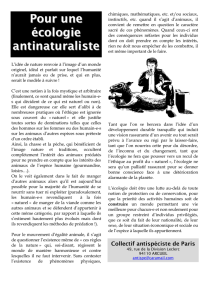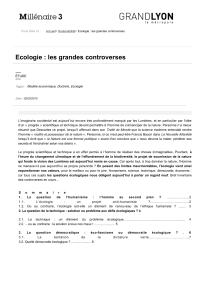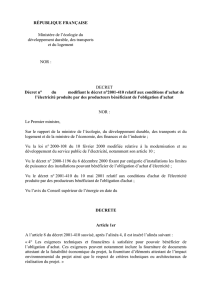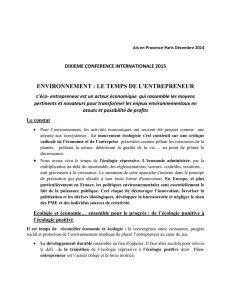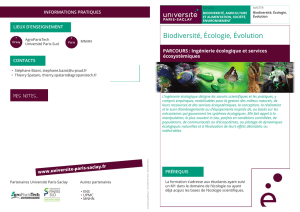Penser l`écologie politique
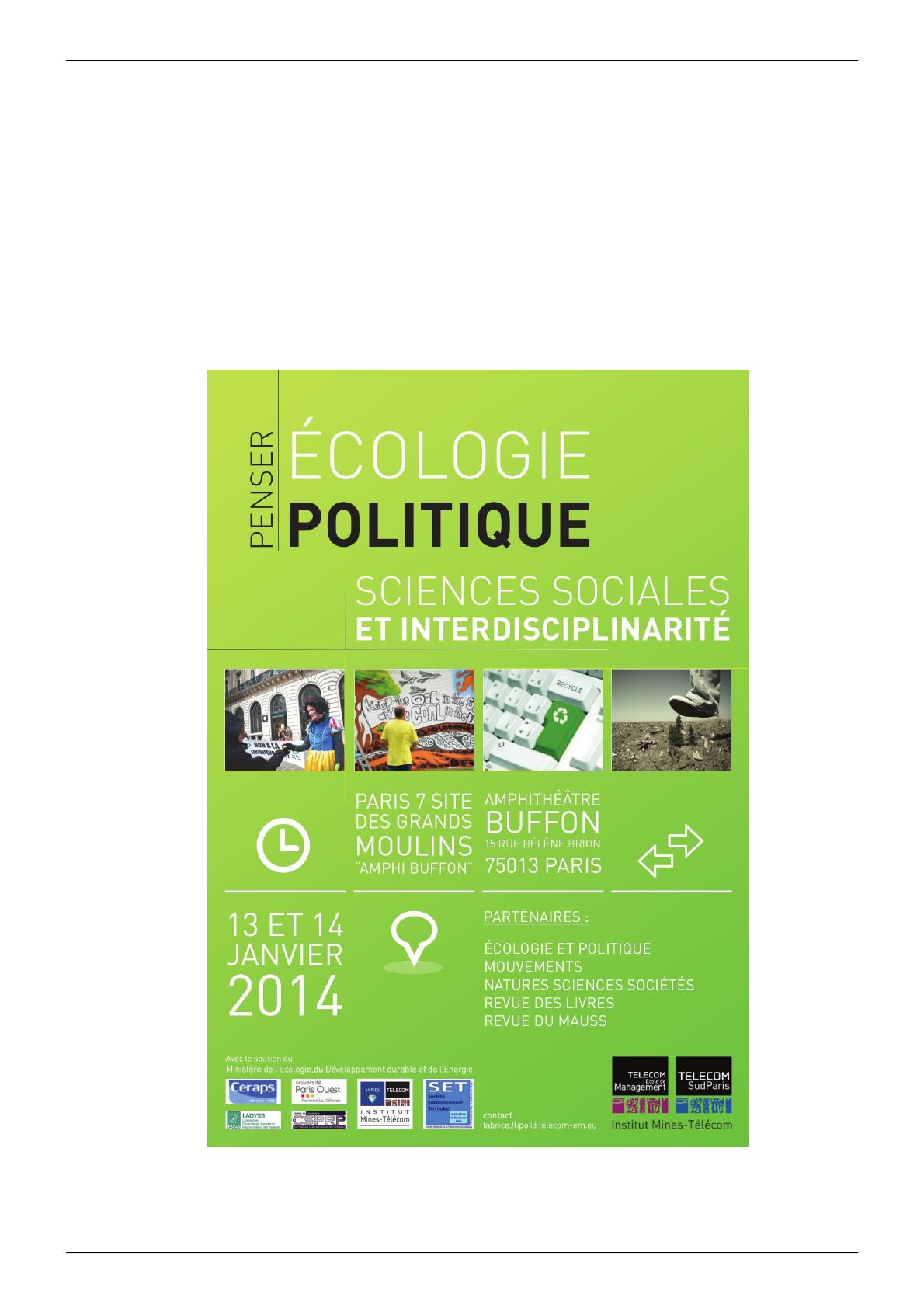
First international conference on Economic De-growth for Ecological Sustainability and Social Equity, Paris, April 18-19th 2008
Actes du premier colloque sur
Penser l’écologie politique
Sciences sociales et interdisciplinarité
Paris, 13-14 janvier 2014
1
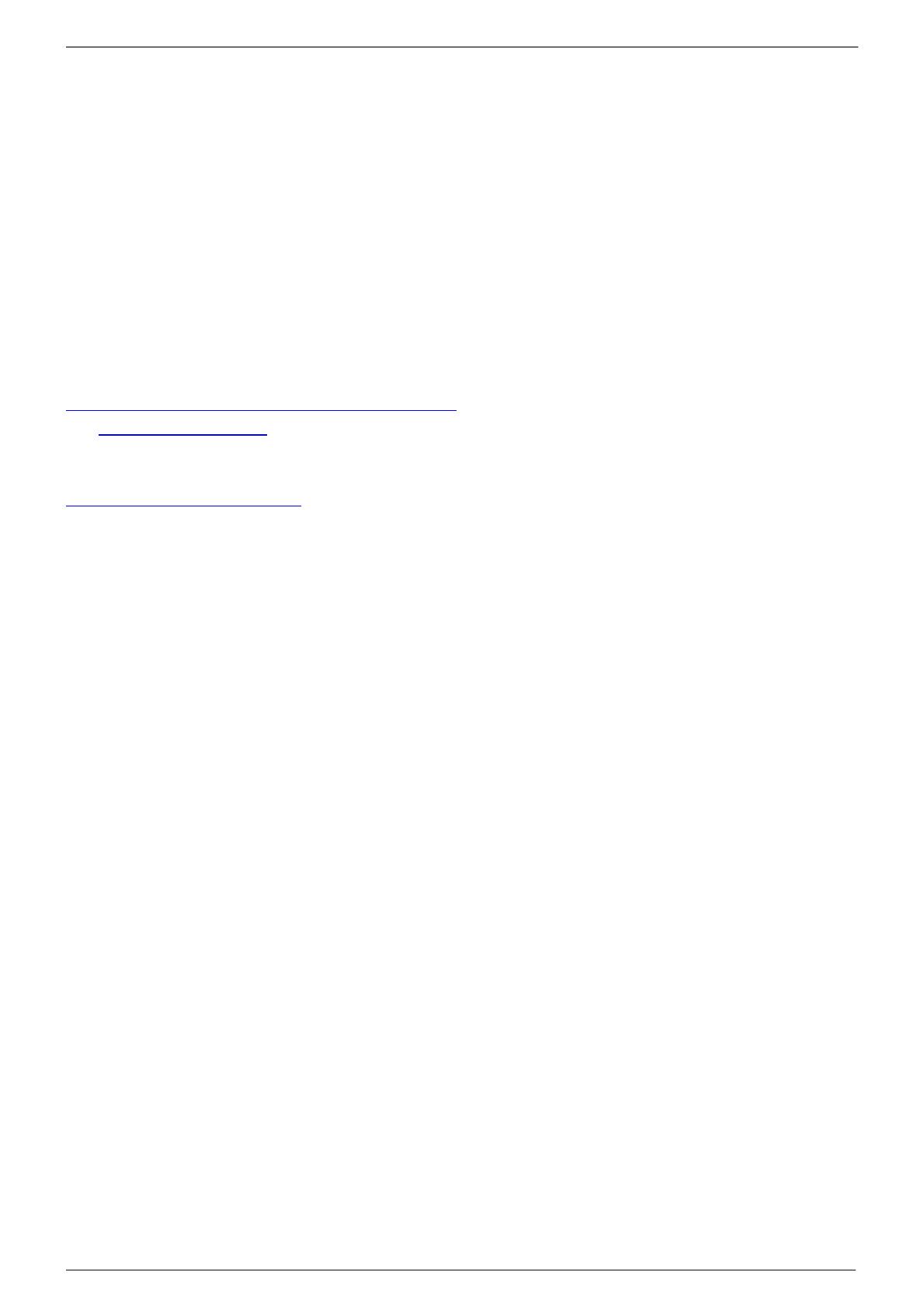
Premier colloque sur l’Ecologie Politique, Paris, 13 et 14 janvier 2014
Coordinateur scientifique: Fabrice Flipo
Site internet du colloque
http://events.it-sudparis.eu/ecologiepolitique/
ou: ecologiepolitique.tk
Contact
fabrice.flipo @it-sudparis.e u
Remerciements
Ce colloque a reçu le soutien de TELECOM & Management SudParis, de l’Institut Mines-
Télécom, du Ministère du Développement Durable et de l’Energie, et de l’Université Paris 7.
Nous remercions les co-organisateurs
2

Premier colloque sur l’Ecologie Politique, Paris, 13 et 14 janvier 2014
Table des matières
Deléage J.-P. - Penser l’écologie politique...........................................................................................12
Jappe A. - Éloge de la « croissance des forces productives » ou critique de la « production pour la
production » ? Le « double Marx » face à la crise écologique. ...........................................................14
Gun O. & F.-D. Vivien - Penser l’économie politique pour penser l’écologie politique ? Une perspective
lacano-marxiste pour la décroissance de Serge Latouche ?...............................................................17
Desguerriers G. - Fonder l’écologie politique »...................................................................................21
Briey de L. - Peut-on vouloir renoncer au productivisme sans renoncer à l’Etat-Providence ? ...........26
Tonaki Y. - Difficile écologie politique au Japon d’après-Fukushima....................................................29
Villalba B. - Temporalités négociées, temporalités prescrites. L’enjeu du délai..................................32
Grisoni A. & R. Sierra - L’écologie politique comme perspective : la reformulation des catégories du
politique sur l’espace public oppositionnel.........................................................................................33
Sauvêtre P. - Governmentality studies et écologie politique...............................................................37
Bertina L. - Ecologistes mais pas verts : des catholiques aux prises avec la question politique. .......41
Vecchione E. - Science et délibération publique: réflexions à partir d'un avenir qui n'existe pas.......45
Chansigaud V. - Le progrès technique comme révélateur de choix idéologiques : le cas des pesticides
(1880-1970)........................................................................................................................................ 49
Beaurain C. - Une approche pragmatiste de l’écologie industrielle : réflexions sur la question des
interactions entre l’économie et la nature..........................................................................................50
Naranjo I. - Approche de l’écologie politique à partir de l’idée d’adaptation aux limites : apport de la
dimension immatérielle dans les méthodologies d’aménagements du territoire................................56
Feger C. & A. Rambaud - Apports et rapports mutuels de la gestion et de l’écologie politique : essai
d’articulation par la comptabilité........................................................................................................60
Ribeiro M. - Différentes écologies: Entreprise et leurs alliances avec populations amazonienne........65
Hurand B. - Les déchets : une question d’intégration.........................................................................73
Kazic D. - La bistronomie versus slow food : les solutions alimentaires n’arrivent peut-être pas par où
on les attendait…............................................................................................................................... 77
Prignot N. - L'écosophie de Félix Guattari : sur les ondes électromagnétiques...................................81
Tessier A. & al. - « Faire de la science » interdisciplinaire : une complication nécessaire ou
superflue ? Exemple d’un cas d’étude avec les Récifs Artificiels en Languedoc-Roussillon................85
Dutreuil S. - Pourquoi des écologies politiques font-elles appel à Gaïa ? ...........................................88
P. Corcuff - Antiproductivisme anticapitaliste, décroissance et pluralisme libertaire..........................99
Sambo A. - L’histoire de l’eau : une contribution à l’écologie politique. Application à la gestion du lac
Tchad............................................................................................................................................... 102
Guest B. - Qu’est-ce que la « littérature » écologique ? ...................................................................109
Hache E. - L’écologie politique au prisme de la science fiction : du monde clos à l’univers infini et
retour ? ............................................................................................................................................ 112
Ferdinand M. - Écologie politique et pensées postcoloniales : Tentatives du « postcolonial
ecocriticism »................................................................................................................................... 113
Gautero J.-L. - La vallée de l’éternel retour, la science et l’écologisme radical.................................116
E. Bourel - Leurre ou tradition retrouvée ? Modulations gabonaises du développement durable ....120
Gervais M. - Le paysan dans l’écologie politique : repenser la nature..............................................124
Lewis N. & J. Rebotier - L’environnement en partage: affirmer la modernité pour (re)lier nature et
sociétés............................................................................................................................................ 129
Bonneuil C. & J.B. Fressoz - L'histoire, la Terre et nous. Quelle histoire de l'anthropocène ?............133
Audet R. - Une écologie politique du discours de la transition..........................................................137
Bécot R. – Interroger la production de l'oubli autour des mouvements sociaux et écologistes.........141
Boudet F. - Le concept d’espèce humaine : un défi pour les sciences humaines et sociales ?.........144
Cochet Y. - L'aversion des SHS pour l'écologie politique..................................................................147
Boudes P. & S. Ollitrault - La sociologie de l’environnement et des mouvements sociaux face à
l’écologie politique ..........................................................................................................................150
Martin F. & R. Larsimont - L’écologie politique depuis l’Amérique Latine.........................................155
3

Premier colloque sur l’Ecologie Politique, Paris, 13 et 14 janvier 2014
Flipo F. - L’écologie politique définie par les controverses générées par sa réception......................160
Vioulac J. - Exploitation de la nature et exploitation de l‘homme: le Capital comme « sujet dominant »
......................................................................................................................................................... 163
Lamizet B. - L‘écologie: une sémiotique politique de l‘espace..........................................................168
Bouleau G. - Pour une écologie politique scientifique de terrain.......................................................172
Hoyaux A.F. & V. André-Lamat - Construction des savoirs et enseignements de l’écologie politique :
du conformisme à l’interobjectivation de la nature..........................................................................176
Tassin E. - Propositions philosophiques pour une compréhension cosmopolitique de l’écologie ......180
Lamarche & al. - Les services écosytémiques face à l’écologie politique : perspectives
interdisciplinaires et interscalaires...................................................................................................184
Renault M. - Dire ce qui compte : une conception pragmatique de la formation des valeurs...........188
Harribey J.-M. - Retour à la critique de l’économie politique pour examiner la question de la valeur de
la nature...........................................................................................................................................192
Canabate A. - Puissance des subjectivités et réappropriation de valeurs : l’écologie politique ou la «
sortie civilisée » (Gorz) du capitalisme.............................................................................................197
4

Premier colloque sur l’Ecologie Politique, Paris, 13 et 14 janvier 2014
Penser l'écologie politique : sciences sociales et
interdisciplinarité
13 et 14 janvier 2014 – Paris Diderot
Bâtiment Buffon - 15 rue Hélène Brion 75013 Paris
Ce colloque part du constat d'une difficulté : de quoi parle-t-on lorsqu’on parle d’« écologie
politique » ? Parle-t-on de développement durable ? D'après-développement, de
buen vivir
,
d'écosocialisme, de décroissance, d'écosophie etc. ? Comment écologie et politique,
politique et écologie s’articulent-elles dans cette expression à la signification des plus
plastiques ? Quelle place prennent les travaux en sciences sociales tant dans les
recherches en environnement que dans la discussion engagée dans le champ de l’écologie
politique ? Le mouvement écologiste distingue, de son côté, depuis les origines,
« l'écologisme » de « l'environnementalisme », au motif que le premier cherche à modifier
les causes profondes de la dégradation de la nature et plus largement du monde vécu,
tandis que le second s'en tient à la protection de la nature. Ces enjeux n'ont jamais été plus
actuels, les écologistes obtiennent des scores parfois élevés aux élections (autour de 20 %
tous partis confondus aux Européennes de 2009), et les questions écologiques font l'objet
de tensions internationales croissantes (sommet Rio+20). Académiquement parlant, en
dépit de cette dimension politique et sociétale évidente, le champ a surtout été occupé par
les sciences dites « dures » (écologie, ingénierie, etc.). A l’heure où les sciences humaines
et sociales en France investissent toujours plus ces questions, mais de manière inégale, il
apparaît nécessaire de faire le point pour cerner les enjeux, les problèmes et les défis à
relever. Dans une bibliothèque, l'étagère la plus fournie, en matière d'écologie politique, se
nomme « développement durable ». L’économie est la discipline la plus représentée, mais
on y trouve également la géographie, la sociologie, le droit, la philosophie, l’anthropologie
et l’histoire. Certes, la thématique écologique s’est construite comme une critique de la
société industrielle et de ses aspects productivistes et de consommation, que la poursuite
de la croissance symbolise. Mais comment aller plus loin ? La critique du capitalisme est-
elle suffisante ?
Il est admis que différentes conceptions de la nature se partagent l’histoire : prémoderne,
moderne et « écologique ». A l’
observation
chez les Grecs aurait succédé l’
expérimentation
chez les Modernes, et le
respect
serait à venir. Or le statut de la troisième conception fait
problème, dans la série. L'analyse politique tient en effet pour acquis que le passage du
prémoderne (ou « antique ») au moderne implique des changements massifs : émergence
de l’État, de l'économie de marché, du développement technologique, passage de la
« liberté des Anciens » à la « liberté des Modernes », d’Aristote au constructivisme social,
etc. Entre le prémoderne et le moderne, l'écart est souvent considéré comme étant celui de
l’émergence de la science et de la technique elles-mêmes. Si l’écart entre la deuxième et la
troisième conception devait être de la même magnitude, reste à savoir dans quel sens il
faut s’engager pour opérer la conversion souhaitée de l’expérimentation au respect. On
accuse fréquemment les écologistes de vouloir « revenir à l’âge de pierre » (ou de la lampe
à pétrole). La protection de la nature n’est-elle pas plutôt un « souci moderne », qui ne se
fait jour que lorsque l'agir humain atteint une certaine magnitude ? La question taraude les
études sur l'écologisme, sans trouver de réponse claire.
Si, pendant des années, voire des décennies, il y a eu si peu de travaux et qu'ils ont été si
peu lus, c'est parce que les auteurs qui se sont engagés à l’époque dans cette voie ont été
marginalisés au motif que, pour s'intéresser à l'écologie, il fallait être écologiste, c'est-à-
dire « croire » aux dangers dont les « écologistes » de l’époque disaient qu’ils menaçaient,
« croire » aux « prédictions » de ces Cassandre. Nous sommes loin aujourd’hui de cette
marginalisation. On n’a jamais autant parlé d’écologie (ou d’environnement) en France et
5
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
 129
129
 130
130
 131
131
 132
132
 133
133
 134
134
 135
135
 136
136
 137
137
 138
138
 139
139
 140
140
 141
141
 142
142
 143
143
 144
144
 145
145
 146
146
 147
147
 148
148
 149
149
 150
150
 151
151
 152
152
 153
153
 154
154
 155
155
 156
156
 157
157
 158
158
 159
159
 160
160
 161
161
 162
162
 163
163
 164
164
 165
165
 166
166
 167
167
 168
168
 169
169
 170
170
 171
171
 172
172
 173
173
 174
174
 175
175
 176
176
 177
177
 178
178
 179
179
 180
180
 181
181
 182
182
 183
183
 184
184
 185
185
 186
186
 187
187
 188
188
 189
189
 190
190
 191
191
 192
192
 193
193
 194
194
 195
195
 196
196
 197
197
 198
198
 199
199
 200
200
 201
201
1
/
201
100%