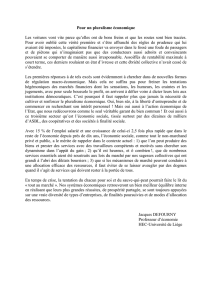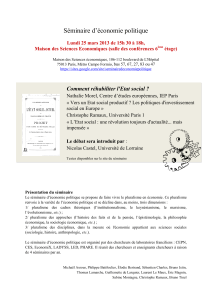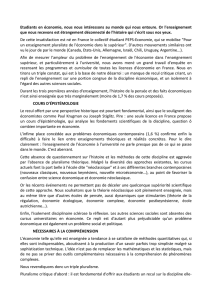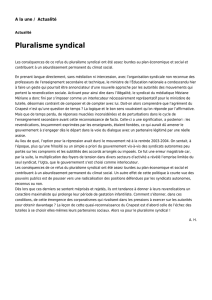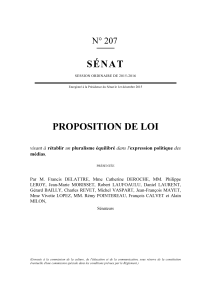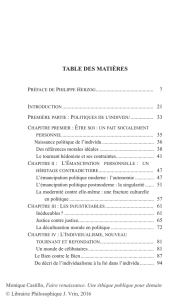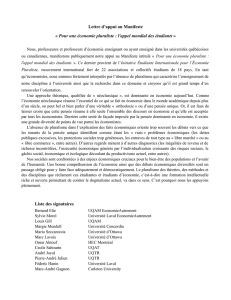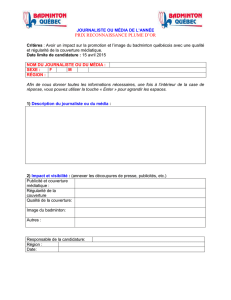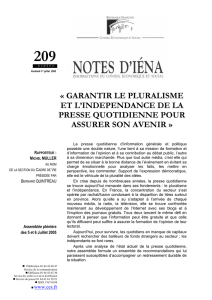Socio-économie des médias
INFORMATIONS SUR L'ENSEIGNEMENT :
1) Compétences développées :
a- Connaître les stratégies économiques des entreprises médiatiques
b- Comprendre les enjeux socio-économiques contemporains de la concentration des médias de
communication
c- Questionner l’économie des industries culturelles
d- Favoriser l’émergence d’une approche critique de l’économie et du fonctionnement des médias de
communication.
e- S’interroger sur la triade : média de communication-économie-Etat
f- Découvrir les spécificités socio-économiques de l’industrie médiatique
g- Analyser les stratégies de concentration et de diversification
h- Développer un discours critique
2) Principaux thèmes et sous thèmes abordés :
a- Les différents acteurs (publics et privés) : enjeux, rôles et caractéristiques
b- Aspect économique : stratégies, publicité, aides financières
c- Régulation des médias (France&UE)
d- Diversification et concentration des médias
e- Spécificités économiques du « bien culturel » et de « l'information »
3) Descriptif détaillé de l'enseignement :
Ce cours est structuré autour d’une approche interdisciplinaire ouvrant la voie à une réflexion critique
d’ensemble.
Ce cours cherche à présenter, analyser et appréhender les spécificités socio-économiques de médias
de communication.
L’idée est de faciliter la compréhension du paysage médiatique français et de décrypter ses enjeux
socio-économiques.

4) Bibliographie, lectures recommandées, sites de référence (outre les documents en ligne) :
a- Patrick-Yves BADILLO, « Usagers et socio-économie des médias », Revue française des sciences de
l'information et de la communication, n°6, 2015.
b- Jean-Marie CHARON, « Stratégies pluri-médias des groupes de presse », dans Les Cahiers du
journalisme, 2009, n°20, p. 54-74.
c- Michel GASSEE, « L'aide directe à la presse en Communauté française (1973-2005) », dans Courrier
hebdomadaire du CRISP, 2005, n° 1873, p. 1-47.
d- Patrick LE FLOCH et Nathalie SONNAC, Économie de la presse, Paris, La Découverte, 2005.
e- Michel MATHIEN, Économie générale des médias, Paris, Ellipses Marketing, 2003.
f- Michel PINÇON et Monique PINÇON-CHARLOT, Sociologie de la bourgeoisie, Paris, La Découverte,
2016.
g- Franck REBILLARD et Nikos SMYRNAIOS, Les infomédiaires, au cœur de la filière de l'information en
ligne, Réseaux, 2010, n° 160-161, p. 163-194.
h- Nadine TOUSSAINT-DESMOULINS, L'économie des médias, Paris, 2011, coll. « Que sais-je ? »,
Presses universitaires de France.
Contrôle terminal :
Ce qui n’a pas été vu en cours ne sera pas à l’examen, sauf les documents à lire pour les séances
suivantes. 2 notes individuelles, 1 qui sera d’un travail de réflexion, 1 issu d’un examen oral.
Dates d’examen pas encore fixé. Travail de réflexion, une sorte de dossier où on peut choisir n’importe
quel point traité en cours, que ce soit dans un article de biblio, un article à lire pour le cours ou le cours
en lui-même. Choisir une thématique et développer une réflexion avec une critique et une approche
particulière. Ne pas faire de commentaire de texte. La réflexion ne doit pas forcément être neutre mais
ni tomber dans une quelconque théorie du complot.
Forme de ce travail : aucune consigne, pas de minimum ni de maximum de page. Faire une
bibliographie, un sommaire, une page de garde. Ce travail doit être envoyé par mail le jour de l’examen
oral : nicolas.tilli@ut-capitole.fr. Il faut l’envoyer sur Word. On peut également l’envoyer sous PDF en
plus du Word.
Examen oral lors de la semaine du 15 mars : sujet tiré au hasard, 10 min d’oral, avec temps de
préparation compris dans les 10 min, pas de sujet de la biblio, uniquement cours et documents. La
caméra doit être allumée.
Envoyer tous les dossiers écrits avant le 26 mars à 17h.

Partie 1. Médias, société et économie
a) Des relations tumultueuses
L’étymologie de « média » est médium.
Au niveau de l’image « Comment contrôler le peuple en démocratie », on peut se demander si un
média peut ou non influencer l’opinion publique.
Lors de l’affaire Fillon, sa côte de popularité a changé du tout au tout très rapidement à cause des
médias.
Nous avons dans notre tête trois registres : rêve, imaginaire et symbolique. La réalité se situe à
l’intersection de l’imaginaire et du symbolique. On n’existe pas tout seul, on existe toujours à travers
l’autre, c’est-à-dire que si personne ne nous parle ou nous percute, il n’y a pas de vie. C’est le lien social
qui nous fait exister. Ce n’est donc qu’à travers l’autre que ma réalité va prendre sens.
Est-ce qu’on pourrait dire « je quitte la société » ? Qu’est-ce qu’une société ? Illusion à un système
organisé de relation et de lien entre les membres de cette société. Cette organisation peut être établit
de différentes manières : juridique, par exemple. L’organisation peut aussi être basé sur d’autres règles
comme la culture, la coutume ou la religion.
Il y a une interaction entre l’individu et le groupe ; et selon la société, l’individu va avoir une
identification différente.
Créé un lien d’identification à travers une communication, un discours, un lien qui va être établit. Dans
la communication politique, les techniques de persuasion sont utilisées.
On est tous prédéterminés par la culture et le langage, le libre arbitre n’existe pas.
Il n’existe pas d’éthique universelle. L’éthique individuelle est celle de l’acte. La morale nous renvoie à
la religion d’un point de vue éthique. La morale a une influence sur la norme juridique. Exemple : la
polygamie est interdite en France au niveau juridique dû à la morale.
Peut-on assimiler les médias à des marchandises soumises aux lois de l’offre et de la demande, soumis
par des entreprises à la recherche de bénéfice. La fonction d’informer ne devrait-elle pas être
considéré comme une mission des pouvoirs publics ? Les médias ne sont pas simplement un produit
culturel ? Les médias ne devraient-ils pas être protégés par la concurrence ? Est-ce que les lois du
marché ne sont pas opposés au rôle socio culturel des médias ?
En Corée du Nord, il n’y a qu’une seule chaîne d’information, est-ce la preuve d’une démocratie ou
non ? Exemple de questions pour l’oral.
Le discours qui donne de la légitimité à la publicité est assez contradictoire puisque d’un côté il est
soutenu que le destinataire du message est libre de choisir, mais d’un autre côté la publicité va tout
faire pour qu’il choisisse un produit en question.
b) Notions préalables : économie de l’information, structures de marché et stratégies des
acteurs CE SERA A L’EXAMEN
1. Economie de l’information

La notion d’économie fait allusion à la production, à la diffusion et à la consommation des ressources
au sens large. Lorsqu’on parle de production, on pense à l’activité de création des ressources en vue
de la consommation. La consommation est l’usage des ressources pour satisfaire des besoins par
plaisir. Entre la production et la consommation, nous retrouvons la diffusion, qui est le fait de distribuer
les ressources afin qu’elles soient consommables. Cette production et cette consommation vont se
retrouver sur le marché, le lieu de rencontre caractérisé par la confrontation d’une offre et d’une
demande. Cette confrontation permettra une consommation au prix du marché. Ce marché est une
notion abstraite, au sens large. Tout cela se passe en théorie.
Cependant, en pratique, il existe un marché pour chaque type de bien et de service, selon les génies
économistes. Cette rencontre dans un marché va former le prix, qui se fixe au point des convergences
de l’offre et la demande.
L’approche macro-économique représente l’idée du fonctionnement du système économique dans
son ensemble. En revanche, une approche micro-économique nous permet de zoomer et d’étudier,
d’analyser et de regarder un marché spécifique, que ce soit au niveau d’un bien ou d’un service, d’une
entreprise ou d’un groupe d’entreprise.
Quand on parle d’économie des médias, on fait allusion à une branche de l’économie avec une
structure, un contexte, un comportement spécifique.
Quand on parle d’information, on imagine un contenu et des données. Le rôle de l’Etat dans ce
contexte triangulaire entre société, économie et média est fondamental et central car c’est l’Etat qui
structure sur les rapports de notre société et qui intervient sur la structure du marché. L’Etat, à travers
le droit, limite les monopoles, favorise la diversité et le pluralisme, impose des taxes et des impôts,
octroie des aides, accorde ou non certaines concessions. L’Etat est acteur dans le marché. Par exemple,
les chaînes publiques. En effet, en France, on avait un monopole de l’audiovisuel jusqu’à dans les
années 80.
Pour les besoins privés : un acteur privé (par exemple M6) a besoin sur le marché d’annonceurs qui
vont venir acheter un espace d’antenne. S’il y a un annonceur qui va payer pour avoir un espace
d’antenne, c’est parce qu’il y a une audience intéressante. Par exemple, Adidas ne va pas payer pour
diffuser une publicité durant l’Amour est dans le pré, mais davantage durant les matchs sportifs, car la
cible correspond davantage. Sur Internet, cela se fait de façon automatique grâce aux cookies et aux
traceurs. C’est pour cela que la publicité est bien adaptée.
Pour que l’audience soit présente, il faut aussi proposer un contenu qui lui fasse sens et qui lui plaise.
Lorsqu’on parle des besoins publics, on va penser au besoin de cohésion sociale, au besoin d’évolution
de certaines thématiques sociétales. Pour les besoins publics, on ne devrait pas avoir des besoins
économiques et financiers puisque cela reflète l’intérêt général et non pas un intérêt particulier d’un
acteur privé.
Cette dualité nous invite donc à présenter deux modèles.
Comment analyser l’économie de l’information ? De façon macroéconomique et micro-économique.
Pour comprendre l’économie de l’information, il faut parler des branches d’activités, des secteurs
d’activités et des filières d’activités.

Une branche d’activité fait allusion à un regroupement d’organisations qui ont un point commun de
produire la même ressource ou le même service. Par exemple, la branche Presse quotidienne
nationale. Cette branche d’activité est directement liée à une production homogène. C’est-à-dire que
c’est ce regroupement d’organisations qui va rendre des services ou fabriquer un produit qui
appartient à la même nomenclature d’activité économique.
Le secteur d’activité regroupe des entreprises classées selon leurs activités principales. C’est-à-dire que
l’on parle d’un regroupement d’organisations qui vont produire majoritairement le même bien ou le
même service. On va donc s’intéresser au résultat de l’exploitation.
La filière d’activité fait penser à une organisation qui développe des activités complémentaires de
l’amont vers l’aval. Il faut penser à l’industrie alimentaire. En amont, il y a l’agriculture, la pèche…
Ensuite, cela se transformera en produit agroalimentaire. On peut également penser à l’intervention
des différentes branches car les activités réalisées en amont et en aval sont différentes de celles du
centre. On pense également aux activités complémentaires qui interviennent aux différentes étapes
de production.
Les notions de filiale et de succursale sont rattachées au droit fiscal et au droit des sociétés.
Quand on parle de filiale, il s’agit d’une entité qui est indépendante de la société mère. La société mère
en est le principal actionniste, et va la diriger. La filiale se caractérise car elle a son propre capital, ses
propres salariés et sa propre comptabilité qui sont différents de la société mère. Elle a donc une
indépendance et une autonomie fiscale par rapport à celle-ci.
En revanche, une succursale n’est pas indépendante. C’est-à-dire qu’elle n’a pas de société morale
différente, elle est simplement décentralisée.
2. La structure de marché
Un acheteur
Quelques acheteurs
Beaucoup d’acheteurs
Un vendeur
Monopole bilatérale
Monopole contrarié
Monopole
Quelques vendeurs
Monopsone contrarié
Oligopole bilatéral
Oligopole
Beaucoup de vendeurs
Monopsone
Oligopsone
Concurrence pure et
parfaite
Quand on parle de monopole on pense à une entreprise seule à vendre son bien ou service, ce qui
représente une situation de concurrence imparfaite dans laquelle un seul vendeur va faire face à une
multitude d’acheteur.
Quand on parle d’oligopole, on a aussi une situation de concurrence imparfaite avec quelques
vendeurs qui font face à une multitude d’acheteurs.
La différence entre les deux situations c’est que dans le monopole il n’y a qu’un vendeur alors
quand dans le cas d’un oligopole, il y a quelques vendeurs. Donc ce qui différencie les deux
situations c’est l’offre et pas la demande car il y a dans les deux cas quelques acheteurs.
Quand on parle de monopole bilatéral c’est faire face à un marché où il y a un seul fournisseur et
acheteur.
Quelques exemples :
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
1
/
18
100%