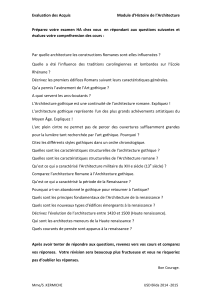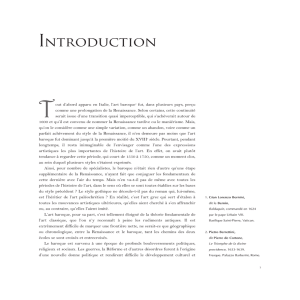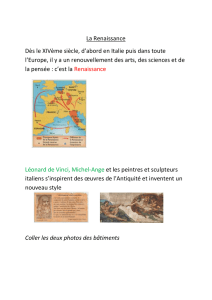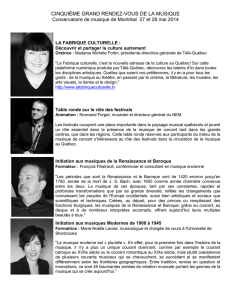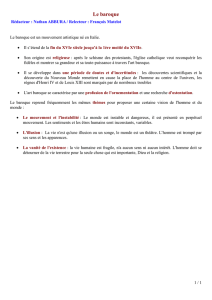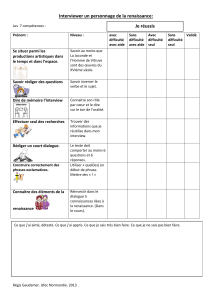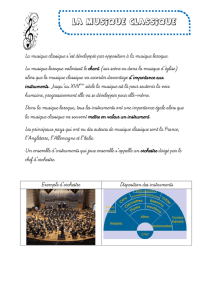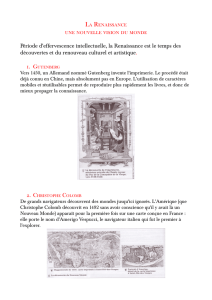L’architecture antique, grecque et romaine se définit par l’ordre qui est un système de proportions autant
qu’un style. Les trois principaux sont: l’ordre Dorique, le plus simple dans son décor. Le Ionique, le chapiteau de la
colonne se distingue par ses volutes. Le Corinthien, le plus orné des trois, présente sur son chapiteau des feuilles
d’acanthes.
L’architecture romane (XIe-XIIe siècle environ) se définit par ses arcs plein cintres, ses proportions équilibrées,
son décor sculpté aux formes stylisées.
L’architecture gothique (XII-XVe siècle environ) se caractérise par des arcs brisés, des proportions élancées,
des ouvertures plus larges.
L’architecture renaissance (XV-XVI), classique (XVII-XVIII), néoclassique (fin du XVIIIe) fait référence aux ordres
antiques, et recherche la régularité, l’équilibre et la symétrie.
L’architecture baroque et roccoco (XVII-XVIII) fait également référence à l’antique, avec une dynamique de
courbe et contre-courbe, d’emboitement, de théatralité et de décor parfois foisonnant.
L’architecture art nouveau (fin XIX- début XX) possède des formes souples, ondulantes et élancées, inspirées
de la végétation.
L’architecture art déco (1910-1930) signe un retour à plus de sobriété dans la décoration avec des formes
géométriques plus droites et régulières.
Le mouvement moderne enfin, né au lendemain de la première guerre mondiale, propose un certain
dépouillement. Les surfaces vitrées se développent et des formes géométriques très épurées apparaissent.



L'art et l'architecture paléochrétiens ou l'art paléochrétien sont l'art produit par les chrétiens ou sous le
patronage chrétien de la première période du christianisme jusqu'à, selon la définition utilisée, parfois entre 260 et
525. Après 550 au plus tard, l'art chrétien est classé comme byzantin ou d'un autre type régional.
L'art et l'architecture paléochrétiens ont adapté les motifs artistiques romains et ont donné de nouvelles
significations à ce qui avait été des symboles païens. Parmi les motifs adoptés figuraient le paon , les Vitis viniferavines
et le " Bon Pasteur ". Les premiers chrétiens ont également développé leur propre iconographie.
Elle commence modestement de la fin du iie siècle à 313, lorsque le christianisme était persécuté, puis elle
s'épanouit pleinement à l'échelle de tout l'empire à partir du règne de Constantin, le premier empereur converti au
christianisme. Elle ne crée pas un vocabulaire nouveau mais donne un sens nouveau aux éléments qu'elle a autour
d'elle pour assembler les fidèles, magnifier les lieux saints, rendre un culte aux martyrs et honorer les morts.
Art gothique et roman coexistent. Il serait plus juste de dire qu’ils sont juxtaposés, dans des corps
d’architecture séparés. Des chapelles latérales sont presque systématiquement ajoutées, à l’âge gothique, à des nefs
de construction romane. Souvent, c’est la nef elle-même qui est entièrement refaite, ou simplement voûtée d’ogives,
laissant subsister le chœur roman. Dans tous les cas, on constate une brutale rupture de style : les nefs gothiques sont
plus élevées que le chœur roman, les chapelles mieux éclairées, les colonnes romanes disparaissent au profit de culots
plus légers. Cette impression de discontinuité entre les deux styles est due en partie à la date tardive des adjonctions
gothiques, qui sont pour la plupart du XVe siècle. Entre les deux chantiers, trois siècles se sont écoulés, qui ont permis
aux constructeurs gothiques de développer ce qui fut leur grande invention: la voûte d’ogives, et toutes les
modifications architecturales qui en découlaient. Quelques édifices corréziens, pourtant, sont intéressants parce qu’ils
se situent véritablement à une époque de transition, qui voit la naissance de l’art ogival. Leur étude permettra de
constater que l’apparition de la voûte d’ogives n’a pas immédiatement bouleversé le mode de construction des églises,
et que d’une certaine manière, l’art roman continue de subsister dans le premier gothique.
• Les églises romanes suivent généralement le plan d'une croix latine : la nef (figurant le corps du Christ) est
coupée par le transept (ses bras), et couronnée par le chœur (sa tête). L'architecture romane utilise trois formes de
voûtes :

la voûte en plein cintre ou en berceau, qui correspond à un demi-cylindre : elle est surtout utilisée pour
couvrir les nefs ;
la voûte en berceau brisé, formée de deux demi-voûtes en arcs de cercle se rejoignant au sommet : également
utilisée pour couvrir les nefs ;
la voûte d'arête, constituée de deux voûtes en plein cintre qui se se croisent perpendiculairement : l'ensemble
forme une travée qui a un plan en quadrilatère, le plus souvent un carré ; elle est peu utilisée pour couvrir les nefs,
mais surtout employée pour couvrir les bas-côtés.
• Du Xe au XIIe siècle, les bâtisseurs remplacent les charpentes de bois par des voûtes de pierre. La forme la
plus typique de l'art roman reste la voûte semi-circulaire, voûte en berceau ou en plein cintre. En général, ces voûtes
sont renforcées à intervalles réguliers par des arcs de pierre taillée (les arcs doubleaux).
• Les murs sont épais, les fenêtres réduites : les églises romanes sont souvent assez sombres. En faisant se
croiser à angle droit deux voûtes en berceau, on obtient une voûte d'arêtes, procédé qui permet de répartir les
poussées sur les piliers des angles. On s'en sert surtout pour les bas-côtés, plus rarement pour la nef. Dans certaines
régions et pays (Sud-Ouest de la France et Italie), la nef est couverte de coupoles.
• L'intérieur des églises (y compris les statues et les chapiteaux) est généralement peint de couleurs vives.
Les voûtes et les murs sont couverts de fresques qui décrivent les miracles des saints ou les épisodes de l'Évangile. La
splendeur des édifices est également renforcée par des portes de bronze, des reliquaires d'or et d'émail, voire des
vitraux. L'église romane est une véritable « Bible de pierre » dont le décor instruit les fidèles.
• Cet art s'est développé en même temps que la féodalité, à une époque où l'Occident est morcelé. Aussi,
les édifices, leurs matériaux, diffèrent souvent d'une région à l'autre. Les églises d'Auvergne ne ressemblent pas à
celles de Bourgogne ou à celles du Poitou.
• On remarque cependant certaines influences : les églises de pèlerinage ou les abbayes appartenant à de
mêmes ordres religieux, comme Cluny ou Cîteaux, présentent des caractères communs.
• L'art gothique se situe dans le prolongement de l'art roman. En effet, les bâtisseurs des cathédrales de la
seconde moitié du XIIe siècle ne changent pas profondément de style. Mais ils utilisent de façon systématique et
rationnelle des procédés architecturaux déjà connus, tels que l'arc brisé et la voûte sur croisée d'ogives. Simple artifice
décoratif à l'origine, celle-ci est utilisée à partir de la fin du XIe siècle dans l'architecture anglo-normande. L'abbé de
Saint-Denis, Suger, est le premier à comprendre l'avantage que l'on peut en tirer : la croisée d'ogives permet de faire
porter le poids de la voûte sur des piliers et non plus sur les murs. Lorsqu'il entreprend de reconstruire son abbaye,
vers 1140, il l'emploie dans tout l'édifice. L'architecture gothique dispose de nouvelles techniques : tels que l'arc brisé
et la voûte sur croisée d'ogives. Ces innovations permettaient de construire des édifices plus hauts et plus grands,
mais aussi de faire des murs plus minces. Les fenêtres pouvaient aussi être plus grandes, et les bâtiments étaient alors
mieux éclairés. Le résultat est à la fois imposant et délicat. Dans l'architecture gothique, les bâtiments sont un
assemblage de « modules » qui, au sol, forment des carrés ou des rectangles. Le poids des voûtes qui couvrent la nef
et les bas-côtés est supporté par quatre piliers occupant les angles d'un carré ou d'un rectangle. La voûte d'ogives, qui
caractérise l'architecture gothique, est composée par des arcs brisés (ou ogives) qui partent des quatre angles et se
rejoignent au centre de l'espace couvert. Plus on écarte les piliers, plus il faut allonger les arcs brisés, donc la hauteur
de la voûte augmente. Il suffit de consolider les piliers de l'extérieur pour éviter qu'ils ne s'écartent dans leur partie
haute. Pour cela, on construit des arcs-boutants qui s'appuient sur les piliers.
Le gothique primitif ou protogótico (1130-1180)
Le gothique classique (1180-1230) Le gothique classique ouvre ce qu’on appelle au 13 siècle, l’âge des
cathédrales: correspond à la phase de maturation et à l’équilibre des formes. Dans les cathédrales, le rythme et la
décoration étaient simplifiés; l’impulsion verticale était de plus en plus prononcée; et l’architecture est devenue
uniforme. Pendant ce temps, le contrefort volant, qui traverse les couloirs latéraux pour transmettre la poussée de la
voûte centrale, devient un organe essentiel. Son utilisation systématique a permis à Chartres la création régulière
grâce à la voûte sexpartite et à l’abandon du principe des colonnes alternantes très marquées à Sens. C’est dans le
domaine royal de la dynastie capétienne que ce style trouve son expression la plus classique.
Le gothique radiant. Les églises deviennent de plus en plus hautes. Techniquement, ce qui permettait de
construire de tels grands bâtiments avec de très grandes fenêtres était l’utilisation de l’armure de fer (technique de la
“pierre armée”). Les fenêtres ont été prolongées jusqu’à ce que les murs ont disparu: les piliers ont formé un squelette
de pierre et le repos sera fait de verre, laissant dans une lumière abondante. La surface éclairée a été encore
augmentée par la présence d’un triforium ajouré. Les vitrines se caractérisaient également par des tracés d’une grande
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
1
/
18
100%