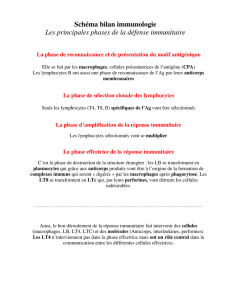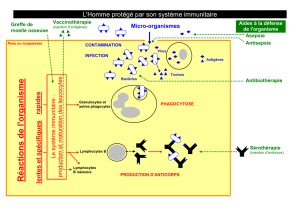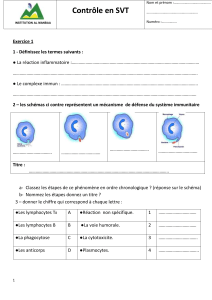Immunité Spécifique : Cours de Biologie Terminale D
Telechargé par
mbougniadonavan555

Chapitre 7. Leçon 2. TleD. Page 1
LECON 2 : LA REPONSE SPECIFIQUE OU ACQUISE OU ADAPTATIVE
O.P.O : Expliquer les mécanismes spécifiques d’une réponse spécifique à médiation cellulaire
et d’une réponse spécifique à médiation humorale ;
Relever et expliquer les trois phases de la réponse spécifique à médiation humorale ;
Expliquer les mécanismes aboutissant à la neutralisation et à l’élimination des antigènes.
INTRODUCTION
La réponse immunitaire peut se poursuivre par une réaction acquise ou adaptative, spécifique
de l'antigène présenté par une cellule appelée «cellule présentatrice de l'antigène », souvent un
phagocyte ; lorsque cette dernière n’arrive pas à éliminer l’Ag en question. En quoi consiste cette IS ?
Et quels en sont les différents mécanismes ?
I. Les caractéristiques de l’IS et différents types d’immunités spécifiques.
O.P.O.I. : Préciser les caractéristiques de l’IS puis préciser les différents types d’immunités
spécifiques
I.1. Les caractéristiques de l’IS
Les caractéristiques de l’IS sont :
- elle est acquise c’est-à-dire ne se met en place qu’à la suite d’un premier contact avec un Ag ;
- elle est spécifique (document 1 ) c’est-à-dire qu’elle est dirigée contre un Ag déterminé (à un Ag
donné correspond un Ac ou cellule immunitaire déterminé) ;
- elle est adaptative c’est-à-dire que la réponse est adaptée à chaque agent infectieux ;
- elle est dotée d’une « mémoire immunitaire » c’est-à-dire qu’elle a la faculté de conserver en
mémoire le souvenir de la première agression. Une 2e agression par le même Ag entraînera une réponse
immunitaire plus rapide, plus affine et plus intense (réaction "secondaire")
I.2. Mise en évidence des 2 types de réponses immunitaires
Le document 2 montre que les cobayes A sont immunisés contre la diphtérie grâce au vaccin
reçu 15 jours plus tôt. La survie des cobayes du lot D montre qu’ils développent une réponse immunitaire
contre la toxine diphtérique : l’injection de sérum contenant des anticorps a passivement transféré
l’immunité des cobayes B et C aux cobayes D. La mort des cobayes E montre que ce transfert
d’immunité ne peut pas se faire par les lymphocytes. Le sérum lutte contre les toxines ou substances
solubles : on parle d’une réponse immunitaire spécifique à médiation humorale (RIMH).
La RIMH est réalisée par la sécrétion des anticorps circulants spécifiques des déterminants
antigènes dans le sang et la lymphe.
NB : Il existe plusieurs catégories d’anticorps (Ac) ou immunoglobulines (Ig) selon leurs rôle et
propriétés (document 4)
Le document 3 montre que l’injection de BCG (vaccin anti tuberculeux) a immunisé les cobayes
A contre la tuberculose. La survie des cobayes E et G ne s’explique que si l’on admet que l’injection de
lymphocytes T a transféré passivement l’immunité des cobayes immunisés B et C aux cobayes E et
G. Ce transfert d’immunité ne peut pas se faire par le sérum et par les lymphocytes B dans le cas de la
lutte contre la tuberculose d’où la mort des cobayes D et F respectivement.
Les lymphocytes luttent les antigènes intracellulaires : on parle d’une réponse immunitaire
spécifique à médiation cellulaire (RIMC).
PARTIE II : LE MECANISME DE L’IMMUNITE
CHAPITRE 7 : LE DEROULEMENT DE LA REPONSE IMMUNITAIRE

Chapitre 7. Leçon 2. TleD. Page 2
La RIMC est réalisée par les cellules effectrices spécifiques du déterminant antigénique : les
lymphocytes T cytotoxiques. La RIMC intervient alors dans la lutte contre les cellules infectées par les
virus, les cellules cancéreuses et les cellules infectées par les bactéries intracellulaires.
I.3. La coopération cellulaire dans l’IS (Document 6 et 7)
La coopération cellulaire est l’intervention de différents types de cellules effectrices au cours
des réponses immunitaires spécifiques. Elle nécessite la participation des CPA (monocytes,
macrophages, cellules dendritiques et LB), les LT4, les LT8 et les LB.
Dans la RIMH la synthèse d’anticorps spécifiques de l’antigène grâce aux LB nécessite une
coopération des LB avec les LT4 et les macrophages.
Dans la RIMC l’activité des LT8 responsables de la destruction des cellules infectées nécessite
une coopération des LT8 avec les LT4 et les macrophages.
L'activation des lymphocytes T et B se fait dans les organes lymphoïdes périphériques lors de la
rencontre avec les antigènes qui leurs sont présentés par des CPA.
Les lymphocytes matures issus de la MRO (LB) et du thymus (LT) vont coloniser les organes
lymphoïdes périphériques en arrivant par voie sanguine et c’est dans ces organes que se fait la rencontre
avec l’antigène qui est présenté aux LT par des CPA. C’est cette "rencontre antigénique" qui va induire
l’activation ou survie et donc la prolifération et la différenciation de ces lymphocytes. Cette "rencontre"
antigénique, pour être efficace, doit être accompagnée d’une stimulation par des molécules
(Interleukines) issues de l’immunité innée.
II. Les différentes phases ou étapes des R.I.S.
O.P.O.I. : Expliquer les mécanismes spécifiques d’une réponse spécifique à médiation
cellulaire et d’une réponse spécifique à médiation humorale
Les lymphocytes matures issus de la MRO (LB) et du thymus (LT) vont coloniser les organes
lymphoïdes périphériques en arrivant par voie sanguine et c’est dans ces organes que se fait la rencontre
avec l’antigène qui est présenté aux LT par des CPA. C’est cette "rencontre antigénique" qui va induire
l’activation ou survie et donc la prolifération et la différenciation de ces lymphocytes. Cette "rencontre"
antigénique, pour être efficace, doit être accompagnée d’une stimulation par des molécules
(Interleukines) issues de l’immunité innée.
Les RIS présentent trois phases :
- la phase d’induction constituée de la reconnaissance de l’Ag et de la sélection clonale ;
- la phase d’activation constituée de la multiplication clonale ou amplification et de la
différenciation ;
- la phase effectrice qui varie selon le RIS
II.1. La phase d’induction et de sélection clonale (document 8, 9 et 10)
Elle varie en fonction du type de lymphocyte. En effet :
Les LB reconnaissent directement l’antigène libre circulant ou exposé à la MP d’une cellule
infectée. Ces cellules peuvent être aussi activées par l’interleukine 1 (IL1) produit par les Cellules
Présentatrices d’Antigènes (CPA).
Les LT4 reconnaissent l’Ag associé à une molécule HLA de classe II. La cellule possédant un
antigène associé au HLA et l’ensemble HLA-Ag exposé à la surface de la MP constitue une CPA. Si la
CPA est un macrophage ou un monocyte alors on dit que la phagocytose ou l’INS initie l’IS.
Toutefois, l’IL1 produit par la CPA permet aussi d’activer le LT4.
Les LT8 reconnaissent l’Ag associé à une molécule HLA de classe I portée par toute cellule
nucléée infectée de l’organisme ou par une CPA.
Remarque : étant donné que l’Ag est en général constitué de plusieurs épitopes, il ressort que
c’est plusieurs types de lymphocytes B ou T spécifiques chacun à un épitope antigénique qui seront
activés ou sélectionnés et on parle de sélection clonale.

Chapitre 7. Leçon 2. TleD. Page 3
II.2. La phase d’activation
a- Cas des lymphocytes T. (document 11)
L’IL1 produit par la CPA déclenche une synthèse d’une autre protéine par les lymphocytes T4 : IL2.
Cette dernière induit la multiplication et la différenciation des clones de LT4 en LT auxiliaires (LTa).
Les LT8 quant à eux sont activés par l’IL2 produit par les LT auxiliaires qui entraine leur
multiplication suivi de leur différenciation en LT cytotoxiques (LTc).
b- Cas des lymphocytes B. (document 12)
Les LTa activent les LB par l’intermédiaire des IL2 et commencent alors à se multiplier et créent un
clone de LB spécifiques du déterminant antigénique.
Parmi les lymphokines sécrétées par les LTa, certaines vont stimuler la différenciation d’une partie
du clone de LB en plasmocytes, cellules sécrétrices d’anticorps circulants. Cette population de
plasmocytes reste en place dans les organes lymphoïdes ; en revanche, les anticorps sécrétés gagnent la
circulation générale d’où leur nom d’Ig circulants se distinguant d’Ig membranaires.
Le plasmocyte se distingue du LB par le volume et quantité abondante de RER, AG et VG justifiant
une synthèse accrue de protéines notamment les Ig.
Remarque : c’est n’est qu’une partie de cellules immunitaires activées qui se différencient
totalement en d’autres cellules. Une autre partie n’achèvent pas leur différenciation et constituent de ce
fait des cellules mémoires qui interviendront de manière plus efficace et plus rapide au second contact
avec le même Ag.
EXO D’APPLICATION (Vade mecum page 57 exo 7)
II.3. La phase effectrice
a- Cas de la RIMC. (document 13 et 15)
La RIMC a pour effecteurs les LT cytotoxiques ou cellules tueuses ou LT cytolytiques (LTc).
Ce sont des LT provenant de la différenciation des LT8 activés par contact avec les CPA.
Les LTc se fixent par leurs récepteurs membranaires spécifiques aux cellules possédant à leur
surface le soi modifié (cellules infectées, cellules cancéreuses, cellules mutées) complémentaire de leurs
récepteur. Ce contact entraîne chez le LTc, l’exocytose de protéines hydrolytiques : les perforines qui
s’enchâssent dans la membrane de la cellule à détruire et forment un canal transmembranaire par lequel
l’eau entre, ce qui provoque son éclatement.
b- Cas de la RIMH. (14)
La RIMH a pour effecteurs les anticorps circulants spécifiques du déterminant antigénique
sécrétés par les plasmocytes. Ces anticorps sont en effet capables de se fixer spécifiquement à un
déterminant antigénique.
Les anticorps ne détruisent pas directement les antigènes. Leur fixation aux déterminants
antigéniques spécifiques provoque :
- la neutralisation directe des antigènes dans un réseau d’anticorps : formation des complexes
immuns ;
- suivi de l’activation soit du complément par voie classique qui va détruire l’Ag par cytolyse
(CAM) ou soit des phagocytes par les complexes immuns qui vont détruire ces derniers par phagocytose.
Dans ce dernier cas, on dit que la phagocytose complète la réponse immunitaire spécifique.
Les étapes de cette immunité acquise sont illustrées dans les documents 16 et 17.
EXO D’APPLICATION (Vade mecum page 57 exo 6 ; 58 exo8 ; 59 exo11 ; 62exo4)
Conclusion
L’INS initie l’IS humorale ou cellulaire selon les cas lorsqu’il est dominé par un Ag. Cette IS est
adaptative à l’Ag. Quelle serait la conséquence du dérèglement du SI ?
1
/
3
100%