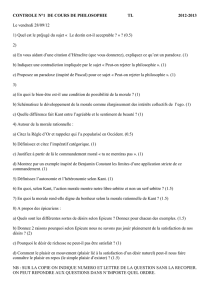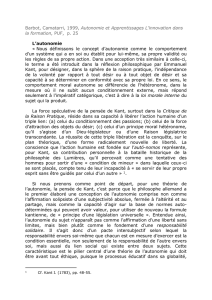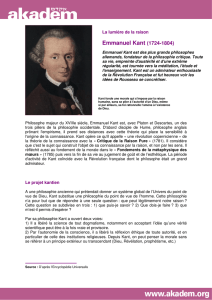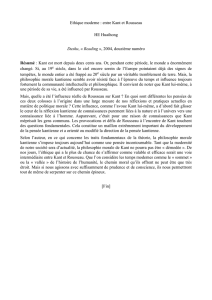Les antinomies cachées de la raison pratique de Kant
Telechargé par
stevensonjohn1998

ANTINOMIES CACHÉES DE LA RAISON PRATIQUE
Comme on le sait, Kant prétend établir dans La Critique de la raison pure que
la tentative de connaître les choses par la pure raison, indépendamment de la
sensibilité, conduit à des antinomies. Quand la raison tente de répondre à
certaines questions – par exemple concernant l’existence d’une cause première -
elle génère deux raisonnements valides conduisant à deux conclusions opposées,
une « thèse » et son « antithèse ». La contradiction peut être résolue à son tour,
affirme Kant, en reconnaissant que les idées rationnelles qui prétendent traiter des
choses au-delà de l’expérience sensible – par exemple l’idée d’un être nécessaire
ou de l’âme immortelle – peuvent servir uniquement au titre d’idées régulatrices.
Nous ne pouvons faire aucune affirmation cognitive concernant les objets de ces
idées, mais elles peuvent servir en tant qu’idéaux pour l’investigation
scientifique.
Comme on le sait aussi, dans la Critique de la raison pratique, Kant présente
une autre antinomie, celle de la raison pratique. Le résultat de cette antinomie est
cependant très différent. Plutôt que d’établir que nous ne pouvons rien affirmer
légitimement concernant le suprasensible, cette antinomie montre selon Kant
que, pour des motifs rationnels pratiques, nous devons croire en l’immortalité de
l’âme et en l’existence de Dieu. Kant s’empresse de soutenir que ces croyances ne
constituent pas un savoir authentique – il ne cherche pas à renverser ses affir-
mations concernant notre ignorance du suprasensible – mais plutôt des croyances
d’une nécessité uniquement subjective et pratique, des éléments de foi néces-
saires à l’action morale. Néanmoins, contrairement à la raison spéculative, la
raison pratique fournit une base rationnelle au maintien de ces croyances. Je
voudrais toutefois suggérer que la raison pratique kantienne est peut-être plus
proche de la raison théorique que ne l’affirme Kant lui-même : pas plus que
la raison théorique, la raison pratique ne peut pas soutenir sans ambiguïté la
croyance en l’immortalité ou en l’existence de Dieu. En effet il y a dans la pensée
de Kant une antinomie cachée de la raison pratique. L’antinomie de la raison
pratique de la deuxième Critique soutient la croyance en l’existence de Dieu et en
l’immortalité. C’est là, pour ainsi dire, le raisonnement en faveur de la « thèse » de
cette antinomie « cachée ». En me fondant sur deux essais plus tardifs et moins
Épreuves
Theis (dir.), Kant - Théologie et religion
© Librairie Philosophique J. Vrin, 2013

156 RACHEL ZUCKERT
connus de Kant, La fin de toutes choses et Sur l’échec de tout essai philosophique
en matière de théodicée, je voudrais suggérer qu’il y a aussi des arguments
kantiens qui vont à l’encontre de ces croyances et qui se fondent là encore, sur la
raison pratique. Ainsi la raison pratique pourrait à la fois exiger et interdire la foi
en l’immortalité et en l’existence de Dieu.
Je présenterai d’abord le raisonnement de la deuxième Critique, puis traiterai
des deux essais postérieurs afin de présenter les antithèses. Je conclurai sur la
suggestion d’une possible résolution kantienne de cette antinomie.
L’ANTINOMIE « OFFICIELLE »
L’antinomie de la raison pratique débute avec l’idée du « souverain Bien » 1 Le
souverain Bien est une idée semblable à celles dont il est question dans la
première Critique, c’est-à-dire qu’il s’agit de la représentation d’une condition
incondition-née. Pour la raison pratique, une telle condition est la fin ultime de
l’action – celle qui subsume, et ainsi conditionne, toutes les autres fins. Ainsi le
souverain Bien est la fin complète, celle qui combine tous nos buts, c’est-à-dire la
combinaison de la vertu et du bonheur. Car l’action humaine vise en général ces
deux fins : toute action morale vise l’obéissance à la loi morale ou la vertu, tandis
que le bonheur est la somme de la satisfaction de toutes les fins du désir sensible et
naturel. Puisque nous sommes des êtres rationnels et sensibles, nous visons
nécessairement les deux sortes de fins, et notre fin totale devrait donc les inclure
toutes les deux. Plus spécifiquement, Kant soutient que le souverain Bien est le
bonheur conditionné par la vertu : c’est un monde où le bonheur de toute personne
est proportionné à sa vertu.
L’antinomie de la raison pratique concerne la possibilité de réaliser cette fin.
D’une part, Kant affirme que nous devons non seulement former cette idée de la
fin humaine ultime, mais que nous sommes aussi obligés, d’un point de vue
moral, de viser son accomplissement. Ainsi, il doit être possible de l’accomplir.
D’autre part, le souverain Bien apparaît comme impossible, car il s’agit d’un
ensemble synthétique combinant deux éléments hétérogènes (la vertu et le
bonheur). S’ils doivent vraiment être combinés au sein de notre but final (et non
pas seulement poursuivis en parallèle), ils doivent alors être dans une relation
causale, en particulier une relation dans laquelle la cause est l’action intention-
nelle (car nous parlons ici d’une fin pratique). Ainsi on doit soutenir soit que viser
le bonheur entraînera la vertu, soit que viser la vertu entraînera le bonheur.
Cependant aucun des deux ne semble possible. Selon Kant, la vertu ne peut jamais
être le résultat de la recherche du bonheur : les agents sont vertueux uniquement
s’ils cherchent à suivre la loi morale pour elle-même. Mais il apparaît aussi que
1. Cf. CRPr, AK V 110-121 ; OP II 749-756. Sur le concept du souverain bien, voir L. Gallois, Le
souverain bien chez Kant, Paris, Vrin, 2008.
Épreuves
Theis (dir.), Kant - Théologie et religion
© Librairie Philosophique J. Vrin, 2013

ANTINOMIES CACHÉES DE LA RAISON PRATIQUE 157
viser la vertu ne peut entraîner le bonheur. Car, affirme Kant, dans l’action morale
nous ne pensons qu’à la légitimité de nos actions. À l’opposé, pour satisfaire nos
désirs sensibles, nous devons connaître les lois naturelles et agir en fonction
d’elles, et nous devons avoir la capacité physique d’accomplir les fins désirées.
Ainsi, il ne semble pas qu’agir moralement puisse apporter le bonheur en soi.
Voilà l’antinomie : si (selon la thèse) la loi morale nous oblige à réaliser le
souverain Bien, mais que cependant le souverain Bien n’est pas possible (comme
le soutient l’antithèse), il semble que la loi morale nous pousse, comme Kant
l’écrit, vers des fins imaginaires et qu’elle soit donc « fausse en soi » 1 ou
irrationnelle. Mais cette loi est la loi de la raison pratique. En conséquence, la
résolution de l’antinomie consiste à affirmer qu’il y a en fait un moyen de consi-
dérer le souverain Bien comme étant possible – et d’affirmer la thèse de cette
manière. En particulier, les « postulats » de l’immortalité de l’âme et de l’exis-
tence de Dieu pourraient expliquer comment le souverain Bien est réalisable. Ils
sont donc nécessaires à une action morale, rationnelle, consistante et engagée.
Le postulat de l’immortalité de l’âme répond à un problème lié à la possibilité
de réaliser le souverain Bien, qui n’est en fait pas mentionné dans l’antithèse, à
savoir : la loi morale veut que nous atteignions la vertu parfaite. Mais aussi vive
que soit notre aspiration à la vertu, la possibilité de subordonner les exigences de
la loi morale à notre amour de soi demeure toujours. Nous ne sommes donc jamais
parfaitement vertueux. Mais si notre âme est immortelle, nous pourrions nous
engager dans une progression sans fin vers la vertu, et ce progrès, sur une durée
infinie, se rapprocherait de la vertu parfaite. Par conséquent ce postulat nous
permet d’affirmer que nous pourrions en fait (plus ou moins) satisfaire aux
obligations de la loi morale.
D’autre part, le postulat de l’existence de Dieu est censé aborder le problème
soulevé dans l’antithèse. Bien que viser la vertu n’apporte pas le bonheur en soi,
cela pourrait être possible, suggère Kant « par l’intermédiaire d’un auteur intel-
ligible du monde » 2. En tant que créateur tout puissant et moral, Dieu peut non
seulement reconnaître la vertu (dans l’intention humaine), mais il peut aussi
agencer les lois naturelles de telle sorte que la vertu puisse apporter le bonheur.
Ainsi, conclut Kant, l’agent moral doit croire en l’immortalité de l’âme et en
l’existence de Dieu.
Comme je l’ai fait remarquer, Kant affirme que ces arguments ne représentent
pas des preuves objectives. Ce sont plutôt des arguments pratiques établissant la
nécessité « subjective » de la foi dans le sens où l’agent moral doit croire en
l’immortalité de l’âme et en l’existence de Dieu afin de maintenir son engagement
dans la recherche du souverain Bien, c’est-à-dire afin de viser une fin sans croire
que cette fin est irréalisable. Ces arguments sont donc pratiques, dans le sens où
1. CRPr., AK V 114 ; OP II 747.
2. Ibid., AK V 115 ; OP II 748.
Épreuves
Theis (dir.), Kant - Théologie et religion
© Librairie Philosophique J. Vrin, 2013

158 RACHEL ZUCKERT
ils établissent certains présupposés de l’action, dans la poursuite de certains buts 1.
Leurs conclusions sont, en conséquence, « subjectives », à la fois parce qu’ils
concernent l’état d’esprit du sujet – il doit avoir de telles croyances – et parce
qu’ils constituent une manière possible de penser le monde (ou son action), non
pas une affirmation selon laquelle le monde serait (en fait) ainsi. Kant soutient
toutefois que ces croyances sont nécessaires à tout agent moral fini. Nous
sommes tous soumis aux obligations de la loi morale, et nous devons donc tous
adhérer aux postulats de la raison pratique.
L’ANTINOMIE « CACHÉE »
J’ai suggéré plus haut que cet argument était la « thèse » de l’antinomie
« cachée », ayant pour effet de rendre les postulats subjectivement nécessaires. Je
soutiendrai maintenant que son antithèse est suggérée dans les deux essais
postérieurs de Kant.
Dans La fin de toutes choses, Kant examine encore la question de
l’immortalité, et il critique l’idée de l’immortalité conçue précisément comme un
progrès sans fin.
Même si nous retenons au sujet de l’état moral et physique de l’homme en
cette vie la meilleure hypothèse, celle d’une progression et d’une approximation
constantes vers le souverain Bien (le but qui lui est fixé),
l’homme ne peut […] tirer son contentement [Zufriedenheit] de la perspective d’un
changement (moral aussi bien que physique) qui se prolonge éternellement. Car
l’état dans lequel il se trouve actuellement sera toujours mauvais lorsqu’on le
compare avec celui, meilleur, qu’il s’apprête à connaître ; et la représentation
d’une progression indéfinie vers le but final comporte en même temps aussi la
perspective d’une série indéfinie de maux qui, bien qu’ils soient compensés par
l’accroissement du bien, ne donnent pas lieu au contentement, dont l’idée même
exige que le but final sera finalement atteint 2.
Kant suggère qu’une immortalité conçue comme une progression sans fin
pourrait être vue, non comme une garantie que l’on pourrait atteindre par la vertu,
mais comme celle d’un effort éternel voué à l’échec : à chaque instant notre état
doit être considéré comme un mal relatif nécessitant encore amélioration. Le véri-
table accomplissement du but final est constamment repoussé. Ainsi l’immorta-
lité n’offre pas la possibilité d’une Zufriedenheit – la satisfaction d’avoir atteint la
vertu –, mais plutôt celle d’une éternelle insatisfaction. Donc contrairement à
l’antinomie officielle, le postulat de l’immortalité ne pourrait pas maintenir
l’engagement moral de l’agent dans l’action morale, mais risquerait plutôt de
1. Voir A. Wood, Kant’s Moral Religion, Ithaca, NY, Cornell, 2009, p. 17-34.
2. FIN, AK VIII 335 ; OP III 319.
Épreuves
Theis (dir.), Kant - Théologie et religion
© Librairie Philosophique J. Vrin, 2013

ANTINOMIES CACHÉES DE LA RAISON PRATIQUE 159
provoquer le désespoir et donc l’apathie morale ou bien « le mysticisme » 1 :
pourquoi s’engager dans cette entreprise vouée à l’échec qu’est la recherche de la
vertu ? Pourquoi ne pas plutôt désavouer ce but irréalisable, et concevoir le
souverain Bien autrement, peut-être en tant que contemplation de l’ordre du
monde tel qu’il est déjà ? Ainsi Kant suggère que le postulat de l’immortalité de
l’âme non seulement ne serait pas « subjectivement nécessaire » à l’engagement
moral du sujet, mais qu’il lui serait même nuisible.
Dans Sur l’échec de tout essai philosophique en matière de théodicée, Kant
discute plusieurs arguments de la théodicée, et comme son titre le suggère, il
soutient qu’ils échouent. Une des discussions en particulier aborde directement –
et contredit par là même – le raisonnement proposé dans l’antinomie officielle.
Parlant pour les adversaires de la théodicée, Kant fait remarquer qu’en fait nous
ne voyons pas la vertu être récompensée par le bonheur, c’est-à-dire que le
souverain Bien n’est pas réalisé dans le monde sensible, comme on pourrait s’y
attendre, si un Dieu tout-puissant et bienveillant avait créé le monde. D’ailleurs,
nous ne comprenons pas comment il pourrait être réalisé. Car la raison ne
découvre
aucun rapport […] entre les fondements internes de détermination du vouloir (à
savoir le mode de penser moral) selon des lois de la liberté, et les causes (externes
pour la plus grande part) indépendantes de notre volonté qui déterminent notre
bonheur d’après les lois de la nature 2.
La réponse de la théodicée à cette objection est, tout comme dans le
raisonnement de la résolution de l’antinomie officielle, de concevoir Dieu en tant
que créateur du monde dont la « sagesse artistique » dans l’organisation des lois
de la nature serait guidée par sa « sagesse morale » afin que le souverain Bien
puisse se réaliser 3. Cependant, Kant contredit son raisonnement de l’antinomie
officielle dans la suite. Car
de l’unité dans l’accord de cette sagesse artistique avec la sagesse morale en un
monde des sens, nous n’avons aucun concept, et nous ne pouvons même pas
espérer que nous en obtiendrons jamais. En effet, être une créature et, en tant
qu’être de nature, suivre simplement le vouloir de son auteur, mais être cependant,
comme être agissant librement (lequel être a une volonté indépendante de
l’influence extérieure, qui peut s’opposer de mainte façon au vouloir du créateur),
susceptible d’impu-tation, et considérer cependant son propre fait comme étant
l’effet d’un être supérieur : c’est une unification de concepts que nous devons
assurément penser ensemble dans l’idée d’un monde à titre du souverain Bien.
Mais celui-là seul peut la pénétrer qui se fraie un chemin jusqu’à la connaissance
du monde suprasensible (intelligible) et qui pénètre la manière dont ce monde
1. Ibid., AK VIII 335 ; OP III 319.
2. EET, AK VIII 262 ; OP II 1402.
3. Cf. EET., AK VIII 263 ; OP II 1403.
Épreuves
Theis (dir.), Kant - Théologie et religion
© Librairie Philosophique J. Vrin, 2013
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%