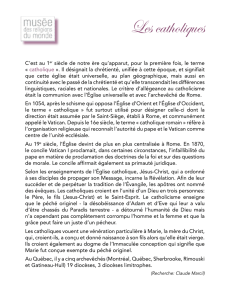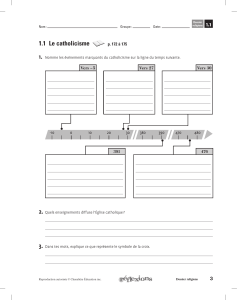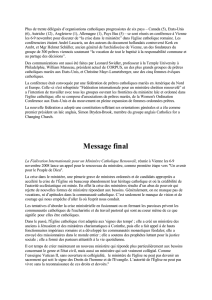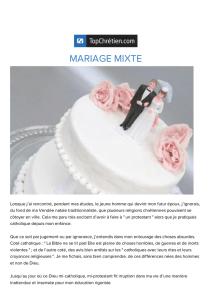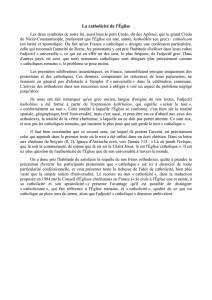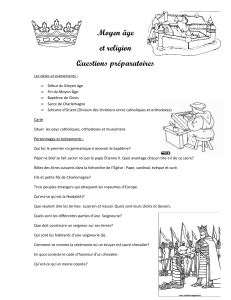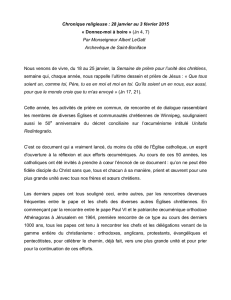Constitution belge et libéralisme : Réflexions historiques
Telechargé par
Koenraad Moreau

L’arche sainte de l’erreur libérale
[Réflexions sur la Constitution belge]
par Pierre Moreau, 23 octobre 1975
On rencontre fréquemment l’opinion selon laquelle la Constitution, dont l’État belge est doté depuis
1831, fut à l’origine d’une véritable renaissance dans tous les domaines de la vie sociale, pour les
provinces méridionales des Pays-Bas. Celles-ci venaient de s’établir, l’année précédente, dans
l’indépendance. « Des siècles et des siècles d’esclavage », dit la chanson, débouchaient enfin, grâce à
la loi fondamentale en question, sur la paix, la prospérité, la concorde et, bien sûr, la liberté. Selon
cet avis très répandu, il faudrait donc souscrire sans réserve à la déclaration du ministre catholique
Jules Malou, du 1er décembre 1875, devant la Chambre :
« La Constitution, mais c’est elle seule qui est pour nous un rempart contre les atteintes indirectes que l’on
porte tous les jours à nos libertés constitutionnelles ! Nous l’aimons comme le soldat aime son arme,
comme nous aimons la forteresse qui nous sert d’abri. »
Le sens évident de ce morceau d’éloquence parlementaire est le suivant : la Constitution belge est un
document exemplaire, le seul garant d’une organisation sociale acceptable et souhaitable par des
hommes libres.
L’année dernière encore, la revue française Permanences publiait en son numéro 112 d’août-
septembre 1974 une étude intitulée « Les catholiques belges face à la Constitution : participer ou se
retirer ? » Rédigé par feu le comte Capelle, ce texte fourmille, paraît-il, de leçons profitables. Quoi
qu’il en soit, le sujet est important. Toujours actuel, il n’est pas circonscrit aux événements qui ont
fait naître la loi fondamentale, ni aux controverses extrêmement animées et même acerbes
auxquelles cette loi a donné lieu dans les milieux catholiques belges. La Constitution se rapporte à de
nombreuses questions que la doctrine sociale de l’Église ne permet pas à chacun de trancher à sa
guise. Les constituants belges furent des précurseurs et ils furent universellement imités. L’influence
qu’ils exercèrent par là est d’autant plus importante qu’ils étaient en grande majorité catholiques. Il
ne fait aucun doute que leur comportement détermine celui de générations entières d’hommes
politiques d’obédience catholique qui, à l’origine, se référaient explicitement à ce précédent mais
qui, plus tard, continuèrent à en recevoir l’impulsion, tacite mais indéniable. Il n’est donc pas
inopportun de faire sur la Constitution belge quelques réflexions.
Les antécédents historiques
Depuis 1579, par l’affiliation des princes catholiques à la Confédération d’Arras en vue de faire pièce
aux princes protestants groupés dans l’Union d’Utrecht, les « Pays de par-deçà » se trouvaient divisés
en deux : protestants au nord et catholiques au sud. Ceux-ci purent continuer, sous la conduite de
leurs seigneurs naturels, à jouir des libertés ancestrales qui leur étaient traditionnellement et
effectivement garanties par les chartes, franchises, joyeuses entrées et constitutions nombreuses qui
obligeaient lesdits princes. En 1648, au terme de la guerre de Trente Ans, les traités de Westphalie,
ou plus exactement le traité de Munster, allait, d’une manière très moderne, consacrer
l’ « indépendance » des provinces rebelles du nord. Au siècle suivant, sous le régime autrichien, les
idées des « philosophes » s’introduisirent dans les provinces méridionales et y accomplirent leur
travail de sape parmi l’aristocratie, la bourgeoisie et, bien entendu, le clergé (cfr Bertrand Van der

Schelden, La Franc-Maçonnerie belge sous le régime autrichien, Uystpruyst, Louvain 1923). Mais les
institutions sociales se maintenaient et, avec elles, chez le peuple, la foi et les mœurs. La Révolution
brabançonne, en 1789, sous la direction de Vonck et Van der Noot, ne constitue qu’un intermède,
une réaction assez brouillonne de quelques-uns contre le caractère tracassier des ordonnances de
Joseph II. Elle ne constitue nullement un acte d’opposition de principe ; contrairement à ce que l’on a
prétendu et que l’on prétend encore, elle n’exprime aucunement une volonté de retour aux
traditions sociales héritées de la chrétienté. La France conventionnelle allait régler la question en
annexant purement et simplement les provinces belges qui furent réduites, durant vingt ans, à la
condition de neuf départements français. Après l’écroulement de l’Empire, leur sort fut fixé
d’autorité par le traité de Paris [30 mai 1814]. Elles servirent à accroître le royaume de Georges-
Frédéric d’Orange-Nassau, qui régna sous le nom de Guillaume Ier. Le traité de Vienne, en 1814, selon
lequel les chancelleries remodelaient l’Europe à leur guise, décréta qu’une constitution serait
attribuée par les Hollandais au nouveau Royaume des Pays-Bas, de commun accord avec les Belges.
La commission qui élabora la loi fondamentale des Pays-Bas fut d’avis de régler séparément les
intérêts religieux de la Belgique catholique et ceux de la Hollande protestante. Elle émit comme
résolution, en attendant un concordat avec le Saint-Siège :
« que la religion catholique, apostolique et romaine continuera à jouir de tous les droits, usages et
coutumes ainsi que de sa hiérarchie, dans les provinces méridionales, dont elle a joui sous ses princes
souverains catholiques conformément aux lois et concordats.
1
. »
Cette commission, composée pour moitié de Belges et pour moitié de Hollandais, était d’avis de
consulter le Souverain Pontife. Un premier projet, non publié, fut approuvé par le roi. Mais bientôt
survint la victoire des armées alliées à Waterloo, qui eut pour effet d’affermir l’autorité de Guillaume
et d’attiser son sectarisme calviniste. Il fit secrètement remanier le projet constitutionnel, mais
plusieurs dispositions de la nouvelle mouture parvinrent à la connaissance des évêques qui, sous la
conduite morale de l’évêque de Gand, Monseigneur de Broglie, transmirent au roi, à leur sujet, des
représentations respectueuses. Ce fut sans effet. Cinq jours plus tard, le 2 août 1815, Monseigneur
de Broglie publia une instruction pastorale dont il n’est pas sans profit de méditer cet extrait :
« Quels justes reproches n’aurait-on pas à nous faire dans la suite si, lorsqu’il était encore en notre pouvoir
d’empêcher les ouailles qui nous sont confiées, de tomber dans un précipice, dont il leur serait ensuite
devenu impossible de sortir, nous aurions, par une lâche condescendance, trahi un de nos devoirs les plus
sacrés ? Que nous resterait-il alors, sinon de nous écrier avec le prophète : ‘Malheur à moi, parce que j’ai
gardé le silence ! »
Grâce à cette intervention vigoureuse, la loi fondamentale fut rejetée par une majorité de 269 voix.
« Le rejet de la loi était d’autant plus significatif, remarque Th. Abner
2
, que les membres du clergé, qui
formait autrefois le premier ordre dans l’État, n’avaient pas été compris parmi les notables chargés
d’accepter ou de rejeter la loi fondamentale. Ces notables étaient nommés par le roi ; ils étaient loin d’être
tous recommandables par leur religion, leur science et leur probité ; les uns étaient imbus des erreurs
philosophiques en vogue ; d’autres étaient des acquéreurs de biens ecclésiastiques ; d’autres enfin, bien
qu’honnêtes, manquaient du courage et de l’intelligence qu’exigeaient les circonstances.»
Guillaume ne manqua pas de reconnaître que le projet de constitution avait échoué sur la question
religieuse, ou, pour reprendre ses propres termes, « sur les articles relatifs au culte ». Mais il imputait
1
Théodore Abner, Études sur le catholicisme libéral et le serment constitutionnel, Van Cortenbergh, Bruxelles,
1878, p. 148.
2
Loc. cit. p. 129.

son échec à l’intervention néfaste et perturbatrice « de quelques hommes de qui le corps social
devait au contraire attendre l’exemple de la charité et de la tolérance évangéliques ».
Quels étaient donc ces « articles relatifs au culte », qui constituaient le cœur du litige ? C’étaient,
d’après le « Jugement doctrinal sur le serment prescrit par la Constitution », document publié
conjointement par tous les évêques belges, les articles suivants :
Art. 190 — La liberté des opinions religieuses est garantie à tous.
Art. 191 — Protection égale est accordée à toutes les communions religieuses qui existent dans le
royaume.
Art. 192 — Tous les sujets du roi, sans distinction de croyance religieuse, jouissent des mêmes droits civils
et politiques, et sont habiles à toutes les dignités et emplois quelconques.
Art. 193 — L’exercice public d’aucun culte ne peut être empêché, si ce n’est dans le cas où il pourrait
troubler l’ordre et la tranquillité publique.
Art. 196 — Le roi veille à ce que tous les cultes se contiennent dans l’obéissance qu’ils doivent aux lois de
l’État.
Que pouvait encore faire Guillaume devant le refus des notables et l’opposition vigoureuse des
évêques ? Passer outre. C’est ce qu’il fit en prenant un arrêté, le 24 août 1815, par lequel il décrète
formellement que le projet de loi qui avait été remis de sa part aux états généraux et aux notables
aura force de constitution pour le royaume. En vertu d’une conception très calviniste de la charité et
de la tolérance évangéliques, il n’eut de cesse que Monseigneur de Broglie, qu’il considérait à juste
titre comme son plus redoutable adversaire en cette affaire, ne fût destitué de son siège épiscopal et
banni. L’évêque devait en effet mourir en exil à Paris en 1821.
Tous les prélats n’avaient pas même rigueur. Et notamment le prince de Méan, qui devait être appelé
en 1817 au siège de l’archevêché de Malines. Guillaume l’avait nommé comme membre de la
première Chambre des états généraux en 1815, sans doute en raison de ce caractère ondoyant
auquel il rendait expressément hommage, dans une lettre qu’il lui adressait dès le 16 septembre
1815 et où il écrivait notamment :
« Protéger l’entière liberté des cultes existants est un des principaux devoirs que la Constitution m’impose,
et, à moins de méconnaître l’esprit de la Constitution et de mal interpréter les expressions y contenues, on
ne peut craindre que ceux qui s’obligent avec moi à l’observer et à la maintenir soient jamais dans le cas de
porter la moindre atteinte aux dogmes et à la discipline de l’Église catholique. En hâtant par vos leçons et
votre exemple l’époque où cette conception sera universelle, vous rendrez un vrai service à la patrie, et
vous acquerrez de nouveaux titres à mon estime. »
Méan prêta le serment constitutionnel et ne consentit jamais à apporter à ce serment les restrictions
univoques que pourtant le Saint-Siège avait réclamées de lui avant de le nommer au siège de
Malines. Toute sa souplesse ne devait pas lui épargner la disgrâce de Guillaume. Si bien que l’on
retrouva Monseigneur de Méan dans le camp des opposants au roi en 1830. Il mourut subitement en
1831, à la veille de la naissance de cette Constitution belge qu’il avait patronnée par son exemple.
D’une constitution à l’autre
La comparaison entre le texte de la Constitution de Guillaume et celle du Congrès est tellement riche
d’enseignements de toutes sortes, que l’on peut s’étonner de voir une personnalité comme le Comte
Capelle, dans le document mentionné plus haut, ne pas y prêter une attention sérieuse. À première
vue, pourtant, le changement radical de l’attitude des notables en ce court laps de temps de seize

années, devant la question identique des rapports entre l’Église et l’État devrait pousser un esprit
curieux à quelque enquête. Comment expliquer que, d’une part en 1815, une assemblée composée
comme on l’a vu refusât, et que, d’autre part en 1831, une autre assemblée à majorité de
catholiques acceptât avec enthousiasme de rejeter l’Église et toute préoccupation religieuse hors de
la vie politique ? Ce qui était proposé aux uns comme aux autres était ni plus ni moins que la
laïcisation de l’État et l’introduction, dans les lois, de ce qu’on persiste à appeler — non sans quelque
noire ironie — les libertés modernes. La perplexité s’accroît si l’on observe que, sous le régime
hollandais, les notables étaient l’objet de pressions, tandis que ceux qui siégeaient au Congrès
comme constituants avaient accepté librement de reprendre à leur compte ce contre quoi les Belges
prétendaient et prétendent encore s’être révoltés en 1830.
Tout s’explique dès qu’on décèle la modification, d’un cas à l’autre, de deux éléments de la situation.
Le premier, le plus déterminant, est la fermeté doctrinale de Monseigneur de Broglie en 1814, qui fit
place au laxisme de Monseigneur de Méan en 1830. Sous l’impulsion de l’évêque de Gand, les chefs
des diocèses avaient, le 28 juillet 1815, adressé au roi une réclamation conçue en ces termes :
« Sire, l’état de la religion et les libertés de l’Église catholique dans cette partie de votre royaume ne
peuvent subsister avec un des articles du projet de la nouvelle Constitution en vertu duquel une protection
et une faveur égales sont accordées à tous les cultes.
« Jamais, depuis la conversion des Belges au christianisme, on n’a introduit cette dangereuse nouveauté
dans ces provinces que par la violence
3
. »
C’était là une fin de non-recevoir on ne peut plus nette. Les évêques s’opposaient aux principes,
comme le veut et l’enseigne la morale catholique depuis les temps apostoliques.
En 1825, Guillaume prit des arrêtés relatifs à l’instruction publique. C’était fort habile, parce qu’il
savait que, sous la conduite d’un archevêque libéral, l’opposition des catholiques se fixerait et
s’épuiserait sur les modalités de leur soumission pratique aux idées modernes. Guillaume avait eu
l’occasion d’apprécier l’attachement de ses nouveaux sujets à la religion qu’il détestait, à la fois
comme protestant et comme protecteur émérite de la franc-maçonnerie
4
. Il se souvenait de son
échec à leur faire accepter les principes nouveaux, ouvertement présentés comme tels. Cette fois, il
s’y prendrait d’une autre manière en vue d’effacer insensiblement la marque catholique. Et, en effet,
encore sous l’empire des lumineux et solides enseignements de l’ancien évêque de Gand :
« notre clergé, écrit Gerlache, tenait le même langage que Mgr de Broglie en 1815, avec cette différence
que Mgr de Broglie repoussait la loi fondamentale et qu’en 1825 on s’y soumettait, mais en persistant à se
tenir toujours en dehors. Il faut noter ces nuances et les transitions habilement ménagées, si l’on veut se
rendre bien compte du changement profond qui s’opère en peu de temps dans I’attitude et les sentiments
des catholiques
5
. »
Oui, ce changement profond dans l’attitude et les sentiments des catholiques, voilà le deuxième
élément qui devait amener les constituants belges à appeler de leurs vœux l’inscription dans la loi de
ces libertés oppressives contre lesquelles ils s’étaient, prétendument, insurgés quelques mois plus
tôt, lors de la « révolution » de 1830. Blanc de Saint-Bonnet devait écrire à propos de ce
phénomène :
3
Th. Abner, La Constitution belge, Van Cortenbergh, Bruxelles, 1875, p. 12.
4
Woordenboeck voor vrijmetselaren, Brinkman, Amsterdam, s.d., tome III, pp. 25-27.
5
Cité par Th. Abner, Le Catholicisme libéral, p. 131.

« Ce fut seulement à partir de 1830, qu’à la suite de M. de Lamennais on vit des esprits religieux céder à
l’illusion du libéralisme. Aussi, tout en croyant porter la Foi au sein des idées libérales, un certain nombre,
comme on le sait, y ont perdu la leur. Lorsque les idées libérales et les idées chrétiennes pénètrent à la fois
dans la même tête, les idées libérales finissent ordinairement par étouffer les idées chrétiennes
6
. »
Il n’y avait plus, pour les ennemis de l’Église, qu’à laisser se dérouler le processus désormais
indépendant des meilleures intentions chez les personnes qui y prenaient part. C’est une méthode
contre laquelle les victimes restent sans défense. Le baron de Gerlache, qui avait présidé le Congrès
(mais qui abjura le libéralisme lorsque l’encyclique Mirari vos en 1834 lui eut ouvert les yeux), était
particulièrement bien placé pour en analyser les effets :
« Il y a quelque chose de pire que le despotisme, écrivait-il, c’est l’excès de la liberté. Le despote opprime
et persécute ceux qui lui sont opposés ; mais l’absence de frein déprave en peu de temps toute une
population. L’autorité trop absolue abuse de sa force, mais elle contient et elle effraie les malveillants ;
tandis que l’esprit démagogique conduit au relâchement de tous les liens politiques et moraux en
favorisant l’anarchie. On peut opposer la patience au despote, on attend qu’il change ou qu’il passe ; mais
la licence populaire ne laisse après elle que des ruines. Quand on peut tout dire et tout écrire, on peut tout
faire : les mauvaises pensées sont mères des mauvaises actions ; c’est ainsi qu’on arrive, sous couvert de
liberté, à la dissolution complète de la société et de la religion. Quoiqu’on nous dise merveille des progrès
de l’intelligence humaine, les premières vertus de ce monde seront toujours la foi, l’espérance, la charité et
la soumission aux puissances. Ce n’est pas à des prêtres qu’il appartient de changer cet ordre divin
7
. »
Ce n’est pas pour rien que Gerlache s’en prend, en passant, aux prêtres libéraux. Il les connaissait
pour les avoir vus à l’œuvre dans l’assemblée qu’il présidait et où ils siégeaient au nombre de treize
parmi les constituants.
Le plus grand malheur
« Surtout, écrivait Monseigneur de Ségur dans son petit ouvrage sur Le Libéralisme catholique,
méfiez-vous grandement des ecclésiastiques imbus de libéralisme. » Et, à ce propos, il cite la
réflexion suivante, faite par Pie IX à un évêque de France :
« Le plus grand malheur qui puisse arriver à un chrétien laïque, c’est d’avoir pour conseiller et ami un
prêtre de mauvaise doctrine. Un prêtre qui a de mauvaises mœurs, on le méprise, on le repousse, mais un
prêtre qui a de mauvaises doctrines, il vous séduit d’autant plus facilement que ses opinions flattent les
idées du jour
8
. »
Depuis un siècle que ces réflexions ont été publiées, les occasions n’ont pas manqué aux catholiques
de vérifier leur bien-fondé. Et l’on pourrait même ajouter, sans crainte de trahir la pensée du
Souverain Pontife, que le plus grand malheur, pour un diocèse ou pour un peuple, est d’être
gouverné par un évêque gagné aux idées modernes. Le règne de prélats libéraux fit lever un clergé
ivre d’esprit révolutionnaire. Écoutez ce langage de forcené, c’est celui de l’abbé Mathan s’adressant
au Congrès en 1830 :
« Une fois qu’un peuple s’est soulevé, qu’il a brisé ses fers, qu’il ne veut plus de ses oppresseurs, qu’il a
accompli sa légitime révolution, alors, Messieurs, sa volonté est sa raison ! Son courroux est la justice ! »
Et encore :
6
Cité par Th. Abner, loc. cit., p. 40.
7
Cité par Th. Abner, loc, cit., p. 132.
8
Cfr Th. Abner, Histoire du peuple de Dieu, Vancortenbergh, Bruxelles, 1877, p. 108.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
1
/
15
100%