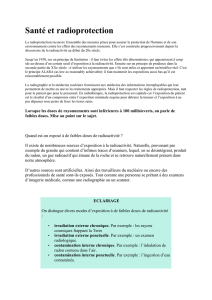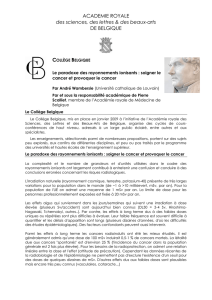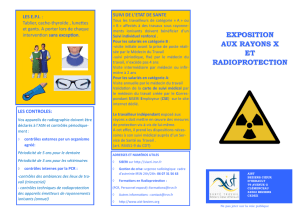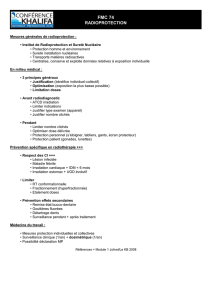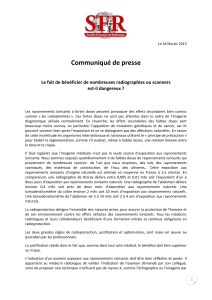Le
ManiDuMeur
d
'imagerie
médicale
M.
et
de
radiothérapie
RAYONNEMENTS
IONISANTS
ET
RADIOPROTECTION
,
,
SOCIETE
FRANÇAISE
DE,
RADIOLOGIE
SQQETE
FRANÇAISE
DE
RADIOTHERAPIE,ONCOLOGIQUE
SOCIETE
FRANÇAISE
DE
BIOPHYSIQUE
ET
MEDECINE
NUCLEAIRE
OFFICE
DE
PROTECTION
CONTRE
LES
RAYONNEMENTS
IONISANTS
CENTRE
ANTOINE
BECL^RE
DCIATION
FRANÇAISE
DU
PERSONNEL
PARAMEDICAL
D'
E
LECTROR
ADIOLOGI
E

-RAYONNEMENTS
IONISANTS
ET
RADIOPROTECTION-
Editorial
RESPECTER
ET
FAIRE
RESPECTER
LES
TEXTES
...
C'EST
DEJA
FAIRE
DE
LA
RADIOPROTECTION
!
L
es
rayonnements
ionisants
et
la
radioactivité
sont
des
thèmes
fami-
liers
aux
manipulateurs
d'électroradiologie
médicale.
Nous
avons
acquis
des
connaissances
spécifiques
et
un
savoir-faire
reconnus
dans
les
différents
domaines
de
l'utilisation
médicale
des
rayonnements
ionisants
et
de
la
radioprotection,
qui
font
de
nous
en
la
matière,
des
référents
indiscutables
pour
nos
autres
collègues
paramédicaux.
L'utilisation
médicale
constitue,
faut-il
le
rappeler,
la
source
d'exposition
artificielle
la
plus
importante
pour
la
population
et
pour
les
travailleurs.
Notre
rôle
essentiel,
en
matière
de
radioprotection
au
sein
de
notre
sys-
tème
de
santé,
a
été
de
nombreuses
fois
pris
en
compte
et
enrichi
par
le
législateur,
à
savoir
:
•
Le
décret
n°
86-1103
du
20
Octobre
1986
relatif
à
la
protection
des
tra-
vailleurs
contre
les
dangers
des
rayonnements
ionisants,
qui
a
institu-
tionnalisé
"la
personne
compétente
en
radioprotection".
Le
fait
que
de
nombreux
M.E.R.M.
aient
été
nommés
-
après
formation
-
dans
cette
fonction
est
une
véritable
reconnaissance
de
notre
professionnalisme
dans
ce
domaine
;
•
Les
décrets
n°
90-705
du
1er
Août
1990
et
n°
92-176
du
25
Février
1992
étendant
la
durée
de
notre
formation
initiale
à
trois
années
d'études,
pour
accroître
et
approfondir
nos
connaissances
;
•
La
loi
n°
95-116
du
4
Février
1995
inscrivant
notre
profession
au
Code
de
la
Santé
Publique,
et
protégeant
notre
exercice
professionnel,
fruit
d'une
formation
qualifiante
;
•
Enfin,
plus
récemment,
le
décret
n°
97-1057
du
19
Novembre
1997
qui
reconnaît,
entre
autres,
notre
rôle
spécifique
en
radioprotection
et
en
contrôle
de
qualité.
Parallèlement,
et
c'est
heureux,
les
dispositions
législatives
et
réglemen-
taires
relatives
à
la
radioprotection
évoluent.
C'est
ainsi
qu'à
compter
du
13
Mai
2000,
grâce
à
la
transposition
de
deux
directives
européennes
dans
le
droit
français,
la
réglementation
de
l'exposition
du
personnel,
de
la
popu-
lation
et
des
patients
sera
modifiée.
Une des
principales
nouveautés
est
la
nécessité
d'évaluer
les
doses
délivrées
aux
patients
et
de
les
optimiser
au
niveau
le
plus
faible
possible
pour
obtenir
l'information
diagnostique
requise.
Ce
processus
dépend
des
choix
médicaux,
des
performances
techniques
du
matériel
utilisé,
et
bien
entendu,
de
la
compétence
du
personnel
qui
réalise
l'examen.
Nos
connaissances
reconnues
dans
les
domaines
de
la
technologie
de
l'image,
du
contrôle
de
qualité
et
de
la
radioprotection,
et
notre
position
d'interface
entre
le
patient
et
la
machine
font
des
professionnels
que
nous
sommes,
les
personnages-clefs
dans
la
mise
en
oeuvre,
en
parte-
nariat
avec
d'autres
acteurs,
des
programmes
d'assurance
qualité
impo-
sés
par
les
textes
précités.
Faut-il
redire
ici
que
nous
sommes
les
seuls
paramédicaux
à
recevoir
une
formation
initiale
nous
permettant
l'appli-
cation
optimale
de
telles
procédures,
dans
le
souci
constant
de
la
réduc-
tion
des
doses
souhaitée
par
le
législateur.
Formation
que
nous
devons
compléter
tout
au
long
de
notre
carrière
pour
appliquer
au
quotidien
et
de
façon
parfaite
les
dispositions
européennes.
En
ma
qualité
de
Président
de
l'A.FP.P.E.,
je
suis
convaincu
que
chaque
manipulatrice
et
manipulateur
aura
à
cœur
d'être
un
acteur
reconnu
dans
le
domaine
de
la
radioprotection
tout
au
long
de
sa
vie
professionnelle.
Si
ce
numéro
spécial
de
la
"Revue
du
Manipulateur"
apporte
à
chacun
quelques
outils
supplémentaires
pour
affiner,
enrichir
et
consolider
ses
connaissances,
alors
notre
objectif
sera
atteint.
Cette
revue
n'aurait
pas
pu
voir
le
jour
sans
la
coopération
et
le
soutien
actif
du
Comité
d'Information
des
Professions
de
Santé
d'E.D.F,
des
médecins
et
experts
qui
ont
accepté
d'apporter
leur
contribution.
En
votre
nom
à
tous,
je
leur
adresse
notre
profonde
gratitude
et
nos
plus
sincères
remerciements.
GUY
SOURY
Président
National
de
l'A.F.P.P.E.
Cette
brochure,
placée
sous
l'égide
du
Professeur
M.
TUBIANA,
membre
de
l'Académie
des
Sciences
et
de
l'Académie
de
Médecine,
Président
dti
centre
A.
Béclère,
a
été
rédigée
sous
la
responsabilité
du
Professeur
C.
VROUSOS,
Service
de
Cancérologie-
Radiothérapie,
CHU
de
Grenoble,
par
un
groupe
de
travail
associant
des
manipulateurs
en
électroradiologie
médicale,
des
médecins
spécialistes
et
des
experts
nationaux.
Comité
de
rédaction
•
Mr
A.
Biau.
Sous-directeur
chargé
de
la
radioprotection.
OPRI.
Le
Vésinet.
•
Pr
A.
Bonnin.
Chef
du
service
de
radiologie
A,
PU.PH
d'imagerie
médicale,
CHU
Cochin,
Paris.
•
Pr
M.
Bourguignon.
Directeur
médical
et
de
la
Recherche.
OPRI.
Le
Vésinet.
•
MrJ.P.
Chaussade.
Conseiller
technique,
Direction
de
la
Communication,
E.D.F.,
Paris.
•
Dr
H.
Cassagnou.
Direction
médicale.
OPRI.
Le
Vésinet.
•
Mr
P.
Cillard.
Unité
de
radioprotection.
Groupe
hospita-
lier
Pitié
Salpétrière.
Paris.
•
Pr
Y.S.
Cordoliani.
Service
de
radiologie.
HIA
du
Val
de
Grâce.
Paris.
•
Mr
J.-M.
Debaets.
Directeur
de
la
rédaction
du
Manipulateur
d'imagerie
médicale
et
de
radiothérapie.
Paris.
•
Mr
R.
Dollo.
Ingénieur.
Service
de
radioprotection.
EDF.
Paris.
•
Mr
P.
Fraboulet.
Unité
de
radioprotection.
Groupe
hos-
pitalier
Pitié
Salpétrière.
Paris.
•
Dr
C.
GaUin-Martel.
Information
des
professions
de
santé.
SCAMT-
SRP-
EDF,
Grenoble.
•
Dr.
V.
Hazebroucq.
Maître
de
conférences
des
universi-
tés,
praticien
hospitalier.
CHU
Cochin,
AP-HP,
Université
Paris
V
René
Descartes.
Paris.
•
Dr
G.
Herbelet.
Praticien
hospitalier.
Médecine
nucléaire.
CH
Saint
Germain
en
Laye.
•
Dr
H.
Kolodié.
Praticien
hospitalier.
Cancérologie
-
radiothérapie.
CHU
Grenoble
•
Pr
M.
Labrune.
Service
de
radiologie.
Hôpital
Antoine
Béclère.
Clamart.
•
Dr
J.
I
.allemand
Service
de
radioprotection.
EDF,
Paris.
•
Mr
F.
Mausoléo.
Unité
de
radioprotection.
Hôpital
A.
Béclère.
Clamart.
•
Mr
J.
Musnier.
Radioprotection.
CHU
Reims.
•
Mr
J.M.
Pugin.
Directeur
de
l'institut
de
formation
de
manipulateurs
du
CHU
de
Nancy.
Secrétaire
Général
du
Comité
d
Harmonisât
ion
des
Centres
de
Formation
des
Manipulateurs
•
MrJ.P.
Vidal.
Sous-directeur.
Responsable
du
contrôle
des
installations.
OPRI.
Le
Vésinet.
Comité
des
experts
et
personnalités
associés
•
Pr
J.C.
Artus.
Médecine
nucléaire.
CRLC.
Val
d'Aurelle.
Paul
Lamarque.
Montpellier.
•
Pr
A.
Aurengo.
Médecine
nucléaire.
Hôpital
de
la
Pitié
Salpétrière.
Conseil
Supérieur
d'Hygiène
Publique
de
France.
Paris.
•
Pr
M.
Carsin.
Président
du
Syndicat
des
Radiologues
Hospitaliers.
Rennes.
•
Dr
J.-F.
Cholat.
Chef
du
SCAMT
E.D.F-G.D.F.
Paris.
•
Pr
J.-M.
Cosset.
Département
de
radiothérapie.
Institut
Curie.
Paris.
•
Dr
L.
Court.
Maître
de
Recherches
du
Service
de
santé
des
Armées.
Chef
du
Service
de
radioprotection.
E.D.F.
Paris.
•
Pr
F.
Eschwège.
Secrétaire.
Société
Française
de
Radiothérapie
Oncologique.
Département
de
radiothérapie.
IGR.
Villejuif.
•
Dr
M.
Fatome.
Médecin-chef
des
services.
Sous-direc-
teur
chargé
des
questions
scientifiques.
Centre
de
recherche
du
service
de
santé
des
armées.
Grenoble.
•
Dr
A.
Flury-Herard.
Direction
des
Sciences
du
Vivant
CFA.
Paris.
•
Dr
D.
FoUiot.
Médecin
coordonnateur
E.D.F
-
G.D.F.
Paris.
•
Pr
G.
Frija.
Secrétaire
général.
Société
Française
de
Radiologie.
Paris.
•
Pr
P.
Galle.
Laboratoire
de
biophysique
SC27
de
l'INSERM.
Université
Paris
Val-de-Marne.
Membre
corres-
pondant
de
l'Académie
des
Sciences.
Conseil
Supérieur
d'Hygiène
Publique
de
France.
•
PrJ.P.
Gérard.
Radiothérapie
-
oncologie.
CHU
Lyon
-
Sud.
Doyen
de
la
Faculté
de
Médecine.
•
Pr
G.
Kalifa.
Société
Française
de
Radiologie.
Hôpital
Saint-Vincent
de
Paul.
Paris.
•
Pr
J.F.
Lacronique.
Président
du
Conseil
d
Administration.
OPRI.
Le
Vésinet.
•
Pr
X.
Marchandise.
Président
de
la
Société
Française
de
Biophysique
et
Médecine
Nucléaire.
Lille.
•
Dr
J.-F.
Mazoyer.
Président.
Fédération
Nationale
des
Médecins
Radiologues.
Paris.
•
Pr
P.
Rouleau.
Président.
Collège
des
Enseignants
de
Radiologie
de
France.
Tours.
•
Mr
G.
Soury.
Président
de
l
Association
française
du
personnel
paramédical
d'électroradiologie
-
Gisors.
2
Le
Manipulateur
-
n°
spécial
-
A.F.P.RE.
Septembre
1999.

RAYONNEMENTS
IONISANTS
ET
RADIOPROTECTION
Sommaire
1.
Naissance
et
décroissance
de
la
dose
maximale
admissible
p
4
2.
Principales
unités
utilisées
en
radioprotection.
Sources
des
rayonnements
ionisants
p
5
3.
Les
effets
des
rayonnements
ionisants
p
9
4.
Doctrine
de
la
radioprotection
p
1
1
5.
A
propos
de
l'irradiation
médicale
et
Directive
Européenne
97/43
Euratom
du
30
Juin
1997
p
13
6.
La
réglementation
de
la
radioprotection
p18
7.
Les
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement
p
21
8.
Contrôles
réglementaires
de
radioprotection
p
22
9.
Contrôles
de
qualité
des
appareillages
et
radioprotection
en
imagerie
par
rayons
X
p
24
10.
Le
système
national
de
matériovigilance
p
26
11.
Exemples
d'exposition
du
personnel
...
p
27
12.
Surveillance
dosimétrique
des
travailleurs
p
31
13.
Radiologie
et
dose
patient
:
exemples
de
doses
délivrées
p
33
14.
Conduite
à
tenir
chez
la
femme
enceinte
p
35
15.
Sources
non
scellées
et
déchets
radioactifs
hospitaliers
p
36
16.
Déchets
nucléaires
p
38
17.
Expositions
accidentelles
aux
rayonnements
ionisants
p
41
18.
Le
manipulateur
en
électroradiologie,
acteur
de
santé
publique
p
45
19.
Formation
des
manipulateurs
en
électroradiologie
médicale
et
radioprotection
p
46
20.
Comment
situer
l'importance
d'une
dose
d'irradiation
?
p
48
Conclusion
p
49
Bibliographie
p
50
N
ous
sommes
très
heureux
de
présenter
aujourd'hui
la
brochure
"Manipulateurs
en
électroradiologie
médicale
-
rayonnements
ionisants
et
radioprotection",
destinée
à
nos
collaborateurs
au
quotidien
pour
satisfaire
leur
demande.
Cette
profession,
reconnue
officiellement
et
inscrite
depuis
1995
au
Code
de
la
Santé
est
très
profondément
convaincue
de
son
rôle
dans
la
limitation
de
la
dose
délivrée
au
patient
dans
l'esprit
de
la
directive
européenne
qui
définit
une
ligne
de
conduite
cohérente
vis-à-vis
de
l'utilisation
des
rayonnements
ionisants
en
médecine.
Malgré
la
diversité
de
leur
action
dans
les
services
d'imagerie
médicale,
de
radiothérapie
et
de
médecine
nucléaire,
leur
formation
initiale
et
leurs
modalités
d'exercice
comportent
un
dénominateur
commun,
celui
de
l'assurance
qualité,
l'application
des
principes
de
justification
et
d'optimisation
pour
la
réduction
des
doses
d'irradiation
aux
patients,
au
personnel
et
à
eux-mêmes.
Dans
ce
document
sont
présentés,
de
façon
synthétique,
les
risques
liés
aux
rayonnements
ionisants
et
les
raisons
qui
ont
amené
à
faire
évoluer
la
réglementation.
Les
aspects
plus
pratiques
du
contrôle
de
qualité,
des
expositions
du
personnel
et
des
patients
sont
ensuite
développés
pour
conclure
sur
les
aspects
de
formation.
Les
situations
accidentelles
sont
abordées
de
façon
succincte.
Nous
souhaitons
que
ce
travail
coopératif
réponde
à
leur
attente.
PR
CONSTANTIN
VROUSOS,
PR
GABRIEL
KALIFA
Photo
de
couverture
:
l'âge
de
la
Terre
(photographiée
par
le
satellite
Météosat)
a
pu
être
estimé
grâce
à
la
radioactivité,
tout
comme
celui
de
l'ensemble
du
système
solaire.
Tirage
:
25
000
exemplaires
A.F.P.P.E.
-
Boîte
Postale
n°
09
-
75622
PARIS
CEDEX
13
Directeur
de
la
Rédaction
:
Jean-Marc
DEBAETS
Tél.
+
Fax
:
01.39.87.54.40
-
E-mail
:
Impression
:
La
Touraine
Roto
1
6
Vincent
-
Tours
Réalisation
:
Graphisme
Jérôme
Poitte
Dépôt
légal
3e
trimestre
1
999
-
Commission
paritaire
n°
77365
AS
Le
Manipulateur
-
n°
spécial
-
A.F.P.P.E.
Septembre
1999.

RAYONNEMENTS
IONISANTS
ET
RADIOPROTECTION
1
.
Naissance
et
décroissance
de
la
dose
maximale
admissible
Pr
Yves-Sébastien
CORDOLIANI
L
a
dose
maximale
admissible
(DMA)
est,
à
l'origine
"la
dose
de
rayonnements
ionisants
qui
ne
doit
causer
aucune
lésion
corporelle
appréciable
chez
une
personne
exposée,
à
aucun
moment
de
sa
vie".
On
l'utilise
comme
norme
pour
le
contrôle
d'exposition
des
professions
exposées.
C'est
un
équivalent
de
dose
annuel,
représentant
une
limite,
dont
le
respect
est
contrôlé
par
la
dosimétrie
réglementaire
des
person-
nels
exposés.
Il
s'agit
cependant
d'une
dose
empirique
dont
il
faut
rappeler
la
genèse
(cf.
dia-
gramme)
:
les
applications
thérapeutiques
des
rayons
X
suivirent
de
peu
leur
décou-
verte,
à
la
fin
du
siècle
der-
nier.
L'utilisation
thérapeutique
nécessitait
une
dosimétrie,
et,
à
défaut
de
moyens
de
mesure,
celle-ci
était
estimée
d'après
la
dose
nécessaire
à
l'apparition
d'effets
cutanés
après
une
exposition
déli-
vrée
en
une
fois,
ou
"dose-
érythème".
Les
irradiations
thérapeutiques
étaient
fon-
dées
sur
cette
dose.
On
sait
aujourd'hui
que
la
dose,
déli-
vrée
en
une
fois,
nécessaire
à
l'obtention
de
cet
effet
est
de
5
à
6
sieverts
(Sv).
Or
les
observations
de
l'époque
avaient
montré,
chez
les
opérateurs
de
ces
installa-
tions,
qu'une
telle
dose,
déli-
vrée
par
petites
fractions
en
un
an,
ne
provoquait
aucun
effet
observable
parmi
ce
personnel.
A
partir
de
cette
dose
pour
laquelle
il
n'y
avait
pas
d'effet
observable,
on
détermina,
en
1927,
une
limite
acceptable
d'exposi-
tion
professionnelle
que
l'on
fixa,
pour
assurer
une
marge
de
sécurité,
à
un
dixième
de
cette
dose
"ineffective".
La
première
DMA
était
née
;
elle
s'exprimait
à
l'époque
en
Rœntgen
(R)
et
valait
55R,
soit
environ
550
mSv
par
an
(A).
A
la
création
de
la
Commission
Internationale
de
Protection
Radiologique
(CIPR),
en
1928,
il
fut
décidé
de
fixer
une
limite
journa-
lière
d'exposition
correspon-
dant
à
cette
dose
annuelle,
rapportée
au
nombre
de
jours
ouvrés.
On
obtenait
ainsi
un
chiffre
correspon-
dant
à
2,5
mSv
par
jour,
qui,
toujours
dans
le
même
souci
"d'arrondir
vers
la
sécurité"
fut
ramené
à
2
mSv
par
jour
(B).
Cette
limite
fut
mainte-
nue
jusqu'en
1949.
A
cette
date,
en
prévision
du
déve-
loppement
de
l'énergie
nucléaire
et
de
l'exposition
potentielle
d'un
plus
grand
nombre
de
travailleurs,
il
fut
décidé,
dans
un
légitime
souci
de
prudence,
mais
tou-
jours
sans
aucun
argument
médical
ou
biologique,
de
diminuer
encore
cette
dose,
pour
la
porter
à
3mSv
par
semaine
soit
150
mSv
par
an.
La
dose-érythème
d'ori-
gine
se
trouvait
donc
divisée
environ
40
fois
(C).
Puis,
en
1956,
certaines
expérimenta-
tions
sur
la
drosophile,
à
doses
moyennes
et
fortes,
mirent
en
évidence
des
modifi-
cations
du
génome
et
il
fut
décidé,
en
appliquant
le
prin-
cipe
d'extrapolation
à
l'homme
pour
de
faibles
doses,
d'abais-
ser
encore
la
DMA
à
50
mSv
par
an
(D).
En
fait,
on
s'aper-
çut
ultérieurement
que
la
dro-
sophile
avait
une
grande
fréquence
de
mutations
spon-
Evolution
de
la
dose
maximale
admissible
E)
CIPR
1990
■
2<
)
D)CIPR
1956
|
50
QCIPR
1949
"IQ^A
■
9m^\//innr
F
■HH
150
LJf
I
CJH
,
É
.IIIOWJUUI
A)
la
dose
érythème/1
0
0
100
200
i
l
I I
300 400 500 600
Dose
en
mSv
tanées
et
était
extraordinaire-
ment
sensible
à
tous
les
agents
physiques
susceptibles
d'in-
duire
des
mutations
géné-
tiques.
Les
expériences
ultérieures
effectuées
sur
des
souris
ont
montré
une
beau-
coup
moins
grande
sensibilité
des
mammifères,
invalidant
le
principe
d'extrapolation
aux
rnammifères
en
général
et
à
l'homme
en
particulier.
Néanmoins,
bien
que
fondée
sur
des
données
non
transpo-
sables
à
l'homme,
cette
limite
fut
conservée.
La
DMA
initiale
n'en
était
plus
qu'au
dixième
de
sa
valeur,
soit
le
centième
de
la
dose-érythème
et
c'est
elle
qui
représente
actuellement
la
limite
de
la
dose
efficace
annuelle
pour
les
personnels
exposés.
En
d'autres
termes,
les
travailleurs
exposés
aux
radiations
ionisantes
sont
actuellement
soumis
à
un
plafond
annuel
d'exposition
conespondant
à
1
%
de
la
dose
pour
laquelle
on
n'ob-
servait
pas
d'effet
lorsqu'elle
était
fractionnée.
Cette
dose
ne
représente
que
25
fois
l'expo-
sition
naturelle
moyenne
annuelle
en
France
et
égale
l'exposition
naturelle
de
cer-
taines
régions
du
monde.
Enfin,
les
dernières
recom-
mandations
de
la
CIPR,
qui
seront
reprises
dans
les
législations
nationales,
ramè-
nent
cette
limite
de
dose
à
100
mSv
sur
5
ans,
soit
20
mSv/an
(E),
c'est-à-dire,
pour
les
travailleurs
exposés,
environ
10
fois
l'exposition
naturelle
annuelle.
4
Le
Manipulateur
-
n°
spécial
-
A.F.P.P.E.
Septembre
1999.

RAYONNEMENTS
IONISANTS
ET
RADIOPROTECTION
2.
Principales
unités
utilisées
en
radioprotection.
Sources
des
rayonnements
ionisants
Raymond DOLLO
I
PRINCIPALES
GRANDEURS
ET
UNITES
UTILISEES
EN
RADIOPROTECTION
Grandeur
Définition
Unité
Ancienne
unité
Activité
(A)
Nombre
de
transitions
nucléaires
par
seconde
becquerel
(Bq)
Curie
(Ci)
1
Bq
=
27.10
-12
ci
Dose
absorbée
(D)
Energie
absorbée
par
l'unité
de
masse
de
matière
irradiée
gray
(Gy)
Rad
1
Gy
=
100
rad
Dose
équivalente
(H
T
)
H
T
=
D.W
R
où
WR
=
facteur
de
pondération
pour
les
rayonnements
sievert
(Sv)
Rem
1
Sv
=
100
rem
Dose
efficace
(E) E
=
IHJ.WT
Où
Wj
=
facteur
de
pondération
pour
les
tissus
sievert
(Sv)
Rem
1
Sv
=
100
rem
Activité
(A)
L'activité
d'un
radionucléide
est
le
nombre
de
transitions
nucléaires
qu'il
subit
par
unité
de
temps.
L'unité
est
le
becquerel
(Bq).
Dose
absorbée
(D)
C'est
l'énergie
communiquée
à
la
matière
par
unité
de
masse.
Son
unité
est
le
joule
par
kilo-
gramme,
ou
Gray
(Gy).
Dose
équivalente
(H
T
)
A
dose
absorbée
égale,
les
diffé-
rentes
variétés
de
rayonnements
produisent
des
effets
biologiques
différents.
La
prise
en
compte
de
l'effet
biologique
s'effectue
en
pondérant
la
dose
absorbée
dans
un
organe
par
la
qualité
du
rayonnement.
On
obtient
alors
la
dose
équivalente,
dont
l'unité
est
le
sievert
(Sv).
Cette
dose
équivalente
n'est
pas
une
quantité
physique
mesurable
directement.
On
l'obtient
par
le
calcul,
en
multi-
pliant
la
dose
absorbée
par
un
coefficient,
appelé
facteur
de
pondération
pour
les
rayonne-
ments,
W
R
.
Il
varie
de
1
à
20
pour
différents
types
de
rayon-
nements.
Dose
efficace
(E)
Tous
les
organes
ne
sont
pas
sensibles
de
la
même
manière
aux
rayonnements.
Pour
les
effets
tardifs
(cancers
et
affec-
tions
génétiques
susceptibles
de
survenir
après
une
irradia-
tion),
on
introduit
la
notion
de
dose
efficace.
Elle
correspond
à
la
dose
équivalente
qui,
si
elle
était
reçue
de
façon
uni-
forme
au
niveau
de
l'orga-
nisme
entier,
entraînerait
le
même
risque
tardif
sur
la
santé
que
des
doses
équiva-
lentes
différentes
reçues
au
niveau
de
différents
organes.
La
notion
de
dose
efficace
est
surtout
utilisée
lorsque
l'ex-
position
de
l'organisme
n'est
pas
homogène.
La
dose
efficace
est
la
somme
des
doses
équiva-
lentes
pondérées
dans
tous
les
tissus
et
les
organes
du
corps
par
un
facteur
de
pondération,
W
T
.
Facteurs
de
pondération
pour
les
rayonnements
(W
R
)
Type
de
rayonnement
Rayons
X
et
y
1
Particules
p
1
Particules
a
20
Neutrons
(selon
l'énergie)
5à20
Couche
cornée
Épiderme
Derme
Hypoderme
Musculature
Couche
basale
(3
(haute
énergie)
Pénétration
des
différents
types
de
rayonnements
ionisants
dans
le
corps
humain.
Le
Manipulateur
-
n°
spécial
-
A.F.P.P.E.
Septembre
1999.
5
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
1
/
52
100%