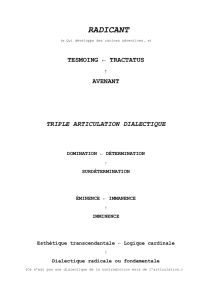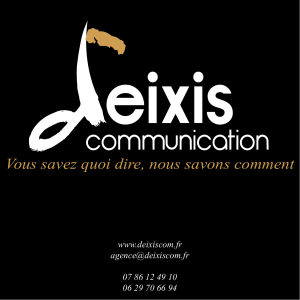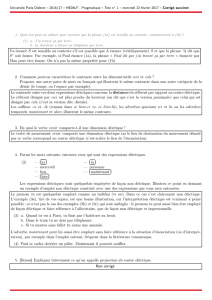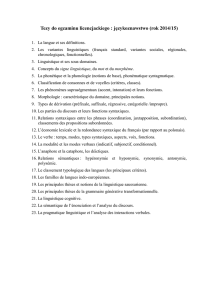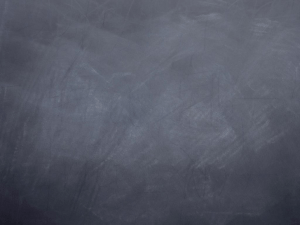24
EN GUISE D'INTRODUCTION

25
Nomination et point de vue : la composante déictique des
catégorisations lexicales
Paul Siblot
Très tôt, dès les premières recensions du langage sans doute, les
astreintes que le temps, l’espace et l’existence du locuteur exercent sur la
parole ont été repérées, leurs traces dans les énoncés relevées, et leur statut
spécifique noté. Il est nécessaire et conjoncturel, car les marques obligées
de l’énonciation doivent ancrer l’énoncé particulier dans son contexte
propre. Les rhéteurs ont résumé la chose d’une sentence qui a passé les
millénaires : « ego, hic et nunc ». Leur constat, immédiatement reconduit,
donne à la formule sa force d’évidence et en fait un procédé de
mnémotechnie. Ce qu’elle est, mais pas seulement. L’étude féconde des
multiples expressions du temps, de l’espace, ou de la subjectivité dans les
langues, témoigne de l’importance des points de contact, où la
systématique de la langue est conduite à prendre en charge l’articulation
de la représentation linguistique au monde, où le discours « embraye » sur
le réel, selon une métaphore de R. Jakobson. D’autres « embrayages » se
repèrent au plan du lexique ; ils sont l’objet de notre propos.
Le langage et le monde
Sous des dehors anodins la formule rhétorique « ego, hic et nunc »
soulève des questions de fond, notamment celle de « l’accord entre l’esprit
et le monde » (Benveniste, 1939/1966 : 52) qu’on renvoie d’ordinaire à la
philosophie du langage.
Le problème du réel en linguistique
Benveniste tenait ce problème pour « métaphysique », et le révoquait
aussitôt qu’évoqué : « le linguiste sera peut-être un jour en mesure de
[l’]aborder avec fruit, il fera mieux pour l’instant de [le] délaisser » (ibid.).
La citation ne veut pas suggérer que le temps a passé, que depuis 1939 les
savoirs ont évolué, ni que des interrogations auparavant hors d’atteinte

26
sont maintenant à portée des sciences cognitives. L’avancée des
connaissances se suffit et son constat peut être laissé à Monsieur de La
Palice ; il n’y aurait en outre pas grand mérite à se prévaloir de ce que
Sartre appelle avec férocité « la supériorité des chiens vivants sur les lions
morts ». Pour le linguiste, la mise en garde de É. Benveniste est autrement
intéressante. Une autre citation, de S. Freud cette fois, le souligne et permet
de prendre la mesure des implications. Sans confondre élaboration
théorique et travail de l’inconscient, on ne peut pas ne pas percevoir une
analogie entre le refoulement psychique et cette mise au ban des rapports
du langage au monde. Or le psychanalyste observe que « ce qui est
demeuré incompris fait retour ; telle une âme en peine, il n’a pas de repos
jusqu’à ce que soient trouvées résolution et délivrance »
1
. La question est
celle d’un effacement de principe du réel qui a longtemps prévalu en
linguistique
2
. Mais ce réel n’a jamais été absent, sinon de la théorie ; aussi
ne peut-il qu’y faire retour.
On parle toujours de quelque chose, nécessairement, même si
c’est pour ne rien dire. Telle est la raison du langage. Et quoi qu’on ait pu
penser, la question taboue des rapports du langage au réel n’a jamais cessé
d’être posée. Elle le fut d’emblée avec l’acte premier de nomination, et elle
le reste en toute actualisation discursive. Elle apparaît au centre des
fonctionnements linguistiques de sorte qu’on ne peut ni la censurer
vraiment, ni la renvoyer à la philosophie, ni la repousser vers on ne sait
quel « extralinguistique ». Sauf à supprimer la motivation du langage, et
par là en altérer la compréhension. L’étude de la langue, comme celle de
la parole, ne peuvent méconnaître l’intime relation du langage au réel.
Représenté dans les discours, présent aussi dans la langue d’une autre
façon, le réel est dans le champ d’étude du linguistique. Lorsqu’on essaie
de l’en chasser il revient au galop, jusque dans les argumentaires qui
prétendaient le tenir à distance. Mieux vaut, à l’exemple de l’aphorisme
antique, lui faire une place explicite.
1
S. Freud, 1909, Cinq leçons sur la psychanalyse.
2
Une des fonctions de l’arbitraire du signe est de légitimer cette coupure. Parmi les
épigones du saussurianisme, L. Hjelmslev est un de ceux qui défendent le plus
vigoureusement cette position de principe : « Jusqu’à présent, nous avons voulu nous en
tenir à l’ancienne tradition selon laquelle un signe est avant tout signe de quelque chose.
C’est là la conception courante à laquelle nous nous sommes conformé, et c’est aussi une
conception largement répandue en épistémologie et en logique. Nous voulons pourtant
démontrer maintenant qu’elle est insoutenable du point de vue linguistique ; nous sommes
d’ailleurs en accord sur ce point avec les théories linguistiques modernes. Selon la théorie
traditionnelle, le signe est l’expression d’un contenu extérieur au signe lui-même ; au
contraire, la théorie moderne (formulée par F. de Saussure et ensuite par L. Weisberger)
conçoit le signe comme un tout formé par une expression et un contenu » (1943/1968 :
65).

27
Un réel omniprésent dans la langue
La formule des rhéteurs récapitule l’inscription de données a priori du
réel dans la parole. Les marques recensées (personne, espace, temps)
concernent des formes où, par le biais de l’énonciateur, la symbolisation
linguistique se trouve expressément mise en rapport avec le réel. Pour les
usagers le rapport du langage au monde est une donnée d’évidence. Allant
de soi, elle reste implicite et n’appelle pas de gloses tant elle est dans
l’ordre des choses, en particulier pour les catégorisations référentielles.
Première dans l’appréhension épilinguistique, la relation référentielle l’est
aussi pour la réflexion métalinguistique, où le renvoi au réel constitue et
institue la norme. L’analyse des fonctions du langage par R. Jakobson en
donne l’illustration. Dans le schéma de la communication qu’il propose, le
« message » occupe une position centrale et sert à positionner les autres
facteurs. Il en va de même de la fonction correspondante qui sert elle aussi
de référence aux autres fonctions. Mais elle n’est identifiée que par de très
rapides remarques : « Même si la visée du référent, l’orientation vers le
contexte – bref la fonction dite “dénotative”, “cognitive”, référentielle –
est la tâche dominante de nombreux messages, la participation secondaire
des autres fonctions… » (1963 : 214). Là encore elle apparaît bien comme
une donnée d’évidence.
Comment la linguistique pourrait-elle ignorer ce réel multiple auquel le
propos réfère, auquel le discours participe, auquel le locuteur et
l’interlocuteur eux-mêmes appartiennent ? Un réel omniprésent, sous-
jacent à l’ensemble des fonctionnements linguistiques, qui confère au
langage un réalisme foncier, mais que les théories linguistiques
méconnaissent lorsqu’elles cherchent à ne rendre compte de la langue que
par un système abstrait de relations purement internes
3
. Par son existence
déjà le système linguistique participe de l’ordre des faits ; mais surtout, les
moyens qu’il donne pour produire et communiquer du sens anticipent la
prise en charge du réel que le discours opère. Il faut bien que le réel s’y
trouve prévu et qu’il soit inscrit en langue, sous une forme ou sous une
autre, pour que le discours puisse référer. Forme qu’il revient au linguiste
de préciser, non d’effacer. À ce stade de réflexion, la théorie postule le
plus souvent au seul plan logique une « ontologie ». Ce qui la conduit, au
3
On peut rappeler quelques-unes des nombreuses réaffirmations du CLG sur ce point clé
de la théorie : « Les valeurs restent entièrement relatives […] c’est du tout solidaire qu’il
faut partir pour obtenir par l’analyse les éléments qu’il renferme » (Saussure 1916/1972 :
157) ; « [les concepts] sont purement différentiels, définis non positivement par leur
contenu, mais négativement par leurs rapports avec les autres termes du système » (162).
« […] la valeur est purement négative et différentielle […] les valeurs n’agissent que par
leur opposition réciproque au sein d’un système défini » (165) ; « […] dans la langue il
n’y a que des différences […] sans termes positifs » (166).

28
motif du refus de boniments « métaphysiques », à faire l’économie d’une
explicitation des nécessaires options épistémologiques. Plutôt que cette
césure commode mais arbitraire et négligente de ses postulats, plutôt
qu’une axiomatique et ses corrélats hypothético-déductifs, plutôt que ces
contournements divers du problème du rapport du langage au monde, on
préfère à l’inverse partir du constat liminaire, minimal, empirique, sur
lequel se fondent les compréhensions immédiates du langage.
De la réalité à la praxis linguistique
Du pudding, on a pu dire que « preuve en est qu’on le mange»
4
.
Autrement dit, la réalité ne se démontre pas mais se constate. L’homme en
prend acte, d’expérience et de façon pragmatique. Tel est le registre du
langage dans ses usages ordinaires, qui justifie qu’on parle de praxis
linguistique et de pratiques langagières. C’est celui de l’acte premier de
parole qui nomme le monde, et dans lequel la nomination prend
implicitement acte de l’existence du monde qu’elle désigne. Ce n’est pas
là un parti pris philosophique, une option matérialiste, ni un axiome
théorique, mais une donnée de fait dont É. Benveniste, dans son analyse
de la phrase nominale, repère la présence au sein du discours et dont il
propose une caractérisation. La forme phrastique est restreinte dans le cas
de la phrase nominale, et la syntaxe réduite jusqu’à l’absence dans la
position extrême de l’énoncé monoterme. Mais aussi limitée qu’elle soit,
la phrase nominale n’en est pas moins un énoncé complet. Cette plénitude
discursive conduit l’analyste à postuler ce qu’il appelle un prédicat de
réalité : « Une assertion finie, du fait même qu’elle est assertion, implique
référence de l’énoncé à un ordre différent, qui est l’ordre de la réalité. À la
relation grammaticale qui unit les membres de l’énoncé s’ajoute
subrepticement un “cela est !” qui relie l’agencement linguistique au
système de la réalité » (Benveniste 1939/1966 : 154). Ce prédicat, réalisé
ailleurs dans des formes verbales, temporelles et personnelles, ne peut dans
le cas concerné être assigné qu’à une forme nominale. Ainsi, selon É.
Benveniste, avec ce présumé « cela est ! » qu’assurerait « une
prédication » interne à la catégorie nominale, un réalisme propre est
reconnu à la catégorie nominale
5
.
Le réel enregistré dans le lexique, l’est à partir de praxis sensitives,
techniques, sociales, grâce auxquelles le monde senti, perçu, travaillé est
anthropologiquement appréhendé : conçu et nommé. La praxis
linguistique s’insère dans la continuité d’une chaîne de praxis diversifiées
dont elle tire les informations qui lui servent à élaborer le « contenu
4
Le mot est de F. Engels dans Dialectique de la nature (post. 1925).
5
Notons qu’avec ce « prédicat de réalité » revient, en catimini, le problème proscrit de
l’» accord entre l’esprit et le monde ».
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
1
/
15
100%